17/06/2022
Raymond Queneau, Un enfant a dit

Une main
Une main traverse la porte
mince mince à en souffrir
d’autres mains jouent aux cartes
là-bas là-bas dans les airs
d’autres encor désertent
la grand’ ennui du ciel
Raymond Queneau, Un enfant a dit,
Pléiade/Gallimard, 1989, p. 101.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, un enfant a dit, main | ![]() Facebook |
Facebook |
16/06/2022
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

C’était le lendemain
Je suis arrivé le matin c’était trop tard
il y avait de la rouille autour de l’évier
le poids du poêle pesait sur le parquet
ça des gondolait même les tuiles il était trop tard
je n’aurais pu redresser tout ça même avec
des cabestans des poulies des objets dont je ne connais
pas le mot qui les désigne et que je ne saurais utiliser
efficacement
les champignons poussaient sur la faïence de la
vaisselle
la vaisselle croupissait dans la paille des fauteuils
les fauteuils s’endormaient sur le poil des ténèbres
les ténèbres mâchaient le chouigne gueumme des morts
je suis arrivé trop tard c’était le lendemain
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline ; Pléiade/
Gallimard, 1989, p. 281.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, lendemain, catastrophe | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2022
Raymond Queneau, Les Ziaux

Les Ziaux
les eaux bruns, les eaux noirs, les eaux de merveille
les eaux de mer, d’océan, les eaux d’étincelles
nuitent le jour, jurent la nuit
chants de dimanche à samedi
tes yeux vertes, tes yeux bleues, tes yeux d’étincelles
les yeux de passante au cours de la vie
les yeux noires, yeux d’estanchelle
silencent les mots, ouatent le bruit
eau de ces yeux penché sur tout miroir
gouttes secrets au bord des veilles
tout miroir, toute veille en ces yeux bleues ou vertes
les ziaux bruns, les ziaux noirs, les ziaux de merveille
Raymond Queneau, Les Ziaux, dans Œuvres complètes, I,
Pléiade/Gallimard, 1989, p. 69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, les ziaux, yeux, eau | ![]() Facebook |
Facebook |
14/06/2022
Raymond Queneau, Les Ziaux

Il pleut
Averse averse averse averse averse averse
pluie ô pluie ô pluie ô ! ô pluie ô pluie ô pluie !
gouttes d’eau gouttes d’eau gouttes d’eau gouttes d’eau
parapluie ô parapluie ô paraverse ô !
paragouttes d’eau paragouttess d’eau de pluie
capuchons pélerines et imperméables
que la pluie est humide et que la pluie mouille et mouille !
mouille l’eau mouille l’eau mouille l’eau mouille l’eau
et que c’est agréable agréable agréable de pluie et de gouttes
d’avoir les pieds mouillés et les cheveux humides
tout humides d’averse et de pluie et de gouttes
d’eau de pluie et d’averse et sans un paragoutte
pour protéger les pieds et les cheveux mouillés
qui ne vont plus friser qui ne vont plus friser
à cause de l’averse à cause de la pluie
des gouttes d’eau de pluie et des gouttes d’averse
cheveux désarçonnés cheveux sans parapluie.
Raymond Queneau, Les Ziaux, dans Œuvres complètes, I,
Pléiade/Gallimard, 1989, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, les ziaux, pluie, averse, gouttes | ![]() Facebook |
Facebook |
13/06/2022
Raymond Queneau, Les Ziaux

L’homme du tramway
Cet homme qi marche le long du quai la nuit
le long de la Seine entre Asnières et Courbevoie
cet homme dans l’ombre à chaque instant fuit
suit son chemin droit et sa courbe voie
cet homme a mal aux pieds — misère
et la fatigue ligote ses épaules
cet homme danse chacun de ses pas
longs comme des nuits d’hiver
depuis une heure le tram ne roule plus
cet homme mesure des kilomètres
à l’épaisseur de ses semelles
il marche la nuit dans cette rue
sa maîtresse l’attend fille peu respectable
elle traîne aux ruisseaux se repaît de bouchers
et son temps se mesure à sa chambre insatiable
qui loge maintenant un homme du tramouai
il doit fuir au matin les yeux fort marmiteux
et reprendre la route vers le dépôt sonore
et pendant que la belle dans le pieu dort encore
il soupire qu’il est doux d’être aimé.
Raymond Queneau, Les Ziaux, dans Si tu t’imagines,
Gallimard, 1952, p. 123-124.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, les ziaux, l'homme du tramway | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2022
Benoît Casas, Venise toute : recension
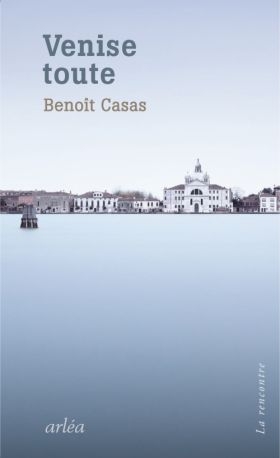
« Je faisais le voyage que j’avais lu » (p. 66)
Il fallait bien que Benoît Casas écrive un jour à propos d’un des lieux qui, dans l’imaginaire, représente l’Italie. Il a, par son activité d’éditeur, publié des auteurs italiens contemporains (Sciascia, Porta, Sanguinetti, Vittorini, Valduga, Zanzotto) et en a co-traduit plusieurs : Levi, Pasolini, récemment Feuilles de route de Fortini1. Comme dans ses livres précédents, il a inventé dans son Venise toute ses contraintes d’écriture, une explicite dans la présentation, une seconde liée à l’idée que la littérature se reconstruit sans cesse à partir de tout ce qui a été écrit — idée que porte le titre —, une troisième enfin relative à ce qui est écrit à propos de Venise. Elles aboutissent à proposer un regard original sur Venise qui donnera, pour qui ne connaît pas la ville, la curiosité de s’y rendre, pour les autres la certitude qu’il faudrait la regarder autrement.
Le livre est composé de paragraphes qui dépassent rarement six lignes et sont réunis, première contrainte très visible, selon l’ordre alphabétique, mais d’une manière particulière : sous le "A", tous les énoncés à propos de Venise contiennent un mot commençant par « a », mis en italique. Ainsi, en ouverture : « La stazione rectangulaire de néons et les lettres immenses annonçant VENEZIA. ». Le procédé vaut jusqu’au "V" inclus, les quatre dernières lettres de l’alphabet étant absentes ; rien n’empêchait de faire entrer ces lettres dans des mots relatifs à Venise, ceux retenus, comme annonçant, n'étant pas plus liés à Venise qu’à une autre ville. Cette omission a un sens ; l’ordre alphabétique, dans les pratiques culturelles, évoque toujours une totalité, c’est l’image convenue du dictionnaire qui comprendrait tous les mots d’une langue (ce qui n’est évidemment pas le cas). L’absence d’entrées me semble suggérer que tout discours à propos de Venise ne peut qu’être incomplet, ce que confirment, très différentes, les deux autres contraintes.
Le lecteur peut être intrigué assez rapidement, me semble-t-il, par la diversité des contenus qui se succèdent dans des paragraphes très brefs, mais également par des décalages dans l’emploi des temps verbaux d’un énoncé à l’autre : on passe (p. 15) de l’imparfait (« Le ciel basculait, etc.) au présent (le ciel (...) brûle). Le hasard de lectures parallèles à Venise toute fait que j’y rencontre un fragment lu peu de temps auparavant, deux vers de Nietzsche, « Je revois les pigeons de Saint-Marc : /La place est silencieuse, le matin s’y repose. »2, repris page 89 avec une transformation de la ponctuation, les deux points devenant une virgule, la majuscule une minuscule.
Tout s’éclaire quand on lit la page qui suit le "V", qui pourrait être titrée, en souvenir de Raymond Roussel, "comment j’ai écrit ce livre" : Casas note que Venise toute « a été écrit suite à de nombreux séjours (...) mais aussi grâce à la lecture de multiples livres » ; suit une liste alphabétique de près de soixante-dix noms d’écrivains, en majorité du XXe et XXIe siècles, quelques-uns du XIXe siècle pour les plus anciens. Qui a lu d’autres livres de Benoît Casas ne sera pas surpris par son utilisation d’extraits de textes divers ; la contrainte ici tient au fait qu’il n’y a qu’un contexte, Venise, la lagune et les îles, qu’il ne s’agit pas d’en construire d’autres : tout doit concourir à en explorer les multiples caractéristiques. Selon les besoins, il conserve tel quel le texte source ou l’abrège ; un seul exemple : dans « Pluie, rafales de pluie, Giudecca, remuée de vagues [ou encore brouillard, sirène de bateaux] ; sorties furtives, tempête » (Sollers, Dictionnaire amoureux de Venise, Plon, 2004), les mots entre crochets ont été omis.
On sait bien que toute écriture littéraire, inscrite dans une histoire, dialogue avec les écrits antérieurs. Dans Venise toute, Benoît Casas s’empare de textes qu’il a lus, les modifie parfois et les fait vivre ensemble ; il crée un contexte où sont rassemblés Suarès, Zanzotto, Théophile Gautier, etc., et tous les fragments perdent ce qui les ferait reconnaître ailleurs comme propres à Suarès, Zanzotto, Théophile Gautier ; réunis ils forment un texte continu, celui de Benoît Casas — on pense à Roubaud avec sa construction de Autobiographie, chapitre dix à partir de poèmes écrits avant 1932 (année de sa naissance). La composition de Venise toute nécessiterait de nombreuses lectures pour être décrite, ce qui importe peu pour le lecteur : sans cette recherche il goûtera les multiples approches de cette ville depuis longtemps mythique.
Benoît Casas, après avoir choisi dans "A" quelques caractéristiques de la ville les reprend dans son alphabet à intervalles très réguliers. Venise apparaît d’abord comme une « labyrinthe », un dédale », un ensemble de « voies obscures et labyrinthiques » ; la ville ne s’invente que si on la parcourt en tous sens et les notations à ce sujet abondent : « Vous lisez la ville à la cadence de vos pas », « s’imprégner de la ville c’est (...) faire le tour complet de l’île à pied », « Si vous voulez comprendre Venise, parcourez la lagune en tous sens, marchez jusqu’à l’épuisement dans les ruelles », etc. Cette nécessité d’une approche lente devrait se répéter à différents moments de l’année comme le suggèrent plusieurs indications (« Janvier », « le printemps », « juin », « octobre », « novembre », « l’hiver », « la neige », « le jour de l’an »). Chaque fois, de manière différente, ce qui est saisi c’est une « Secrète circulation entre eau ciel et terre » telle qu’elle aboutit à une « conjonction terre-mer-ciel », qui « se confondent pour ne former qu’un seul et équivoque élément ». En même temps, toutes les eaux sont des miroirs ; partout des reflets, des doubles qui font que « tout vole en éclats et se métamorphose : celui qui regarde est cette métamorphose ».
Le thème récurrent du reflet et du labyrinthe suffirait à présenter Venise. Pour que la ville soit "toute", Benoît Casas cite plusieurs fois des lieux emblématiques (Saint Marc, Santa Maria dei Miracoli), des peintres (Le Tintoret, Tiepolo) et un écrivain (Ezra Pound) dont les noms sont liés à Venise ; il n’oublie pas non plus, très présente, « l’odeur des entrailles de la ville ». L’essentiel est de restituer l’extrême « diversité » qui tient notamment au fait que « Toutes [les] couches du passé, dans cette ville, appartiennent simultanément au présent » ; les reprises et variations tout au long du livre disent le caractère inépuisable de la ville et que « on ne la connaît jamais ». Une réussite.
————————————————————
1 Les éditions NOUS ont également réédité le Venise de Théophile Gautier, La Sicile de Maupassant, les Excursions aux îles Éoliennes de Dumas.
2 Nietzsche, Le Gai Savoir, Appendice, Chants du Prince, "Mon bonheur".
Benoît Casas, Venise toute, Éditions Arléa, 2022, 120 p., 16 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 2 mai 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2022
Constantin Cavafy, Il est venu pour lire : deux versions

Il est venu pour lire
Il est venu pour lire. Deux ou trois volumes sont entrouverts, des historiens, des poètes. Mais à peine a-t-il lu pendant une dizaine de minutes, puis il y a renoncé. Il somnole sur le canapé. Il se consacre entièrement aux lettres, mais il a vingt-trois ans et il est très beau. Et, cet après-midi, l’amour a passé sur son corps parfait, sur ses lèvres. La passion a pris possession de cette chair tout imprégnée de beauté, sans inepte pudeur quant au genre de jouissance.
Marguerite Yourcenar, Présentation critique de Constantin Cavafy, suivie d’une traduction intégrale de ses poèmes par M. Y. et Constantin Dimaras, Gallimard, 1958, p. 203.
Il est venu pour lire
Il est venu pour lire. Deux, trois volumes
sont ouverts : historiens et poètes.
Mais à peine eut-il lu, dix minutes,
qu’il les abandonna. Sur le canapé il somnole.
Il appartient entièrement au monde des livres —
mais il a vingt-trois ans et il est très beau ;
et cet après-midi l’amour a passé
dans sa chair superbe, sur ses lèvres.
Dans sa chair, toute de beauté,
la chaleur amoureuse a passé ; sans qu’une pudeur
ridicule le retienne sur la nature du plaisir...
Constantin Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis,
Les Belles-Lettres, 1977, p. 169.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, il est venu pour lire : deux versions | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2022
Constantin Cavafy, janvier 1904 : deux versions
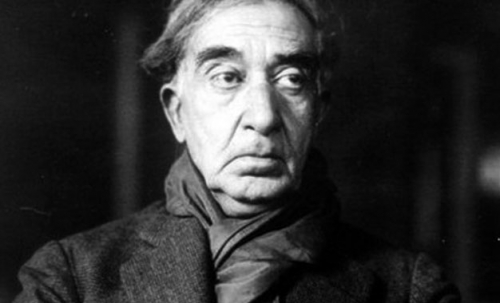
Janvier 1904
Ah ! ces nuits de janvier
où je m’attarde à recréer par la pensée
les lointains instants : je te retrouve,
j’entends tes derniers mots, j’entends les premiers.
Nuits désespérées de janvier,
lorsque la vision fuit, me laissant seul.
Qu’elle s’évanouit vite !
plus d’arbres, de rues, de maisons de lumières ;
ton corps fait pour l’amour s(éteint, il se dissipe.
Constantin Cavafy, Jours anciens, traduction Bruno
Roy, Fata Morgana, 1978, np.
Janvier 1904
Ah ! ces nuits de janvier !
Quand je revis par la pensée
Les instants où je t’ai rencontré,
Que j’entends nos dernières paroles, et aussi les premières.
Ces nuits désespérées de janvier,
Quand la vision se dissipe et m’abandonne...
Comme elle a hâte de disparaître !
Les arbres, les rues, les maisons, les lumières, tout s’en va,
De même que ton visage aimé qui s’estompe et se perd.
Constantin Cavafy, Œuvres poétiques, traduction Socrate C. Zervos et
Patricia Portier, Imprimerie Nationale, 1991, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constantin cavafy, janvier 1904 : deux versions | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2022
Art roman en Brionnais, 5
Bois-Sainte-Marie





Photographies Chantal Tanet
| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2022
Art roman en Brionnais, 4
Semur-en-Brionnais





Photographies Chantal Tanet
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art roman en brionnais, 4 | ![]() Facebook |
Facebook |
07/06/2022
Art roman en Brionnais, 3

Charlieu, Couvent des Cordeliers

Charlieu, Cloître des Cordeliers

Iguerande

Iguerande

Iguerande
Photographies Chantal Tanet
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art roman en brionnais, 3 | ![]() Facebook |
Facebook |
06/06/2022
Art roman en Brionnais, 2

Charlieu

église Saint-Philibert, Charlieu

Montceaux-l'Etoile

Montceaux-l'Etoile

Montceaux-l'Etoile
Photographies Chantal Tanet
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art roman en brionnais, 2 | ![]() Facebook |
Facebook |
05/06/2022
Art roman en Brionnais

Anzy-le-Duc

Anzy-lz-Duc

Anzy-le-Duc

Charlieu

Charlieu
Photographies Chantal Tanet
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art roman en brionnais | ![]() Facebook |
Facebook |
04/06/2022
Étienne Faure, Vol en V

Les dieux sont courroucés sur l’Ukraine, il tonne,
ça résonne tout le long de la frontière cernée
de saules et de bouleaux, deux tristesses, deux détresses
— pousser malgré l’eau des marais et la terre sableuse
parmi les tombes d’outre-tombe (terre et ombre)
d’outre-rivière en son temps signataire
du pacte sinueux germano-soviétique —,
les croix en bois dans le jardin
plantées comme s’il en poussait après la pluie
ont repris leur élévation vers le ciel
bleu égaré, vieille antienne
évanouie finalement après qu’on est passé clore
le sujet comme on clôt l’incident de toute une vie,
ne sachant si les tombes affalées
parmi les Versgissmeinnicht et les orties
avaient appartenu un temps au camp
des assaillants, des réfugiés, ni de quel
pays démantelé l’hiver fut recomposé,
ni
de quel bois les souvenirs se chauffent.
Bang
dans un jardin planté de croix
Étienne Faure, Vol en V, Gallimard, 2022, p. 131.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, vol en v, ukraine, passé, tombe | ![]() Facebook |
Facebook |
03/06/2022
Étienne Faure, Vol en V

Dans la ville à pied, sans repli, sans arrière-
pays, origines, hors cela, il emprunte
au début sous le nom de rue, pont, grève,
un parcours exempté de fil, anonyme,
laissant l’impasse pour attraper les quais
via les passages, les cours et circuler
inclus dans la foule en mue sans arrêt
selon l’heure ou l’allure à laquelle on passe,
interdit soudain sous un nom, un bouquet
au mur scellé (mortellement blessé)
après la chute de naguère, le bruit d’un corps au sol,
épitaphe à jamais cernée du crible des impacts
encore au mur, semblant redire : passant,
nous allons mourir et personne n’en saura rien,
ou bien continuer de parler aux vivants
plus avant, ceux qui vont te survivre
— et le flâneur éclairé sous un angle
un instant exposé au soleil du soir,
médite à découvert avant de traverser vite,
regagner l’ombre.
passage à découvert
Étienne Faure, Vol en V, Gallimard, 2022, p. 121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, vol en v, marche, anonyme, épitaphe | ![]() Facebook |
Facebook |





