11/09/2012
Jacques Bens, 41 sonnets irrationnels

—Parlons clair : tu adoptes quoi comme système ?
Si tu préfères : tu mets quoi dans un poème ?
Ta philosophie ?Mmm ? Ton modus vivendi ?
— Des bruits, des sons, des mots, des pieds, des vers, des phrases.
— Oui, je sais. Mais ce n'est pas ça que je te dis.
Je parle des idées, comment dire ? Du thème,
Du... Ou plutôt, voici : dis-moi ce que tu aimes
Dans les vers honorés, méconnus ou maudits ?
— Les bruits, les sons, les mots. Parfois, une ou deux phrases.
Un sourire pincé, un cri, mais pas l'emphase,
Une fleur oubliée, un rire démentiel,
Une chanson, par-ci par)là, qui vient, qui jase,
Quatre regrets, mon cœur, et peut-être Pégase,
Ma jeunesse partie,
Mer,
Terre,
Soleil,
Ciel.
Jacques Bens, 41 sonnets irrationnels, Gallimard, 1965, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques bens, 41 sonnets irrationnels, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
10/09/2012
Émile Verhaeren, Poèmes : Les soirs, Les débâcles, Les flambeaux noirs

Le cri
Sur un étang désert que lustra une eau brunie,
Un rai du soir s'accroche au sommet d'un roseau,
Un cri s'écoute, un cri désespéré d'oiseau,
Un cri pauvre qui pleure au loin une agonie.
Comme il est faible et frêle et peureux et fluet !
Et comme avec tristesse il se traîne et s'écoute,
Et comme il se répète et comme avec la route
Il s'enfonce et se perd dans l'horizon muet !
Et comme il scande l'heure, au rythme de son râle,
Et comme, en son accent minable et souffreteux,
Et comme, en son écho languissant et boiteux,
Se plaint infiniment la douleur vespérale !
Il est si doux parfois qu'on ne le saisit pas.
Et néanmoins toujours, et sans fatigue, il tinte
L'obscur et triste adieu de quelque vie éteinte ;
Il dit les pauvres morts et les tristes trépas :
La mort des fleurs, la mort des insectes, la douce
Mort des ailes et des tiges et des parfums ;
Il dit les vols lointains et clairs qui sont défunts
Et reposent, cassés, dans l'herbe et dans la mousse.
Émile Verhaeren, Poèmes : Les soirs, Les débâcles, Les flambeaux
noirs, Mercure de France, 1920, p. 63-64.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Émile verhaeren, poèmes : les soirs, les débâcles, les flambeaux noirs, le cri, oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2012
Jacques Demarcq, Les Zozios

le verlaine
Carnamen caramba
Le ciel par-dessus toi ? que vois-je
de tes dessous monte à l'assaut
quand floue froutant sur le rivage
tu viens rincer l'œil du ruisseau
De dentelles te soudoient... nuages
dont l'air s'essouffle en cui-cui sots
léché partout d'émoi ; j'en nage
de tiédeur soûl — honte à l'oiseau
Qui s'émeut ; tant et plus que haut
tirant de ma queue la plume
s'y dresse un voli volume
de frais titillés pohumes
Dotée d'ailes de surcroît, l'image
de mes doigts fous compte aller où
— Vers l'aine ?
*
Oh merci mon cœur
ce bel ange au nid
qui se glisse et rit
berçant persifleur
ma mélancolie
Ce merle oui moqueur
pris de griverie
d'un mélange honni
perçant postérieure
la merde en colique
*
Le pipeau à Popol
pis que pitre il est fol
si l'artiste est l'Arthur
qui le sifflet cajole
Dans sa cage il carbure
et gazouille au gazole
si tenté qu'ailé vole
au verger d'envergure
Puis d'invertir les drôles
à l'attaque au lard dur
dans ma carne à la gnôle
et crie cuite le grill sur
Zizique avant toute
rose
le reste au lit n'est que rature
Jacques Demarcq, Les Zozios, éditions NOUS, 2008, p. 238-239.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques demarcq, les zozios, verlaine | ![]() Facebook |
Facebook |
08/09/2012
Hugo Hofmannsthal, Le lien d’ombre, poèmes complets

Tercets, IV
Parfois des femmes que nul n’a jamais aimées viennent
En rêve à notre rencontre, on dirait des petites filles,
Et elles sont indiciblement émouvantes à voir.
Comme si avec nous sur d’invisibles routes
Elles avaient par un soir de jadis longuement cheminé,
Tandis que les cimes des arbres s’agitent en respirant
Et que tombe sur nous un souffles parfumé, et la nuit, et l’angoisse,
Et que le long du chemein, de notre chenmin, l’obscur,
Dans la clarté du soir les étangs muets resplendissent.
Miroir de notre nostalgie, ils scientillent comme en rêve,
Et à toutes les paroles murmurées, à tout le flottement
De l’air du soir et au premier éclat des étoiles,
Les âmes, cessœurs, profondément tressailent
Et s’affligent, et s’emplissent d’une gloire triomphante,
Émues par le profond pressentiment qui comprend la grandeur de la
vie
Et sa splendeur et son austérité.
Terzinen, IV
Zuweilen kommen niegeliebte Frauen
Im Traum als kleine Mädchen uns entgegen
Und sind unsäglich rührend anzuschauen,
Als wären sie mit uns auf fernen Wegen
Einmal an einem Abend lang gegangen,
Indes die Wipfel atmend sich bewegen
Und Duft herunterfällt und Nacht und Bangen,
Und längs des Weges, unsres Wegs, des dunkeln,
Im Abendschein die stummen Weiher prangen
Und, Spiegel unsrer Sehnsucht, traumhaft funkeln,
Und allen leisen Worten, allem Schweben
Der Abendluft und erstem Sternefunkeln
Die Seelen schwesterlich und tief erbeben
Und traurig sind und voll Triumphgepränge
Vor tiefer Ahnung, die das große Leben
Begreift und seine Herrlichkeit und Strenge.
Hugo Hofmannsthal, Le lien d’ombre, poèmes complets, traduit de l’allemand, annoté et présenté par Jean-Yves Masson, édition bilingue, Verdier poche, 2006, p. 200-201.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hugo hofmannsthal, le lien d’ombre, poèmes complets, tercets | ![]() Facebook |
Facebook |
07/09/2012
Guy Goffette, Épilepsie force douze

I
La parole
Un seul soir ivre
Le petit ramoneur ne passera plus
Demandez le matin
La logique où est la logique
Elle boit un verre
au café de la gare
La mer vomit pas loin
contre un poteau indicateur
Si seulement les tickets
L’antipode dit que c’est l’heure
périodiquement
XI
Écrire ah
La tête que font les gens pressés
dans les vitrines
Combien en voulez-vous
Un peu de mou pour vos chats Madame
Le sergent de ville passe
dans les portefeuilles
L’identité du bonhomme de neige
est confuse
Glisser dans le Moyen Âge
est une question de souplesse
Quant à écrire
la putain se méfie
Guy Goffette, Épilepsie force douze, dans Traversées, n° 46, printemps 2007, p. 4 et 14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy goffette, Épilepsie force douze, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
06/09/2012
Guennadi Aïgui, degré : de stabilité, traduction Léon Robel

La forêt – par le bruit seul
telles des miettes de fumier sec incolore nombreux
roulés par le vent sur la route !
et toi – calmé –
comme un puits dans le champ :
au milieu et à l’intérieur
et par les cheveux – comme les insectes sacrés
seul et nombreux !
et le village à peine se compose
comme ordures sur la neige
d’un froissement dans l’ouïe plus clair
comme quelque part soi-même
mais l’écoutant – pleurant ?
le condamné en lui on dirait de voir le permis
est coulé en le visage – des profondeurs !
orientant les traces de la pluie comme par un matin d’été
le long des joues et le long du cou
et le long de soi que l’on pleure
le long de soi comme d’un rose – par parties – du corps
et pourtant d’un rose !
et ensuite de nouveau de la joue
Guennadi Aïgui, degré : de stabilité, traduction Léon Robel, in Collectif Change, Seghers/Laffont, septembre 1976, p. 62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guennadi aïgui, degré : de stabilité, traduction léon robel, la forêt | ![]() Facebook |
Facebook |
05/09/2012
André du Bouchet, Carnets ; L'emportement du muet

On ne peut pas quitter la réalité d’un pas — décoller —
*
Poésie réparatrice
elle dit souvent ce qui manque. C’est à ce prix qu’elle cesse d’être complaisance et parure — qu’elle constitue un appel ardent à tout ce que l’on croit.
*
axiome de la poésie : que cela soit indémontrable et jamais gratuit.
*
La poésie rétablit inlassablement au présent le verbe qui est au passé.
*
un poème — qu’est-ce — rien
et pourtant le monde était là
comme le vent dans les tiges
le monde est là — comme le
vent dans les tiges
et aux confins bleus du monde
André du Bouchet, Carnets 1952-1956,, Plon, 1990, p. 5, 6, 19, 36 et 75.
*
ce qui me sépare des choses n’est pas plus épais
que l’haleine ou le feuillet
de l’autre feuillet
André du Bouchet, Carnet 2, Fata Morgana, 1998, p. 11.
sur le point d’être nommé, ce
qu’on voit ayant pris de court, l’omission du nom — fraîcheur reconduite — peut, sans faire défaut, de nouveau s’inscrire dans le temps de la nomination. Cela
fera comme tache ou
jour.
*
Trouver distance sur la page, c’est recevoir ce qu’elle a donné.
*
… hauteur
atteinte dans la langue, mais du coup, et sans le vouloir, nous nous découvrons soudain portés à la hauteur où chacun tout à tour est atteint.
André du Bouchet, L’emportement du muet, Mercure de France, 2000, p. 71, 85, et 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, carnets, l'emportement du muet, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
04/09/2012
Dino Campana, Chants orphiques

La chimère
Je ne sais si entre des rochers ton pâle
Visage m’apparut, ou si un sourire
De lointains ignorés
Tu fus, baissé le front
D’ivoire éblouissant ou une jeune
Sur de la Joconde :
Ou des printemps défunts
Pour tes pâleurs mythiques
La Reine ou la Reine adolescente :
Mais pour ton poème ignoré
De douleur et de volupté
Musique jeune fille exsangue,
Marqué de lignes de sang
Dans le cercle des lèvres sinueuses,
Reine de la mélodie :
Mais pour ta vierge tête
Penchée, moi poète nocturne
J’ai veillé les vives étoiles dans les prairies du ciel,
Moi pour ton doux mystère,
Moi pour ta démarche taciturne.
Je ne sais si des cheveux la pâle
Flamme fut la marque
Vivante de sa pâleur,
Je ne sais si ce fut une douce vapeur,
Douce sur ma douleur,
Sourire d’un visage nocturne :
Je regarde les rochers blancs les sources muettes des vents
Et l’immobilité des firmaments
Et les ruisseaux gonflés qui vont pleurant
Et les ombres du travail humain penchées sur les margelles souffrantes
Et toujours dans de tendres cieux des lointaines claires ombres courantes
Et toujours je t ‘appelle je t’appelle Chimère.
Non so se tra roccie il tuo pallido
Viso m’apparve, o sorriso
Di lontananze ignote
Fosti, la china eburnea
Fronte fulgente o giovine
Suora de la Gioconda :
O delle primavere
Spente, per i tuoi mitici pallori
O regina o Regina adolescente :
Ma peril tuo ignoto poema
Di voluttà e di dolore
Musica fanciulla esangue,
Segnato di linea di sangue
Nel cerchio della labbra sinuose,
Regina de la melodia :
Ma per il vergine capo
Reclino, io poeta notturno
Vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo,
Io per il tuo divenir taciturno.
Non so se la fiamma pallida
Fu dei capelli il vivente
Segno del suo pallore,
Non so se fu un dolce vapore,
Dolce sul mio dolore,
Sorriso di un volto notturno :
Guardo le bianche rocce le mute fonti dei venti
E l’immobilità dei firmamenti
E igonfii rivi che vanno pliangenti
E l’ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti
E ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti
E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera.
Dino Campana, Chants orphiques, édition bilingue, introduction de Maria Luisa Spaziani, postface et traduction de l’italien de Michel Sager, Seghers, 1977, p. 46-49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dino campana, chants orphiques, la chimère | ![]() Facebook |
Facebook |
03/09/2012
Luis Cernuda, La Réalité et le Désir (La Realidad y el Deseo)

Cimetière dans la ville
Derrière la grille ouverte entre les murs,
la terre noire sans arbres, sans une herbe,
les bancs de bois où vers le soir
s’assoient quelques vieillards silencieux.
Autour sont les maisons, pas loin quelques boutiques,
des rues où jouent les enfants, et les trains
passent tout près des tombes. C’est un quartier pauvre.
Comme des raccommodages aux façades grises,
le linge humide de pluie pend aux fenêtres.
Les inscriptions sont déjà effacées
sur les dalles aux morts d’il y a deux siècles,
sans amis pour les oublier, aux morts
clandestins. Mais quand le soleil paraît,
car le soleil brille quelques jours vers le mois de juin,
dans leur trou les vieux os le sentent, peut-être.
Pas une feuille, pas un oiseau. La pierre seulement. La terre.
L’enfer est-il ainsi. La douleur y est sans oubli,
dans le bruit, la misère, le froid interminable et sans espoir.
Ici n’existe pas le sommeil silencieux
de la mort, car la vie encore
poursuit son commerce sous la nuit immobile.
Quand l’ombre descend du ciel nuageux
et que la fumée des usines s’apaise
en poussière grise, du bistrot sortent des voix,
puis un train qui passe
agite de longs échos tel un bronze en colère.
Ce n’est pas encore le jugement, morts anonymes.
Dormez en paix, dormez si vous le pouvez.
Peut-être Dieu lui-même vous a-t-il oubliés.
Tras la reja abierta entre los muros,
La tierra negra sin árboles ni hierba,
Con bancos de madera donde allá a la tarde
Se sientan silenciosos unos viejos.
En torno están las casas, cerca hay tiendas,
Calles por las que juegan niños, y los trenes
Pasan al lado de las tumbas. Es un barrio pobre.
Tal remiendosde las fachadas grises,
Cuelgan en las ventanas trapos húmedos de lluvia.
Borradas están ya las inscripciones
De las losas con muertos de dos siglos,
Sin amigos que les olviden, muertos
Clandestinos. Mas cuando el sol despierta,
Porque el sol brilla algunos dias hacia junio,
En lo hondo algo deben sentir los huesos viejos.
Ni una hoja ni un pájaro. La piedra nada más. La tierra.
Es el infierno así ? Hay dolor sin olvido,
Con ruido y miseria, frío largo y sin esperanza.
Aquí no existe el sueño silencioso
De la muerte, que todavia la vida
Se agita entre estas tumbas, como una prostituta
Prosigue su negocio bajo la noche inmóvil.
Cuando la sombra cae desde el cielo nublado
Y del humo de las fábricas se aquieta,
En polvo gris, vienen de la taberna voces,
Y luego un tren que pasa
Agita largos ecos como un bronce iracundo.
No es el juicio aún, muertos anónimos.
Sosegaos, dormid ; dormid si es que podéis.
Acaso Dios también se olvida de vosotros.
Luis Cernuda, La Réalité et le Désir (La Realidad y el Deseo), édition bilingue, traduction de l’espagnol par Robert Marrast et Aline Schulman, choisis et préfacés par Juan Goytisolo, Gallimard, 1969, p. 87-89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luis cernuda, la réalité et le désir (la realidad y el deseo) | ![]() Facebook |
Facebook |
02/09/2012
Philippe Jaccottet, Chants d'en bas
Parler donc est difficile, si c’est chercher… chercher quoi ?
Une fidélité aux seuls moments, aux seules choses
qui descendent en nous assez bas, qui se dérobent,
si c’est tresser un vague abri pour une proie insaisissable….
Si c’est porter un masque plus vrai que son visage
pour pouvoir célébrer une fête longtemps perdue
avec les autres, qui sont morts, lointains ou endormis
encore, et qu’à peine soulèvent de leur couche
cette rumeur, ces premiers pas trébuchants, ces feux timides
— nos paroles :
bruissement du tambour pour peu que l’effleure le doigt inconnu…
Philippe Jaccottet, Chants d’en bas, dans À la lumière d’hiver, Gallimard, 1977, p. 59
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
01/09/2012
Paul Valéry, Littérature

Les livres ont les mêmes ennemis que l’homme : le feu, l’humide, les bêtes, le temps, et leur propre contenu.
*
Dans le poète :
L’oreille parle,
La bouche écoute ;
C’est l’intelligence, l’éveil, qui enfante et rêve ;
C’est le sommeil qui voit clair ;
C’est l’image et le phantasme qui regardent,
C’est le manque et la lacune qui créent.
*
La poésie n’est que la littérature réduite à l’essentiel de son principe actif. On l’a purgée des idoles de toute espèce et des illusions réalistes ; de l’équivoque possible entre le langage de la « vérité » et le langage de la « création », etc.
Et ce rôle quasi créateur, fictif du langage — (lui, d’origine pratique et véridique) est rendu le plus évident possible par la fragilité ou par l’arbitraire du sujet.
*
L’idée d’Inspiration contient celle-ci : Ce qui ne coûte rien est ce qui a le plus de valeur.
Ce qui a le plus de valeur ne doit rien coûter.
Et celle-ci : Se glorifier le plus de ce dont on est le moins responsable.
Quelle honte d’écrire, sans savoir ce que sont langage, verbe, métaphores, changements d’idées, de ton ; ni concevoir la structure de la durée de l’ouvrage, ni les conditions de sa fin ; à peine le pourquoi, et pas du tout le comment ! Rougir d’être la Pythie…
Paul Valéry, Littérature, dans Œuvres II, édition établie et annotée par Jean Hytier, Bibliothèque de la Pléiade, 1960, p. 546, 547, 548, 550..
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, poésie, littérature | ![]() Facebook |
Facebook |
31/08/2012
Giorgio Caproni, Le Mur de la terre, traduit de l’italien par Philippe Di Meo
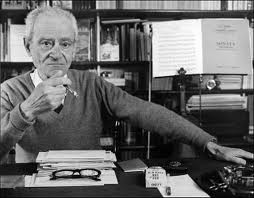
Et seul
lorsque je serai si seul
que je n’aurai plus même
pour compagnie moi-même,
je prendrai alors moi aussi ma
décision.
Un jour à l’aube,
je décrocherai la lanterne
du mur, et dirai adieu
au vide.
Pas à pas,
descendrai dans le ravin.
Mais alors aussi, ma
pierre abandonnée,
au nom de quoi, et où
trouverai-je un sens (que, semble-t-il,
d’autres n’ont pas trouvé) ?
E solo
quando sarò così solo
da non aver più nemmeno
me stesso per compagnia,
allora prenderò anch’io la mia
decisione.
Staccherò
dal muro la lanterna
un’alba, e dirò addio
al vuoto.
A passo a passo
scenderò nel vallone.
Ma anche allora, in nome
di che, e dove
troverò un senso (che altri,
pare, non han trovato),
lasciato questo mio sasso.
Giorgio Caproni, Le Mur de la terre, traduit de l’italien
par Philippe Di Meo, Atelier La Feugraie, 2002, p. 130-131.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio caproni, le mur de la terre, traduit de l’italien par philippe di meo | ![]() Facebook |
Facebook |
30/08/2012
Renée Vivien, La Vénus des aveugles, dans Poésies complètes

Chanson pour mon ombre
Droite et longue comme un cyprès,
Mon ombre suit, à pas de louve,
Mes pas que l’aube désapprouve.
Mon ombre marche à pas de louve,
Droite et longue comme un cyprès,
Elle me suit, comme un reproche,
Dans la lumière du matin.
Je vois en elle mon destin
Qui se resserre et se rapproche.
À travers champs, par les matins,
Mon ombre me suit comme un reproche.
Mon ombre suit, comme un remords,
La trace de mes pas sur l’herbe
Lorsque je vais, portant ma gerbe,
Vers l’allée où gîtent les morts.
Mon ombre suit mes pas sur l’herbe
Implacable comme un remords.
Renée Vivien, La Vénus des aveugles, dans Poésies complètes,
Librairie Alphonse Lemerre, 1944, p. 204-205.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : renée vivien, la vénus des aveugles, dans poésies complètes | ![]() Facebook |
Facebook |
29/08/2012
Serge Essénine, La Confession d'un voyou, dans Quatre poètes russes

La confession d’un voyou
Ce n’est pas tout un chacun qui peut chanter
Ce n’est pas à tout homme qu’est donné d’être pomme
Tombant aux pieds d’autrui.
Ci-après la toute ultime confession,
Confession dont un voyou vous fait profession.
C’est exprès que je circule, non peigné,
Ma tête comme une lampe à pétrole sur mes épaules.
Dans les ténèbres il me plaît d’illuminer
L’automne sans feuillage de vos âmes.
C’est un plaisir pour moi quand les pierres de l’insulte
Vers moi volent, grêlons d’un orage pétant.
Je me contente alors de serrer plus fortement
De mes mains la vessie oscillante de mes cheveux,
C’est alors qu’il fait si bon se souvenir
D’un étang couvert d’herbes et du rauque son de l’aulne
Et d’un père, d’une mère à moi qui vivent quelque part,
Qui se fichent pas mal de tous mes poèmes,
Qui m’aiment comme un champ, comme de la chair,
Comme la fluette pluie printanière qui mollit le sol vert.
Ils viendraient avec leurs fourches vous égorger
Pour chaque injure de vous contre moi lancée.
Pauvres, pauvres paysans !
Sans doute vous êtes devenus pas jolis
Et toujours vous craignez Dieu et les poitrines des marécages.
Oh ! si seulement
Vous pouviez comprendre qu’en Russie votre enfant
Est le meilleur poète.
Craignant pour sa vie, n’aviez-vous pas du givre au cœur
Lorsqu’il trempait ses pieds nus dans les flaques d’automne ?
Il se promène en haut de forme aujourd’hui
Et en souliers vernis.
[...]
Serge Essénine, dans Quatre poètes russes, V. Maïakovsky, B. Pasternak, A. Blok, S. Essénine, texte russe présenté et traduit par Armand Robin, éditions du Seuil, 1949, p. 59-61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serge essénine, la confession d'un voyou, armand robin | ![]() Facebook |
Facebook |
28/08/2012
Liliane Giraudon, Divagation des chiens

« À force. À force de rêver d’un autre lecteur, j’en suis arrivée à imaginer une sorte de "manœuvre" pour échapper au rang des poètes qui d’ailleurs n’ont jamais voulu de moi. "Enfantillages", mais c’est vrai. La seule appartenance mythique et impersonnelle que je désirais, c’était celle-là. Je mesure mieux maintenant ces larmes versées à la lecture d’une lettre de Hölderlin où il déclarait simplement "les hommes ont-ils donc réellement honte de moi ?" Parlait-il de lui ou de l’ensemble de ce qu’il avait déjà écrit ? Je sais bien. Il ne faut pas mélanger. Son corps, soi-même, l’écriture (Ah ! l’horrible imbécillité de ceux qui bavent "moderne", estampillent la moindre affichette, la plus petite liste artistique. Comme si le poème avait à s’ordonner à l'art ou à une quelconque idée neuve du beau. Comme si écrire était un jeu. Du savoir-faire avec en prime quoi ? Quel risque ?) Il m’a fallu du temps pour comprendre. Agencer formellement sur du rien à dire, ce néant d’après dans le vacarme d’un monde plus sanglant et stupide que celui des siècles précédents, non. Ce que je voulais, c’était tout simplement la fatalité comme ajustement. Non pas "ma vie sans moi", mais le poème sans moi. J’ai manqué de forces. Je ne pouvais vivre cette évidence. Alors il y eut les exercices spirituels pour ne plus écrire. J’ai cru que j’allais devenir folle.Depuis, sur les bords de l’étang où je fais de longues marches jusqu’à la tombée du jour, j’ai ramassé un chien. Il ne me quitte plus. Nous mangeons strictement la même chose : viande crue.
Je ne bois plus que de l’eau. Je suis devenue chaste. Mes cheveux ont blanchi mais ils sont toujours aussi longs. Ne m’envoie plus rien. C’est vraiment inutile. Je ne veux plus lire. Ni rien savoir. Je t’en prie, n’insiste plus pour les traductions d’Émilie Dickinson. Je les ai toutes détruites cet hiver. Dans le petit poêle. Tu as raison. J’ai trahi, mais "fidèlement". Ce retournement connu de nous seules ne pouvait être que catégorique.
Hölderlin, Celan ou Pessoa deviendront des otages. C’est le Retour. Saison très noire pour ceux qui poursuivent. Ici les premières violettes apparaissent. Il suffit d’écarter doucement les herbes. Chasser de son cœur la mortelle impatience. Commencer vraiment la véritable attente. Celle concernant ceux qui enfin n’attendent plus rien... »
Liliane Giraudon, Divagation des chiens, P.O.L., 1988, p. 14-15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liliane giraudon, divagation des chiens, écrire la poésie | ![]() Facebook |
Facebook |





