13/12/2018
Pierre Michon, L'empereur d'Occident

Je savais ceci : Attalus était né en Orient. Nul ne sait plus à quoi fut employée sa jeunesse, s’il eut un père ou une mère ; personne ne sait de quel grand rêve, lyre dans les bosquets, buisson ardent où l’on vous remet des lois et un pouvoir, arbustes en fleur entre lesquels on aperçoit des chairs très nues dans la fièvre extravagante des premiers désirs, de quelle raison, de quel vouloir il s’épuisa à faire une réalité de sa vie : personne, sauf peut-être moi. Il rencontra Alaric entre 400 et 410 du Christ ; il pouvait avoir quarante ans ; certains disent qu’à ce moment de sa vie il jouait de la lyre ; d’autres, les mieux informés, les moins dignes de foi, affirment qu’il était préfet de Rome quand le Goth s’empara de lui : je ne veux pas les croire. Alaric guerroyait alors en Italie ou dans la Narbonnaise, peut-être déjà sous les murs de Rome, peut-être seulement dans les bois d’Autun.
Pierre Michon, L’empereur d’Occident, Fata Morgana, 1989, p. 53-54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre michon, l’empereur d’occident, rome, désir, réalité | ![]() Facebook |
Facebook |
08/03/2017
Pierre Michon, Le Roi du bois

Tôt un matin, j’allais me couper des sifflets sous un taillis, dans un de ces fonds humides où viennent des essences tremblantes que le moindre souffle agite, saules et trembles, et qui recueillent à leur pied de pauvres espèces, les couleuvres, les grenouilles : on fait dans ces écorces les meilleurs sifflets, on en tire une plainte ténue mais exagérée comme le chant des crapauds. Oui, Dieu sait que je n’allai chercher là que de bons sifflets. L’odeur des feuilles pourries montait et penché là-dedans j’avançais avec précaution, très occupé, le regard à hauteur de terre. Le jour de juin me trouva dans ce sous-bois. À un détour par une trouée je vis au loin le front d’un palais dans le soleil levant en haut de la colline : rien n’y bougeait, nul n’était levé, c’était clair et inhabité comme un rocher ; ici les brumes de la nuit persistaient, les feuillages retombaient, tout était noir. J’étais bien.
Pierre Michon, Le Roi du bois, éditions infernales, 1992, p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre michon, le roi du bois, sifflet, arbre, grenouille, couleuvre, palais | ![]() Facebook |
Facebook |
30/12/2012
Pierre Michon, Les Onze

Je vous prie, Monsieur, d'arrêter votre attention sur ceci : que savoir le latin quand on est Monseigneur le Dauphin de la Maison de France et le fils de Corentin la Marche, ne sont pas une seule et même chose ; ce sont même deux choses diamétralement opposées : car quand l'un, le dauphin, lit à chaque page, à chaque désinence, à chaque hémistiche, une glorieuse ratification de ce qui est et doit être, dont il fait lui-même partie, et que levant les yeux par ailleurs entre deux hémistiches, il voit par la fenêtre des Tuileries le grand jet d'eau du grand bassin et derrière le grand bassin sur les chevaux de Marly la Renommée avec sa trompette, l'autre, François Corentin, qui relève la tête vers des futailles et de la terre de cave gorgée de vin, l'autre voit dans ces mêmes désinences, ces mêmes phrases qui coulent toutes seules et trompettent, à la fois le triomphe magistral de ce qui est, et la négation de lui-même, qui n'est pas : il y voit que ce qui est, même et surtout si ce qui est paraît beau, l'écrase comme du talon on écrase une taupe.
De cela , Monsieur — et surtout de ce que Corentin le père bien sûr ne savait pas lire, mais encore à peine parler, et seulement patois, excellait seulement dans le savant mélange de vins violets et d'alcools blancs ; de ce que sa présence, sa vie, était à elle seule pour qui lit Virgile, une honte inexpiable (ce qui bien sûr quand on lit Virgile, quand vraiment on le lit avec le cœur, et non pas à la façon déboussolée d'un écolier limousin, est un solécisme inexpiable, mais ceci est une autre affaire) ; de ce que, privé de langage, le père l'était aussi de ce qu'on appelle l'esprit ; que d'ailleurs s'il s'était avisé d'avoir de l'esprit et de jurer lui aussi que Dieu est un chien cela aurait donné quelque chose d'informe qu'on peut transcrire à peu près par Diàu ei ùn tchi, une sorte d'éternuement — de cela tout découle, tout ce qui nous intéresse : la curiosité intellectuelle, la volonté, l'âpreté littéraire, et pour finir l'impeccable réversion de l'injure patoise en petits sonnets anacréontiques ; le grand couteau limousin tout à fait dissimulé dans des bouquets de fleurs versifiables [...]
Pierre Michon, Les Onze, Verdier, 2009, p. 39-41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre michon, les onze, le latin, virgile, dividion sociale | ![]() Facebook |
Facebook |
31/03/2012
Pierre Michon, Le Roi du bois

J'ai peint pour être prince.
J'avais peut-être douze ans. C'était le plein été, l'heure du soir où il fait encore chaud, mais les ombres tournent. Je faisais glander des porcs dans un bois de chênes vers Nemi, en contrebas d'un grand chemin ; j'avais écorcé une baguette et m'étais beaucoup réjoui d'en frapper ces grosses bêtes ineptes passant à ma portée. Je m'en étais lassé et me contentais de briser à toute volée les fougères, les fleurs hautaines du sous-bois, dont ma violence exaltait les odeurs ; j'aimais user de ce fléau. J'entendis venir de loin une voiture lourde, à petit train ; je me cachai et me tins coi : le plein soleil frappait la route et j'étais là dans l'ombre à regarder cette route au soleil, pas plus haut que la terre, invisible. À dix pas de moi et de mes porcs dans la lumière de l'été un carrosse s'arrêta, peint, chiffré, avec des bandes d'azur ; de cette caisse armoriée jaillit une fille très parée qui riait ; elle courut comme vers moi ; elle m'offrit ses dents blanches, la fougue de ses yeux ; toujours riant elle se suspendit à la limite de l'ombre, résolument me tourna le dos, un interminable instant elle se campa dans ce soleil marbré de feuilles où flambèrent ses cheveux, ses jupes d'azur énorme, le blanc de ses mains et l'or de ses poignets, et quand dans un rêve ses mains se portèrent à ses jupes et les levèrent, les cuisses et les fesses prodigieuses me furent données, comme si c'était du jour, mais un jour plus épais ; brutalement tout cela s'accroupit et pissa. Je tremblais. Le jet d'or au soleil sombrement tombait, faisait un trou dans la mousse. La fille ne riait plus, tout occupée à serrer haut ses jupes et sentir d'elle s'évader cette lumière brusque ; la tête un peu penchée, inerte, elle considérait le trou que cela fait dans l'herbe. La défroque d'azur lui bouffait à la nuque, craquante, gonflée, avec extravagance offrant les reins.
Pierre Michon, Le Roi du bois, éditions Verdier 1996, p. 13-15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre michon, le roi du bois, le peintre | ![]() Facebook |
Facebook |
22/07/2011
Pierre Michon, Le roi vient quand il veut
Si les hommes étaient faits d'étoffe indémaillable, nous ne raconterions pas d'histoire, n'est-ce pas ?
Pierre Michon, Les Onze (Verdier, 2009)
Contemporain de la légende
Pourquoi le mot vie dans vos titres, des « minuscules » à celle de Joseph Roulin ?
 Les Vies sont une longue tradition, on en a raconté pendant des siècles. C’étaient d’assez courts récits, non pas véristes et affectant le naturel (« la vie même ») comme nos biographies, mais faisant la part belle au légendaire, aux distorsions de la mémoire, aux interventions de l’au-delà. Les vies qu’on prenait la peine d’écrire étaient nécessairement surnaturelles : elles ne valaient que par un point de tangence avec le divin qui les transportaient hors du commun. Les Vies des douze Césars, après tout, nous entretiennent de monstres que leur mort a transformé en dieux, comme il arrivait aux empereurs de Rome ; les Vies des hommes illustres de Plutarque, les Vies des philosophes illustres de Diogène Laërce traitent de fondateurs quasi légendaires, de miracles guerriers ou mathématiques s’incarnant dans des hommes fortuits.
Les Vies sont une longue tradition, on en a raconté pendant des siècles. C’étaient d’assez courts récits, non pas véristes et affectant le naturel (« la vie même ») comme nos biographies, mais faisant la part belle au légendaire, aux distorsions de la mémoire, aux interventions de l’au-delà. Les vies qu’on prenait la peine d’écrire étaient nécessairement surnaturelles : elles ne valaient que par un point de tangence avec le divin qui les transportaient hors du commun. Les Vies des douze Césars, après tout, nous entretiennent de monstres que leur mort a transformé en dieux, comme il arrivait aux empereurs de Rome ; les Vies des hommes illustres de Plutarque, les Vies des philosophes illustres de Diogène Laërce traitent de fondateurs quasi légendaires, de miracles guerriers ou mathématiques s’incarnant dans des hommes fortuits.
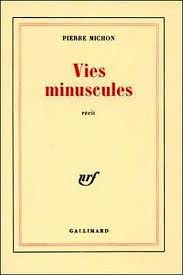 Ce trait est encore plus patent dans les hagiographies chrétiennes, où c’est le surnaturel seul qui tient debout des existences dont la spécificité biographique est négligeable. Les Vies de saints, innombrables et superposables, délivrent le récit de toute contingence, ne s’intéressent qu’à la vie intérieure, qui n’a pas eu de témoins, ou aux lévitations et extases dans lesquelles c’est Dieu même qui s’essaie dans un corps désormais inessentiel : on est loin de la passion de la contingence, de la chasse au petit fait vrai, de la postulation a priori d’une individualité spécifique et inaliénable — mais peut-être aussi fictive que les lévitations — qui caractérisent la biographie.
Ce trait est encore plus patent dans les hagiographies chrétiennes, où c’est le surnaturel seul qui tient debout des existences dont la spécificité biographique est négligeable. Les Vies de saints, innombrables et superposables, délivrent le récit de toute contingence, ne s’intéressent qu’à la vie intérieure, qui n’a pas eu de témoins, ou aux lévitations et extases dans lesquelles c’est Dieu même qui s’essaie dans un corps désormais inessentiel : on est loin de la passion de la contingence, de la chasse au petit fait vrai, de la postulation a priori d’une individualité spécifique et inaliénable — mais peut-être aussi fictive que les lévitations — qui caractérisent la biographie.
Ce très vieux genre a secrètement survécu à sa laïcisation en roman, récit ou nouvelle. Car les modernes aussi ont écrit des vies, en annonçant clairement cette intention dans leurs titres, de façon parfois traditionnelle (la Vie de Rancé), mais le plus souvent nostalgique ou parodique, en tout cas référée : les Vies imaginaires de Schwob, la Vie de Samuel Belet de Ramuz, les Trois vies de G. Stein, ou même Une vie. Et il semble bien que ce qui demeure, dans ces récits explicitement nommés ou d’autres qui le sont moins (Un cœur simple, par exemple, qui est exactement une vie), c’est un sentiment très vacillant du sacré, balbutiant, timide ou désespéré, un sacré dont nul Dieu n’est plus garant : ce qui s’y joue sous les cieux vides, c’est ce qu’a de minimalement sacré tout passage individuel sur terre, plus déchirant aujourd’hui de ce qu’aucune compatibilité céleste n’en garde mémoire. Ces vies sont tangentes à l’absence de Dieu comme les hagiographies l’étaient à sa toute présence ; elles expérimentent le drame de la créature déchue en individu.
Barthes notait que l’anthropologie repose sur le postulat qu’ « il est profondément injuste qu’un homme puisse naître et mourir sans qu’on ait parlé de lui » ; cette injustice, l’anthropologie essaie de la réparer à sa façon, mais ça n’est pas interdit non plus à la littérature. C’est à cela, entre autres choses, que je me suis employé dans des vies.
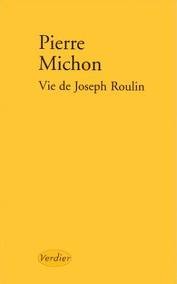 Et puis, je suis fasciné par ces titres dans lesquels ce qu’il y a de plus individuel, le nom propre, est mis en résonance avec le mot vie, qui est le plus universellement, et comme tautologiquement, partagé. « Untel a vécu », disent de tels titres ; ils ont la pauvreté fatale d’une stèle funéraire ; ils sont comme le blason de ce qu’on appelle le romanesque. Et bien sûr c’est la mort qui paradoxalement résonne dans de tels frontispices : certains auteurs l’ont souligné, qui, par antiphrase, ont appelé leurs vies : La Mort d’Ivan Illitch, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant1, etc.
Et puis, je suis fasciné par ces titres dans lesquels ce qu’il y a de plus individuel, le nom propre, est mis en résonance avec le mot vie, qui est le plus universellement, et comme tautologiquement, partagé. « Untel a vécu », disent de tels titres ; ils ont la pauvreté fatale d’une stèle funéraire ; ils sont comme le blason de ce qu’on appelle le romanesque. Et bien sûr c’est la mort qui paradoxalement résonne dans de tels frontispices : certains auteurs l’ont souligné, qui, par antiphrase, ont appelé leurs vies : La Mort d’Ivan Illitch, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant1, etc.
Pierre Michon, Le roi vient quand il veut, Propos sur la littérature, textes réunis et édités par Agnès Castiglione avec la participation de Pierre-Marc de Biasi, Albin Michel, 2007, p. 21-23. ["Contemporain de la légende" est composé de réponses à des questions, recueillies par T. H. et publiés dans Le Français aujourd’hui, « La nouvelle », septembre 1989]
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre michon, le roi vient quand il veut, vies, hagiographie | ![]() Facebook |
Facebook |





