02/01/2014
Maurice Genevoix, La ferveur du souvenir
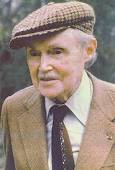
Pour "commémorer" la boucherie de 1914 (3)
J'ai parlé de quelques souvenirs [...]. Souvenirs du front d'abord, et plus précisément d'un secteur, l'un de ces secteurs circonscrits que l'on se voyait attribué comme par un tirage au sort. J'en sais un où mon régiment, après un hiver dans la boue, a connu deux mois de carnages à peu près ininterrompus1, où le "tour" des relevés, impitoyablement, à des intervalles fatidiques, a ramené les mêmes hommes dans les mêmes tranchées bouleversées, refaites, redémolies encore, de relève en relève, regorgeant de morts plus nombreux, tous connus, tous fraternels, peu à peu pourrissants sous nos yeux, à nos côtés, mais toujours reconnaissables. Et je retrouverais, sans contraindre beaucoup ma mémoire, le mouvement, l'accent, les termes mêmes des lettres que j'écrivais alors, m'indignant de cette "méconnaissance" de l'homme aux prises avec les réalités du combat, qui conduisait le haut commandement à de pareilles aberrations.
C'était comme s'il eût retiré à chaque vivant sa dernière chance, prononcé un verdict de condamnation sans appel. À quoi bon ce sursaut d'espoir, cette ivresse de respirer encore qui saisissait chaque survivant au sortir de chaque bataille, si c'était pour se voir ramené à date fixe, inexorablement, vers la même boue, les mêmes cadavres, les mêmes batteries exactement pointées, réglées, le même massacre en quelque sorte familier, qui resserrait, précisait, multipliait et renouvelait ses coups de manière à n'épargner personne ? À la longue, qui eût pu y tenir, réprimer jusqu'au bout en soi-même les sursauts de la bête vivante, et qui savait ?
Maurice Genevoix, La ferveur du souvenir, La Table ronde, 2013, p. 112-113.
1.Les Éparges, entre janvier et avril 1915.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice genevoix, la ferveur du souvenir, guerre de1914, les éparges, tranchée, massacre | ![]() Facebook |
Facebook |
19/12/2013
Caroline Sagot-Duvauroux, Köszönöm

Problème. Écrire convient-il à la poésie, il y a tant de poèmes et tous à crans de tourbillon. Si écrire convenait au poème, un suffirait, un de chaque. La pièce s’ajusterait comme s’ajustent la Critique de la raison pure ou le Parménide à leur propos. Et ça n’est pas parce qu’il y a mille façons d’aimer qu’un poème d’amour ne suffit pas. D’ailleurs on sait qu’il n’y a pas mille façons d’aimer. C’est peut-être même parce qu’il n’y en a qu’une et qu’elle se trouve sous le sabot d’un cheval, qu’on se rendra mieux à la chercher qu’à la trouver. La soumission que cherche le poème est bannie de l’écriture. Proche du religieux. De l’hésitation inquiète. L’angoisse décide de l’orée puis sans chemin dans le brouillon, accepte la pleine mer du brouillon pour n’avoir qu’à accueillir le secours ou la mort qui nommera pour elle le silence, sûre d’unique certitude qu’elle est incapable, que sa langue savante de poème est incapable du silence. Alors mieux vaut l’océan pour n’avoir d’autre choix que se mouiller. Et que l’eau du moins soit, avec ses turpitudes de sel. Car ce n’est pas soi, ce n’est pas être que le poème attend mais autre chose, la chose qui ouvrirait taire et qui peut être taire, on ne sait. Passion de chair qui veut dire passion de chair et passion de la parole sous l’autre chose en même temps que chair ouverte à la parole. Qu’est-ce que c’est ? On écrit cependant. On se colle à l’engrenage de distance. Blanchot au bord du poème se tait car tout de même il s’est tu (non par détresse d’écrivain non par triomphe de l’insolence d’homme), par poème, pour se mouiller. Oui tout de même il l’a fait. Il est mort comme un loup.
Savoir quoi que ce soit indiffère la poésie tant l’inquiète la venue. C’est un truc pour paresseux, pour idiots ou pour fidèles. Ce qui est presque dire pour tout le monde, juste pour tout le monde. La poésie est tellement à tous qu’elle n’est plus respectable et voilà ce qui effraye car il faudrait s’y risquer, aller aux putes : lire.
Caroline Sagot-Duvauroux, Köszönöm, éditions José Corti, 2005, p. 113-114.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot-duvauroux, köszönöm, poésie, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2013
Valère Novarina, Notre parole

Qui communique ? Est-ce moi qui parle ? Écoutons notre langue et comme il y a quelque chose de mystérieux dans ce mot même de personne...Et comme nous avons reçu une idée trop petite, précise, trop étriquée, trop mensurée,, trop propriétaire de l'homme : « acteur social », « particulier », « consommateur », « ego d'artiste », « usager de soi »... Chacun de nous est bien plus ouvert, non fini, et visité. Il y a quelque chose de présent, d'absent et de furtif en nous. Comme si nous portions la marque de l'inconnu. Comme si l'homme était parmi les bêtes le seul animal qui ne s'appartienne pas. Il y a comme un voleur en nous, une présence dans la nuit. Nous ne pouvons en parler. Nous luttons contre lui pour lui demander son nom et il répond par des énigmes. Nous lui demandons son nom et c'est le nôtre qui a changé. Il y a un autre en moi, qui n'est pas vous, qui n'est personne.
Quand nous parlons, il y a dans notre parole un exil, une séparation d'avec nous-mêmes, une faille d'obscurité, une lumière, une autre présence et quelque chose qui nous sépare de nous. Parler est une scission de soi, un don, un départ. La parole part du moi en ce sens qu'elle le quitte. Il y a en nous, très au fond, la conscience d'une présence autre, d'un autre que nous même, accueilli et manquant, dont nous avons la garde secrète, dont nous gardons le manque et la marque.
Valère Novarina, Notre parole, dans Le théâtre des paroles, P.O.L, 2007, p. 237-239.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valère novarina, notre parole, communiquer, parler, obscurité, exil | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2013
Valère Novarina, Le drame dans la langue française

Le drame dans la langue française
26 de juille [1974]. Foutre la langue, être précipité. Faire un feu d'enfer Trouver le rapport entre ça d'économie et ça de langue. On trouve le rapport qui fait d'un trou la langue française. Mâcher en bouche. Corriger les dactyles, comme on corrige les fesses. Au bout du langue française qui apparaît. Elle va le sortir par le trou corrigé. Allégorie de la langue française trouée.
Pas récrire ce qu'on ne supporte plus, chercher la bagarre, attaquer l'ancien texte. Ça se produit par accrocs. Ça fout la peur. Ceci rend fou. Il touche quelque chose qui rend fou. Le langue rend fou. Prendre par morceau, cerner un morceau. Laisser les blancs, chasser les blancs. Chute de la représentation, effondrement théâtral. Fatigue de plus en plus à représenter, à dire quoi que ce soit par du langue. Fatigue de la présentation, fatigue à représenter de plus en plus grande et qui met dans un état de givrage complet, destruction des lieux, outrage public à la langue française, effondrée et dessous. C'est dessous la langue qu'on est maintenant, effondré. Le vingt-sept.
Nécessité d'aérer par des numéros, de chiffres, d'artistes, d'articles, des mesures, des dates, de music-hall, de fantaisistes, des mesures des chiffres de kilomètres effectués. Asphyxié. Page treize-quinze écrites presqu'en dormant. Fabrication d'états crépusculaires par la pratique du martyrisement de son langue du bonne française cadmium. Tout est atteint par les maladies, tout est appliqué aussitôt. Presque plus rien qu'on ne pratique aussitôt. De moins en moins de notes dans ce cahier-ci, de moins en moins de maximes, de traitements remis à plus tard. Tout est tout de suite appliqué. Gendrée du perpétuel des morts. Hors du langue, pansée, j'applique à la langue le pensement. Toujours un carré. Quatre heures semble être une bonne mesure pour les séances. Faire toujours des séances de quatre heures. Se dater la rémine et s'poncer l'calibri. Prendre la trotteuse. Pulsif le carré noir alimentier. Il échange les tuyaux contre la médecine gouvernementale. Fin vingtième.
Valère Novarina, Le drame dans la langue française, dans Le Théâtre des paroles, P.O.L, 2007, p. 67-69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valère novarina, le drame dans la langue française, représenter | ![]() Facebook |
Facebook |
30/11/2013
Philippe Jaccottet, Le bol du pèlerin (Morandi)
Une semaine avec les éditions La Dogana

[...] ces paysages de Morandi sont, à les bien regarder, très étranges. Tous, rigoureusement, « sans figures », et si la plupart comportent des maisons, celles-ci ont souvent des fenêtres aveugles : on les dirait fermées, sinon vides.
Ce serait une erreur pourtant d'y voir l'image d'un monde désert, d'une « terre vaine », comme celle du poème d'Eliot ; je ne crois pas que, même sans le vouloir ou sans en être conscient Morandi ait fait de cette partie de son œuvre une déploration sur la fin des campagnes.
Certains critiques ont noté que le peintre aimait à laisser se déposer, quand il ne le faisait pas lui-même, une légère couche de poussière sur les objets de ses natures mortes : était-ce encore une couche de temps qui devait les protéger et les rendre plus denses ? Sur ses paysages aussi, on a souvent cette impression d'un voile de poussière. Il me vient l'image puérile du « marchand de sable », parce que son office est d'apaiser, d'endormir. Je pense même à la « Belle au bois dormant » ; on pourrait nommer ainsi la lumière égale, jamais scintillante ou éclatante, n'opérant jamais par éclairs ou trouées, qui les baigne ; même aussi claire que l'aube, avec des roses et des gris subtils, elle est toujours étrangement tranquille. Paysages « aux lieux dormants ».
Philippe Jaccottet, Le bol du pèlerin (Morandi), La Dogana, 2006, p. 45-46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, le bol du pèlerin (morandi), poussière, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2013
Pascal Quignard, Abîmes
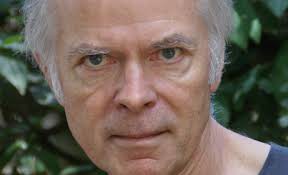
Amaritudo
Dans la volupté se perd le désir d'être heureux. Plus on s'abandonne tout entier au désir, plus le bonheur est presque là. On le guette et toute l'erreur consiste dans ce point. On s'attend à sa rencontre. On le pressent. On le voit soudain ; on l'attend encore plus ; il s'approche ; il arrive. En arrivant il se détruit.
Ces arguments permettent de comprendre les décisions de la chasteté.
Le désir est lié au perdu sans limites.
De deux façons. 1. Le désir est plus proche du perdu que la joie génitale, plus récente, qui croit mettre la main dessus. 2. On perd le désir en jouissant. Cette perte très désagréable dans ses conséquences est même la définition de la volupté.
*
Elle frottait ses yeux avec le dos de ses poings.
Les yeux mi-marron mi-noir, impénétrables.
Jamais rien de lumineux ne remontait à la surface de cette eau. Ni même ne la plissait. Ce regard était pour moi, comme il l'est resté, la profondeur elle-même. C'est exactement ce que les anciens Grecs appelaient l'abîme.
Les animaux aussi ont des yeux aussi directs, sans arrière pensée, sans aucun arrière fond, infinis, aussi graves, aussi peu trompeurs, attentifs, angoissés, dévorants que les siens l'étaient. Elle fléchissait ses genoux avant de s'asseoir.
Pascal Quignard, Abîmes, Folio / Gallimard, 2004 [Fasquelle, 2002], p. 57 et 75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, abîmes, désir, bonheur, volupté, yeux | ![]() Facebook |
Facebook |
16/11/2013
Antonin Artaud, LesTarahumaras
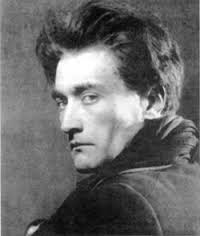
Le rite du Peyotl chez les Tarahumaras
Comme je l'ai déjà dit ce sont les prêtres du Tutuguri qui m'ont ouvert la route de Ciguri comme quelques jours auparavant le Maître de toutes les choses m'avait ouvert la route du Tutuguri. Le Maître de toutes les choses est celui qui commande aux relations extérieures entre les hommes : l' amitié, la pitié, l'aumône, la fidélité, la piété, la générosité, le travail. Son pouvoir s'arrête à la porte de ce qu'ici en Europe nous entendons par métaphysique ou théologie, mais il va beaucoup plus loin dans le domaine de la conscience interne que celui de n'importe quel chef politique européen. Nul au Mexique ne peut être initié, c'est-à-dire recevoir l'onction des prêtres du soleil et la frappe immersive et réagrégatrice de ceux du Ciguri, qui est un rite d'anéantissement, s'il n'a été auparavant touché par le glaive du vieux chef Indien qui commande à la paix et à la guerre, à la Justice, au Mariage et à l'Amour. Il a, paraît-il, en mains les forces qui commandent au hommes de s'aimer ou qui les affolent, alors que les prêtres du Tutuguri font se lever avec leur bouche l'Esprit qui les produit et les dispose dans l'Infini où il faut que l'Âme les cueille et les reclasse dans son moi. L'action des prêtres du Soleil cerne toute l'âme et s'arrête aux limites du moi personnel où le Maitre de toutes les choses vient en cueillir le retentissement. Et c'est là que le vieux chef mexicain m'a frappé afin de m'ouvrir de nouveau la conscience, car pour comprendre le Soleil j'étais mal né ; et puis c'est l'ordre hiérarchique des choses qui veut qu'après être passé par le TOUT, c'est-à-dire le multiple, qui est les choses, on en revienne au simple de l'un, qui est le Tutuguri ou le Soleil, pour ensuite se dissoudre et ressusciter par le moyen de cette opération de réassimilation ténébreuse qui est comprise dans le Ciguri, comme un Mythe de reprise, puis d'extermination, et enfin de résolution dans le crible de l'expropriation suprême, ainsi que ne cessent de le crier et de l'affirmer leurs prêtres dans leur Danse de toute la Nuit. Car elle occupe la nuit entière, du couchant à l'aurore, mais elle prend toute la nuit et la ramasse comme on prend tout le jus d'un fruit jusqu'à la source de la vie. Et l'extirpation de propriétés va jusqu'à dieu et l'outrepasse ; car dieu, et surtout dieu, ne peut prendre ce qui dans le moi est authentiquement le soi-même si fort que celui-ci ait l'imbécillité de s'abandonner.
Antonin Artaud, LesTarahumaras, L'Arbalète, 1963, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
14/11/2013
Philippe Beck, Élégies Hé

46
à Yves di Manno
Les soupirs vigoureux
sont pleins d'idéalités refusées.
Comédier, c'est-à-dire pleurer
et raisonner,
permet l'élégie qui apprend.
À moitié tragédier et élégier,
ou lier les deux verbes
par l'observation des cris idéalisés,
c'est-à-dire enseigner.
Double satirisation
de l'élan idyllique.
Satirisation mouillée,
et s. bien séchée ensuite.
Alors, les personnages romantiques,
les p.,
sont des éventails au soleil.
L'air est plein de Cendre de la Dispersion.
Nous la respirons.
Les signes d'âpreté sont dans le front.
Bise vérifie
le camaïeu délicieux.
Philippe Beck, Élégies Hé, Théâtre typographique,
2005, p. 60.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, Élégies hé, enseigner, satire, romantique | ![]() Facebook |
Facebook |
13/11/2013
Philippe Beck, Poésies didactiques

27. Recension
La recension
qui est un acte de courage
involontaire souvent
est un complément du livre
qui est un acte etc.
Beaucoup d'ouvrages
n'ont pas besoin d'articles ;
mais il faut qu'ils apparaissent
dans la société civile. On les
diffuse.
Ils contiennent déjà
la recension,
et les notes, cachées
visibles, ou
gigognes,
raisonnent
serrées, des ostentations.
Elles renferment (ouvrent
au dedans de la bouche
qui ne peut pas se taire)
des expériences
que résume la littérature.
Car l'expérience
a envie d'un ton.
Les recensions devraient
avoir toujours un ton.
(Un flambeau de mélèze
a ses recensions
pareil.)
Le ton est atmosphérique.
Au soleil.
Philippe Beck, Poésies didactiques, Théâtre
typographique, 2001, p. 84.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, poésies didactiques, livre, diffusion | ![]() Facebook |
Facebook |
12/11/2013
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

Pour un art poétique
Prenez un mot prenez-en deux
faites les cuir (1) comme des œufs
prenez un petit bot de sens
puis un grand morceau d'innocence
faites chauffer à petit feu
au petit feu de la technique
versez la sauce énigmatique
saupoudrez de quelques étoiles
poivrez et puis mettez les voiles
où voulez-vous en venir ?
À écrire
Vraiment ? à écrire ?
(1) "cuir" pour le compte des syllabes
*
Encore l'art po
C'est mon po — c'est mon po — mon poème
Que je veux — que je veux — éditer
Ah je l'ai — ah je l'ai — ah je l'aime
Mon popo — mon popo — mon pommier
Oui mon po — oui mon po — mon poème
C'est à pro — c'est à propos — d'un pommier
Car je l'ai — car je l'ai — car je l'aime
Mon popo — mon popo — mon pommier
Il donn' des — il donn' des — des poèmes
Mon popo — mon popo — mon pommier
C'est pour ça — c'est pour ça — que je l'aime
La popo— la popomme — au pommier
Je la sucre — et j'y mets — de la crème
Sur la po — la popomme — au pommier
Et ça vaut — ça vaut bien — le poème
Que je vais — que je vais — éditer
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline,
dans Œuvres complètes I, édition établie par
Claude Debon, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, 1989, p. 270-271.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond quenau, le chien à la mandoline, art poétique, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
08/11/2013
Albert Camus, Carnets I, mars 1935-février 1942

mars 1936
Si le temps coule si vite, c'est qu'on n'y répand pas de points de repères. Ainsi de la lune au zénith et à l'horizon. C'est pourquoi ces années de jeunesse sont si longues parce que si pleines, années de vieillesse si courtes parce que déjà constituées. Remarquer par exemple qu'il est presque impossible de regarder une aiguille tourner cinq minutes sur un cadran tant la chose est longue et exaspérante.
mai 1936
Et les voilà qui meuglent : je suis immoraliste.
Traduction : j'ai besoin de me donner une morale. Avoue-le donc, imbécile. Moi aussi.
Intellectuel ? Oui. Et ne jamais renier. Intellectuel = celui qui se dédouble. Ça me plaît. Je suis content d'être les deux. "Si ça peut s'unir ?" Question pratique. Il faut s'y mettre. "Je méprise l'intelligence" signifie en réalité : je ne peux supporter mes doutes".
avril 1937
Le besoin d'avoir raison, marque d'esprit vulgaire.
juin 1937
Combat tragique du monde souffrant. Futilité du problème de l'immortalité. Ce qui nous intéresse, c'est notre destinée, oui. Mais non pas "après, "avant".
Albert Camus, Carnets I, mai 1935-février 1942, Folio / Gallimard, 2013 [1962], p. 24, 33, 33, 39, 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, carnets i, temps, morale, intellectuel, immortalité | ![]() Facebook |
Facebook |
04/11/2013
Henri Michaux, Connaissance par les gouffres
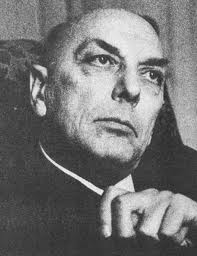
I. Comment agissent les drogues
Les drogues nous ennuient avec leur paradis.
Qu'elles nous donnent plutôt un peu de savoir.
Nous ne sommes pas un siècle à paradis.
Toute drogue modifie vos appuis. L'appui que vous preniez sur vos sens, l'appui que vos sens prenaient sur le monde, l'appui que vous preniez sur votre impression générale. Ils cèdent. Une vaste redistribution de la sensibilité se fait, qui rend tut bizarre, une complexe, continuelle redistribution de la sensibilité. Vous sentez moins ici et davantage là. Où « ici» ? Où « là » ? Dans des dizaines d'« ici», dans des dizaines de « là », que vous ne vous connaissiez pas, que vous ne reconnaissez pas. Zones obscures qui étaient claires. Zones légères qui étaient lourdes. Ce n'est plus à vous que vous aboutissez, et la réalité, les objets mêmes, perdent leur asse et leur raideur, cessent d'opposer une résistance sérieuse à l'omniprésente mobilité transformatrice.
Des abandons paraissent, de petits (la drogue vous chatouille d'abandons), de grands aussi. Certains s'y plaisent. Paradis, c'est-à-dire abandon. Vous subissez de multiples, de différentes invitations à lâcher... Voilà ce que les drogues fortes ont en commun et aussi que c'est toujours le cerveau qui prend les coups, qui observe ses coulisses, ses ficelles, qui joue petit et grand jeu, et qui, ensuite, prend du recul, un singulier recul.
Henri Michaux, Connaissance par les gouffres (1967), dans Œvvres poétiques, III, édition établie par Raymond Bellour et Ysé Tran, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2004, p. 3.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, connaissance par les gouffres, drogue, paradis | ![]() Facebook |
Facebook |
13/10/2013
Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue
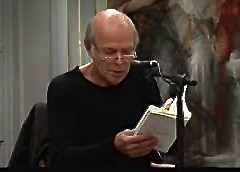
En jouant sur le mot qui se tient sur le bout de la langue, je ne joue pas sur les mots. Je ne tire pas par les cheveux de cette femme la tête érigée dans l'air, étendant les bras dans un suspens comparable aux gestes des patriciennes effrayées devant le phallus voilé de la Villa des Mystères. La non-domination du souvenir d'un nom néanmoins connu ou d'une idée qu'on ressent en l'absence de ses signes — qu'on ne ressent pas vraiment mais qui brûle : « Je brûle ! Je brûle ! » — a non-domination de soi et l'ombre portée de la mort pour peu qu'on ne remette pas la main sur le mot qui fuit. C'est cette main dans le silence. C'est cette prédation silencieuse. Écrire, trouver le mot, c'est éjaculer soudain. Ce sont cette rétention, cette contention, cette arrivée soudaine.
C'est approcher non pas le feu — « Je brûle ! » — mais le foyer central où le feu prend sa flamme.
Le poème est ce jouir. Le poème est ce nom trouvé. Le faire-corps avec la langue est le poème. Pour procurer une définition précise du poème, il faut peut-être de dire simplement : le poème est l'exact opposé du nom sur le bout de la langue.
Pascal Quignard, Le nom sur le bout de la langue, P. O. L, 1993, p. 76-77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, le nom sur le bout de la langue, poème, mort, souvenir | ![]() Facebook |
Facebook |
12/10/2013
Pierre Reverdy, Le Livre de mon bord

Reverdy par Picasso
Pour calmer la souffrance de ne pouvoir aller au-delà de ses limites — se replier souvent très en deça de ses limites.
L'esprit a créé le temps et il le trouve long. Comme il n'a pas créé la vie, il la trouve toujours un peu courte.
À partir d'un certain âge les artistes ont beaucoup plus besoin d'admirateurs que d'amis.
Ce n'est pas ce qu'écrit un auteur dans son journal qui présente la plupart du temps un réel intérêt, mais que ce soit écrit par cet auteur qui s'est, par ailleurs, distingué. On rêve d'un journal anonyme où tout ce qui serait consigné serait réellement émouvant — quelque vie particulièrement dramatique et sincèrement dévoilée. Mais ce n'est pas dans l'ordre du talent ou du génie de se dissimuler. Ce ne sont pas les faits qui comptent, mais l'homme que nous voulons voir vivre par les faits. Le journal d'un grand homme inconnu n'a jamais encore été trouvé.
Ils portent presque tous un masque c'est vrai — mais, ce qu'il y a de plus terrible, c'est que derrière ce masque, il n'y a rien.
Il y a les auteurs qui écrivent avec de la lumière, d'autres avec du sang, avec de la lave, avec du feu, avec de la terre, avec de la boue, avec de la poudre de diamant et enfin ceux qui écrivent avec de l'encre, les malheureux, avec de l'encre tout simplement.
Pierre Reverdy, Le Livre de mon bord, dans Œuvres complètes II, édition préparée, présentée et annotée par Étienne-Alain Hubert, "Mille&unepages", Flammarion, 2010, p. 650, 652, 658, 659-660, 666. 669.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, le livre de mon bord, journal, masque, temps, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
05/10/2013
Jean Bollack, Au jour le jour

Mallarmé
X 631
Pour Mallarmé, tout écrit est vers, et fournit la matière du beau ; il est « partout dans la langue où il y a rythme », même si le plus souvent le rythme que porte l'énoncé est entravé. Il n'existe donc pas de frontière — de la prose peut-être, mais guère de la poésie.
En ce temps de révolution, la souveraineté de l'alexandrin subsistait et tout le reste venait en second, contestait son autorité et l'ébranlait — on a une matière et sa décomposition. Mallarmé, dans un entretien, forcément plus public, qu'il accorde, retraduit la situation, moins pour se trouver lui-même que pour la faire comprendre à d'autres et expliciter sa pensée. Il embrasse la littérature dans sa totalité, retient tout ce qui peut y prétendre. Il se fait le critique expert des œuvres les plus lues, et prend pour critère le pouvoir créateur d'une poésie, redéfinie, et jamais soumise à la réalité immédiate. La création même, le pouvoir démiurgique nouveau sont revendiqués ; ils forment le domaine réservé du lettré, et suscitent les objections d'un interlocuteur profane.
Jean Bollack, Au jour le jour, P.U.F, 2013, p. 532.
©Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, au jour le jour, mallarmé, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |





