17/11/2012
Francis Ponge, Prose ou poésie
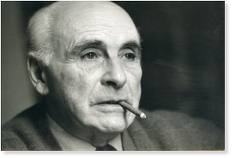
Prose ou poésie
Bien sûr j'ai lu les Poèmes en prose de Baudelaire et les proses de Mallarmé dans Divagations : sont-ce des poèmes en prose ? Cette antinomie entre poésie et prose est un non-sens. [...] J'aime Connaissance de l'Est de Claudel, mais non pas Les Nourritures terrestres de Gide, un livre que l'on peut appeler de prose poétique. Le fait qu'il n'y a plus de règles fixes de prosodie, proésie, signifie qu'il est impossible de classer intelligemment des proses comme poèmes et d'autres non. Une des premières anthologies de poèmes en prose d'après-guerre s'achève, je pense, sur moi. [...] L'anthologie commençait avec Parny au XVIIIe siècle. Ensuite venaient Aloysius Bertrand, Michaux, moi-même. Mais mes textes critiques, mes textes sur les peintres par exemple, sont tout aussi difficiles, souvent plus difficiles, à écrire que ceux considérés comme poétiques. Je ne fais pas de différence. Mes audaces et mes scrupules sont les mêmes, quelque genre que vous assigniez au texte. Mon premier recueil, publié en 1926, s'intitulait Douze petits écrits et s'ouvre avec trois ou quatre po... choses que l'on peut considérer comme des poèmes, si cela vous plaît.
Francis Ponge, "entretien avec Anthony Rudolf", 4 mai 1971, Modern poetry in Translation, n°21, juillet 1974, dans Œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2002, traduction de l'anglais par Bernard Beugnot, p. 1409.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, prose ou poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
14/11/2012
Christiane Veschambre, Après chaque page

On n'écrit pas pour se bâtir un "soi" — je n'écris pas pour devenir "moi".
On n'écrit pas plus pour "s'emparer du monde", ainsi que le dit un article rendant compte du roman "événement de la rentrée" (septembre est aussi le mois de la rentrée dite littéraire en France). Le journaliste se félicite de cette détermination de l'auteur, et de ce que, en même temps, son livre "invite à rester soi".
C'est d'abord désemparé, dessaisi qu'on vient à écrire. Dessaisi de tout contenu préalable, de toute forme reconnue. Dessaisi du rassurant partage forme / contenu. Aussi y a-t-il peu de chances pour que le livre qui naîtra peut-être de cet "espace vide", comme le nommait Peter Brook en parlant des conditions nécessaires du travail théâtral, fasse partie des "romans de la rentrée".
Quelque chose du "moi" et du "monde" s'effrite, s'écroule, se dissout. La lumière de septembre (m') ouvre l'espace intérieur et extérieur, au-dedans et au-devant de moi, qui délivre des confrontations dialectiques, quelque chose veut, comme un animal caché sous la terre, sous l'eau ou dans la grotte, surgir et le traverser, cet espace, et c'est avec des mots qu'il me faut le laisser venir. Lui qui vient d'un monde sans mots, sans catégories, sans intentions.
Et il disparaîtra. Ce qui surgit, toujours disparaît. Ça s'appelle la Vie. Ça ne se capture pas, ça ne se construit pas, ça ne se crée pas. Ça peut nous traverser, ça peut redonner vie, imprévisible, inassignable, à nos mots. Ça nous échappe, nous la perdons. Mais de la même façon que nous voulons vivre, encore vivre, jusqu'à la mort, contre la mort, nous l'espérons, la Vie, avec nos mots, après chaque page, nous la perdons, nous l'attendons, la prochaine fois peut-être, elle nous adviendra, et nous disparaissons.
Christiane Veschambre, Après chaque page, Le Préau des collines, 2010, p. 32-33.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, après chaque page, écrire, la vie | ![]() Facebook |
Facebook |
08/11/2012
Édith Azam, Salle de spectacle du silo d'Arenc

J'écrire ?
J'écrire et ne sais pas pourquoi j'écris
J'écrire me connaît
L'acte d'écrire nous sait par cœur
Écrivant ce n'est pas moi
non ce n'est absolument pas moi qui écrit
Écrire me bouillonne et cherche plus que moi dans moi
Mais je ne décide pas
Je ne décide pas jamais ce que j'écrire
Je n'ai que la volonté d'écrire
mais que j'écrire c'est plus que moi
écrire me boursoufle me fatigue m'épuise
et j'aimerais ne pas j'écrire
j'aimerais plus jamais ça mais j'écrire plus fort que moi
À chaque fois l'acte d'écrire emporte tout et malgré moi
Alors j'écris
J'écris le hurlement d'écrire qui a su remonter jusqu'à moi
Le hurlement d'écrire tient debout dans le corps
Il faudrait retrousser la peau
Il faudrait bien admettre enfin
qu'écrire n'est rien d'autre
que notre chair hurlante
Édith Azam, Salle de spectacle du silo d'Arenc, architecte Roland Carta, photographies Lisa Ricciotti, éditions Al Dante, 2012, n.p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 2dith azam, salle de spectacle du silo d'arenc, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
10/10/2012
Giorgio Agamben, Nudités

Identité sans personne
[...] Persona signifiait à l'origine "masque" et c'est à travers le masque que l'individu acquiert un rôle et une identité sociale. Ainsi, à Rome, tout individu était identifié par un nom qui exprimait son appartenance à une gens, à une lignée, mais celle-ci, à son tour, se trouvaient définie par le masque en cire de l'aïeul que chaque famille patricienne conservait dans l'atrium de sa demeure. De là à faire de la personne la « personnalité » qui définit la place de l'individu dans les drames et dans les rites de la vie sociale, il n'y a qu'un pas et persona a fini par indiquer la capacité juridique et la dignité politique de l'homme libre. Quant à l'esclave, tout comme il n'avait pas d'aïeux, ni de masque, ni de nom, il ne pouvait pas davantage avoir une « personne », une capacité juridique (servus non habet personam). La lutte pour la reconnaissance est donc, à chaque fois, une lutte pour le masque, mais ce masque coïncide avec la « personnalité » que la société reconnaît à chaque individu (ou avec le « personnage » qu'elle fait de lui avec sa connivence plus ou moins réticente).
Il n'est donc pas étonnant que la reconnaissance des personnes ait été pendant des millénaires la possession la plus jalouse et la plus significative. Si les autres êtres humains sont importants et nécessaires, c'est avant tout parce qu'ils peuvent me reconnaître. Le pouvoir lui-même, la gloire, la richesse, tout ce à quoi "les autres" semblent être si sensibles n'a de sens, en dernière analyse, qu'en vue de cette reconnaissance de l'identité personnelle. On peut bien, comme aimait à le faire, selon les récits, le calife de Bagdad Haroun-al-Rashid, se promener incognito par les rues de la ville et s'habiller comme un mendiant ; mais s'il n'y avait jamais un moment où la gloire, les richesses et le pouvoir étaient reconnues comme « miens », si, comme certains saints invitent à le faire, je passais tout ma vie dans la non-reconnaissance, alors mon identité personnelle serait perdue à jamais.
Giorgio Agamben, Nudités, traduction de l'italien par Martin Rueff, éditions Payot & Rivages, 2012 [2009], p. 69-70.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio agamben, nudités, identité, personne, martin rueff | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2012
Pascal Quignard, Abîmes, Dernier Royaume III

Amaritudo
Dans la volupté se perd le désir d'être heureux. Plus on s'abandonne tout entier au désir, plus le bonheur est presque là. On le guette et toute l'erreur consiste dans ce point. On s'attend à sa rencontre. On le pressent. On le voit soudain ; on l'attend encore plus ; il s'approche ; il arrive. En arrivant il se détruit.
Cet argument permet de comprendre les décisions de la chasteté.
Le désir est lié au perdu sans limites.
De deux façons. 1. Le désir est plus proche du perdu que la joie génitale, plus récente, qui croit mettre la main dessus. 2. On perd le désir en jouissant. Cette perte très désagréable dans ses conséquences est même la définition de la volupté.
Pascal Quignard, Abîmes, Dernier Royaume III, Folio -Gallimard, 2004 [2002], p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, abîmes, dernier royaume iii, la perte, le désir | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2012
Charles Baudelaire, Fusées

L'enthousiasme qui s'applique à autre chose que les abstractions est un signe de faiblesse et de maladie.
La vie n'a qu'un charme vrai ; c'est le charme du Jeu Mais s'il nous est indifférent de gagner ou de perdre ?
De la langue et de l'écriture prises comme opérations magiques, sorcellerie évocatoire.
Dans certains états de l'âme presque surnaturels, la profondeur de la vie se révèle tout entière dans le spectacle, si ordinaire qu'il soit, qu'on a sous les yeux. Il en devient le symbole.
Il y a dans l'acte de l'amour une grande ressemblance avec la torture ou avec une opération chirurgicale.
Si un poète demandait à l'État le droit d'avoir quelques bourgeois dans son écurie, on serait fort étonné, tandis que si un bourgeois demandait du poète rôti, on le trouverait tout naturel.
Ce qu'il y a d'enivrant dans le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique de déplaire.
À chaque minute nous sommes écrasés par l'idée et la sensation du temps. Et il n'y a que deux moyens pour échapper à ce cauchemar : la plaisir et le travail. Le plaisir nous use. Le travail nous fortifie. Choisissons.
Plus nous nous servons d'un de ces moyens, plus l'autre inspire de répugnance.
Charles Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, texte établi et annoté par Y.-G. Le Dantec, édition révisée par Claude Pichois, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1968, p. 1251, 1252, 1256, 1257, 1257, 1257, 1259, 1266.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles baudelaire, fusées, le temps, l'amour, la vie | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2012
Jacques Bens, 41 sonnets irrationnels

—Parlons clair : tu adoptes quoi comme système ?
Si tu préfères : tu mets quoi dans un poème ?
Ta philosophie ?Mmm ? Ton modus vivendi ?
— Des bruits, des sons, des mots, des pieds, des vers, des phrases.
— Oui, je sais. Mais ce n'est pas ça que je te dis.
Je parle des idées, comment dire ? Du thème,
Du... Ou plutôt, voici : dis-moi ce que tu aimes
Dans les vers honorés, méconnus ou maudits ?
— Les bruits, les sons, les mots. Parfois, une ou deux phrases.
Un sourire pincé, un cri, mais pas l'emphase,
Une fleur oubliée, un rire démentiel,
Une chanson, par-ci par)là, qui vient, qui jase,
Quatre regrets, mon cœur, et peut-être Pégase,
Ma jeunesse partie,
Mer,
Terre,
Soleil,
Ciel.
Jacques Bens, 41 sonnets irrationnels, Gallimard, 1965, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques bens, 41 sonnets irrationnels, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
05/09/2012
André du Bouchet, Carnets ; L'emportement du muet

On ne peut pas quitter la réalité d’un pas — décoller —
*
Poésie réparatrice
elle dit souvent ce qui manque. C’est à ce prix qu’elle cesse d’être complaisance et parure — qu’elle constitue un appel ardent à tout ce que l’on croit.
*
axiome de la poésie : que cela soit indémontrable et jamais gratuit.
*
La poésie rétablit inlassablement au présent le verbe qui est au passé.
*
un poème — qu’est-ce — rien
et pourtant le monde était là
comme le vent dans les tiges
le monde est là — comme le
vent dans les tiges
et aux confins bleus du monde
André du Bouchet, Carnets 1952-1956,, Plon, 1990, p. 5, 6, 19, 36 et 75.
*
ce qui me sépare des choses n’est pas plus épais
que l’haleine ou le feuillet
de l’autre feuillet
André du Bouchet, Carnet 2, Fata Morgana, 1998, p. 11.
sur le point d’être nommé, ce
qu’on voit ayant pris de court, l’omission du nom — fraîcheur reconduite — peut, sans faire défaut, de nouveau s’inscrire dans le temps de la nomination. Cela
fera comme tache ou
jour.
*
Trouver distance sur la page, c’est recevoir ce qu’elle a donné.
*
… hauteur
atteinte dans la langue, mais du coup, et sans le vouloir, nous nous découvrons soudain portés à la hauteur où chacun tout à tour est atteint.
André du Bouchet, L’emportement du muet, Mercure de France, 2000, p. 71, 85, et 119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, carnets, l'emportement du muet, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
01/09/2012
Paul Valéry, Littérature

Les livres ont les mêmes ennemis que l’homme : le feu, l’humide, les bêtes, le temps, et leur propre contenu.
*
Dans le poète :
L’oreille parle,
La bouche écoute ;
C’est l’intelligence, l’éveil, qui enfante et rêve ;
C’est le sommeil qui voit clair ;
C’est l’image et le phantasme qui regardent,
C’est le manque et la lacune qui créent.
*
La poésie n’est que la littérature réduite à l’essentiel de son principe actif. On l’a purgée des idoles de toute espèce et des illusions réalistes ; de l’équivoque possible entre le langage de la « vérité » et le langage de la « création », etc.
Et ce rôle quasi créateur, fictif du langage — (lui, d’origine pratique et véridique) est rendu le plus évident possible par la fragilité ou par l’arbitraire du sujet.
*
L’idée d’Inspiration contient celle-ci : Ce qui ne coûte rien est ce qui a le plus de valeur.
Ce qui a le plus de valeur ne doit rien coûter.
Et celle-ci : Se glorifier le plus de ce dont on est le moins responsable.
Quelle honte d’écrire, sans savoir ce que sont langage, verbe, métaphores, changements d’idées, de ton ; ni concevoir la structure de la durée de l’ouvrage, ni les conditions de sa fin ; à peine le pourquoi, et pas du tout le comment ! Rougir d’être la Pythie…
Paul Valéry, Littérature, dans Œuvres II, édition établie et annotée par Jean Hytier, Bibliothèque de la Pléiade, 1960, p. 546, 547, 548, 550..
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, poésie, littérature | ![]() Facebook |
Facebook |
28/08/2012
Liliane Giraudon, Divagation des chiens

« À force. À force de rêver d’un autre lecteur, j’en suis arrivée à imaginer une sorte de "manœuvre" pour échapper au rang des poètes qui d’ailleurs n’ont jamais voulu de moi. "Enfantillages", mais c’est vrai. La seule appartenance mythique et impersonnelle que je désirais, c’était celle-là. Je mesure mieux maintenant ces larmes versées à la lecture d’une lettre de Hölderlin où il déclarait simplement "les hommes ont-ils donc réellement honte de moi ?" Parlait-il de lui ou de l’ensemble de ce qu’il avait déjà écrit ? Je sais bien. Il ne faut pas mélanger. Son corps, soi-même, l’écriture (Ah ! l’horrible imbécillité de ceux qui bavent "moderne", estampillent la moindre affichette, la plus petite liste artistique. Comme si le poème avait à s’ordonner à l'art ou à une quelconque idée neuve du beau. Comme si écrire était un jeu. Du savoir-faire avec en prime quoi ? Quel risque ?) Il m’a fallu du temps pour comprendre. Agencer formellement sur du rien à dire, ce néant d’après dans le vacarme d’un monde plus sanglant et stupide que celui des siècles précédents, non. Ce que je voulais, c’était tout simplement la fatalité comme ajustement. Non pas "ma vie sans moi", mais le poème sans moi. J’ai manqué de forces. Je ne pouvais vivre cette évidence. Alors il y eut les exercices spirituels pour ne plus écrire. J’ai cru que j’allais devenir folle.Depuis, sur les bords de l’étang où je fais de longues marches jusqu’à la tombée du jour, j’ai ramassé un chien. Il ne me quitte plus. Nous mangeons strictement la même chose : viande crue.
Je ne bois plus que de l’eau. Je suis devenue chaste. Mes cheveux ont blanchi mais ils sont toujours aussi longs. Ne m’envoie plus rien. C’est vraiment inutile. Je ne veux plus lire. Ni rien savoir. Je t’en prie, n’insiste plus pour les traductions d’Émilie Dickinson. Je les ai toutes détruites cet hiver. Dans le petit poêle. Tu as raison. J’ai trahi, mais "fidèlement". Ce retournement connu de nous seules ne pouvait être que catégorique.
Hölderlin, Celan ou Pessoa deviendront des otages. C’est le Retour. Saison très noire pour ceux qui poursuivent. Ici les premières violettes apparaissent. Il suffit d’écarter doucement les herbes. Chasser de son cœur la mortelle impatience. Commencer vraiment la véritable attente. Celle concernant ceux qui enfin n’attendent plus rien... »
Liliane Giraudon, Divagation des chiens, P.O.L., 1988, p. 14-15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liliane giraudon, divagation des chiens, écrire la poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
20/08/2012
Philippe Beck et Xavier Person, Redonnons sa place à la poésie
Je reprends ci-dessous le texte paru dans la page « Rebonds » de Libération du 17 août 2012. À diffuser !
À l’heure où certains imaginent fondre la poésie dans un vaste ensemble réunissant le roman et le théâtre (1), il est peut-être bon de rappeler la place que peut occuper la poésie au sein de la littérature. Et ce dont, pour nous, «poésie» est le mot.
En ces temps de crise inédite, alors que les désastres ne sont plus seulement derrière nous ou à côté de nous, mais bien devant nous, est-il encore temps de s’arrêter au vieux mot «poésie» ? Les modernités littéraires successives ont, chacune à leur manière, déclaré la caducité de ce terme, son invalidité, en même temps qu’elles en refondaient les puissances. La mort répétée de la poésie, l’adieu qu’elle ne cesse de se faire à elle-même, inscrivent sa dynamique dans une interrogation et une incertitude qui, paradoxalement, lui redonnent légitimité aujourd’hui.
D’autres l’ont dit avant nous, dans la saturation des discours et des mots usés qui opacifient le réel de leurs fausses évidences, l’écriture poétique ouvre parfois une brèche. Par une sorte d’arrêt dans le flux continu de la prose du monde, elle peut faire disjonction. «Autres directions» est le panneau qu’elle invite à suivre au sortir du chemin à sens unique que semble indiquer le langage usuel.
Une politique de la poésie est peut-être à imaginer sous le rapport de son «idiorythmie», par quoi elle oppose à la normalisation des manières d’être et de penser un hiatus inacceptable. Cependant, il ne s’agit pas d’idolâtrer nos singularités, mais bien plutôt, affrontant la faillite de nos certitudes et de nos représentations, de nous engager dans ce que nous ignorons de nous-mêmes et du monde.
Entendons-nous bien : nous ne voulons pas opposer la poésie au roman, à tout le reste, ni l’enfermer dans quelque cercle des poètes en voie de disparition, mais bien plutôt interroger la littérature à partir de cette «littérature de la littérature», en quoi consiste le poème, cet «effort au style», «taux de densité cruelle», qui de la poésie fait une expérience à l’extrême pointe du langage et de la pensée. En cet échec possible du langage et de la pensée, en cet espoir aussi bien.
La poésie est le plus souvent une tentative de construction, même précaire, de formes incertaines. Elle peut prendre le risque d’autres agencements dans la langue, d’autres configurations de pensée, d’émotions. Qu’elle soit du côté du chant ou du côté de la «littéralité de la littérature», selon Derrida, elle ose quelque chose et, pour cela, doit avoir du courage : «Le courage, le cœur, le courage de se rendre, au travers du refoulement, à ce qui se passe ici dans la langue et par la langue, aux mots, aux noms, aux verbes et finalement à l’élément de la lettre […].»
Il s’agit pour nous de prendre ce qui a nom «poésie» assez au sérieux pour y chercher - pourquoi pas ? - d’autres manières de vivre et de penser. Construire une cabane à l’instant du désastre ? Non. En ces temps inconnus où nous entrons, pouvons-nous continuer de toujours écrire et lire ce que nous connaissons déjà, toujours la même histoire ?
Prétention excessive ? C’est juste l’attention à un mot que nous proposons, loin des infantilisations bienveillantes mais néfastes auxquelles la réduisent trop souvent des actions de «promotion». Le courage dont nous parlons n’appelle nulle condescendance. De sorte qu’au-delà de l’estompement d’un mot du fronton du Centre national du livre (CNL), c’est le sens même de l’action culturelle dans le champ de la «littérature de recherche» qu’on pourrait aujourd’hui interroger.
Des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, des journalistes, des critiques et des lecteurs de tous âges, des écrivains et des artistes, de multiples acteurs de la vie littéraire continuent de prêter attention aux écritures poétiques. Que le Centre national du livre fasse place dans sa réforme à ce qui les anime est la moindre des choses.
Notre souhait est que les Assises du livre et de l’écrit, dont la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, vient de confirmer la mise en œuvre, prennent en compte les résonances du mot «poésie» et, par lui, ce qui fait notre dignité d’êtres de langage, à travers les saisons.
Cette concertation donne espoir aux écrivains, qui se sont mobilisés pour dénoncer la manière dont le processus était imposé et les risques qu’il faisait courir au champ poétique. Qu’il ait pu être question d’estomper le mot «poésie» pour, aux dires de l’actuel président du CNL, obéir aux préconisations de la Cour des comptes, n’est pas insignifiant.
(1) Prévue dans le projet de réforme du Centre national du livre (CNL) datant du 12 mars, la suppression de la commission Poésie du CNL a été suspendue en juillet par la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, qui doit lancer prochainement une concertation sur le sujet.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck et xavier person, redonnons sa place à la poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
11/08/2012
Philippe Jaccottet, Observations et autres notes anciennes

Il m’a semblé parfois (mais quelles chimères n’invente-t-on pas, presque honnêtement, pour justifier ses limites !) que ma plus vraie vie, ma seule vraie vie, n’était faite que des moments pour lesquels j’avais cru trouver une expression un peu juste ; comme si devenir poésie, si peu que ce fût, leur conférait plus de réalité, ou, plus précisément encore, les révélait, les fixait, les accomplissait. Sans doute survivaient-ils déjà d’une certaine manière dans le souvenir ; mais la parole leur ajoutait quelque chose qu’elle était seule à pouvoir leur donner, une valeur, et une espèce de privilège. (Sans doute ces moments ne me semblaient-ils pas arrachés au temps pour la simple raison qu’ils pourraient me survivre, si les poèmes étaient beaux. Car enfin les œuvres qui nous paraissent les plus assurées de durer ne sont encore que de très fragiles feuilles de papier, qui brûleront ou moisiront un jour. Mais comment expliquer ce que l’on ne ressent que confusément, encore que profondément ? Disons qu’il ne s’agirait pas de prolonger son nom au-delà de la mort, ni même de le faire durer des moments fugitifs ; mais plutôt de donner à ces moments fugitifs une sorte de forme spirituelle — et forme est encore mal dire ; ainsi le parfum de la violette de mars, qui fanera pourtant, semble creuser un couloir ténébreux et velouté dans le mur du temps et s’ouvrir brusquement sur ce qui n’a plus ni nom, ni parfum, ni saison).
Philippe Jaccottet, Observations et autres notes anciennes, 1947-1962, Gallimard, 1998, p. 37-38.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, observations, poésie et expérience de la langue | ![]() Facebook |
Facebook |
26/07/2012
Émile Verhaeren, Impressions

Le poète plonge dans la vie totale bien trop profondément pour qu'il écrive d'après une formule et s'inquiète d'autre chose que de s'exprimer et d'exprimer en même temps le monde. Rires, larmes, rages, espoirs, désespoirs, pitiés, charités, haines, égoïsmes, vives, vertus, foi, doutes, ardeurs, peines, vanités, angoisses, terreurs, tout cela se mêle en lui, se combat en lui, s'unit parfois en lui, tout cela, suivant les heures, est tour à tour vainqueur ou vaincu, et c'est tout cela — que la cause d'émotion vienne du dedans de lui ou du dehors — qu'il reflète et qu'il traduit. Et traduisant cela, il est l'écho du monde qui n'est que cela.
Si, dans un instant de sécurité et de joie, le poète érige en son œuvre ce qu'il est convenu d'appeler la Beauté, c'est-à-dire une image grave, simple et régulière, sacrez-le artiste de l'art pour l'art : qu'importe ? S'il décrit des tempêtes d'âmes, s'il plonge et crie, s'il grince et se flagelle, nommez-le un romantique : qu'importe ? S'il se penche sur la misère, s'il aime et guérit les plaies, s'il secourt de sa bonté les errants, les flagellés et les pauvres, appelez-le écrivain social : qu'importe encore ?
Émile Verhaeren, Impressions (troisième série), Mercure de France, 1928, p. 188.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Émile verhaeren, impressions, l'art pour l'art, la poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
17/07/2012
Jean Follain, Paris

Cimetières
Le Père-Lachaise, lieu de l'ultime résistance des communards, reste pénétré des odeurs du dernier siècle quand s'agglutinèrent à Paris plusieurs villages de la banlieue. M. Thiers, le nabot à vigoureuse cervelle dont la gravure d'apothéose décore encore de vieilles maisons rurales, y est enterré sous un immense mausolée carré. Quelques-uns, parmi les tombeaux de généraux de Napoléon, sont encore entretenus, beaucoup ne le sont plus : l'amateur d'émotions, le revers du veston recouvert de pellicules, y découvre d'anciennes couronnes fangeuses et circonscrit d'un doigt spatulaire les aigles en relief sur la pierre moussue.
La multitude des cippes, des amphores, des croix, force le cœur dans les beaux jours de végétation abondante, alors que dans des coins pas encore défrichés, se balancent coquelicots et folles avoines, ainsi en est-il non loin du mur sanglant.
Autour du four crématoire, le colombarium forme une grande bibliothèque d'urnes. De petits bourgeois à esprit fort, porteur de leur vivant d'un regard têtu et doux, des ouvriers convaincus et sobres se font incinérer. leurs parents pour rendre les devoirs à leurs cendres doivent si elles sont haut placées le long du mur prendre l'échelle et monter jusqu'à la case numérotée parmi tant d'autres.
On peut visiter le four crématoire. La salle de crémation porte la marque de l'architecture salomonique. Elle comporte un orgue. La bière est introduite dans un simulacre de four en stuc décorée de roses, puis enlevée dans la coulisse et glissée devant deux parents seulement dans le véritable four qui consume à peu près tout car on ne retrouve que quelques débris d'os.
Pour la visite publique, le four fonctionne en veilleuse ; j'ai vu parmi les visiteuses une petite bourgeoise vêtue de noir, la lueur rose éclairant son visage s'écrier en riant : « Eh bien, moi qui aime la chaleur, je serai servie. »
Jean Follain, Paris, éditions R.-A. Corréa, 1935, p. 59-61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean follain, paris, cimetière, le père-lachaise | ![]() Facebook |
Facebook |
13/07/2012
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

La poésie
c'est refuser la vie — partie par partie —
pour l'accepter tout entière —
que l'image se pulvérise et devienne dérisoire.
La banalité poétique se résorbe aussi bien que l'autre, seulement il faut l'avoir éprouvée, jusque dans la trame — ce qui n'est pas facile
*
Le poète est celui qui, dormant et sachant qu'il dort,
ne se réveille pas —
*
le poème sort avec sa lie
hors de sa gangue d'angoisse
et de toute la boue qui le charrie
*
la poésie, c'est cette exaspération des facultés critiques,
de cette faculté critique qui ne mord pas sur la matière
il y a cette révélation de l'insipide
— de cette clarté
qui court en avant d'elle-même
ce qu'il y a de plus éclatant, de plus exotique, est comme la préfiguration de sa banalité
qui n'est suscité que pour être incinéré
l'image n'est que l'indication de sa course, de sa rapidité.
Nous sommes — heureusement — en retard sur cette banalité.
Notre vie, notre poids, notre étonnement, notre lenteur — notre admiration.
on a touché l'essence de la poésie, quand on sent passer ce souffle incolore, ce souffle
le vent dont nous sommes affublés
le feu, c'est cet immense retard sur la banalité —
l'image n'est suscitée que pour être incinérée.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le Bruit du temps, 2011, p. 249, 252, 253, 254-55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |





