12/03/2012
Antoine Emaz, Cuisine (publie.net)

La « poésie » va prendre en charge ce que le récit classique ne peut porter, peut-être parce qu'il ne s'agit pas de fiction. Quelques chose l, comme si travailler dans le vrai interdisait le récir, parce qu'un poète n'est pas un autobiographe narcissique ou exhibitionniste et qu'il sait que la poésie est et n'est pas un confessionnal. Donc on va avec le récit, on le détourne, on le déboîte, le défait, on le déstructure, le pousse aux limites... plus rien n'est reconnaissable mais tout est dit. Ce cœur noir moteur, c'est lui qui pulse. En poésie, quand on sait lire, l'urgence est palpable, la nécessité de dire évidente. Cela peut être plus ou moins masqué par le dispositif d'écriture qui est à la fois un mode d'exposition et un mode de défense, mais c'est bien un cœur ouvert, au bout. L'enfant qui pleure de Reverdy.
En poésie, ce qui est dit est l'affleurement lisible de ce qui est tu : la vague / les profondeurs de la mer.
Dans tout ce que je note au jour le jour, cette piétaille de lignes, je ne vois pas bien en quoi je suis poète. Je note seulement ce que d'ordinaire on ne retient pas, espérant que tel ou tel détail sera révélateur, qu'il portera un peu plus que seulement lui-même.
Antoine Emaz, Cuisine, publie.net, p. 31, 35, 50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
29/02/2012
Thomas Bernhard, Mes Prix littéraires
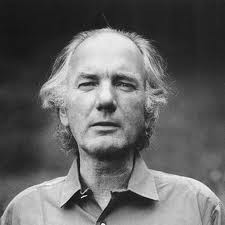
[après la publication de Gel]
[...] lorsque le déluge de critiques, incroyablement violent et complètement contradictoire, des éloges les plus embarrassants aux descentes en flèche les plus féroces, a pris fin, je me suis senti d'un seul coup comme anéanti, comme si je venais de tomber sans rémission dans un épouvantable puits sans fond. J'étais persuadé que l'erreur d'avoir placé tous mes espoirs dans la littérature allait m'étouffer. Je ne voulais plus entendre parler de littérature. Elle ne m'avait pas rendu heureux , mais jeté au fond de cette fosse fangeuse et suffocante d'où l'on ne peut plus s'échapper, pensai-je à l'époque. Je maudissais la littérature et ma dépravation auprès d'elle et j'allais sur des chantiers pour finalement me faire engager en tant que chauffeur-livreur pour la société Christophorus, située sur la Klosterneuburgerstrasse. Pendant des mois j'ai fait des livraisons de bière pour la célèbre brasserie Gösser. Ce faisant, j'ai non seulement très bien appris à conduire des camions, mais aussi à connaître encore mieux qu'avant la ville de Vienne tout entière. J'habitais chez ma tante et je gagnais ma vie comme chauffeur de poids lourds. Je ne voulais plus entendre parler de littérature, j'avais placé en elle tout ce que j'avais, et elle m'avait récompensé en me jetant au fond d'une fosse. La littérature me dégoûtait, je détestais tous les éditeurs et toutes les maisons d'édition et tous les livres. Il me semblait qu'en écrivant Gel, j'avais été victime d'une escroquerie gigantesque. J'étais heureux quand, dans ma veste de cuir, je m'installais au volant du vieux camion Steyr et sillonnais la ville en faisant vrombir le moteur. C'est là que se montrait toute l'utilité pour moi d'avoir appris à conduire des camions depuis longtemps, c'était une des conditions pour obtenir un poste en Afrique auquel je m'étais porté candidat, des années auparavant, ce qui finalement ne s'était pas fait, en raison d'un concours de circonstances en réalité très heureux, comme je sais aujourd'hui.
Thomas Bernhard, Mes Prix littéraires, traduit de l'allemand par Daniel Mirsky, "Du Monde entier", Gallimard, 2009, p. 41-42.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, prix littéraires, littérature | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2012
Caroline Sagot-Duvauroux, Le Vent chaule
 Problème : peut-on supporter d'être parmi. Objet soi-même parmi les objets dont on a perdu l'usage et qui retrouvent leur condition de chose et nous font leçon. Que faut-il faire ? qu'est-ce que je peux faire ? Tenir au plus près du vent. Laisser s'échapper ce qui peut s'échapper. Cesser de souffrir affreusement de l'anachronisme entre séduction et vérité. J'entends par vérité l'audace de n'être que là. Non distrait du cours mais chopé quelquefois par un autre cours. Sauter d'un misérable saut, le regard planté, local, où ça bouge. N'être que le sursaut d'une braise dans la fournaise. S'accepter du moindre souffle. Refuser la castration d'un mode. S'attacher à la soif non au goût. Tenter tenter. La polyphonie est trop arrangée trop sublime pour la vérité. Cacophonie va mieux, je suis désolée. L'irrécupérable est aussi le boulot de la poésie. Peut-être faut-il jeter le livre tout de suite. Le laisser aux poches de résistance à l'état rélictuel que l'on trouve dans les décharges. Madame de Lafayette nous voici. Aux poches avec poing mouchoir poussière toute une vie dit Beckett. S'y connaît en embosse cap au pire. L'incertitude est un espoir quelquefois. Ce n'est pas tout à fait triste. Et si je ne fais pas ça, je mens. Et ça c'est cahots, choses avec promesses ça et là. Je peux tirer quelques phrases heureuses, quelques trouvailles, les recueilir. Mais la lame de fond ! qui démantèle tout ce qui se présente avant même que le corps se dépouille de l'annonce, corps du récit, corps du pamphlet, corps du poème, corps, corps, corps, jusqu'au corps du Christ ! Mais la lame de fond, l'étrange broussaille de sensations, analogies, qui afflue Devant. D'où la pensée lèvera peut-être, non préalable. Le minotaure invisible, le déferlement souterrain des apories qui fend les jarrets du grand récit, la lame de fond, si je ne sais la dire je ne peux la dédire. Et je ne sais la dire, alors je laisse flotter au bord du néant des friches de langues ou d'histoires qui s'entêtent comme du chiendent. Ça me coûte beaucoup mais j'ai une joie à l'hasardeux pari qu'une lecture écrira. C'est ce qui manque que j'aimerais donner le plus et le donner manquant. Le lien. L'ordre brisé.
Problème : peut-on supporter d'être parmi. Objet soi-même parmi les objets dont on a perdu l'usage et qui retrouvent leur condition de chose et nous font leçon. Que faut-il faire ? qu'est-ce que je peux faire ? Tenir au plus près du vent. Laisser s'échapper ce qui peut s'échapper. Cesser de souffrir affreusement de l'anachronisme entre séduction et vérité. J'entends par vérité l'audace de n'être que là. Non distrait du cours mais chopé quelquefois par un autre cours. Sauter d'un misérable saut, le regard planté, local, où ça bouge. N'être que le sursaut d'une braise dans la fournaise. S'accepter du moindre souffle. Refuser la castration d'un mode. S'attacher à la soif non au goût. Tenter tenter. La polyphonie est trop arrangée trop sublime pour la vérité. Cacophonie va mieux, je suis désolée. L'irrécupérable est aussi le boulot de la poésie. Peut-être faut-il jeter le livre tout de suite. Le laisser aux poches de résistance à l'état rélictuel que l'on trouve dans les décharges. Madame de Lafayette nous voici. Aux poches avec poing mouchoir poussière toute une vie dit Beckett. S'y connaît en embosse cap au pire. L'incertitude est un espoir quelquefois. Ce n'est pas tout à fait triste. Et si je ne fais pas ça, je mens. Et ça c'est cahots, choses avec promesses ça et là. Je peux tirer quelques phrases heureuses, quelques trouvailles, les recueilir. Mais la lame de fond ! qui démantèle tout ce qui se présente avant même que le corps se dépouille de l'annonce, corps du récit, corps du pamphlet, corps du poème, corps, corps, corps, jusqu'au corps du Christ ! Mais la lame de fond, l'étrange broussaille de sensations, analogies, qui afflue Devant. D'où la pensée lèvera peut-être, non préalable. Le minotaure invisible, le déferlement souterrain des apories qui fend les jarrets du grand récit, la lame de fond, si je ne sais la dire je ne peux la dédire. Et je ne sais la dire, alors je laisse flotter au bord du néant des friches de langues ou d'histoires qui s'entêtent comme du chiendent. Ça me coûte beaucoup mais j'ai une joie à l'hasardeux pari qu'une lecture écrira. C'est ce qui manque que j'aimerais donner le plus et le donner manquant. Le lien. L'ordre brisé.
Caroline Sagot Duvauroux, Le Vent chaule, suivi de L'Herbe écrit, éditions José Corti, 2009, p. 108-109.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot-duvauroux, le vent chaule, poésie et expérience | ![]() Facebook |
Facebook |
19/02/2012
Francis Ponge, Prose ou poésie
 Prose ou poésie
Prose ou poésie
Bien sûr j'ai lu les Poèmes en prose de Baudelaire et les proses de Mallarmé dans Divagations : sont-ce des poèmes en prose ? Cette antinomie entre poésie et prose est un non-sens. [...] J'aime Connaissance de l'Est de Claudel, mais non pas Les Nourritures terrestres de Gide, un livre que l'on peut appeler de prose poétique. Le fait qu'il n'y a plus de règles fixes de prosodie, proésie, signifie qu'il est impossible de classer intelligemment des proses comme poèmes et d'autres non. Une des premières anthologies de poèmes en prose d'après-guerre s'achève, je pense, sur moi. [...] L'anthologie commençait avec Parny au XVIIIe siècle. Ensuite venaient Aloysius Bertrand, Michaux, moi-même. Mais mes textes critiques, mes textes sur les peintres par exemple, sont tout aussi difficiles, souvent plus difficiles, à écrire que ceux considérés comme poétiques. Je ne fais pas de différence. Mes audaces et mes scrupules sont les mêmes, quelque genre que vous assigniez au texte. Mon premier recueil, publié en 1926, s'intitulait Douze petits écrits et s'ouvre avec trois ou quatre po... choses que l'on peut considérer comme des poèmes, si cela vous plaît.
Francis Ponge, "entretien avec Anthony Rudolf", 4 mai 1971, Modern poetry in Translation, n°21, juillet 1974, dans Œuvres complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2002, traduction de l'anglais par Bernard Beugnot, p. 1409.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
11/02/2012
Aragon, Les Chambres, et : J'appelle poésie cet envers du temps...
Chambres
Un bras autour de toi
Le second sur mes yeux
L'un t'empêche de fuir
L'autre maintient mes songes
Ce lieu fermé de nous
Soudain si je m'éveille
Du sommeil des voleurs
La nuit noire m'y noie
Tout m'est plus que mémoire
À ce moment d'oubli
Dans la forêt du lit
Tout n'est plus que murmure
Et notre tragédie
Au long jeu de dormir
À demi-mots amers
L'obscurité la dit
Absente mon absente
Si faussement que j'ai
Dans mes bras étrangers
Comme une image peinte
Absente mon absente
Si faussement plongée
En mes bras étrangers
Comme une image feinte
J'ai des yeux pour pleurer
Quelle que soit la chambre
Les plafonds s'y ressemblent
Pour être malheureux
Ailleurs sans doute ailleurs
Aussi bien qu'où je suis
Oreille à tous les bruits
Qui braillent le malheur
Au grand vent dans un port
Comme un amant quitté
Au bout de la jetée
Espère et désespère
Et les barques à sec
La grève à marée basse
Et là-bas de mer lasse
Échoués les varechs
[...]
Aragon, Les Chambres, Poème du temps qui ne passe pas,
Éditeurs Français Réunis, 1969, p. 25-27 , repris dans
Œuvres poétiques complètes, II, p. 1097-1098.
 J'appelle poésie cet envers du temps, ces ténèbres aux yeux grands ouverts, ce domaine passionnel où je me perds, ce soleil nocturne, ce chant maudit aussi bien qui se meurt dans ma gorge où sonne à la volée les cloches de provocation... J'appelle poésie cette dénégation du jour, où les mots disent aussi bien le contraire de ce qu'ils disent que la proclamation de l'interdit, l'aventure du sens ou du non-sens, ô paroles d'égarement qui êtes l'autre jour, la lumière noire des siècles, les yeux aveuglés d'en avoir tant vu, les oreilles percées à force d'entendre, les bras brisés d'avoir étreint de fureur ou d'amour le fuyant univers des songes, les fantômes du hasard dans leurs linceuls déchirés, l'imaginaire beauté pareille à l'eau pure des sources perdues...
J'appelle poésie cet envers du temps, ces ténèbres aux yeux grands ouverts, ce domaine passionnel où je me perds, ce soleil nocturne, ce chant maudit aussi bien qui se meurt dans ma gorge où sonne à la volée les cloches de provocation... J'appelle poésie cette dénégation du jour, où les mots disent aussi bien le contraire de ce qu'ils disent que la proclamation de l'interdit, l'aventure du sens ou du non-sens, ô paroles d'égarement qui êtes l'autre jour, la lumière noire des siècles, les yeux aveuglés d'en avoir tant vu, les oreilles percées à force d'entendre, les bras brisés d'avoir étreint de fureur ou d'amour le fuyant univers des songes, les fantômes du hasard dans leurs linceuls déchirés, l'imaginaire beauté pareille à l'eau pure des sources perdues...
J'appelle poésie la peur qui prend ton corps tout entier à l'aube frémissante du jouir... Par exemple.
l'amour l'amour l'amour l'amour l'amour
[...]
Aragon, J'appelle poésie cet envers du temps, dans Œuvres poétiques complètes, II, édition publiée sous la direction d'Olivier Barbarant, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, p. 1407.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, poésie, temps, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
09/02/2012
Norge, La Langue verte
Glose
In principio erat verbum
 Mon chien s'appelle Sophie et répond au nom de Bisoute. C'est plus gentil ? Et le baiser est moins solennel que la sagesse. Vous me la baillez belle avec vos querelles de langage. Les peintres sont voués à la couleur :les poètes se défendraient-ils d'être voués aux mots ? Mais sémantique, rhétorique, vous croyez à cela, vous, Mossieu ? P'têt'ben qu'oui. Calembredaine ? Jardinier, encore un mot de germé. Bonne chance et fouette cocher ! D'accord : ça ne nourrit pas son homme... Qui mange le vent de sa cornemuse n'a que musique en sa panse. Déjà, ce n'est pas si peu.
Mon chien s'appelle Sophie et répond au nom de Bisoute. C'est plus gentil ? Et le baiser est moins solennel que la sagesse. Vous me la baillez belle avec vos querelles de langage. Les peintres sont voués à la couleur :les poètes se défendraient-ils d'être voués aux mots ? Mais sémantique, rhétorique, vous croyez à cela, vous, Mossieu ? P'têt'ben qu'oui. Calembredaine ? Jardinier, encore un mot de germé. Bonne chance et fouette cocher ! D'accord : ça ne nourrit pas son homme... Qui mange le vent de sa cornemuse n'a que musique en sa panse. Déjà, ce n'est pas si peu.
La vérité ne se mange pas ? La musique non plus. Mais je dis, moi, que la poésie se mange. Ici, des mots seuls on vous jacte et ce n'est pas encore poèmes ; mais enfin, des poèmes, qui sait où ça commence...
Les mots, disait Monsieur Paulhan, sont des signes, et Mallarmé, lui, que ce sont des cygnes. Ah, beaux outils, les mots sont des outils, rabot, évidoir, herminette, gouge, ciseau. Ainsi, les formes naissent, portant la marque de l'outil et je retrouve à la statue ce joli coup de burin. Et je retrouve à la pensée ce délicat sillon du verbe. Tudieu, quelle patine ! Quel héritage, quelle usure, quelles reliques de famille ! Quelle Jouvence et quel arroi. Des taches de sang, des coulées de verjus. Des traces de larmes ; et les sourires n'en laisseraient-ils pas ? En veux-tu de l'humain, en voilà. Ce n'est pas de petite bière (de bière, fi) mais de cuvée haute en cru. Venues de toutes part au monde, agiles comme des pollens. Ici, les monts de Thrace et là les rudesses picardes : et là le miel attique et l'Orient avec ses sucs. Des graillons, des flexions, des marées, puis un petit vent coulis, un soudain carillon de voyelles. Boissy d'Anglas. Quant au tudesque, zoui pour le bouffre mot : lansquenet (toujours hérissés ces tudesques) qui fait la pige au mot azur. Mais en français d'expression, pas trop n'en faut. D'expression, oui-dà, mais de race. Et de décence. En tapinois quand il sied, mais en garnde clarté si c'est l'heure. J'y reviens, mon frère qui respires, as-tu déjà pensé au spacieux mot : azur ?
Ainsi les mots naissent, les mots durent, les mots se fanent et reverdissent. Des moissons, des vendanges, des forêts, des nids de mésanges et des couvées de minéraux. Fluide, flot, flamme, fleur, flou, flèche, flûte, flexible, flatteur... vous entendez ces allusions, vous reconnaissez cette lignée. Mais le génie français est réservé : il caresse l'harmonie imitative. Mais il décrit un chien sans marcher à quatre pattes.
[...]
Totaux
Ton temps têtu te tatoue
T'as-ti tout tu de tes doutes ?
T'as-ti tout dû de tes dettes ?
T'as-ti tout dit de tes dates ?
T'as-t-on tant ôté de ta teinte ?
T'as-t-on donc dompté ton ton ?
T'as-ti tâté tout téton ?
T'as-ti tenté tout tutu ?
T'es-ti tant ? T'es-ti titan ?
T'es-ti toi dans tes totaux ?
Tatata, tu tus ton tout.
Golgotha
Jésus le crucifix au mur de la bouchère
Prenait-il en pitié les viandes passagères
Dans ce matin fidèle au raffut des chalands
Chuchoteurs que les rôts de veau fussent bien blancs
Et l'entrecôte mieux fissurée à la graisse,
Partant plus tendre. Un peu c'était comme à confesse,
O seigneur ; le saignant les rapproche de toi,
La dame carnassière et le monsieur qui tance. Or, le boucher, tirant de la grande potence
Un gigot qui pendait assez proche la croix,
Frôla de lui le flanc douloureux du dieu triste
Et le sang du mouton rougit le corps du Christ.
Norge, La langue verte, Gallimard, 1954, p. 9-11, 36 et 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norge, la langue verte, allitération, golgotha | ![]() Facebook |
Facebook |
05/02/2012
Franck Venaille, C'est nous les modernes — Bernard Vargaftig

En hommage à Bernard Vargaftig, 1934-2012
 Il existe une profonde obsession du langage chez Bernard Vargaftig. On peut estimer qu'elle est double et vise, d'abord, les termes qu'il n'utilisera jamais, ensuite ceux qui, de livre en livre, forment l'ossature même de son écriture. Dans Trembler comme le souffle tremble, le texte est si dense que l'on peut imaginer que les mots laissés à la porte sont légion et attendent plus ou moins calmement que l'on fasse appel à eux. On découvre également que craie — enfance — tremblement — rue reviennent régulièrement dans l'énoncé, l'accompagnant de leur rythme et de leur cadence récurrente. D'ailleurs, ce que nous dit ici Vargaftig, n'est pas nouveau. C'est une voix que l'on retrouve de livre en livre. Voix sortie de l'enfance douloureuse et inquiète. Chant d'amour. Travail acharné sur le langage afin de le rendre toujours plus poétique, c'est-à-dire respectant des lois et des règles strictes et immuables. Cette fois-ci nous sommes, me semble-t-il, à l'épicentre de l'énigme qui accompagne tout travail créatif. Quelque chose a été oublié mais quoi ? Quelles sont les causes profondes de ce tremblement de l'écriture qui est tout le contraire d'une maladresse, mais le signe que la vie, de l'intérieur, anime le langage et le fait vibrer. Mais aucune réponse n'est apportée à notre questionnement. À nous de lire et de le faire bien. La thématique est donc connue. Alors d'où vient cet étrange bonheur de retrouver ce que l'on pressentait ? C'est que, d'une manière assez obsessionnelle, Vargaftig continue à bouleverser le sens et le rythme de l'énoncé poétique. On est pris par ce chant qui sourd de la page, ce chant qui ramène à autrefois, avant que l'enfant découvre la peur (non pas métaphysique mais bien réelle) née de la présence des occupants nazis. Depuis des années, Vargaftig compose ses poèmes comme un artiste plasticien (Boltanski ?) peut fabriquer des objets avec de la terre. Il prend. Il soupèse. Il ajoute ou rejette jusqu'à ce que la nudité du vers apparaisse et éblouisse le lecteur. Car chez Vargaftig, il y a d'abord le vers, lumineux, sous toutes ses formes, et qui s'affirme comme tel. Ce n'est pas un poète honteux d'entendre sa poésie chanter. Il suffit de l'écouter lire pour comprendre que ce n'est pas de lui que naîtront les travaux de sape entrepris contre la « forme » poésie. L'écoutant, j'entends un lyrique s'exprimer, tenir compte des blancs, des silences, des retraits qui sont nombreux dans l'écriture et lui donnent ce ton inimitable. Cet homme, que je connais depuis 1962 mais que je n'avais jamais revu est fidèle à une musique des mots venant disait-on de la poésie française du 16e siècle et de l'Europe centrale. Il existe chez Vargaftig, une manière d'imposer sa voix, sa voix brisée, secrète amie que l'on n'oublie jamais, sa voix d'écorché. Quand nous nous sommes retrouvés, quarante ans plus tard, nous avons parlé, longuement, avec le maximum de précision, et cela sur un banc, face à un fleuve. Tout pouvait s'arrêter. Mais tout a repris. Je viens de relire Trembler comme le souffle tremble. Le livre dit également la présence de la peur, du danger, de la détresse. Ce sont là des données difficiles à affronter. La force du poète Vargaftig est là : il peut faire face avec ses armes qui portent un nom : le poème.
Il existe une profonde obsession du langage chez Bernard Vargaftig. On peut estimer qu'elle est double et vise, d'abord, les termes qu'il n'utilisera jamais, ensuite ceux qui, de livre en livre, forment l'ossature même de son écriture. Dans Trembler comme le souffle tremble, le texte est si dense que l'on peut imaginer que les mots laissés à la porte sont légion et attendent plus ou moins calmement que l'on fasse appel à eux. On découvre également que craie — enfance — tremblement — rue reviennent régulièrement dans l'énoncé, l'accompagnant de leur rythme et de leur cadence récurrente. D'ailleurs, ce que nous dit ici Vargaftig, n'est pas nouveau. C'est une voix que l'on retrouve de livre en livre. Voix sortie de l'enfance douloureuse et inquiète. Chant d'amour. Travail acharné sur le langage afin de le rendre toujours plus poétique, c'est-à-dire respectant des lois et des règles strictes et immuables. Cette fois-ci nous sommes, me semble-t-il, à l'épicentre de l'énigme qui accompagne tout travail créatif. Quelque chose a été oublié mais quoi ? Quelles sont les causes profondes de ce tremblement de l'écriture qui est tout le contraire d'une maladresse, mais le signe que la vie, de l'intérieur, anime le langage et le fait vibrer. Mais aucune réponse n'est apportée à notre questionnement. À nous de lire et de le faire bien. La thématique est donc connue. Alors d'où vient cet étrange bonheur de retrouver ce que l'on pressentait ? C'est que, d'une manière assez obsessionnelle, Vargaftig continue à bouleverser le sens et le rythme de l'énoncé poétique. On est pris par ce chant qui sourd de la page, ce chant qui ramène à autrefois, avant que l'enfant découvre la peur (non pas métaphysique mais bien réelle) née de la présence des occupants nazis. Depuis des années, Vargaftig compose ses poèmes comme un artiste plasticien (Boltanski ?) peut fabriquer des objets avec de la terre. Il prend. Il soupèse. Il ajoute ou rejette jusqu'à ce que la nudité du vers apparaisse et éblouisse le lecteur. Car chez Vargaftig, il y a d'abord le vers, lumineux, sous toutes ses formes, et qui s'affirme comme tel. Ce n'est pas un poète honteux d'entendre sa poésie chanter. Il suffit de l'écouter lire pour comprendre que ce n'est pas de lui que naîtront les travaux de sape entrepris contre la « forme » poésie. L'écoutant, j'entends un lyrique s'exprimer, tenir compte des blancs, des silences, des retraits qui sont nombreux dans l'écriture et lui donnent ce ton inimitable. Cet homme, que je connais depuis 1962 mais que je n'avais jamais revu est fidèle à une musique des mots venant disait-on de la poésie française du 16e siècle et de l'Europe centrale. Il existe chez Vargaftig, une manière d'imposer sa voix, sa voix brisée, secrète amie que l'on n'oublie jamais, sa voix d'écorché. Quand nous nous sommes retrouvés, quarante ans plus tard, nous avons parlé, longuement, avec le maximum de précision, et cela sur un banc, face à un fleuve. Tout pouvait s'arrêter. Mais tout a repris. Je viens de relire Trembler comme le souffle tremble. Le livre dit également la présence de la peur, du danger, de la détresse. Ce sont là des données difficiles à affronter. La force du poète Vargaftig est là : il peut faire face avec ses armes qui portent un nom : le poème.
Franck Venaille, C'est nous les modernes, Poésie Flammarion, 2010, p. 185-186.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck venaille, c'est nous les modernes, bernard vargaftig | ![]() Facebook |
Facebook |
25/01/2012
Julien Gracq, Carnets du grand chemin
 Étrange siècle, que le dix-huitième. Au moment même où la poésie semble en lui faire définitivement faux bond à l'art des vers, la littérature, elle, se met dans toute la France à rimailler à propos de bottes, de la lettre de château jusqu'à la satire vengeresse, du pamphlet politique jusqu'au traité de jardinage et de sylviculture. Cette métromanie galopante qui au XVIIe siècle obligeait déjà Boileau à suer sang et eau sur ses Satires et ses Épîtres, devient au siècle suivant une vraie épidémie. L'encaisse-or de la poésie volatilisée, l'encaisse-papier circule partout en nourrissant une inflation de mauvais aloi ; là aussi le XVIIIe siècle est bien celui qui commence avec la rue Quincampoix.
Étrange siècle, que le dix-huitième. Au moment même où la poésie semble en lui faire définitivement faux bond à l'art des vers, la littérature, elle, se met dans toute la France à rimailler à propos de bottes, de la lettre de château jusqu'à la satire vengeresse, du pamphlet politique jusqu'au traité de jardinage et de sylviculture. Cette métromanie galopante qui au XVIIe siècle obligeait déjà Boileau à suer sang et eau sur ses Satires et ses Épîtres, devient au siècle suivant une vraie épidémie. L'encaisse-or de la poésie volatilisée, l'encaisse-papier circule partout en nourrissant une inflation de mauvais aloi ; là aussi le XVIIIe siècle est bien celui qui commence avec la rue Quincampoix.
Dans le prestige qui entoure à cette époque les petits vers, le "chant", la musique verbale, atteint à sa teneur la plus faible, et même s'élimine complètement comme élément de valeur, toutes les images sont des clichés (et même surexposés) ; ne reste que la difficulté artificielle imposée par le mètre et la rime : simple exercice d'assouplissement et de musculation abusivement tenu par toute une époque pour la beauté, dont il est un accessoire insignifiant. Une bonne partie de l'œuvre rimée de Voltaire, capable d'écrire une prose si déliée et si acérée, nous fait l'effet de gammes acrobatiques, où la virtuosité du doigté nous reste encore sensible, mais dont on se demande pourquoi on a jugé les notes dignes de s'inscrire sur une portée.
Julien Gracq, Carnets du grand chemin, José Corti, 1992, p. 236-237.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, carnets du grand chemin, xviiième siècle, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
18/01/2012
Jean Bollack, note sur Le Cygne de Baudelaire

Baudelaire, dans "Le Cygne", l'une des investigations les plus poussées de la faculté de mémoire qui ait jamais été conçue, s'est attaché à faire de l'Andromaque de Virgile, et en arrière de celle d'Homère, le symbole de l'absence, accueillie et surmontée dans la pathos de la mise en scène. C'est le pouvoir de l'esprit, ne se séparant pas, mais se reconstituant par la séparation : «... je pense à vous », « je ne vois qu'en esprit », « je pense à mon grand cygne », puis « je pense à la négresse » : le mouvement s'étend à tout ce qui jamais a été arraché, exilé, exclu. À « l'immense majesté » des pleurs de la veuve répond la fécondité d'une "mémoire" déjà fertile, comme la terre, contenant tout ce qui a jamais pu être dit et écrit plus tard (comme le Livre soit de Mallarmé soit de Celan). La majesté, toute objective, est d'abord le produit d'une tradition livresque, immémoriale et c'est elle qu'en fait le poète retrouve, qu'il se remémore et qu'il analyse dans les étagements de l'alexandrin, transposant les conquêtes de l'expérience immédiate dans les couches les plus médiatisées de la culture littéraire, celles où l'on peut faire sonner un mot comme "Hélénos". C'est comme si les arrachements les plus tragiques étaient à l'origine de toutes les créations et qu'inversement, on n'accédait à l'absence que par les livres. Un exil à lui, propre au poète (« ... dans la forêt où mon esprit s'exile »), le rapproche des exilés de tous les temps. « Un vieux souvenir sonne...» ; il n'y en a qu'un : au terme d'une extension, il est vieux comme le monde, recueillant toute la perte :
« Je pense...». À fin, c'est n'importe quoi, tout ce qu'on fait exister en vers parce qu'on ne l'avait plus. C'est aussi une histoire de la poésie. La douleur est la Muse, qui connaît toute chose. Le poète jubilant a une clé qui ouvre ce qu'il touche.
Jean Bollack, extrait d'un ouvrage à paraître.
©photo Tristan Hordé
Le Cygne
Victor Hugo
I
Andromaque, je pense à vous ! Ce petit fleuve,
Pauvre et triste miroir où jadis resplendit
L'immense majesté de vos douleurs de veuve,
Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit,
A fécondé soudain ma mémoire fertile,
Comme je traversais le nouveau Carrousel.
Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une ville
Change plus vite, hélas! que le cœur d'un mortel) ;
Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques,
Ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts,
Les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques,
Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus.
Là s'étalait jadis une ménagerie ;
Là je vis, un matin, à l'heure où sous les cieux
Froids et clairs le Travail s'éveille, où la voirie
Pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux,
Un cygne qui s'était évadé de sa cage,
Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec,
Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage.
Près d'un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec
Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre,
Et disait, le cœur plein de son beau lac natal :
« Eau, quand donc pleuvras-tu? quand tonneras-tu, foudre ? »
Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal,
Vers le ciel quelquefois, comme l'homme d'Ovide,
Vers le ciel ironique et cruellement bleu,
Sur son cou convulsif tendant sa tête avide,
Comme s'il adressait des reproches à Dieu !
II
Paris change ! mais rien dans ma mélancolie
N'a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs,
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie,
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.
Aussi devant ce Louvre une image m'opprime :
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous,
Comme les exilés, ridicule et sublime,
Et rongé d'un désir sans trêve ! et puis à vous,
Andromaque, des bras d'un grand époux tombée,
Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus,
Auprès d'un tombeau vide en extase courbée ;
Veuve d'Hector, hélas ! et femme d'Hélénus !
Je pense à la négresse, amaigrie et phtisique,
Piétinant dans la boue, et cherchant, l'œil hagard,
Les cocotiers absents de la superbe Afrique
Derrière la muraille immense du brouillard ;
À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve
Jamais, jamais ! à ceux qui s'abreuvent de pleurs
Et tettent la Douleur comme une bonne louve !
Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs !
Ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile
Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor !
Je pense aux matelots oubliés dans une île,
Aux captifs, aux vaincus !... à bien d'autres encor !
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, dans Œuvres complètes texte établi et annoté par Y.-G. Le Dantec, édition révisée, complétée et présentée par Claude Pichois, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1961, p. 81-83.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean bollack, baudelaire, le cygne, souvenir, exil | ![]() Facebook |
Facebook |
06/01/2012
Walter Benjamin, Sens unique
 Assistance technique
Assistance technique
Il n'y a rien de plus misérable qu'une vérité exprimée comme elle a été pensée. Dans un pareil cas sa transcription par écrit n'est même pas une mauvaise photographie. La vérité est comme un enfant, comme une femme qui ne vous aime pas : devant l'objectif de l'écriture, lorsque nous avons plongé sous le voile noir, elle se refuse à avoir l'air paisible et bien aimable. C'est brusquement, comme à l'improviste, qu'elle veut être effarouchée, chassée de la rêverie où elle est plongée, et être effrayée par une émeute, de la musique, des appels à l'aide. Qui voudrait compter les signaux d'alarme dont est pourvu l'intérieur d'un véritable écrivain ? Et « écrire » ne signifie rien d'autre que les mettre en action. Alors la douce odalisque sursaute, tire à elle la première chose qui lui tombe sous la main dans la pagaille de son boudoir, notre crâne s'y enveloppe et, presque méconnaissable, adresse ainsi la parole devant nous, en chuchotant, aux gens. Mais comme elle doit être bien faite, et avoir le corps rayonnant de santé, pour ainsi paraître parmi eux déguisée, traquée, et pourtant triomphante et adorable.
Walter Benjamin, Sens unique, précédé de Enfance Berlinoise, traduit de l'allemand par Jean Lacoste, Les Lettres nouvelles - Maurice Nadeau, 1978, p. 228-229.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : walter benjamin, sens unique, jean lacoste | ![]() Facebook |
Facebook |
03/12/2011
Julien Gracq, Lettrines, 2

La littérature de cette fin de siècle commence à ressembler furieusement aux armées de campagne modernes, dévorées de plus en plus par leur encombrant appareil logistique. Tel l'éclaire de loin, tel la renseigne, tel lui dresse des plans, tel classe ses archives, tel inventorie son matériel, tel prévoit déjà sa reconversion future, tel met au point pour elle de nouvelles méthodes et conçoit dans ses laboratoires les armes suprêmes du futur. Le train des équipages, les services auxiliaires, sont gonflés à craquer. D'écrivains de première ligne — d'écrivains qui tout bonnement écrivent — point, ou si peu.
*
Dans un grand journal du soir, à la page des spectacles, on peut trouver la liste des films « en exclusivité » à Paris classés sous trois rubriques : Films français — Films étrangers — Films d'auteurs. Le premier mouvement est d'en sourire, mais il y a là, même naïf, en somme un essai de tri qui, transposé dans le domaine de l'imprimé, ne serait pas sans clarifier le commerce de la littérature. La notion utile de livre sans auteur, introduite dans la librairie, en officialisant un secteur de littérature industrielle, permettrait à la clientèle de masse, dans les bibliothèques de gare et de métro, au tourniquet des drugstores, d'aller à l'imprimé comme on va au cinéma du samedi soir, sans se poser de questions de provenance embarrassantes et inopportunes.
Mais — j'y songe — c'est déjà fait. Si on parcourt de l'œil l'éventaire d'une librairie de gare, il est clair que le nom de l'auteur n'est plus aujourd'hui sur la couverture, neuf fois sur dix, que l'équivalent du nombril au milieu du ventre : quelque chose dont l'absence se remarquerait, mais qui ne saurait a priori inciter personne à une quelconque recherche de paternité.
Julien Gracq, Lettrines 2, dans Œuvres complètes, II, édition établie par Bernhilde Boie, avec la collaboration pour ce volume de Claude Dourguin, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1995, p. 305
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Gracq Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, lettrines 2, littérature | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2011
Édith Azam, Devant la porte, un paillasson : la parole
 Devant la porte, un paillasson : la parole...
Devant la porte, un paillasson : la parole...
Nous avons eu jadis, peut-être, la parole.
Nous sommes dupes de nous-mêmes, de ce foutu langage qui nous dévisse la bouche, y voyons une forme de supériorité animale qui se résume, au bout du compte, à calfeutrer nos phantasmes les plus, non, les mieux lubriques croyant nous éloigner de la bête mais... nous sommes des brutes, des barbares.
Nous nous mentons depuis la langue, depuis cette épine molle et gluante qui nous creuse en quotidien la bouche ce toute la mort qu'on lui a fait.
Nous, en permanence, violons de la langue dans une bêtise abjecte qui nous sabote tout le squelette tant est si mal que, à défaut de marcher debout nous : nous rampons du gosier.
Nous nous traînons plus bas que taire, persuadés que le langage relèvera un peu les choses mais.., nous ignorons les massacres dont nous sommes les seuls responsables et qui fait le défaut de langue majeur : son mensonge.
Nous, à cause de cela, sommes devenus l'imbécile jouet du langage.
Nous ne comprenons rien, ne voyons pas le point où la pensée s'em-pute dressant la langue contre nous, et ne faisons rien du langage si ce n'est : le corrompre, le brûler, sans discontinuité altérer ce pour quoi il est fait.
Nous ne sommes pas capables — veulerie, sabotages, pleutres, bouffons, narcisses — de faire qu'une parole soit un acte.
Nous avons dévoyé la langue, nous l'avons salopée : Nous, massacreurs du langage, nous nous baisons tous d'abord par la bouche, d'abord par la bouche oui : de bouche à bouche, nous nous dévorons de la langue.
[...]
Édith Azam, Devant la porte, un paillasson : la parole..., dans Action Poétique, n° 204, juin 2011, p. 69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, devant la porte un paillasson : la parole | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2011
James Sacré, D'autres vanités d'écriture
À propos du lyrisme
 Le lyrisme : ou l’histoire de la poésie à travers des confusions de formes et de thèmes. Déjà Pindare fait courir l’homme plutôt que les héros au rythme de ses grandes odes. Horace un peu plus tard mesure les siennes aux dimensions familières du quotidien. Une fois les dieux disparus et quelques solides valeurs métaphysiques-morales éboulées, la poésie épique ne sait plus très bien qui elle est et s’habille d’un nouveau nom : poésie lyrique. Ronsard un instant ne s’y retrouve plus et cherche des repères, il veut par exemple réduire le lyrisme à l’exploitation de quelque thèmes ; mais le voilà qui chante l’amour le plus humain en décasyllabes aussi bien qu’en alexandrins, et la fureur divine l’anime autant sinon plus dans ses sonnets que dans la Franciade. Du Bellay comprend bien qu’il n’y a jamais eu qu’une opposition factice entre les vers épiques et les vers lyriques, que ce n’était qu’une affaire de sujet et de conventions formelles jamais bien respectées, et que la fureur divine n’est en somme que la sublimation d’une mélancolie plus qu’humaine. Le dix-septième siècle s’accroche au mot « sublime », mais Boileau s’empêtre en des « je ne sais quoi » et des va-et-vient ambigus (à propos des formes autant que des thèmes) où l’épique se démêle mal du lyrisme. Puis le « véritable » épique se trouve rapporté à un problématique originel commerce des hommes avec Dieu : toute la poésie avec lui d’ailleurs, ce qui embrouille un peu plus les choses. « L’enthousiasme » de Mme de Staël installe enfin l’épique, et la poésie tout aussi bien, en plein mystère du moi. Dans le même temps le mot lyrisme prend place au cœur de toute écriture poétique. Désormais poètes et poèmes se perdent (ou croient se retrouver) en d’inépuisables abandons ou résistances au moi : plongées dans le rêve ou le subconscient, dans le silence ou le bruit du langage (mais comment ne pas y entendre toujours un semblant de cœur qui bat, désespérément magnifique ou dérisoire ?), ou désir d’une impossible objectivité devenant le monde. De toutes façons c’est toujours, autour d’un moi aussi insaisissable que les anciens dieux, la même impression d’un silence vivant mêlé à la magnifique insignifiance des mots.
Le lyrisme : ou l’histoire de la poésie à travers des confusions de formes et de thèmes. Déjà Pindare fait courir l’homme plutôt que les héros au rythme de ses grandes odes. Horace un peu plus tard mesure les siennes aux dimensions familières du quotidien. Une fois les dieux disparus et quelques solides valeurs métaphysiques-morales éboulées, la poésie épique ne sait plus très bien qui elle est et s’habille d’un nouveau nom : poésie lyrique. Ronsard un instant ne s’y retrouve plus et cherche des repères, il veut par exemple réduire le lyrisme à l’exploitation de quelque thèmes ; mais le voilà qui chante l’amour le plus humain en décasyllabes aussi bien qu’en alexandrins, et la fureur divine l’anime autant sinon plus dans ses sonnets que dans la Franciade. Du Bellay comprend bien qu’il n’y a jamais eu qu’une opposition factice entre les vers épiques et les vers lyriques, que ce n’était qu’une affaire de sujet et de conventions formelles jamais bien respectées, et que la fureur divine n’est en somme que la sublimation d’une mélancolie plus qu’humaine. Le dix-septième siècle s’accroche au mot « sublime », mais Boileau s’empêtre en des « je ne sais quoi » et des va-et-vient ambigus (à propos des formes autant que des thèmes) où l’épique se démêle mal du lyrisme. Puis le « véritable » épique se trouve rapporté à un problématique originel commerce des hommes avec Dieu : toute la poésie avec lui d’ailleurs, ce qui embrouille un peu plus les choses. « L’enthousiasme » de Mme de Staël installe enfin l’épique, et la poésie tout aussi bien, en plein mystère du moi. Dans le même temps le mot lyrisme prend place au cœur de toute écriture poétique. Désormais poètes et poèmes se perdent (ou croient se retrouver) en d’inépuisables abandons ou résistances au moi : plongées dans le rêve ou le subconscient, dans le silence ou le bruit du langage (mais comment ne pas y entendre toujours un semblant de cœur qui bat, désespérément magnifique ou dérisoire ?), ou désir d’une impossible objectivité devenant le monde. De toutes façons c’est toujours, autour d’un moi aussi insaisissable que les anciens dieux, la même impression d’un silence vivant mêlé à la magnifique insignifiance des mots.
James Sacré, D’autres vanités d’écriture, éditions Tarabuste, 2008, p. 91-92.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, d'autres vanités d'écriture, lyrisme, ronsard, du belly | ![]() Facebook |
Facebook |
25/10/2011
Patrick Beurard-Valdoye, Amour en cage

Amour en cage
La parole volante était proscrite
qu’était prison sans parloir ?
dans ses moment perdus l’Europe est une prison
juste un chiriklo qui tend l’espace et le clôt
en effet les tsiganes volaient des poules parfois des enfants ils étaient même des voleurs de langue empruntant où ils passaient des mots et sans les rendre allant jusqu’à corrompre leur sens les savants réputés considéraient l’idiome tsigane comme fait d’éléments de bric et de broc volés aux langues pures l’emprunt étant souvent et explicitement interprété en termes de perte de l’identité linguistique et si l’on avait interdit l’usage de ces mots détournés qu’auraient-ils donc eu à dire à se taire ? aussi les instituteurs faisaient-ils payer une couronne aux garçons surpris parlant le romani les filles on leur rasait la tête.
quant aux gitanes autant jeteuses de sorts que voleuses d’hommes on se souvenait justement de cette affaire du paysan Janik disparu avec la tsigane sans laisser d’autre trace qu’un journal intime versifié publié en feuilleton valache dans le morave Lidové Noviny
le parti agraire prêtait désormais l’oreille aux pétitions paysannes et la loi du 14 juillet combattant la peste tsigane obligeait les nomades et tous mauvestis se livrant à ce mode de vie à se déclarer pour obtenir l’indispensable carnet anthropométrique — la CIKÁNSKÁ LEGITIMACE — avec empreinte des dix doigts mention de noms et surnoms — mais le prénom romani que la mère souffle une seule fois à son nourrisson, l’administration ne l’aurait jamais — et tout détail hauteur poids visage cheveux barbe yeux front menton nez lèvres dents suivi de dix-neuf pages destinées aux observations particulières (à la rubrique profession de ces illettrés qui n’en avaient pas vraiment, le fonctionnaire écrivait TSIGANE) des panneaux d’interdiction fleurissaient accrochés aux branches des êtres ou chênes vénérables parce que les tsiganes illettrés savaient tout de même lire dans l’essence et l’écorce d’un des vingt-quatre hommes-arbres.
Patrick Beurard-Valdoye, Amour en cage, extrait de Gadjo-Migrandt (à paraître), publié dans L’étrangère, n° 26-27, 2011, p. 55-56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick beurard-valdoye, amour en cage, tsigane | ![]() Facebook |
Facebook |
12/10/2011
Louis Zukofsky, Un objectif & deux autres essais, traduction Pierre Alféri
 On a toujours trouvé la poésie plus littéraire que la musique, mais la prétendue musique pure, en tant que communication, peut être littéraire. Les voix d’une fugue, disait Bach, doivent se comporter comme des hommes raisonnables dans une conversation sérieuse. Pourtant, la musique ne dépend pas principalement, comme la poésie, d’une voix humaine qui sache la rendre. Et l’imagination peut dépouiller la parole de tout élément graphique pour qu’elle devienne un pur mouvement sonore. C’est en vertu de cet horizon musical de la poésie (jamais atteint, sans doute, par les poèmes) que n’importe qui peut écouter la poésie d’Homère sans connaître le grec et en tirer quelque chose ; se mettre « sur la même longueur d’onde » que la tradition humaine, que sa voix mûrie parmi les sons de la nature, et ainsi échapper à l’emprise d’une époque et d’un lieu comme on n’a guère de chance d’y échapper en étudiant la grammaire homérique. En ce sens, la poésie est internationale.
On a toujours trouvé la poésie plus littéraire que la musique, mais la prétendue musique pure, en tant que communication, peut être littéraire. Les voix d’une fugue, disait Bach, doivent se comporter comme des hommes raisonnables dans une conversation sérieuse. Pourtant, la musique ne dépend pas principalement, comme la poésie, d’une voix humaine qui sache la rendre. Et l’imagination peut dépouiller la parole de tout élément graphique pour qu’elle devienne un pur mouvement sonore. C’est en vertu de cet horizon musical de la poésie (jamais atteint, sans doute, par les poèmes) que n’importe qui peut écouter la poésie d’Homère sans connaître le grec et en tirer quelque chose ; se mettre « sur la même longueur d’onde » que la tradition humaine, que sa voix mûrie parmi les sons de la nature, et ainsi échapper à l’emprise d’une époque et d’un lieu comme on n’a guère de chance d’y échapper en étudiant la grammaire homérique. En ce sens, la poésie est internationale.
Si quelque chose a un sens, la poésie a le sens de tout. Ce qui veut dire : sans elle, la vie n’aurait guère de présent. Écrire des poèmes ne suffit pas s’ils ne gardent pas la vie enfuie. Écrire des poèmes semble toujours insuffisant quand ils parlent d’une vie enfuie. Le poète peut cesser visiblement d’écrire, mais il se mesure secrètement à chaque mot de poésie jamais écrit. S’il est d’une profondeur constante, il pense, en outre, à ceux qui ont vécu, vivent et vivront pour dire les choses qu’il ne peut dire. Qui fait cela travaille sans cesse et ne craint pas de paraître oisif. L’effort de poésie se reconnaît, tranchant sur la plupart des textes au goût du jour, malgré l’habit et les retards des poètes. La poésie n’a pas tel visage aujourd’hui pour faire mauvaise figure demain. On trahit une pensée bien courte en disant que la poésie s’oppose — parce qu’elle ajoute — à la science. La poésie s’explique sur-le-champ, sauf aux paresseux et aux insensibles.
Louis Zukofsky, Un Objectif & deux autres essais, traduit de l’américain par Pierre Alféri, Un Bureau sur l’Atlantique / Éditions Royaumont, 1989, p. 47-48 et 26-27.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis zukofsky, pierre alféri, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |





