09/09/2011
Giorgio Manganelli, Discours de l'ombre et du blason
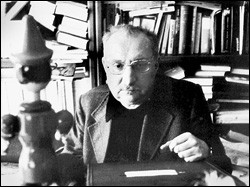 Un écrivain ne cesse jamais d’écrire, jamais ne cesse de lire ; un lecteur jamais ne cesse de lire, jamais ne cesse d’écrire. Les mots ignorent les hiatus, lacunes, haltes, parkings, sommeils ; leur magie n’a pas de cesse, le miracle est la règle, la continuité le prodige, le chaos est un ordre, la fureur une paix, la nuit étincelle, le jour est peuplé des images du rêve. Les mots parlent, les mots n’ont rien à dire, donc ils parlent. Aucune horloge ne scande leur temps, aucune loi ne les emprisonne, aucune prohibition ne les concerne. Aucun désir ne les retient. Vous avez lu : la littérature a tué la nature. Vous auriez dû lire : la parole a, dans le même instant, créé et tué la nature ; avant la parole, il n’y avait pas de nature, et le big bang ne fut rien d’autre que l’explosion d’un dictionnaire. Avoir affaire aux mots est une condition sans remède ; ils exercent sur nous avec indifférence un chantage qui n’admet aucun compromis, et toute concession accroît leurs exigences, et nos tortures. Soyons clairs : je ne parle pas d’exigence de perfection ; ni de style. On ne peut pas perfectionner ses rêves, mais on peut perfectionner sa dépendance à l’égard des rêves, se faire oniromane, s’intoxiquer de logos, de words, words, words, et en ce sens il est facile d’atteindre à l’extrême imperfection, de se dégrader, de se dégrader absolument devant la parole. La dégradation est nécessaire. Je suis désolé, mais je ne peux en distinguer personne, même pas les pères de famille. Un coup de téléphone m’a interrompu. J’aurais pu ne pas répondre, mais voyez-vous, la seule éventualité qu’il y ait des mots — au sens que l’on a dit — m’entraîne au vice. Je devrais dire maintenant : où en étions-nous restés ? Mais je sais aussi qu’il n’y a aucun lieu où rester ; tout lieu est structurellement identique à tout autre ; où que j’aille, je suis « ici ». L’ « ici » me possède, il te possède, tu n’as aucun moyen de t’en libérer, il ne t’est même ni permis ni possible de vouloir t’en libérer. Rien ne rassure davantage que la dégradation. Horrible est le moment où notre dignité se redresse en censeur des mots ; les mots alors se dispersent en riant ; et nous ne distinguons plus le double de la parole. Le double se joue de nous, se déguise en parole. Notre dignité ne cesse de s’accroître au contact de la parole, parole feinte qu’il suffirait de mettre devant un miroir, ou d’exposer à la violente lumière de midi ; car le double n’a pas d’image dans le miroir, et ne donne pas d’ombre ; c’est en cela probablement que le miroir fait allusion au blason.
Un écrivain ne cesse jamais d’écrire, jamais ne cesse de lire ; un lecteur jamais ne cesse de lire, jamais ne cesse d’écrire. Les mots ignorent les hiatus, lacunes, haltes, parkings, sommeils ; leur magie n’a pas de cesse, le miracle est la règle, la continuité le prodige, le chaos est un ordre, la fureur une paix, la nuit étincelle, le jour est peuplé des images du rêve. Les mots parlent, les mots n’ont rien à dire, donc ils parlent. Aucune horloge ne scande leur temps, aucune loi ne les emprisonne, aucune prohibition ne les concerne. Aucun désir ne les retient. Vous avez lu : la littérature a tué la nature. Vous auriez dû lire : la parole a, dans le même instant, créé et tué la nature ; avant la parole, il n’y avait pas de nature, et le big bang ne fut rien d’autre que l’explosion d’un dictionnaire. Avoir affaire aux mots est une condition sans remède ; ils exercent sur nous avec indifférence un chantage qui n’admet aucun compromis, et toute concession accroît leurs exigences, et nos tortures. Soyons clairs : je ne parle pas d’exigence de perfection ; ni de style. On ne peut pas perfectionner ses rêves, mais on peut perfectionner sa dépendance à l’égard des rêves, se faire oniromane, s’intoxiquer de logos, de words, words, words, et en ce sens il est facile d’atteindre à l’extrême imperfection, de se dégrader, de se dégrader absolument devant la parole. La dégradation est nécessaire. Je suis désolé, mais je ne peux en distinguer personne, même pas les pères de famille. Un coup de téléphone m’a interrompu. J’aurais pu ne pas répondre, mais voyez-vous, la seule éventualité qu’il y ait des mots — au sens que l’on a dit — m’entraîne au vice. Je devrais dire maintenant : où en étions-nous restés ? Mais je sais aussi qu’il n’y a aucun lieu où rester ; tout lieu est structurellement identique à tout autre ; où que j’aille, je suis « ici ». L’ « ici » me possède, il te possède, tu n’as aucun moyen de t’en libérer, il ne t’est même ni permis ni possible de vouloir t’en libérer. Rien ne rassure davantage que la dégradation. Horrible est le moment où notre dignité se redresse en censeur des mots ; les mots alors se dispersent en riant ; et nous ne distinguons plus le double de la parole. Le double se joue de nous, se déguise en parole. Notre dignité ne cesse de s’accroître au contact de la parole, parole feinte qu’il suffirait de mettre devant un miroir, ou d’exposer à la violente lumière de midi ; car le double n’a pas d’image dans le miroir, et ne donne pas d’ombre ; c’est en cela probablement que le miroir fait allusion au blason.
Les anciens savaient que chaque mot a un double, et que ce double a un destin qui n’est pas celui du mot. Écho est le double de la parole, qui témoigne pour elle quand elle a passé outre. Ce que nous lisons, écoutons, pensons, est parole, mais ce qui reste en nous est le double sous la forme d’Écho, c’est l’image de la parole « reflétée », mais le reflet n’a pas de reflet. Dans cette triste et gracieuse histoire, Écho se prend d’amour — « Je me suis désespérément prise d’amour » — pour Narcisse, lui-même amoureux, non pas de son double, mais de son image renversée. Il s’ensuit que c’est l’Écho qui permet à la parole de demeurer ininterrompue, car si elle n’avait pas ce double à sa disposition elle finirait par tomber, comme Narcisse, dans un amour spéculaire, porteur de mort comme le sont toutes les tentatives qu’on fait pour se posséder soi-même.
[…]
Giorgio Manganelli, Discours de l’ombre et du blason, ou du lecteur et de l’écrivain considérés comme déments, traduit de l’italien par Danièle Van de Velde, Fiction & Cie, éditions du Seuil, 1987, p. 122-124.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio manganelli, discours de l'ombre et du blason, rêve, écrire, lire | ![]() Facebook |
Facebook |
05/09/2011
Antonin Artaud, L'Anarchie sociale de l'art, Le Théâtre de la cruauté

Et les sentiments universels, éternels d’André Chénier, s’il les a éprouvés, étaient ni tellement universels ni tellement éternels qu’ils puissent justifier son existence à une époque où l’éternel s’effaçait derrière un particulier aux préoccupations innombrables. L’art, justement, doit s’emparer des préoccupations particulières et les hausser au niveau d’une émotion capable de dominer le temps.
Or tous les artistes ne sont pas en mesure de parvenir à cette sorte d’identification magique de leurs propres sentiments avec les fureurs collectives de l’homme.
Et toutes les époques ne sont pas en mesure d’apprécier l’importance sociale de l’artiste et cette fonction de sauvegarde qu’il exerce au profit du bien collectif.
Antonin Artaud, L’Anarchie sociale de l’art, dans Œuvres complètes, tome VIII, Gallimard, 1971 et 1980, p. 233.
POST-SCRIPTUM
Qui suis-je ?
D’où je viens ?
Je suis Antonin Artaud
et que je le dise
comme je sais le dire
immédiatement
vous verrez mon corps actuel
voler en éclats
et se ramasser
sous dix mille aspects
notoires
un corps neuf
où vous ne pourrez
plus jamais m’oublier
Antonin Artaud, Le Théâtre de la cruauté, dans Œuvres complètes, tome XIII, Gallimard, 1974, p. 118.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, andré chénier, anarchie de l'art, théâtre de la cruauté | ![]() Facebook |
Facebook |
20/08/2011
Bernard Noël, Les Plumes d'Éros
L’enfer, dit-on
 Le sexe nous lie à l’espèce. Il est en nous son instrument. Ainsi, il mine notre particularité là même où nous croyons l’éprouver le plus vivement : chacun est unique en son corps ; chacun est semblable à tous par l’emportement sexuel. Nous voulons être unique dans ce qui est notre expression la moins individuelle mais que nous tâchons de faire nôtre en greffant de la langue sur la sexualité. Le mouvement des mots se mêle alors aux tressaillements de l’espèce et nous fait rêver d’un orgasme durable. Le désir se couvre d’amour et l’espèce devient une origine perdue derrière l’horizon.
Le sexe nous lie à l’espèce. Il est en nous son instrument. Ainsi, il mine notre particularité là même où nous croyons l’éprouver le plus vivement : chacun est unique en son corps ; chacun est semblable à tous par l’emportement sexuel. Nous voulons être unique dans ce qui est notre expression la moins individuelle mais que nous tâchons de faire nôtre en greffant de la langue sur la sexualité. Le mouvement des mots se mêle alors aux tressaillements de l’espèce et nous fait rêver d’un orgasme durable. Le désir se couvre d’amour et l’espèce devient une origine perdue derrière l’horizon.
Entre le corps et le sexe, quelque chose est advenu qui rejoue radicalement la vieille interprétation mécaniste ; cette fois, plus de métaphysique, ce n’est plus l’esprit qui nous traverse ou nous habite, c’est un élan dont nous détournons le sens. S’il vient à s’éclairer, au fond de nous le plus ancien des dieux remue : un dieu dont tous les dieux suivants ont fait notre démon.
L’espèce est la partie la plus vêtue de nous-même : toute la langue s’est enroulée sur elle pour la dissimuler. Le dieu archaïque a pris le visage d’Éros. Le sexe est devenu une idée, à moins qu’il ne soit un morceau.
L’attribut le plus naturel ne fonctionne donc plus si naturellement : il en est la représentation, il est devenu un sujet. En lui, l’organique a cédé la place à l’illusoire, si bien qu’il est un mensonge capable de dire la vérité que nous souhaitons entendre. Nous parlons encore de « possession » : nous ne possédons qu’une ombre.
Tout cela pour avancer contradictoirement vers un désir contradictoire, puisqu’il nous tire autant vers nous que hors de nous. Longtemps le partage s’est fait par référence à un mal et à un bien, mais il fallait y croire sans aucun doute. Devant le ciel vide et les idées mortes, les choses devraient revenir à leur réalité. Elles s’en gardent — ou nous les en gardons — car elles continuent à disparaître derrière les signes qu’elles nous font. Nommer est une magie décevante, qui convoque le tout et ne fait apparaître que le rien.
[…]
Bernard Noël, L’enfer, dit-on, dans Les Plumes d’Éros, Œuvres I, P. O. L, 2010, p. 315-316.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
15/08/2011
Pierre Bergounioux, Le miroir brisé

À compter de la fin du deuxième tiers du XIXe siècle, le genre romanesque est périmé comme le furent, avant lui, la tragédie, la poésie didactique, l’oraison funèbre. À cela, il y a deux raisons, l’une substantielle, l’autre formelle.
Lorsque les Trois Glorieuses abrègent le blême intermède de la Restauration et que la bourgeoisie d’affaires prend directement en mains l’initiative politique, il n’existe pas de langage spécialisé qui ferait écho à ce qui se passe alors, développement de l’industrie au détriment de la terre, domination d’une nouvelle classe, urbaine, après l’éviction de la vieille noblesse rurale. Un genre mineur, sans règles, rédigé en langue vulgaire et non pas en latin, est disponible, dans un coin. C’est une forme à peine élaborée, allongée, du récit, cette aptitude anthropologique qui n’est que la récurrence indéfinie de la structure de base du langage, la phrase. Celle-ci se ramène à un même binôme, à l’association d’un signe d’espace et d’un autre de temps, d’un nom et d’un verbe, selon la grammaire. Quelqu’un fait quelque chose.
C’est au moyen de cet instrument rudimentaire que des hommes incertains mais corpulents, énergiques, vont rendre compte, avec une pénétration admirable, une ironie mordante et, pour finir, mortelle, de la reconfiguration de la société révolutionnée. En à peine plus de trois décennies, ils ont pesé, jugé, condamné. Rien ne vaut la peine, que la littérature en tant qu’elle établit que rien ne vaut la peine, et d’abord l’axiome fondateur du vouloir pratique, qui est « la maximisation des chances pacifiques de gain pécuniaire ». Tout est dit. Et les ingénus, les tièdes qui n’auraient pas compris qu’une nouvelle injustice a supplanté la vieille injustice, qu’au coupleimmémorial, ennemi, que composaient le propriétaire foncier et l’esclave puis le manant, s’est substitué celui du capitaliste et du prolétaire, ces ingénus, ces attardés seraient bien incapables d’avancer quoi que ce soit qui vaille après que Flaubert s’est assis sur le « banc d’infamie ».
Il ne se passe rien d’autre, dorénavant, que la répétition sans attrait ni équité ni surprise (en principe) du cycle argent-marchandise-argent. Ça, c’est pour le fond. Mais, du côté de la forme, les choses ont singulièrement changé. L’Allemagne, qui peine à sortir de son morcellement féodal, à rejoindre, sur la scène du monde, les deux États-nations qui se disputent depuis trois siècles le premier rôle, l’Allemagne, on l’a dit, pense à proportion de l’impuissance physique à laquelle elle se trouve réduite. Dès 1848, un philosophe rhénan de trente ans, d’origine juive, formé à l’école hégélienne, rédige d’une main décidée, un Manifeste dont l’écho de tonnerre remplira le siècle et demi qui suit. La destruction violente de la société dont les grands romanciers français ont livré la description vivante est à l’ordre du jour, ses fossoyeurs nommément convoqués — « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »
Pareilles déclarations ne sauraient être prises à la légère par l’adversaire. Il lui faut répondre, justifier la domination bureaucratique-légale qui garantit ses intérêts, opposer des raisons au projet révolutionnaire hautement rationnel sorti du cerveau du jeune Marx. Et c’est le deuxième discours qui vient flanquer, sur sa droite, après la théorie matérialiste de l’histoire, sur sa gauche, le langage romanesque. Auguste Comte, déjà, mais Spencer et surtout Durkheim, Max Weber jettent les fondements de la science sociale. Ils appliquent aux choses humaines les rigoureux principes auxquels les savants ont soumis, depuis la Renaissance, les trois règnes et les quatre éléments. Ils adoptent l’attitude de neutralité axiologique qui conditionne l’accès à la réalité objective, enquêtent, mobilisent les ressources de l’analyse statistique, accèdent à des vérités qui disqualifient la sociologie spontanée, sauvage que possède, implicitement, tout agent social et qu’explicitent, sans y voir malice, les romanciers. L’éclat d’un contre-projet politique sérieux, d’un côté, la genèse d’une interprétation rigoureuse des faits sociaux, de l’autre, privent le roman, dès le milieu du XIXesiècle, de la vertu révélatrice que lui avaient conférée les romanciers français. Zola, venu trop tard, procède mécaniquement à un inventaire qui n’établit plus rien quon ne sache déjà.
[…]
Pierre Bergounioux, Un Miroir brisé, dans La Nouvelle Revue Française, "Le roman du XXe siècle", sous la direction de Jean Rouaud, n° 596, février 2011, p. 31-33.
© Photo Chantal Tanet, 2006.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre bergounioux, le miroir brisé, le roman, matérialisme | ![]() Facebook |
Facebook |
27/07/2011
René Crevel, Le Clavecin de Diderot
 Pour la France officielle la poésie c’est, avant tout, un jeu, un exercice d’éloquence. Et il ne s’agit même plus de la faconde méridionale. Le soleil, l’ail, l’accent, le mélange de sperme, de coquillage secret et de fruits trop mûrs, dont se trouve naturellement parfumée toute vieille cité phocéenne, voilà qui a été corrigé par la tristesse septentrionale.
Pour la France officielle la poésie c’est, avant tout, un jeu, un exercice d’éloquence. Et il ne s’agit même plus de la faconde méridionale. Le soleil, l’ail, l’accent, le mélange de sperme, de coquillage secret et de fruits trop mûrs, dont se trouve naturellement parfumée toute vieille cité phocéenne, voilà qui a été corrigé par la tristesse septentrionale.
Langue d’oc et langue d’oïl, l’une en l’autre fondue, et, l’Europe a eu sa langue diplomatique. Quant aux autochtones, ils se sont consacrés au culte d’un verbalisme décoloré. De Racine (Andromaque, le fameux discours à Pyrrhus : avant que tous les Grecs vous parlent par ma voix) à Lamartine (la phrase sur le drapeau tricolore qui a fait le tour du monde et le drapeau rouge qui n’a fait que le tour du champ de Mars), les leçons que reçoivent, de leurs grands ou petits maîtres, à propos de textes rimés, lycéens et étudiants, ne sont que leçons de ruses oratoires.
Quant à la connaissance intime et générale de l’homme, certains ne font profession de lui vouer leurs travaux, leurs existences qu’à seule fin de lui dénier, de l’intérieur, toute chance de progrès.
En vérité, depuis des siècles, on se contente de répéter les mêmes expériences et considérations sur certains réflexes à fleur de peau, avec une volonté d’agnosticisme ou, au moins, le désir de conclure qu’il n’y a rien de changé sous le soleil. Et que se produise, quelque part, ce changement dont ne veulent pas les classes favorisées, elles crieront à la monstruosité. De toute source, il faut, sur le champ, faire une eau de table, et, si le geyser ne veut se laisser mettre en bouteille, qu’on l’écrase des plus lourdes pierres. Ainsi, un égocentrisme à courtes vues décide les individus à l’individualisme, les nations au nationalisme.
René Crevel, Le Clavecin de Diderot, 1932, présentation de Claude Courtot, collection Libertés, n° 38, Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1966, p. 51-52.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené creve, le clavecin de diderot, poésie, individualisme | ![]() Facebook |
Facebook |
24/07/2011
Paul Claudel, Dodoitzu

Aile étrange du poème ! Quand une fois la chanson a pris l’essor, une fois le sol natal abandonné, qui dira quelles rides, quels reflets, elle est appelée à éveiller sur des miroirs inattendus, quelle inspiration elle fournira à l’écho, quelles variations sur un distant rivage elle proposera à l’oreille attentive de l’oiseau-moqueur ? Ainsi là-bas sous le Soleil levant, sous les pieds du paysan attelé à sa noriah, sous l’effort du marin qui hisse la voile, dans le tapage rythmique du lourd maillet qui décortique le riz, ou le balancement songeur de la jeune mère (son pied chaussé de la courte chaussette blanche, ah ! plus que le berceau, c’est le cœur battant du tendre petit bébé qui lui communique sa pulsation !) il naît une mélopée à laquelle viennent s’adapter comme d’elles-mêmes d’humbles paroles. Du bourdonnement naïf est né le dodoitZu, frère rustique, mais à mon avis bien plus savoureux, du savant uta. Quelques lignes, quelques vers à la mesure d’un gosier d’oiseau ou d’une élytre de cigale. Un amateur local les a écoutés et transcrits, de la musique native il ne reste plus que le résidu verbal. À son tour un étranger, en l’espèce : Georges Bonneau, professeur à l’Institut français de Kyotô, s’y est intéressé. Il les traduit, il en fait un recueil. Et ce recueil tombe sous les yeux d’un vieux poète qui a fait de longs séjours là-bas, dans le pays de la Sérénité matinale. Voici que peu à peu, dans sa chambre intérieure, à l’accent rétorqué du chantre primitif, s’anime un pied correspondant. Quelque chose de neuf à la fois et de provoqué. Le sentiment retourne à sa source lointaine sous la forme de nostalgie.

Ma figure dans le puits
Ma figure dans le puits
Pas moyen que je me l’ôte
Ma figure dans le puits
Pas moyen que je me l’ôte
Et que j’en mette une autre
Et si l’on me trouve jolie
Tant pis ! C’est pas ma faute !
Her face in the well
My face in the well
I cannot take it out
My face in the well
I cannot take it off
And if you think I’m pretty
It’s really not ma fault !
Le crapaud
Quand j’entends dans l’eau
Chanter le crapaud
Des choses passées
J’ai le cœur mouillé !
Nightingale and toad
When I hear in the cool
Gold of the moonlight pool
The nightingale singing,
It is my heart ringing.
Paul Claudel, Dodoitzu, peintures de Rihakou Harada, Gallimard, 1945, non paginé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, dodoitzu, figure dans le puits, crapaud, personne | ![]() Facebook |
Facebook |
22/07/2011
Pierre Michon, Le roi vient quand il veut
Si les hommes étaient faits d'étoffe indémaillable, nous ne raconterions pas d'histoire, n'est-ce pas ?
Pierre Michon, Les Onze (Verdier, 2009)
Contemporain de la légende
Pourquoi le mot vie dans vos titres, des « minuscules » à celle de Joseph Roulin ?
 Les Vies sont une longue tradition, on en a raconté pendant des siècles. C’étaient d’assez courts récits, non pas véristes et affectant le naturel (« la vie même ») comme nos biographies, mais faisant la part belle au légendaire, aux distorsions de la mémoire, aux interventions de l’au-delà. Les vies qu’on prenait la peine d’écrire étaient nécessairement surnaturelles : elles ne valaient que par un point de tangence avec le divin qui les transportaient hors du commun. Les Vies des douze Césars, après tout, nous entretiennent de monstres que leur mort a transformé en dieux, comme il arrivait aux empereurs de Rome ; les Vies des hommes illustres de Plutarque, les Vies des philosophes illustres de Diogène Laërce traitent de fondateurs quasi légendaires, de miracles guerriers ou mathématiques s’incarnant dans des hommes fortuits.
Les Vies sont une longue tradition, on en a raconté pendant des siècles. C’étaient d’assez courts récits, non pas véristes et affectant le naturel (« la vie même ») comme nos biographies, mais faisant la part belle au légendaire, aux distorsions de la mémoire, aux interventions de l’au-delà. Les vies qu’on prenait la peine d’écrire étaient nécessairement surnaturelles : elles ne valaient que par un point de tangence avec le divin qui les transportaient hors du commun. Les Vies des douze Césars, après tout, nous entretiennent de monstres que leur mort a transformé en dieux, comme il arrivait aux empereurs de Rome ; les Vies des hommes illustres de Plutarque, les Vies des philosophes illustres de Diogène Laërce traitent de fondateurs quasi légendaires, de miracles guerriers ou mathématiques s’incarnant dans des hommes fortuits.
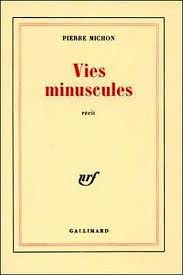 Ce trait est encore plus patent dans les hagiographies chrétiennes, où c’est le surnaturel seul qui tient debout des existences dont la spécificité biographique est négligeable. Les Vies de saints, innombrables et superposables, délivrent le récit de toute contingence, ne s’intéressent qu’à la vie intérieure, qui n’a pas eu de témoins, ou aux lévitations et extases dans lesquelles c’est Dieu même qui s’essaie dans un corps désormais inessentiel : on est loin de la passion de la contingence, de la chasse au petit fait vrai, de la postulation a priori d’une individualité spécifique et inaliénable — mais peut-être aussi fictive que les lévitations — qui caractérisent la biographie.
Ce trait est encore plus patent dans les hagiographies chrétiennes, où c’est le surnaturel seul qui tient debout des existences dont la spécificité biographique est négligeable. Les Vies de saints, innombrables et superposables, délivrent le récit de toute contingence, ne s’intéressent qu’à la vie intérieure, qui n’a pas eu de témoins, ou aux lévitations et extases dans lesquelles c’est Dieu même qui s’essaie dans un corps désormais inessentiel : on est loin de la passion de la contingence, de la chasse au petit fait vrai, de la postulation a priori d’une individualité spécifique et inaliénable — mais peut-être aussi fictive que les lévitations — qui caractérisent la biographie.
Ce très vieux genre a secrètement survécu à sa laïcisation en roman, récit ou nouvelle. Car les modernes aussi ont écrit des vies, en annonçant clairement cette intention dans leurs titres, de façon parfois traditionnelle (la Vie de Rancé), mais le plus souvent nostalgique ou parodique, en tout cas référée : les Vies imaginaires de Schwob, la Vie de Samuel Belet de Ramuz, les Trois vies de G. Stein, ou même Une vie. Et il semble bien que ce qui demeure, dans ces récits explicitement nommés ou d’autres qui le sont moins (Un cœur simple, par exemple, qui est exactement une vie), c’est un sentiment très vacillant du sacré, balbutiant, timide ou désespéré, un sacré dont nul Dieu n’est plus garant : ce qui s’y joue sous les cieux vides, c’est ce qu’a de minimalement sacré tout passage individuel sur terre, plus déchirant aujourd’hui de ce qu’aucune compatibilité céleste n’en garde mémoire. Ces vies sont tangentes à l’absence de Dieu comme les hagiographies l’étaient à sa toute présence ; elles expérimentent le drame de la créature déchue en individu.
Barthes notait que l’anthropologie repose sur le postulat qu’ « il est profondément injuste qu’un homme puisse naître et mourir sans qu’on ait parlé de lui » ; cette injustice, l’anthropologie essaie de la réparer à sa façon, mais ça n’est pas interdit non plus à la littérature. C’est à cela, entre autres choses, que je me suis employé dans des vies.
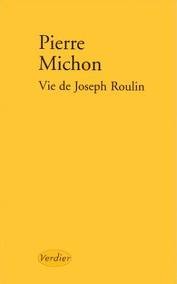 Et puis, je suis fasciné par ces titres dans lesquels ce qu’il y a de plus individuel, le nom propre, est mis en résonance avec le mot vie, qui est le plus universellement, et comme tautologiquement, partagé. « Untel a vécu », disent de tels titres ; ils ont la pauvreté fatale d’une stèle funéraire ; ils sont comme le blason de ce qu’on appelle le romanesque. Et bien sûr c’est la mort qui paradoxalement résonne dans de tels frontispices : certains auteurs l’ont souligné, qui, par antiphrase, ont appelé leurs vies : La Mort d’Ivan Illitch, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant1, etc.
Et puis, je suis fasciné par ces titres dans lesquels ce qu’il y a de plus individuel, le nom propre, est mis en résonance avec le mot vie, qui est le plus universellement, et comme tautologiquement, partagé. « Untel a vécu », disent de tels titres ; ils ont la pauvreté fatale d’une stèle funéraire ; ils sont comme le blason de ce qu’on appelle le romanesque. Et bien sûr c’est la mort qui paradoxalement résonne dans de tels frontispices : certains auteurs l’ont souligné, qui, par antiphrase, ont appelé leurs vies : La Mort d’Ivan Illitch, Les Derniers Jours d’Emmanuel Kant1, etc.
Pierre Michon, Le roi vient quand il veut, Propos sur la littérature, textes réunis et édités par Agnès Castiglione avec la participation de Pierre-Marc de Biasi, Albin Michel, 2007, p. 21-23. ["Contemporain de la légende" est composé de réponses à des questions, recueillies par T. H. et publiés dans Le Français aujourd’hui, « La nouvelle », septembre 1989]
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre michon, le roi vient quand il veut, vies, hagiographie | ![]() Facebook |
Facebook |
11/07/2011
Montesquieu, Pensées
 Dès qu’un homme pense, et qu’il a un caractère, on dit : « C’est un homme singulier ».
Dès qu’un homme pense, et qu’il a un caractère, on dit : « C’est un homme singulier ».
La plupart des gens se ressemblent en ce qu’ils ne pensent point : échos éternels, qui n’ont jamais rien dit et ont toujours répété ; artisans grossiers des idées des autres.
Il faut que la singularité consiste dans une manière fine de penser qui a échappé aux autres : car un homme qui ne saurait se distinguer que par une chaussure particulière serait un sot par tout pays.
Les pensées et les actions d’un homme singulier lui sont tellement propres qu’un autre homme ne pourrait jamais les employer sans se démentir.
Plaire dans une conversation vaine et frivole est aujourd’hui le seul mérite. Pour cela, le magistrat abandonne l’étude de ses lois. Le médecin croirait être discrédité par l'étude de la médecine. On fuit, comme pernicieuse, toute étude qui pourrait ôter le badinage.
Rire sur rien et porter d’une maison à l’aure une chose frivole s’appelle science du monde, et on craindrait de perdre celle-ci si on s’appliquait à une autre.
Ôtez des conversations continuelles le détail de quelque grossesse ou de quelque accouchement ; celui des femmes qui étaient ce jour-là au Cours ou à l’Opéra ; quelque nouvelle portée de Versailles, que le Prince a fait ce jour-là ce qu’il fait tous les jours de sa vie ; quelque changement dans les intérêts d’une cinquantaine de femmes d’une certaine façon, qui se donnent, se troquent et se rendent une cinquantaine d’hommes, aussi d’une certaine façon : vous n’avez plus rien.
Je me souviens que j’eus autrefois la curiosité de compter combien de fois j’entendrais faire une petite histoire, qui ne méritait certainement d’être dite ni retenue pendant trois semaines qu’elle occupa le monde poli ; je l’entendis faire deux cents vingt-cinq fois ; dont je fus très content.
On ne veut pas qu’un fripon puisse devenir homme de bien, mais on veut bien qu’un homme de bien puisse devenir un fripon.
Montesquieu, Pensées, dans Pensées, Le Spicilège, édition établie par Louis Desgraves, Bouquins / Robert Laffont, 1991, p. 200, 211-212, 252.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : montesquieu, pensées, conformisme, mondanité | ![]() Facebook |
Facebook |
08/07/2011
Jean Bollack, préface à : Philippe Beck, Chants populaires, traduits en allemand
Les Chants populaires de Philippe Beck ont été traduits en allemand par Tim Trzaskalik et publiés avec une préface de Jean Bollack, inédite en français.

La poésie de Philippe Beck, que ce volume présente au public allemand, se distingue de toute autre — disons le mot : radicalement. On pourrait parler de licence, à condition d’associer au terme la plus grande distance, qu’elle existe, ou qu’on l’imagine face à la chose qui se dit ou que l’on écrit (ce qui ne va pas de soi). Le lecteur allemand retrouve dans ce recueil les contes réunis par les frères Grimm, d’après une traduction française, puis réécrits, retraduits, commentés, creusés, plus encore. Une trace du modèle y reste, l’auteur s’y rapporte dans la langue du poète : c’est dire qu’il s’en éloigne. Je conjecture qu’il nous parle en se parlant à lui-même, et en prenant possession de Grimm. Le récit ne sera plus le même, une fois retracé, reformulé, intégré dans un nouveau discours ; il est passé à autre chose, pour de vrai ou pour nous, pour le faire mieux comprendre, ou pas, tel autre.
Les contes sont devenus des poèmes, comme le montrent les titres, « Porte » ou « Bruit » ou « Faille », des thèmes recentrés, encore que Beck n’écrive pas proprement des poèmes, du moins comme on a pu les faire et refaire avant lui – et avant une coupure. L’unité de composition n’est plus là ni la fermeture, abolies, et pouvant ainsi ressurgir ailleurs dans la différence, d’une langue ou d’une matière ; elles seront simples ou plus complexes, avec, à l’horizon, l’énigme, et, repérables, les rencontres quotidiennes, la référence particulière, vécue.
Ce qui se dit se réfère ; c’est le plus souvent du dit, de l’avant-dit. Tout se redit, mais Beck s’est créé initialement une forme – un vers , si c’en est un, court et limitatif, qui scande à sa façon, se réduit aussi et se brise. Il prête au discours, mieux vaut dire aux mots et à leur substance sonore, un débit et un rythme qui se maintient, saccadé ou fluide. Il est hérité des anciennes épopées, françaises entre autres ; les ressources narratives, défaisant l’alexandrin, y jouent leur rôle. Dès le départ, quasi immémorial, un mouvement s’est enclenché ; il se poursuit, s’offre à l’avance à toutes les interventions à venir. Ancestral, le rythme et sa base créent une continuité essentielle ; elles ne sont pas moins proches, réinventées, adaptées à un nouvel état de la langue, épuisée et disponible, dépassable. Sur ce fond, en ce lieu primaire, riche de toutes les potentialités, une invention poétique vient s’inscrire en second ; elle s’y retrouve et s’actualise ; c’est comme si une poésie en acte depuis toujours, et comme telle préalable, se transformait en un réceptacle et empêchait tout déploiement verbal, contraignant à la rigueur d’un jugement.
La pensée, dans ce cadre, peut prétendre à une place, il ne lui faut que l’objet, la matière ; pour la façon de dire, elle n’est pas implicite ni accordée ; elle est comme préparée, je dirais, disponible. Ainsi, dans une autre geste, non moins large, dans un autre livre, Beck a choisi de lire les critiques et les réactions que l’œuvre de Mallarmé a pu susciter autour de lui, auprès de ses contemporains ; la reprise a pu en faire la matière, toujours dans le cadre continu décrit, d’une interrogation et inclure ainsi une relation critique dédoublée. Le poète peut y intervenir en tiers, introduisant par sa présence et sa réflexion une autre constante complémentaire de l’autre, à l’autre pôle.. Ainsi, pour les contes, on attend le retour de la voix off, qui dira ce qu’il en est, de l’écrit et de l’inscrit, comme elle le lit et l’entend. Le lecteur connaît le récit, ou mieux, il l’a relu, puis il découvre comme à neuf ce que le poète en fait. Il le redit multiplement, selon ses choix, retraduisant, ou commentant, ou approfondissant en s’emparant. Le défi est énorme.
Dans un passage de « Robe », d’après « La véritable fiancée », le château est le dernier degré des exigences exorbitantes de la marâtre. Fille est opposée à Ancienne (la vieille magicienne) ; elle rêve et bâtit dans les nuées. Le poète tend la corde de l’arc jusqu’aux extrêmes. Est-ce hors conte ?
« Parfois, tristes maçonnent des vapeurs »
La fille cède sa place. Ce sont les pierres qui construisent :
« Elles [les pierres ] sont le bâtiment des bâtiments ».
En creusant un dédoublement (tiré du polyptote sémantique), on perce jusqu’au principe — l’art, le faire — inhérent à la matière :
« Des mains ont manié des pierres ».
C’est, tiré d’un autre retour sur soi (« manier » se lit à travers la figure de la paronomase — une « étymologie » ; elle a pour fonction de dire vrai (de dire l’étymon). L’exemple est encastré dans un médaillon scintillant – il faudrait encore dire autrement : ce sont des « fleurs » que le texte porte à l’épanouissement. Un développement peut aussi bien être appelé dépouillement, cela se tient. Il se dessine au hasard, mais les hasards ne se comptent pas.
L’originalité n’est jamais première ; elle se situe, elle se démarque, se ménage des espaces propres, s’autonomise face à la référence. Elle invente ainsi sans inventer, et fait voir sans aucun paradoxe ce qu’elle trouve. Toujours on s’appuie, toujours on se libère, on découvre ce que c’est ou ce que cela pourrait être. On peut aussi (pensons à « Tour » d’après « Œillet ») lire les transpositions sans confronter. On saisit alors la force condensée de l’abstraction et la liberté d’une réduction.
Je me suis servi, en étudiant les poèmes de Celan, du terme de « réfection ». Le procédé que l’on trouve ici appartient à la même catégorie. La contradiction en moins peut-être. La reprise s’interprète différemment, selon les positions prises et les moments de l’histoire. Beck s’est construit une base initiale, presque avant d’avoir cherché, puis trouvé sa voie dans le monde de la lettre.
Jean Bollack, préface (en allemand) à : Philippe Beck, Populäre Gesänge, Matthes & Seitz, Berlin, 2011, traduction par Tim Trzaskalik de Chants populaires, Flammarion, 2007.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, jean bollack, chants populaires, traduction | ![]() Facebook |
Facebook |
03/07/2011
Pascal Quignard, La barque silencieuse
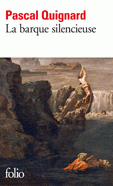
Le livre ouvre l’espace imaginaire, espace lui-même originaire, où chaque être singulier est réadressé à la contingence de sa source animale et à l’instinct indomesticable qui fait que les vivants se reproduisent.
Les livres peuvent être dangereux mais c’est la lecture surtout, par elle-même, qui présente tous les dangers.
Lire est une expérience qui transforme de fond en comble ceux qui vouent leur âme à la lecture. Il faut serrer les livres dans un coin car toujours les vrais livres sont contraires aux mœurs collectives. Celui qui lit vit seul son « autre monde », dans son « coin », dans l’angle de son mur. Et c’est ainsi que seul dans la cité le lecteur affronte physiquement, solitairement, dans le livre, l’abîme de la solitude antérieure où il vécut. Simplement, en tournant simplement les pages de son livre, il reconduit sans fin la déchirure (sexuelle, familiale, sociale) dont il provient.
Qu’est-ce qu’une autre vie sinon une autre intrigue linguistique ?
Le large existe.
Écrire déchire la compulsion de répétition du passé dans l’âme.
À quoi sert d’écrire ? À ne pas vivre mort.
Le large a inventé une place partout sur cette terre. Ce sont les livres. La lecture est ce qui élargit.
La mort est comme la langue. La mort est une machine à effacer des conditions de l’apparaître. La mort, comme la langue, apporte avec elle l’invisible. Plus encore, la mort apporte avec elle l’imprévisible. Matthieu XXV 13 : Nescitis diem neque horam. Vous ne savez ni le jour ni l’heure. La définition de la mort est le temps pur. L’homme, au fond de celui qui parle, n’est que le temps qui répond à la langue.
Pascal Quignard, La barque silencieuse, Folio/Gallimard 2011 [éditions du Seuil, 2009], p. 65, 102, 103, 103, 133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la barque silencieuse, le livre, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
17/06/2011
Pascal Quignard, La barque silencieuse, Petits traités
 J’aurais passé ma vie à chercher des mots qui me faisaient défaut. Qu’est-ce qu’un littéraire ? Celui pour qui les mots défaillent, bondissent, fuient, perdent sens. Ils tremblent toujours un peu sous la forme étrange qu’ils finissent pourtant par habiter. Ils ne disent ni ne cachent : ils font signe sans repos. Un jour que je cherchais dans le dictionnaire Bloch et Wartburg l’origine du mot de corbillard je découvris un coche d’eau qui transportait des nourrissons. Je me rendis le lendemain à la Bibliothèque nationale qui se trouvait alors rue de Richelieu, dans le IIe arrondissement de Paris, dans l’ancien palais qu’occupait jadis le cardinal Mazarin. Je consultais une histoire des ports. Je notais trois dates : 1595, 1679, 1690. En 1595 les corbeillats arrivaient à Paris le mardi et le vendredi. Les mariniers les délestaient tout d’abord du fret puis ils débarquaient les nourrissons serrés dans leur maillot, fichés tout droits dans leur logette sur le pont ; ils les posaient sur des tonneaux sur la grève ; les petits bébés entravés étaient restitués ensuite un à un à leur mère par un homme qu’on appelait le meneur de nourrissons. Dès l’aube, le lendemain — c’est-à-dire tous les mercredis et samedis — les corbeillats transportaient de Paris à Corbeil d’autres petits afin qu’ils tètent le sein et sucent le lait des nourrices dans la campagne et la forêt. En 1679 Richelet écrivait corbeillard. En 1690 Furetière écrivait corbillard et le définissait : Coche d’eau qui mène à Corbeil petite ville à 7 lieuës de Paris. C’est ainsi que le corbillard, du temps où vivaient à Paris Malherbe, Racine, Esprit, La Rochefoucauld, La Fayette, La Bruyère, Sainte-Colombe, Saint-Simon, était un bateau de nourrissons qui voguait sur la Seine, longeant les berges, hurlant.
J’aurais passé ma vie à chercher des mots qui me faisaient défaut. Qu’est-ce qu’un littéraire ? Celui pour qui les mots défaillent, bondissent, fuient, perdent sens. Ils tremblent toujours un peu sous la forme étrange qu’ils finissent pourtant par habiter. Ils ne disent ni ne cachent : ils font signe sans repos. Un jour que je cherchais dans le dictionnaire Bloch et Wartburg l’origine du mot de corbillard je découvris un coche d’eau qui transportait des nourrissons. Je me rendis le lendemain à la Bibliothèque nationale qui se trouvait alors rue de Richelieu, dans le IIe arrondissement de Paris, dans l’ancien palais qu’occupait jadis le cardinal Mazarin. Je consultais une histoire des ports. Je notais trois dates : 1595, 1679, 1690. En 1595 les corbeillats arrivaient à Paris le mardi et le vendredi. Les mariniers les délestaient tout d’abord du fret puis ils débarquaient les nourrissons serrés dans leur maillot, fichés tout droits dans leur logette sur le pont ; ils les posaient sur des tonneaux sur la grève ; les petits bébés entravés étaient restitués ensuite un à un à leur mère par un homme qu’on appelait le meneur de nourrissons. Dès l’aube, le lendemain — c’est-à-dire tous les mercredis et samedis — les corbeillats transportaient de Paris à Corbeil d’autres petits afin qu’ils tètent le sein et sucent le lait des nourrices dans la campagne et la forêt. En 1679 Richelet écrivait corbeillard. En 1690 Furetière écrivait corbillard et le définissait : Coche d’eau qui mène à Corbeil petite ville à 7 lieuës de Paris. C’est ainsi que le corbillard, du temps où vivaient à Paris Malherbe, Racine, Esprit, La Rochefoucauld, La Fayette, La Bruyère, Sainte-Colombe, Saint-Simon, était un bateau de nourrissons qui voguait sur la Seine, longeant les berges, hurlant.
Pascal Quignard, La Barque silencieuse, Dernier royaume VI, Folio / Gallimard, 2011 (éditons du Seuil, 2009), p. 9-10.
XIe traité : Liber
Le terme de « livre » ne peut être défini. Objet sans essence. Petit bâtiment qui n’est pas universel.

tablette de Sumer
La « réunion de feuilles servant de support à un texte imprimé, cousues ensemble, et placées sous une couverture commune » ne le définit pas. Ce que les Grecs et les Romains déroulaient sous leurs yeux, les tablettes d’argile que consignait Sumer, les bandes de papyrus encollées de l’Égypte, les carreaux de soie de la Chine, ce que les médiévaux enchaînaient à des pupitres et qu’ils étaient impuissants à porter sur leurs genoux, ou à tenir entre les mains, les microfilms qu’entassent les universités américaines, des feuilles de palmier séchées et frottées d’huile, des lamelles de bambou, des briques, un bout de papier, une pierre usée, un petit carré de peau, une plaque d’ivoire, un socle de bronze, une pelure d’écorce, des tessons — rien de ce que l’usage de ces matières requiert ne s’éloigne sans doute à proprement parler de la lecture, mais rien ne vient s’assembler tout à coup sous la forme plus générale ou plus essentielle du « livre ». Même, l’addition de tous les traits hétérogènes que ces objets présentent, cette addition ne le constituerait pas.
Les critères qui le définissent ne définissent rien.
[...]
Pascal Quignard, Petits traités, tome III, éditions Clivages, 1984, p. 41-42 (repris en Folio / Gallimard, Petits traités I [tomes I à IV], 1997).
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la barque silencieuse, un littéraire, petits traités, livre | ![]() Facebook |
Facebook |
01/05/2011
Claude Dourguin, Ciels de traîne
 La frontière entre littérature et non littérature, complètement occultée depuis une trentaine d’années, correspond à celle qui sépare l’évocation et la désignation. Étant bien entendu que le registre de langue, à lui seul peut relever de l’évocation : dire l’amour dans la langue de Racine éveille des harmoniques, des entrecroisements de références, un véritable système suggestif, tellement riche qu’il place d’emblée dans la littérature, dans son champ : cela, bien sûr, ne préjuge pas de l’œuvre, ni de sa qualité.
La frontière entre littérature et non littérature, complètement occultée depuis une trentaine d’années, correspond à celle qui sépare l’évocation et la désignation. Étant bien entendu que le registre de langue, à lui seul peut relever de l’évocation : dire l’amour dans la langue de Racine éveille des harmoniques, des entrecroisements de références, un véritable système suggestif, tellement riche qu’il place d’emblée dans la littérature, dans son champ : cela, bien sûr, ne préjuge pas de l’œuvre, ni de sa qualité.
Toute œuvre digne de ce nom nourrit une recherche de l’Être et des formes du vrai (sinon de la vérité) — dans son langage, ses objets, les sensations puis les perceptions du monde extérieur s’il est requis. Faute de cette ambition ou de ce questionnement, il s’agit d’une activité d’agrément, d’une construction plus ou moins habile, plus ou moins plaisante, d’un numéro (comme on parle d’un numéro de music-hall ou de cirque), une voltige de signes.
Corollaire, on peut poser qu’il ne saurait y avoir de recherche ou d’expression artistique hors de son incarnation dans une multiplicité de situations, de réalités qui sont celles de la vie ici-bas. Voir Rilke qui a écrit là-dessus les pages les plus belles et définitives.
Il y a toujours plus de vérité dans la réalité passée par l’art, la peinture, la littérature, que dans son état brut, comme elle se livre à la perception. Tout est faux — au sens d’exactitude — chez Stendhal et nul comme lui pour nous apprendre l’italianité, l’opéra, la passion, évoquer la vie de province sous la Monarchie de Juillet, désigner la bêtise etc. Chardin en dit davantage sur la nature des fruits que ceux qui sont devant nous sur la table.
Qu’entendre par cette « vérité » ? La part profonde du mystère, de tremblement, d’obscurité, d’infini, approchés, suggérés ; l’au-delà de l’apparence dans chaque artiste saisit un fragment, différent chaque fois, une face nouvelle, sans que jamais il puisse être épuisé.
La difficile, passionnante question de la langue. Relative mais tout de même réelle une confiance nous rassure : certes, la langue ne parvient à cerner le réel en sa complexité, en sa totalité, en sa fragilité, mais elle donne autre chose que lui, son aura, sa part tremblante justement, ce qui le déborde, peut-être sa face voilée, incertaine qui le relie à un ailleurs sinon à une transcendance. Oui, la langue dans son effort de désignation, d’appréhension se charge de mystère, et ce n’est pas rien : même inadéquat, même insuffisant ce mouvement vaut qu’on le tente.
Il n’est pas interdit de tenir à une certaine conception de la littérature, qui n’est pas tout à fait une activité comme une autre. On peut la vouloir, la prétendre engagement de tout l’être. S’ensuit une certaine façon de conduire la vie, si l'on veut que l’écrit soit recevable. La littérature n’est pas que le fruit de la planche à billets (dans tous les sens !), à elle, il lui est interdit de se payer de mots. Une certification, une authentification, une réserve or — la vie, justement, sa conduite — sont obligatoires, le devraient du moins. Faute de quoi autant vaut le tout venant du quotidien, nul besoin des draperies de la littérature.
Claude Dourguin, Ciels de traîne, éditions José Corti, 2011, p. 13, 14, 44-45, 17, 19.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, ciels de traîne, littérature et réel, littérature et non littérature | ![]() Facebook |
Facebook |
20/04/2011
La Commune de Paris : une exposition
L’exposition sur la Commune à la mairie de Paris (du 18 mars au 28 mai 2011) présente une documentation précieuse, des affiches, des lithographies et des photographies, notamment celles des barricades par Bruno Braquehais et Auguste-Hippolyte Collard, celles aussi des hommes et des femmes qui constituaient la Commune. L’ensemble est fort bien présenté et, pourtant, provoque le malaise : les choix d’une bonne partie des images retenues pour illustrer la Semaine sanglante (21 au 28 mai 1871), relèvent d'une idéologie favorable aux Versaillais. Au cours de cette semaine, les massacres se succédèrent, mais l’iconographie privilégie les images des bâtiments incendiés par les Communards et celles des carcasses de ces lieux détruits. Peut-être aurait-il fallu préciser qu’aux yeux des Communards ces lieux étaient d’abord des symboles d’un pouvoir rejeté ? Le commentaire à propos de l’incendie de l’Hôtel de Ville est une lamentation sur la perte « d’ouvrages remarquables », des archives et de la bibliothèque, mais il aurait fallu aussi se lamenter sur les atrocités des Versaillais, et ne pas se contenter de donner sans commentaire la phrase de Mac-Mahon : « Aujourd’hui [le 28 mai] la lutte est terminée : l’ordre, la travail et la sécurité vont renaître ».

On cherchera en vain des documents relatifs à l’envoi au bagne des Communards qui avaient échappé aux massacres, comme si cette répression n’avait rien à voir avec la Commune elle-même. Pas plus présents les livres sur la Commune — Louise Michel n’a-t-elle donc rien écrit ? Un Dictionnaire de la Commune (celui de Bernard Noël) n’est-il pas disponible ? mais on trouve dans des vitrines quelques-uns des carnets de Parisiens opposés à la Commune… Enfin, comment ne pas juger étrange l’absence d’un catalogue qui aurait réuni la documentation, si partiale soit-elle ? On se demande si ces courtes semaines de 1871 ne continuent pas à effrayer les bien-pensants… Il faut peut-être attendre le cent cinquantenaire de la Commune, en 2021, pour une exposition digne de ce nom. En attendant, on se reportera au site de la mairie du 20e arrondissement et à l’excellent site consacré à la Commune : http://lacomune.perso.neuf.fr

Victor Hugo, qui ne fut pourtant pas un Versaillais, rejetait la Commune ; il écrivait de Bruxelles le 28 avril : « Depuis le 18 mars, Paris est mené par des inconnus, ce qui n’est pas bon, mais par des ignorants, ce qui est pire. À part quelques chefs, qui suivent la foule plus qu’ils ne guident le peuple, la Commune, c’est l’ignorance. Je n’en veux pas d’autre preuve que les motifs donnés pour la destruction de la Colonne, ces motifs, ce sont les souvenirs que la Colonne rappelle. »1 Ignorants donc, et inconnus, les 33 ouvriers, 12 journalistes, 14 employés, etc., qui dirigèrent la Commune… Peu d’écrivains y participèrent, et si l’on se souvient encore de Vallès, Henri Rochefort est oublié et l’enseignement ne fait aucune part à Eugène Pottier (2), qui n’a pas écrit seulement L’Internationale ; exilé aux Etats-Unis, militant socialiste, il pensait que seules les rencontres fréquentes entre ouvriers de tous les pays pouvaient s’opposer aux dégâts du capitalisme, et il écrivait en 1875, à l’occasion de l’Exposition de Philadelphie :
« Que de peuple en peuple on se voie,
Qu’on tienne congrès sur congrès,
Le travail, pour changer de voie,
A forgé les rails du progrès » (p. 118)
Quant à Courbet, condamné pour sa participation à la descente de la colonne Vendôme, mort dans l’exil en 1877, c’est sans doute le tableau « L’origine du monde » qui lui assure aujourd’hui sa renommée.
Quel intérêt la Commune a-t-elle pour la littérature ? Directement, aucun. Mais ses projets ouvraient la voie à un développement considérable de la formation intellectuelle du plus grand nombre, condition nécessaire pour une diffusion générale de la culture. Par exemple : suppression du travail de nuit, constitution d’une chambre fédérale des travailleuses, séparation de l’Église et de l’État, suppression du budget des cultes, gratuité totale des fournitures scolaires, etc. Ces mesures auraient ébranlé les fondements du pouvoir et toutes les composantes de la classe dirigeante s’unirent pour abattre la Commune. Il faut se souvenir des mots de Thiers : « Le sol est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon ».
Publié dans ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : commune de paris, eugène pottier, communard | ![]() Facebook |
Facebook |





