16/10/2015
Robert Coover, La bonne et son maître

Elle entre, posément, gravement, sans affectation, circonspecte dans ses mouvements (comme on le lui a appris), sans faire trop de bruit en marchant, sans traîner les pieds non plus, mais en avançant calmement, discrètement, jetant un bref regard au lit vide et aux draps froissés, au pyjama jeté n'importe où. Elle hésite. Non. On recommence. Elle entre. Posément et gravement, sans affectation, sans faire trop de bruit en marchant, sans traîner les pieds non plus, sans avoir l'air de conduire une danse, sans battre la mesure de la tête et des mains, sans rien fixer et sans tourner la tête d'un côté plutôt que d'un autre, mais en avançant calmement, discrètement en franchissant la porte, sur le sol ciré, puis au-delà du lit vide et des draps froissés (sans y jeter un bref regard, ce qui est mieux), jusqu'aux grands rideaux là-bas sur le mur. Comme on le lui a appris.
Robert Coover, La bonne et son maître, traduit de l'américain par Denis Roche, Seuil, 1984, p. 7.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert coover, la bonne et son maître, apprentissage, soumission, répétition, récit | ![]() Facebook |
Facebook |
15/10/2015
Thomas Bernhard, Je te salue Virgile
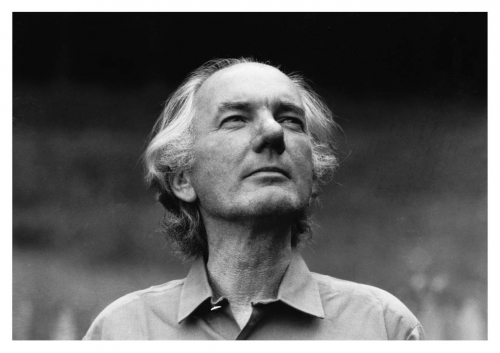
Octobre
Sur ces amas de décombres, ne riment à rien
les lamentations de la mère,
à rien l'intercession du père ivrogne,
à rien le récit mortuaire du lieutenant,
la rébellion des cardinaux à rien,
à rien la projection de l'avenir,
les pleurs de tous les peuples à rien,
à rien l'éther mortifié,
la fin des océans...
Les mâchoires enfouies je les déterre,
ces avilissements,
ma décrépitude, je les fais comparaître
devant ma bouche dépravée,
devant mon crâne desséché
jusque dans ma piteuse fin de matinée...
Dans la nuit
tu compenses les incendies de ce monde
par mon imbécillité fraternelle...
Thomas Bernhard, Je te salue Virgile, traduit de
l'allemand par Kza Han et Herbert Holl,
Gallimard, 1988, p. 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, je te salue virgile, octobre, décombres, lamentations, rien, mère | ![]() Facebook |
Facebook |
14/10/2015
Emmanuel Laugier, 27 fois — et suivantes : Jacques Dupin

27 fois — et suivantes : Jacques Dupin
papier de riz cassant le rêve
où sa jambe revenue
ouvre la garrigue
au son rêche des tissus
une écharde orpheline fait assez simple ra-
ccord persistant
la jambe harassée
où le nerf court et brûle
le long de la colonne du souffle
si l’écrire
le détachait de son corps
la semence de la voix
soufflée
là même où il répond
et s’en va
la suffocation à travers laquelle
il ne respire plus
est nœud gordien
logé au rappel de sa voix ici même
où le champ s’ouvre et se consume dans une fumée âcre
[...]
Emmanuel Laugier, 27 fois — et suivantes : Jacques Dupin,
dans Koshkonong, n°8, été 2015, p. 16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emmanuel laugier, 27 fois — et suivantes : jacques dupin, corps, femme, voix, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
13/10/2015
Jean-Pierre Chevais, Sans titre, dans Rehauts

Sans titre
on fait la pause on a reçu en partant un sandwich mais on est deux ils n’ont pas dit ce qu’il y avait dedans on fait quand même la pause
on a fait la pause on n’a plus rien à faire on en aurait eu un chacun on serait encore à s’occuper pas longtemps mais un peu
on fait une deuxième fois la pause on a en partant rien eu d’autre on hésite à poursuivre on va quand même le faire
*
en rentrant de la pause on a trouvé dans la cour un sandwich il était pas trop abîmé mais on est deux on l’a pas ramassé
ils nous cachent quelque chose on va rentrer de la pause un peu plus tard peut-être qu’ils ont besoin d’un peu de temps c’est tout
la fois suivante on n’a pas eu le temps de rentrer ils ont demandé pourquoi qu’est-ce qu’on en sait et même si on savait
*
quand on hésite à quoi penser on repense au sandwich dans la cour on le sait bien pourtant penser dans ces cas-là ça n'a jamais suffi
on s'est en fin de compte séparés on n'avait rien à se dire n'empêche ça n'a pas été rien d'abord on n'y arrivait pas à la fin si
on fait maintenant la pause chacun à part ça repose c'est vrai quand même il y a des jours on crierait bien mais alors fort
[...]
Jean-Pierre Chevais, "Sans titre", dans Rehauts, automne-hiver 2015, n° 36, p. 47-48.
Rehauts, 112 p., 13 €. Abonnement 1 an, 2 numéros : 22 € ; 2 ans, 39 €.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre chevais, "sans titre", dans rehauts, on, sandwich, pause, travail | ![]() Facebook |
Facebook |
12/10/2015
Julien Bosc, Sans lieu-dit ni demeure

Sans lieu-dit ni demeure
des neiges d’avril
écloses ou en bouton
de premières capucines
orange lie de vin ou jaune
un bouleau arqué par la neige à tout-va d’une seule nuit
d’inattrapables montmorency en haut du cerisier de huit ans
l’ombre adolescente et pas peu fière d’un jeune tilleul
un ciel bleu
un ténu vent silencieux
une conscience exsangue sans lieu-dit ni demeure
et rien
hormis le geai des chênes simulant la crécelle
le fond du puits
la corde
la gorge et le galet
Julien Bosc, Sans lieu-dit ni demeure, dans Rehauts, n° 36, automne-hiver 2015, p. 91.
Julien Bosc a publié récemment Maman est morte (Rehauts, 2012), Tout est tombé dans la mer (Approches, 2014)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, sans lieu-dit ni demeure, arbres, neige, mélancolie | ![]() Facebook |
Facebook |
11/10/2015
Volney, Les Ruines : Palmyre
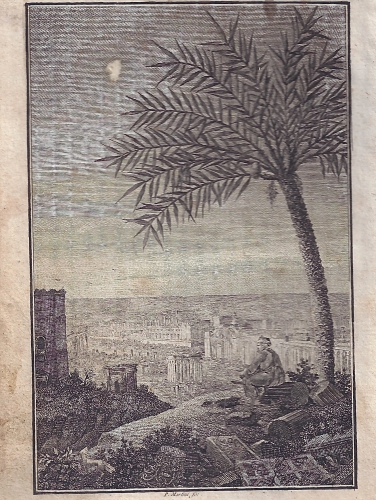
Frontispice de l'édition des Ruines (1791)
Palmyre
[...] me trouvant rapproché de [la ville] de Palmyre, située dans le désert, je résolus de connaître par moi-même ses monuments si vantés ; et, après trois jours de marche dans des solitudes arides, ayant traversé une vallée remplie de grottes et de sépulcres, tout à coup, au sortir de cette vallée, j’aperçus dans la plaine la scène de ruines la plus étonnante ; c’était une multitude innombrable de superbes colonnes debout, qui, telles que les avenues de nos parcs, s’étendaient, à perte de vue, en files symétriques. Parmi ces colonnes étaient de grands édifices, les uns entiers, les autres à demi-écroulés. De toutes parts la terre était jonchée de semblables débris, de corniches, de chapiteaux, de fûts, d’entablements, de pilastres, tous de marbre blanc, d’un travail exquis. Après trois quarts d’heure de marche le long de ces ruines, j’entrai dans l’enceinte d’un vaste édifice, qui fut jadis un temple dédié au Soleil ; et je pris l’hospitalité chez de pauvres paysans arabes, qui ont établi leurs chaumières sur le parvis même du temple ; et je résolus de demeurer pendant quelques jours pour considérer en détail la beauté de tant d’ouvrage.
Volney, Les Ruines, ou Méditation sur les révolutions des empires, Paris, janvier 1791, p. 7-8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : volney, les ruines, méditation, palmyre, temple, beauté | ![]() Facebook |
Facebook |
10/10/2015
Marina Tscetaieva, Souvenirs

Histoire d’une dédicace
Mon amie partait pour un long voyage, à travers mers et montagne. Nous passions nos journées et nos soirées à déchirer (le jour) et à brûler (le soir) des tonnes de lettres et de manuscrits. Des lettres au propre. Des manuscrits au brouillon. « Ça, on garde ? » — « Non, on brûle » — « Et ça, on brûle ? » — « Non, on garde » « Brûler », naturellement, c’était son rôle, « garder », le mien — puisque c’était elle qui partait. Ce qu’elle n’arrivait pas à brûler, elle me le donnait. Et l’avocat devenait l’exécuteur des hautes œuvres.
Brûle plus clair
Mon feu d’enfer !
Regarde en l’air ;
Les p’tits oiseaux qui volent au ciel !
Le ciel, c’est la voûte noire de la cheminée ; les oiseaux, les noirs lambeaux de papier consumé. Oiseaux de l’enfer. En enfer, le firmament est un four ardent.
Encore une boule de papier (papier d’avant-guerre et donc indestructible : même le feu n’en veut pas) : fraîcheur de toile, crissement de soie, elle craque dans la main — dans la main d’abord, puis dans le feu, la montagne plumeuse de cendres est de plus en plus haute au-dessus de la grille de la cheminée, et de plus en plus tassée au-dessous. [...]
Classeurs, tiroirs, corbeilles, placards, étagères. Bouts de papier, encore, encore, encore. D’abord blancs, ensuite noirs. Au milieu de la grille, argent caucasien touché de noir : la cendre.
Dans ses mains, la cendre des mots
Elle les fixe d’un air étonné :
Les âmes voient ainsi d’en haut
Les corps qu’elles ont abandonnés.
Le corps de l’écrivain, ce sont ses manuscrits. Ce qui brûle : des années de travail. Cette « elle » là ne brûlait que des lettres : le cœur refroidi d’un autre ; nous — ce sont nos manuscrits, notre travail de dix-huit ans que nous brûlons !
Marina Tsvetaieva, Souvenirs, traduit et annoté par Anne-Marie Tatsis-Botton, Anatolia / éditions du Rocher, 2006, p. 203-205.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvetaieva, souvenirs, histoire d'une dédicace, manuscrit, brûler, garder, cendre | ![]() Facebook |
Facebook |
09/10/2015
Virginia Woolf, Une maison hantée

Une maison hantée
Quelle que fût l’heure à laquelle on se réveillait, on entendait une porte se fermer. D’une pièce à l’autre, main dans la main, ils allaient, soulevant ceci, ouvrant cela, vérifiant — un couple fantôme.
« C ‘est ici que nous l’avons laissé », disait-elle. Et il ajoutait : « Oh, mais là aussi !) « À l’étage », murmurait-elle. « Et dans le jardin », chuchotait-il. « Doucement, disaient-ils ensemble, sinon ils vont se réveiller ».
Mais non, vous ne nous avez pas réveillés. Oh que non ! On pouvait se dire : « Ils le cherchent ; ils tirent le rideau », puis on lisait encore une page ou deux. « Maintenant ils l’ont trouvé », fort de cette certitude, on arrêtait le crayon dans la marge. Puis, fatigué de lire, il arrivait qu’on se lève pour faire sa propre ronde, maison entièrement vide, portes ouvertes et, au loin, à la ferme, les roucoulades satisfaites des pigeons ramiers et le ronron de la batteuse. « Que suis-je venue faire ici ? Qu’est-ce que je cherchais ? » J’avais les mains vides « Alors peut-être à l’étage ? » Les pommes étaient bien au grenier. Plus qu’à redescendre, rien n’avait bougé dans le jardin, hormis le livre qui avait glissé dans l’herbe.
Virginia Woolf, Une maison hantée, traduction Michèle Rivoire, dans Œuvres romanesques I, édition Jacques Aubert, Gallimard / Pléiade, 2012, p. 829.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, une maison hantée, fantômz, nuit, recherche, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |
08/10/2015
Bernard Noël, Poèmes, I, espace pour ombre

espace pour ombre
espace
de quelle eau lente
fait
un sourire s’épuise
trop devenu sourire
tu
déchires la glace
et
la surface tombe
*
qui parle
si le temps est désert
si ta place gelée
on
pose un souvenir
la nuit écume
le corps se fend
hier
comme une pierre au fond de l’eau
*
regard
de quel regard tombé
cette durée t’exile
l’amour te traverse
et
l’intouchable
la vitre refuse l’ongle
le miroir boit le visage
le rire même
s’éparpille cassé
[...]
Bernard Noël, Poèmes I, Textes / Flammarion,
1983, p. 139-141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, poèmes i, espace pour ombre, regard, nuit, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
07/10/2015
Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes, II, Poésie

Dans les yeux de la nuit
Une femme s’endort sur un toit c’est la nuit
Abandonnée antique au péril du vertige
Aux traîtrises rêveuses des gestes du sommeil
Songeuse ensevelie en glissades mortelles
Sur le haut toit déserte glace tendue face à l’espace
Sur le zinc oxydé de vieux soleil tueur
Et de lune ancienne empoisonneuse en larmes
La grande somnambule y crie de tous ses ongles
De ses doigts déments naissent des diamants crissants
Et des gouttes de sang qui chantent en dansant
La danse en perles du mercure
Vers la femme qui dort sur le monstre du vide
Une cheminée fume un nuage en haillons
Dans la soie noire de la suie le vent des nuits
Dresse une tente errante
Creuse l’antre céleste nomade
Pour l’adoration des yeux prodigieux
De la femme endormie aux paupières battantes
Ses trop longs cils vibrants émeuvent les rayons
Des étoiles rétractiles
C’est la nuit la dormeuse un œil clos l’autre ouvert
Tout le monde à jour contre ce qu’elle voit .
Roger Gilbert-Lecomte, Œuvres complètes, II, Poésie,
édition établie par Jean Bollery, Gallimard, 1977, p. 74.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger gilbert-lecomte, Œuvres complètes, ii, poésie, les yeux de la nuit, femme, sommeil, vide | ![]() Facebook |
Facebook |
06/10/2015
André Frénaud, Hæres — et : La fin de La Quinzaine littéraire ?
Trouvé dans l’héritage
Initiales
entrelacées
devenues anonymes
sur les draps du lit
d’un défunt amour
Lieu commun
Le champ-les-vaches, la vie-la-mort... À la gaieté !
André Frénaud, Hæres, Gallimard,
1982, p. 153, 168.
Communiqué
La fin de la Quinzaine littéraire ?
Le jeudi 1er octobre, le numéro à venir de La Nouvelle Quinzaine littéraire, journal fondé par Maurice Nadeau en 1966, a été préparé sans la participation de la direction éditoriale, sans que celle-ci soit informée ni du lieu de sa réalisation, ni des textes censés le composer.
Cela fait suite à une succession d’événements qui ont fait exploser la structure du journal. La gérante de la société de la NQL et directrice de la publication, Patricia De Pas, a en quelques jours :
-
- annoncé une restructuration globale du journal et de ses orientations éditoriales ;
-
- évincé la direction éditoriale formée de Jean Lacoste, Pierre Pachet et Tiphaine
Samoyault qui avaient été cooptés par l’ensemble des collaborateurs du journal à la mort de Maurice Nadeau en 2013 ;
-
- annoncé un déménagement imminent (qui n’a de fait pas encore eu lieu) pour imposer des réunions dans des locaux dépendant de l’Université Paris II Assas
-
- mis fin par mail à sa collaboration avec Hugo Pradelle, qui représentait La Nouvelle Quinzaine littéraire à l’extérieur et qui était l’un des seuls postes rémunérés du journal.
Les collaborateurs, réunis en assemblée le 30 septembre, ont fait part à Patricia De Pas de leur inquiétude face à la rapidité et à la violence de ces changements, ont posé des questions sur les nouvelles orientations du journal et ont marqué leur scepticisme face à un projet préparé sans concertation et dans la précipitation. Ils ont réaffirmé leur soutien à la direction collégiale qu’ils ont choisie.
Patricia De Pas, en 2013, avait repris les actifs de la société en faillite de la Quinzaine littéraire. Elle avait pu fonder une nouvelle société dont elle est l’actionnaire majoritaire et dont l’actionnaire minoritaire est la Société représentant les lecteurs ayant répondu à l’appel lancé par Maurice Nadeau juste avant sa mort pour sauver le journal.
Pendant deux ans, Patricia De Pas s’est occupée de la gestion administrative et commerciale de la NQL, qui continuait à être entièrement réalisée par les collaborateurs et la direction éditoriale (tous bénévoles). Elle a marqué depuis quelques jours son intention d’intervenir personnellement dans la ligne éditoriale et les contenus du journal.
La grande majorité des collaborateurs s’apprête à réagir collectivement, moins contre ces projets qui pourraient être discutés, que contre des procédés qui rompent avec les pratiques de collaboration amicale qui les ont réunis autour de Maurice Nadeau au long des années, et avec les promesses de gestion transparente et de respect des règles de droit que Patricia De Pas avait elle-même avancées.
Tiphaine Samoyault, Pierre Pachet, Jean Lacoste
05/10/2015
Déborah Heissler, Sorrowful Songs
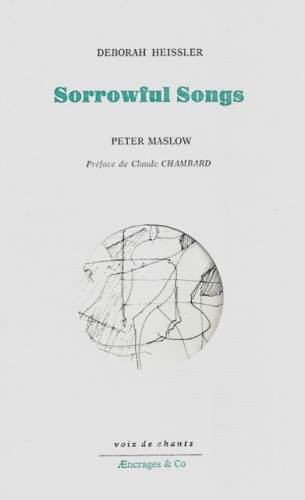
Dans les quatre pages titrées "Valse pour Debbie" qui précèdent les poèmes, Claude Chambard propose une lecture des Sorrowful Songs, rappelant que le titre est emprunté à une œuvre du compositeur polonais Henrik Gónecki, Symphony of Sorrowful Songs, n°3, opus 36 (1976) et détaillant les variations autour de « la disparition, l’amour, les chairs & les sentiments à vif » ; il entend aussi dans le motif de la perte, central dans le livre, « en écho les cris & les silences des disparus de la Shoah ». Il me semble juste, en effet, de ne pas lire les poèmes de Déborah Heissler comme seulement un ensemble lyrique, où se lient les motifs de la mort — avec la mort d’une femme, Blanche —, du temps, et de l’amour, où un "je" veille le corps de la disparue et se remémore les jours passés.
Cet ensemble de poèmes en prose forme une narration très homogène, divisée en trois séquences, toutes titrées. Le premier titre, "Jardin — Elle endormie", renvoie à la mort, celle de Blanche (« morte hier soir »), mais aussi à l’extrait du poème en anglais en exergue : il y est question d’un oiseau qui, de la branche où il est posé dans le jardin, vient sur la courbe du cou d’une femme ; courbe bleue (« the blue curve »), et cette couleur est un des éléments de construction du recueil, elle apparaît toujours liée à la féminité (« spasme du bleu », « Trêve des corps précipités et bleus », « Ce bleu. », début d’une prose juste après le nom de Blanche, puis le mot enfin dans le souvenir de petites filles).
Il est d’autres éléments organisateurs. Le lecteur des précédents livres de Déborah Heissler reconnaît dans Sorrowful Songs plusieurs motifs, le silence, l’obscurité, la présence de la neige. Il y a en effet la nuit, « les silences de Blanche », la pluie « sans bruit », il y a la neige et son « léger bruit », présente jusqu’à la fin du recueil, écho au nom de la femme. On relève également diverses formes de reprises : l’adresse à la disparue (« Tu »), dans le souvenir de ce qu’elle fut, introduit un fragment de Philippe Jaccottet (« Ph. J. ») dans lequel le mot « oublieux » suscite le début du poème suivant, « Vous oublierez tout ». Ailleurs, c’est le titre d’un poème (« Chambre où / te perdre ») que l’on retrouve pour titre de la troisième séquence ; etc. On ajoutera que le retour de mots et de fragments tout au long du livre est aussi une manière de dire le deuil : répétition du même contre l’oubli.
Sans doute est-on à la lecture moins sensible à la construction qu’au chant du deuil. Au jardin de l’ouverture de Sorrowful Songs, figure de la nature organisée, s’oppose la mort et, par le biais d’une citation de Sylviane Dupuis, l’image d’un monde qui se défait (« Bribes de mondes égrenés qui explosent nus entre ses doigts »). Ensuite, quand sont évoquées des plantes, il s’agit de plantes sauvages, courantes mais au nom peu habituel : euphorbe, ficaire, saxifrage. La disparue, dans le souvenir de ce qu’elle fut, se substitue à tout ce qui est encore vivant ; ce qui est vu par la fenêtre, dans la pièce où le narrateur veille — « vieillard aux mains brunes » — , se limite à l’horizon, à la ligne du « rideau des arbres » et à la neige qui efface tout. Le corps aimé devient arbre, ombre, cathédrale, monde ; quand un titre, « Elle était devenue arbre », est repris pour vers du poème suivant, on ne peut s’empêcher de penser au couple de Philémon et Baucis.
Tout ne s’efface pas, « le temps travaille » et le souvenir recrée les jours de l’enfance, mais aussi rappelle ce que fut l’amour des corps ; alors, la phrase ordonnée disparaît, restent les verbes (« Voir. Sentir. Jouir. ») et, tout aussi elliptique, la trace du désir vécu comme un « ciel ouvert » (« Cri. Gorge. Nuit comme lignes qui se fondent »). Tout ne s’efface pas, et s’impose aussi dans la veille de la morte, l’image du jaillissement, de la sortie de soi, de la naissance : après « Jouir et saillir. Sourdre. » vient « Ce point de création [...] ».
Ainsi se mêlent dans ce poème élégiaque les motifs de la mort, du chagrin et de la tristesse inconsolable, et ceux de la vie à travers les moments toujours en mémoire de l’amour. Cependant, si l’on entend l’allusion à Boulez (après celles à Debussy et à Bach) à la fin du recueil, avec les marteaux « Sans maître désormais », c’est la mélancolie qui domine, comme dans la symphonie de Henrik Gónecki : du poème de Char, le musicien retient pour clore la pièce « Le pas s’est éloigné. Le marcheur s’est tu ».
Déborah Heissler, Sorrowful Songs, dessins de Peter Maslow, préface de Claude Chambard, Æncrages & Co, 2015, np,, 18 €.
Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 20 septembre 2015.
| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
04/10/2015
Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes

A quiconque sombre, tu diras que cela, debout désormais —
A échoué comme Eux — et conscient qu’il se relevait —
Poussé par le Fait, et non par la Compréhension
Que la Faiblesse s’est dissipée — ou la Force — levée —
Dis-leur que le Pire, est facile dans l’Instant —
L’Effroi, n’est que le Sifflement, avant la Balle —
Quand la balle entre, entre le Silence —
Mourir — annule le pouvoir de tuer —
If any sink, assure that this, now standing —
Failed like Themselves — and conscious that it rose —
Grew by the Fact, and not the Undersatnding
How Weakness passed — or Force — arose —
Tell that the Worst, is easy in a Moment —
Dread, but the Whizzing, before the Ball —
When the Ball enters, enters Silence —
Dying — annuls the power to kill —
Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes, traduction de l’américain par François Heusbourg, éditions Unes, 2015, p. 71 et 70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, nous ne jouons pas sur les tombes, être debout, faiblesse, force, silence, mourir | ![]() Facebook |
Facebook |
03/10/2015
André Frénaud, Hæres,

Sur la route
Douce détresse de l’automne,
des abois très lointains,
une échauffourée de nuages, comme un remuement
de souvenirs qui se cachent.
Et la lisière des peupliers pour donner figure
à la lumière qui va venir.
André Frénaud, Hæres, Gallimard, 1982, p. 91.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hæres, sur la route, automne, nuages, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
02/10/2015
Antonio Porta, Les rapports : recension

On ne connaît pas Antonio Porta (1935-1989) en France. Quelques textes dans la revue Change en 1969 ont été suivis de Choisir la vie, ensemble de poèmes traduits par Joseph Guglielmi, épuisé depuis longtemps, et c’est donc un bonheur de lire aujourd’hui la belle traduction de I rapporti (1966). De l’avant-garde poétique italienne des années 1960 à laquelle appartenait Porta, seuls ont un peu franchi la frontière les œuvres de Nanni Balestrini — pour des romans — et d’Edoardo Sanguineti — dont les éditions NOUS ont donné Corollaire en 2013 ; leur anthologie manifeste I Novissimi reste inconnue, tout comme les activités du "Gruppo 63" qui réunissait de nombreux écrivains (dont Umberto Eco, G. Manganelli, G. Scabia, etc.) et des créateurs de différentes disciplines.
Les rapports est précisément lié aux questions, toujours d’actualité, que se posait le "Gruppo 63" : comment rompre avec la narration classique, comment rendre compte avec des mots de la complexité du réel ? Pour Porta, l’absence de lisibilité du monde aboutit dans les poèmes de la fin des années 1950 et des années 1960, comme l’analyse Judith Balso dans la postface, à « une destruction délibérée de toute lisibilité narrative ou linéaire »(1). Chacun voit en même temps, dès qu’il regarde autour de lui, un nombre très élevé d’événements, d’actions, et la linéarité du langage permet seulement de les rapporter successivement. Porta ne peut rien contre cette contrainte mais, en quelque sorte, la déborde par exemple avec une énumération sans hiérarchie, du moins apparente, de propos :
« oui, c’est ça, drogue, sels pour le bain, la visite
au château, oh les beaux jours, » « lutte
pour la paix, désarmement, mais condamnation de la coexistence,
moins de bureaucrates et plus de soldats, » « pour des milliers
de marins des millions d’objets inutiles, » « il est essentie
de tout entendre, » « le désir vrai est de se blanchir »
L’allusion à Beckett (et sans doute à Kafka dans ce contexte) n’est pas indifférente, référence à celui qui a mis en morceaux des codes du théâtre. Une autre manière de rompre avec la narration et le lyrisme naît de l’emploi, dans nombre de poèmes, d’un "il" qui ne renvoie pas à un sujet identifiable ; ainsi est brisé tout processus d’identification, toute tentation lyrique ; « Il n’y a plus personne. Et toutes les personnes à la fois », comme l’écrit la traductrice à propos de cette « troisième personne impersonnelle » (De Francesco), et l’on sort donc de toute représentation :
Chaque jour il trouve le seuil brûlé,
une paire de chaussure, une prise de ta-
bac, en marge, l’anéantissement, une jour-
née de soulagement [...]
Ce qui est cependant lisible du monde, c’est la violence sous toutes ses formes, et elle est explorée sans détours : coups de fusil, noyade, yeux qui éclatent, éventration, incendie, accident, inondation... ; elle gagne même les animaux, puisque « Des chiens mordent les passants ». Il existe peut-être une autre violence, qui consiste à ne pas choisir de dire ce qu’il est possible de dire, ou plutôt d’écrire quelque chose et son contraire : « Il sème le germe du doute, / tout est clair, tout est o- / bscur », « [...] dans la fente la lumière, l’obscurité, / derrière le rideau il y a la nuit le jour ». Dans cette indécision où aucune forme n’est reconnaissable, le corps humain lui-même peut perdre son apparence et se métamorphose ; il devient animal (« Je fus pris de terreur en devenant lièvre ») ou se défait, se démembre (« le nez fend pour devenir salive la lèvre / en remontant au-dessus des dents [etc.] ». Sortie sans retour du "je" de toute identité et, par là, de la tradition poétique — et l’on peut se demander si le choix d’un pseudonyme (Antonio Porta pour Leo Paolazzi) n’appartient pas aussi au projet poétique.
Le refus de la narration, c’est le refus d’un ordre, la mise en cause d’une poésie (et d’une prose) qui prétend donner des choses une image, donc d’être au fond rassurante : tout pourrait être représenté. On comprend que le projet de Porta, et celui du "Gruppo 63", était politique et qu’il n’avait pas choisi le camp des bien pensants. L’essentiel était de chercher : pour lui, « découvrir, au moins, telle est la fin de l’art, / l’image d’un homme, nous ».
Antonio Porta, Les rapports, traduit de l’italien par Caroline Zekri, préface d’Alessandro De Francesco, postface de Judith Balso, éditions NOUS, 128 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 septembre 2015.
______________________________
1. Sur la question de la lisibilité aujourd’hui, on peut lire les actes d’un colloque : Bénédicte Gorrillot, Alain Lescart, L'illisibilité en questions, avec M. Deguy, J-M. Gleize, C. Prigent, N. Quintane, Septentrion, 2014.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio porta, les rapports, poésie italienne, poésie et politique, réel | ![]() Facebook |
Facebook |





