30/09/2011
Jean Tortel, Appareil de la terre
 L’odeur des vieux papiers se fait plus âcre, les modulations des oiseaux plus ténues. Les pêcheurs au bord de la rivière s’apprêtent à quitter, remisant leur attirail. Une auberge désaffectée conserve une seule habitante. À la fenêtre apparaît sa silhouette ancienne. Elle reste désemparée parce que ce morceau de pâté, que répudierait le médecin des pauvres, sent déjà fort, mais elle décide pourtant de la manger en le faisant revenir à la poêle. Des voix ne lui font plus peur : celle du forgeron, du distillateur, de l’émondeur qui, par leurs romances, ornent ses jours, maintenant, comme ils pensent avec elle, comptés, mais ne le furent-ils pas toujours au plus juste dès sa naissance, un jour de plein soleil.
L’odeur des vieux papiers se fait plus âcre, les modulations des oiseaux plus ténues. Les pêcheurs au bord de la rivière s’apprêtent à quitter, remisant leur attirail. Une auberge désaffectée conserve une seule habitante. À la fenêtre apparaît sa silhouette ancienne. Elle reste désemparée parce que ce morceau de pâté, que répudierait le médecin des pauvres, sent déjà fort, mais elle décide pourtant de la manger en le faisant revenir à la poêle. Des voix ne lui font plus peur : celle du forgeron, du distillateur, de l’émondeur qui, par leurs romances, ornent ses jours, maintenant, comme ils pensent avec elle, comptés, mais ne le furent-ils pas toujours au plus juste dès sa naissance, un jour de plein soleil.
Plainte
Ce jour-là une femme dit :
Qui veut me porter mon fils
il est lourd et la nuit revient.
O temps des légumes terreux
rouges ou verts
des navets vineux
dans un jardin bordé d’épines
sous un ciel de silence accepté
temps que je n’ai plus
pourtant ce monde reste réel
et j’aime à voir sa beauté.
Jean Tortel, Appareil de la terre, Gallimard, 1964, p. 17 et 64.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tortel, appareil de la terre | ![]() Facebook |
Facebook |
29/09/2011
Alain Veinstein, Voix seule

Un pas
À mesure que je m’enfonce
je n’ai rien tant à cœur
que la vérité.
Mais quoi que je fasse et dise,
pas de pas gagné
qu’il soit possible de tenir :
tous les témoins sont morts
et je reste seul en scène
à tenir un rôle
que les vrais mots de l’enfance
feraient voler en éclats.
Jour
Le seul jour jusqu’ici
je l’ai éclairé
à coups de pelle. Souvenez-vous.
Malgré les éclats de rire
et le effets de cruauté,
la pelle
m’a appris la vie.
Je lutte ici même contre l’envie
de la reprendre
et d’ensanglanter avec fureur
la terre épuisée par la brume.
Où es-tu ?
Parti pour ne pas revenir,
ne plus être
père,
père, jamais
et pourtant
les deux bras tendus,
je brandis
une couronne de roses
et je crie :
je suis ton enfant,
celui que tu berçais dans tes bras,
prêt à se faufiler, si Dieu le veut,
comme un rat dans ta tombe.
Et pourtant, nous ne nous reverrons plus,
nous avons, toi et moi, des visages sans avenir.
Le ciel est froid et sombre
contre mon dos.
Il ne manquerait plus que le vent se lève
sur le petit tas brillant
que j’appelais père
il y a à peine un instant.
Alain Veinstein, Voix seule, Fiction & Cie, Seuil, 2011, p. 59, 91 et 122.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain veinstein, voix seule, absence | ![]() Facebook |
Facebook |
28/09/2011
Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts
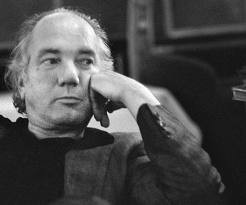 Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.
Ce qui est décrit a beau être effrayant, écrire n’en demeure pas moins un plaisir. Si on réussit.
De toute ma vie je ne me suis jamais libéré par l’écriture. Si tel avait été le cas, il ne resterait rien. Et que ferais-je de la liberté que j’aurais obtenue ? Je ne suis pas du tout partisan de la délivrance. Du cimetière peut-être. Mais non, je ne crois pas à cela non plus, parce qu’alors il n’y aurait rien.
Je n’ai pas besoin d’inventer quoi que ce soit. La réalité est bien pire. Par le biais de mes relations avec les gens de ce village, je sais ce qu’ils endurent, je sais à quelle heure ils dorment, ce qu’ils mangent, et quand leur cancer se déclare. Il y a beaucoup de fabriques de papier dans ce secteur, et un bon nombre d’estropiés auxquels les machines ont coupé les doigts, les bras ou un bout d’oreille. Peu à peu les machines leur coupent tout. Ou bien vous roulez à motocyclette sur les rails. Et vous y laissez une jambe. C’est ce qui est arrivé à l’ancien propriétaire de cette ferme. C’était un travailleur posté. J’ai chauffé la maison avec des jambes de bois. Lui en avait fait une grande consommation.
L’être humain refuse d’admettre que la nature est plus grandiose qu’un battement de cœur. Une prairie en fleurs est une chose si prodigieusement fondamentale que la gorge se serre rien qu’à y penser. Mais tout sera perdu, hormis pour quelques créatures un peu demeurées. Peut-être verra-t-on naître alors quelque chose de véritablement nouveau.
Pour que ça vienne avec fraîcheur, j’alterne toujours : après la prose, une pièce de théâtre. Le principal attrait du théâtre, ce sont les gens avec lesquels vous travaillez. Lorsque vous écrivez de la prose, vous êtes seul. Vous envoyez le manuscrit à l’éditeur, vous recevez bientôt de sa part une lettre stupide, puis vous n’avez plus aucune nouvelle, jusqu’à ce que vous parvienne un livre imprimé à la va-comme-je-te-pousse, truffé de ces fautes que vous vous étiez escrimé à corriger, ensuite, après un long silence, les critiques entrent en scène, le cauchemar, et en plus vous ne gagnez presque rien. En revanche, travailler pour le théâtre, c’est du stress. Au bout de quelques semaines, ça me tape sur les nerfs, tous ces acteurs effroyables. Je suis alors content quand une nouvelle prose démarre pendant ce temps-là. Et je supporte de traverser des mois en solitaire.
Thomas Bernhard, Point de vue d’un incorrigible redresseur de torts, traduit de l’allemand par Jean-Baptiste Para, dans Europe, n° 959, mars 2009, p. 19, 19, 19-20, 21, 21-22.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, prose et théâtre, écrire, jean-baptiste para | ![]() Facebook |
Facebook |
27/09/2011
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline

Encore une fois les hibous
J’allais à travers temps évoquant l’avenir
Que j’avais vu la veille au sein de quelque rêve
Et le long de l’espace au rebours de l’agir
Je laissais s’écouler glauque et vive la sève
De grands arbres plantés à l’instar du menhir
Pour marquer du soleil la fugitive trêve
Et qu’à leurs pieds géants les ans viennent gésir
En attendant le jour où l’homme se relève
Ni debout ni couchés des êtres à genous
Plantaient leur front plaintif dans une terre aride
La bouche dilatée arrachant des caillous
Mais je ne voudrais pas d’un destin aussi dous
Souligner la tendance assurément putride
C’est lorsque la nuit vient que volent les hibous
Qui cause ? Qui dose ? Qui ose ?
Si j’osais je dirais ce que je n’ose dire
Mais non je n’ose pas je ne suis pas osé
Dire n’est pas mon fort et fors que de le dire
Je cacherai toujours ce que je n’oserai
Oser ce n’est pas rien ce n’est pas peu de dire
Mais rien ce n’est pas peu et peu se réduirait
À ce rien si osé que je n’ose produire
Et que ne cacherait un qui le produirait
Mais ce n’est pas tout ça Au boulot si je l’ose
Mais comment oserai-je une si courte pause
Séparant le tercet d’avecque le quatrain
D’ailleurs je dois l’avouer je ne sais pas qui cause
Je ne sais pas qui parle et je ne sais qui ose
À l’infini poème apporter une fin
*
Acriborde acromate et marneuse la vague
au bois des écumés brouillés de mille cleurs
pulsereuse choisit un destin coquillage
sur le sable où les nrous nretiennent les nracleus
Si des monstres errants emportés par l’orague
crentaient avec leurs crons les crepâs des sancleurs
alors tant et si bien mult et moult c’est une ague
qui pendrait sa trapouille au cou de l’étrancleur
Où va la miraison qui flottait en bombaste
où va la mifolie aux creux des cruses d’asthe
où vont tous les ocieux sur le chemins des mers
on ne sait ce qui court en poignant sur la piste
on ne sait ce qui crie en poussant le tempiste
dans le ciel où l’apur cherche un bénith amer
on ne sait pas
Raymond Queneau, Le Chien à la mandoline, Le Point du jour,
Gallimard, p. 197-198, 141-142, 139-140.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Queneau Raymond | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : raymond queneau, le chien à la mandoline, jeu de langage | ![]() Facebook |
Facebook |
26/09/2011
Paul Valéry, Littérature (Œuvres II)
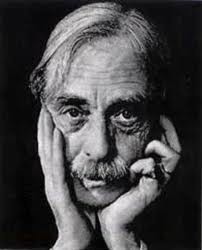
Les livres ont les mêmes ennemis que l’homme : le feu, l’humide, les bêtes, le temps, et leur propre contenu.
Dans le poète :
L’oreille parle,
La bouche écoute ;
C’est l’intelligence, l’éveil, qui enfante et rêve ;
C’est le sommeil qui voit clair ;
C’est l’image et le phantasme qui regardent,
C’est le manque et la lacune qui créent.
La poésie n’est que la littérature réduite à l’essentiel de son principe actif. On l’a purgée des idoles de toute espèce et des illusions réalistes ; de l’équivoque possible entre le langage de la « vérité » et le langage de la « création », etc.
Et ce rôle quasi créateur, fictif du langage — (lui, d’origine pratique et véridique) est rendu le plus évident possible par la fragilité ou par l’arbitraire du sujet.
L’idée d’Inspiration contient celle-ci : Ce qui ne coûte rien est ce qui a le plus de valeur.
Ce qui a le plus de valeur ne doit rien coûter.
Et celle-ci : Se glorifier le plus de ce dont on est le moins responsable.
Quelle honte d’écrire, sans savoir ce que sont langage, verbe, métaphores, changements d’idées, de ton ; ni concevoir la structure de la durée de l’ouvrage, ni les conditions de sa fin ; à peine le pourquoi, et pas du tout le comment ! Rougir d’être la Pythie…
Paul Valéry, Littérature, dans Œuvres II, édition établie et annotée par Jean Hytier, Bibliothèque de la Pléiade, 1960, p. 546, 547, 548 et 550.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, littérature, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
25/09/2011
Emily Jane Brontë, Poèmes (1836-1846)

Viens-t’en avec moi
Viens-t’en avec moi
Il n’est plus que toi
Dont mon cœur puisse se réjouir ;
Nous aimions par les nuits d’hiver
Errer dans la neige :
Si nous renouvelions ces vieux plaisirs ?
Noires et folles, les nuées
Tachent d’ombre, là-haut, les terres élevées
Comme elles faisaient autrefois,
Et ne s’arrêtent que là-bas,
À l’horizon confusément amoncelées,
Tandis que les rayons de lune
Si prestement luisent et fuient
Qu’à peine pouvons-nous dire qu’ils ont souri.
Viens avec moi — viens te promener avec moi ;
Nous étions bien plus autrefois,
Mais la Mort nous a dérobés nos compagnons
Comme le Soleil la rosée ;
Oui, la Mort les a pris un à un, nous laissant
Tous deux seuls désormais ;
Aussi mes sentiments se voudraient-ils aux tiens
Nouer étroitement, n’ayant d’autre soutien.
« Non, ne m’appelle pas, cela ne saurait être ;
L’Amour serait-il si constant ?
La fleur de l’Amitié peut-elle dépérir
Pour revivre après de longs ans ?
Non, quand même le sol est humide de larmes
Et si belle qu’elle ait pu croître ;
Car la sève une fois tarie, son flux vital
Ne s’épanchera jamais plus :
Mieux encore que ne fait l’étroit cachot des morts
La Terre sépare le cœur des hommes. »
[Printemps 1844]
Come, walk with me
Come, walk with me ;
There only thee
To bless my spirit now ;
We used to love on winter nights
To wander throw the snow.
Can we not woo back old delights ?
The clouds rush dark and wild ;
They fleck with shade our mountain heights
The same as long ago,
And on the horizon rest at last
In looming masses piled ;
While moonbeams flash and fly so fast
We scarce can say they smiled.
Come, walk with me — come, walk with me ;
We were not once so few ;
But Death has stolen our company
As sunshine steals the dew :
He took them one by one, and we
are left, the only two ;
So closer would my feelings twine,
Because they have no stay but thine.
« Nay, call me not ; it may not be ;
Is human love so true ?
Can Friendship’s flower droop on for years
And then revive anew ?
No ; though the soil be wet with tears,
How fair soe’er it grew ;
The vital sap once perished
Will never flow again ;
And surer than that dwelling dread,
The narrow dungeon of the dead,
Time parts the hearts of men. »
[Spring 1844]
Emily Jane Brontë, Poèmes (1836-1846), choisis et traduits d’après la leçon des manuscrits par Pierre Leyris, édition bilingue, Poésie / Gallimard, 1963, p. 144-147.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily jane brontë, amour, temps, come, walk with me | ![]() Facebook |
Facebook |
24/09/2011
Jean Paulhan, À demain la poésie
Ce qu'en dit le premier venu
 Il est probable, puisque tout le monde le répète, qu'il y a un mystère dans la poésie. Il est sûr en tout cas que nous nous conduisons à son égard comme s'il y avait un mystère. Tu ouvres un livre de poèmes, et tu es dès l'abord saisi. Avant même d'avoir rien lu. Tu attends. Quoi ? Peu importe, tu attends. Déjà tout séparé, retranché, détaché. De quoi ? Mais par exemple — que tu sois homme, ou poète — de toute jalousie, de tout amour-propre, de tout souci de comparaison. Parfaitement débarrassé de toi-même (ce qui ne va pas toujours sans quelque anxiété). Pourtant, tu n'es pas humilié pour autant. Pas molesté le moins du onde. C'est au contraire : tu te rassembles, tu es tout entier redressé — comme si tu entrais dans un beau monument, comme si tu te mêlais à quelque cérémonie. Tout réconcilié, tu penses à toi sans mauvaise humeur. Ta voix intérieure même se transforme.
Il est probable, puisque tout le monde le répète, qu'il y a un mystère dans la poésie. Il est sûr en tout cas que nous nous conduisons à son égard comme s'il y avait un mystère. Tu ouvres un livre de poèmes, et tu es dès l'abord saisi. Avant même d'avoir rien lu. Tu attends. Quoi ? Peu importe, tu attends. Déjà tout séparé, retranché, détaché. De quoi ? Mais par exemple — que tu sois homme, ou poète — de toute jalousie, de tout amour-propre, de tout souci de comparaison. Parfaitement débarrassé de toi-même (ce qui ne va pas toujours sans quelque anxiété). Pourtant, tu n'es pas humilié pour autant. Pas molesté le moins du onde. C'est au contraire : tu te rassembles, tu es tout entier redressé — comme si tu entrais dans un beau monument, comme si tu te mêlais à quelque cérémonie. Tout réconcilié, tu penses à toi sans mauvaise humeur. Ta voix intérieure même se transforme.
Ensuite vient le poème, laissons cela. Et quand il est passé ? Non, tu n'as pas appris grand-chose. Que le temps passe vite. Si l'on veut. (Pourtant il est toujours là.) Qu'il faut profiter de la vie pendant que tu la tiens. Bien sûr. Peut-être que tes cheveux ressemblent à des feuilles, et tes dents à des rochers. (D'ailleurs, pas tant que ça.) Tu t'en doutais. Cependant, tu te sens vaguement changé, il t'est resté quelque trace de l'évènement : c'est comme s'il était soudain devenu bizarre que les cheveux ressemblent plus ou moins à des feuilles, et que ta vie soit courte. Dans quelle stupeur es-tu plongé, où le plus banal te paraît singulier, et le singulier banal ? Or il arrive que l'état se prolonge et t'étrange quelques moments. (Comme si le mystère de la poésie, c'était de rendre mystérieux tout ce qui n'est pas elle.) Il dépasse de ta manche un fil qui t'agace parce que tu le vois trembloter sur le papier de ton livre. Tu le brûles à la base, du bout de ta cigarette. Alors tu le vois soudain qui se tord en grelottant, puis se penche et s'abat comme un arbre coupé à la hache, tu crois l'entendre gémir. Tu demeures consterné. Un peu plus tard, tout rentre dans l'ordre. Mais entre l'attente et la retombée, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est proprement là le mystère. Et si l'on accorde qu'il est précisément mystérieux que reste-t-il à en dire ? Rien.
Jean Paulhan, À demain, la poésie, Introduction à une anthologie [1947], dans Œuvres complètes, tome II, Le Cercle du Livre précieux, 1966, p. 312.
Publié dans MARGINALIA, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, la poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
23/09/2011
Jacques Réda, L'Herbe des talus

Tombeau de mon livre
Livre après livre on a refermé le même tombeau.
Chaque œuvre a l’air ainsi d’une plus ou moins longue allée
Où la dalle discrète alterne avec le mausolée.
Et l’on dit, c’était moi, peut-être, ou bien : ce fut mon beau
Double infidèle et désormais absorbé dans le site,
Afin que de nouveau j’avance et, comme on ressuscite —
Lazare mal défait des bandelettes et dont l’œil
Encore épouvanté d’ombre cligne sous le soleil —
Je tâtonne parmi l’espace vrai vers la future
Ardeur d’être, pour me donner une autre sépulture.
Jusqu’à ce qu’enfin, mon dernier fantôme enseveli
Sous sa dernière page à la fois navrante et superbe,
Il ne reste rien dans l’allée où j’ai passé que l’herbe
Et sa phrase ininterrompue au vent qui la relit.
Jacques Réda, L'herbe des talus, Gallimard, 1984, p. 208.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l'herbe des talus, tombeau | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2011
Fernando Pessoa, Le Gardeur de troupeaux

Je suis un gardeur de troupeaux.
Le troupeau ce sont mes pensées
Et mes pensées sont toutes des sensations.
Je pense avec les yeux et les oreilles
Et avec les mains et avec les pieds
Et avec le nez et avec la bouche.
Penser une fleur c’est la voir et la respirer
Et manger un fruit c’est en savoir le sens.
C’est pourquoi lorsque par un jour de chaleur
Je me sens triste d’en jouir à ce point,
Et couche de tout mon long dans l’herbe,
Et ferme mes yeux brûlants,
Je sens tout mon corps couché dans la réalité,
Je sais la vérité et je suis heureux.
Fernando Pessoa, Le Gardeur de troupeaux et les autres poèmes d’Alberto Caeiro, traduit du portugais par Armand Guibert, Gallimard, 1960, p. 55-56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, le gardeur de troupeaux, alberto caeiro, armand guibert | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2011
Maurice Blanchot, L'Attente l'Oubli

Il n’est pas vrai que tu sois enfermée avec moi et que tout ce que tu ne m’as pas encore dit te sépare du dehors. Ni l’un ni l’autre nous ne sommes ici. Seuls quelques-uns de nos mots y ont pénétré, et de loin nous les écoutons.
Vous voulez vous séparer de moi ? Mais comment vous y prendrez-vous ? Où irez-vous ? Quel est le lieu où vous n’êtes pas séparée de moi ?
S’il t’est arrivé quelque chose, comment puis-je supporter d’attendre de le savoir pour ne pas le supporter ? S’il t’est arrivé quelque chose — même si cela ne t’arrive que bien plus tard, et longtemps après ma disparition — comment n’est-ce pas insupportable dès maintenant ? Et, c’est vrai, je ne le supporte pas tout à fait.
Attendre, seulement attendre. L’attente étrangère, égale en tous ses moments, comme l’espace en tous ses points, pareille à l’espace ; exerçant la même pression continue, ne l’exerçant pas. L’attente solitaire, qui était en nous et maintenant passée au dehors, attente de nous sans nous, nous forçant à attendre hors de notre propre attente, ne nous laissant plus rien à attendre. D’abord l’intimité, d’abord l’ignorance de l’intimité, d’abord le côte à côte d’instants s’ignorant, se touchant et sans rapport.
Maurice Blanchot, L’Attente l’Oubli, Gallimard, 1962, p. 30-31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice blanchot, l'attente l'oubli | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2011
Jaufre Rudel, Lanquan li jorn son lonc en may...

Lorsque les jours sont longs en mai,
J’aime ouïr les oiseaux lointains ;
Je vais courbé par le désir,
Je songe à un amour lointain,
Et les chants, les fleurs d’aubépine
Valent les glaces de l’hiver.
Jamais d’amour je n’aurai joie
Sinon de cet amour lointain
Car il n’est femme plus parfaite
En nul endroit proche ou lointain.
Elle est si belle et gente et pure
Que je voudrais, pour l’approcher,
Être pris par les Sarrasins.
Triste et joyeux je reviendrai,
Si je la vois, ‘amour lointain.
Mais qui sait quand je la verrai ?
Nos deux pays sont si lointains !
Que de chemins et de passages !
Je ne puis être sûr de rien :
Qu’il en soit comme il plaît à Dieu !
André Berry, Florilège des troubadours, publié avec une préface, une traduction et des notes par A. B., Firmin-Didot, 1930, p. 59.
Lorsque les jours sont longs en mai
Me plaît le doux chant d’oiseaux lointains,
Et quand je suis parti de là
Me souvient d’un amour lointain ;
Lors m’en vais si morne et pensif
Que ni chants ni fleurs d’aubépines
Ne me plaisent plus qu’hiver gelé.
Jamais d’amour je ne jouirai
Si je ne jouis de cet amour lointain,
Je n’en sais de plus noble, ni de meilleur
En nulle part, ni près ni loin ;
De tel prix elle est, vraie et parfaite
Que là-bas au pays des Sarrasins,
Pour elle, je voudrais être appelé captif !
Triste et joyeux m’en séparerai,
Si jamais la vois, de l’amour lointain
Mais je ne sais quand la verrai,
Car trop en est notre pays lointain :
D’ici là sont trop de pas et de chemins ;
Et pour le savoir ne suis pas devin
Mais qu’il en soit tout comme à Dieu plaira.
Poètes et romanciers du Moyen Âge, texte établi et annoté par Albert Pauphilet, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1963, p. 783.

Lorsque les jours sont longs en mai m’est beau le doux chant d’oiseaux de loin et quand je me suis éloigné de là je me souviens d’un amour de loin je vais courbé et incliné de désir si bien que chant ni fleur d’aubépine ne me plaisent comme l’hiver gelé
Jamais d’amour je ne jouirai si je ne jouis de cet amour de loin car mieux ni meilleur je ne connais en aucun lieu ni près ni loin tant est son prix vrai et sûr que là-bas au royaume des Sarrazins pour elle je voudrais être captif
Triste et joyeux je la quitterai quand je verrai cet amour de loin mais je ne sais quand je la verrai car trop sont nos terres loin il y a tant de passages de chemins et moi je ne suis pas devin mais que tout soit comme il plaît à Dieu
Jacques Roubaud, Les Toubadours, anthologie bilingue, Seghers, 1971, p. 75 et 77.
Lanquan li jorn son lonc en may
M’es belhs dous chans d’auzelhs de lonh,
E quan mi suy partiz de lay
Remembra.m d’un amor de lonh :
Vau de talan embroncx e clis
Qi que chans ni flors d’aldelpis
No.m platz plus que l’yverns gelatz.
Ja mais d’amor no.m janziray
Si no.m jau d’est’amot de lonh,
Que gensot ni melhor no.n si
Ves nulha part, ni pres ni lonh ;
Tant es sos pretz verais e fis
Que lay el reng dels Sarrazis
For hieu per lieys chaitius clamatz !
Iratz e gauzens m’en partray,
S’ieu ja la vey, l’amor de lonh :
Mas non sai quoras la veyrai,
Car trop son nostras terras lonh :
Assatz hi a pas e camis,
E per aisso no.n suy devis…
Mas tot sia cum a Dieu platz !
Jaufre Rudel, dans Poètes et romanciers du Moyen Âge, Texte établi et annoté par Albert Pauphilet, Biblliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1963, p. 782 et 783.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jaufre rdel, l"amour de loin, alpbert pauphilet, andré berry, jacques roubaud | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2011
Danielle Collobert, Les joncs, dans Œuvre II

Les joncs enivrés
Rejetaient les épaves des vents
Les fleurs inutiles.
Les ondulations troubles
Au fond des étangs gardaient
Les secrets de la mort.
L’enfance de la mer
Échappe
Au souvenir.
Le mouvement adhère
À l’innocence voulue
D’un regard.
Les formes désagrégées
Glissent
En lambeaux de fuite.
L’écrasant
Sommeil
Restitue
Le rappel.
Les murailles transparentes
Aux falaises
De violence
S’opposent
Aux montées
Des mers.
La continuité engagée
Dans le regard
Accorde
Le temps de la somnolence.
Danielle Collobert, Ensemble III (Les joncs), dans Œuvres II, édition préparée et présentée par Françoise Morvan, P.O.L., 2005, p. 121-124.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2011
Samuel Beckett, Mal vu mal dit

De sa couche elle voit se lever Vénus. Encore. De sa couche par temps clair elle voit se lever Vénus suivie du soleil. Elle en veut alors au principe de notre vie. Encore. Le soir par temps clair elle jouit de sa revanche. À Vénus. Devant l’autre fenêtre. Assise raide sur sa vieille chaise elle guette la radieuse. Sa vieille chaise en sapin à barreaux et sans bras. Elle émerge des derniers rayons et de plus en plus brillante décline et s’abîme à son tour. Vénus. Encore. Droite et raide elle reste là dans l’ombre croissante. Tout de noir vêtue. Garder la pose est plus fort qu’elle. Se dirigeant debout vers un point précis souvent elle se fige. Pour ne pouvoir repartir que longtemps après. Sans plus savoir ni où ni pour quel motif. À genoux surtout elle a du mal à ne pas le rester pour toujours. Les mains posées l’une sur l’autre sur un appui quelconque. Tel le pied de son lit. Et sur elles sa tête. La voilà donc comme changée en pierre face à la nuit. Seuls tranchent sur le noir le blanc de ses cheveux et celui un peu bleuté du visage et des mains. Pour un œil n’ayant pas besoin de lumière pour voir. Tout cela au présent. Comme si elle avait le malheur d’être encore en vie.
Samuel Beckett, Mal vu mal dit, éditions de minuit, 1981, p. 7-8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beckett Samuel | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, mal vu mal dit, vénus | ![]() Facebook |
Facebook |
17/09/2011
Pierre Reverdy, Main d'œuvre

Cœur à cœur
Enfin me voilà debout
Je suis passé par là
Quelqu’un passe aussi par là maintenant
Comme moi
Sans savoir où il va
Je tremblais
Au fond de la chambre le mur était noir
Et il tremblait aussi
Comment avais-je pu franchir le seuil de cette porte
On pourrait crier
Personne n’entend
On pourrait pleurer
Personne ne comprend
J’ai trouvé ton ombre dans l’obscurité
Elle était plus douce que toi-même
Autrefois
Elle était triste dans un coin
La mort t’a apporté cette tranquillité
Mais tu parles tu parles encore
Je voudrais te laisser
S’il venait seulement un peu d’air
Si le dehors nous permettait encore d’y voir clair
On étouffe
Le plafond pèse sur ma tête et me repousse
Où vais-je me mettre où partir
Je n’ai pas assez de place pour mourir
Où vont les pas qui s’éloignent de moi et que j’entends
Là-bas très loin
Nous sommes seuls mon ombre et moi
La nuit descend
La Lucarne ovale (1916), p. 87-88
Temps couvert
Je suis au milieu d’un nuage
de neige
ou de fumée
L’éclat du jour fait son tapage
la fenêtre en battant
ouvre le mur du coin
la paupière assoupie
et l’œil déjà baissé
Plus loin
sur le détour où aurait dû tomber
le grand vent qui passait
en roulant l’atmosphère
la neige et la fumée
Quelques grains de soleil
et le poids de la terre
à peine soulevée
Cravates de chanvre (1922), p. 211.
Pierre Reverdy, Main d’œuvre, poèmes, 1913-1949, Mercure de France, 1949.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, main d'œuvre, la lucarne ovale, cravates de chanvre | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2011
Philippe Beck, Chants populaires
Chaque poème ou chant populaire s’inspire ici d’un conte « noté » par les Grimm.[…] Les Chants populaires dessèchent des contes, relativement. Ou les humidifient à nouveau. Par un chant objectif. Un conte est de la matière chantée ancienne, intempestive et marquante, à cause d’une généralité. (Philippe Beck, Avertissement, p. 7 et 9).

27. Technique
La force de l’homme est le point.
Celui-là sur le banc
fut un homme.
Celui-ci sur le banc continue.
Il devient ce qu’il est.
Qui est un homme ?
Bête se demande.
Elle dit parfois : « Voilà un homme ».
Ou « Voici ».
Elle va sur lui. Droit devant.
Il prend un bâton et souffle dans le dur.
Il souffle autour.
Les braises vont
au visage de la bête.
Des pierres qui brillent.
Des pierres combatives.
Comme foudre mariée à grêle.
Bête sent qu’il y a une idée
dans le souffle. I. cause
étonnement.
Et l’arrêt en plein vol.
En plein air.
Bête allée à Technicité.
En passant.
Elle visite bouche ouverte et tombée
(coquillage)
pays de violence et d’invention.
Silence et inauguration
dans la bête.
Avant les jeux.
Elle commence la vertu commune.
Et les tissus de vertu.
D’après « Le Loup et l’Homme »
Philippe Beck, Chants populaires, collection Poésie, Flammarion, 2007, p. 85-86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Beck Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe beck, grimm, chants populaires | ![]() Facebook |
Facebook |





