31/10/2011
Michel Leiris, Journal, 1922-1989
 Contre la tendance (ou mieux : les prétentions) totalitaire du surréalisme : l'artiste n'a pas à se mêler à tout prix de tous les problèmes du jour (qu'il envisage fatalement sous un angle esthétique, mettant de l'art partout, infestant toutes choses, — alors qu'à l'origine il se proposait de nier l'art en abattant ses barrières (ce faisant, il n'a réussi qu'à libérer, rendre plus pernicieux le fauve)) ; il ne doit pas non plus viser à l'art pur, s'enfermer dans sa tour d'ivoire, se mettre en cage ; simplement, qu'il se pose tous les problèmes du jour, mais qu'il les résolve à sa manière, selon ses moyens propres. Échec pratique de Dada qui, supprimant ces barrières, n'a amené que la pire confusion, le mélange de l'esthétisme à tout.
Contre la tendance (ou mieux : les prétentions) totalitaire du surréalisme : l'artiste n'a pas à se mêler à tout prix de tous les problèmes du jour (qu'il envisage fatalement sous un angle esthétique, mettant de l'art partout, infestant toutes choses, — alors qu'à l'origine il se proposait de nier l'art en abattant ses barrières (ce faisant, il n'a réussi qu'à libérer, rendre plus pernicieux le fauve)) ; il ne doit pas non plus viser à l'art pur, s'enfermer dans sa tour d'ivoire, se mettre en cage ; simplement, qu'il se pose tous les problèmes du jour, mais qu'il les résolve à sa manière, selon ses moyens propres. Échec pratique de Dada qui, supprimant ces barrières, n'a amené que la pire confusion, le mélange de l'esthétisme à tout.
Qu'il y ait pour l'individu une mort sans au-delà, et pour le monde une fin par retour à l'équilibre, enlève aux choses tout « sérieux ». Et c'est pourquoi l'on ne peut parler que de « jeu ».
Que tout soit jeu, cela veut dire que tout est théâtre, simulation, illusion, etc., et qu'en somme « tout n'est que vanité ». Sûr de cela comme je le suis, je pourrais être un pataphysicien conséquent, qui tiendrait pour allant de soi que toutes les solutions sont imaginaires, donc égales entre elles et finalement égales à zéro (car une solution, pour être quelques chose, doit être la solution juste, à l'exclusion des autres). Ainsi, l'idée que je ne fais que jouer mon propre jeu — solution imaginaire entre autres solutions imaginaires — selon mon propre système de valeurs ou choix originel ne me gênerait nullement. Mais le fait est — et là est ma contradiction — que j'éprouve un désir impérieux de justifier objectivement ce système subjectif, de lui trouver des fondements qui dépassent ma propre personne et soient pour mes actions des sortes de lettres de créance, ce qui revient à transformer le jeu en quelque chose de sérieux, de non gratuit, et donc à récuser le côté « bon plaisir » sans lequel il n'est pas de jeu.
Question : une œuvre d'art peut-elle (à elle seule) donner la joie quasi-extatique que donne parfois un spectacle naturel ?
— Il semblerait que non. Mais le spectacle naturel donnerait-il cette joie s'il ne renvoyait à des œuvres qu'on a vues ou à des lectures qu'on a faites ?
Vœu : rester capable de « faire l'art »quand on n'est plus en âge de faire l'amour.
Michel Leiris, Journal, 1922-1989, édition établie, présentée et annotée par Jean Jamin, Gallimard, 1992, 26 décembre 1935, p. 294, 22-24 août 1969, p. 639, 17 août 1977, p. 683.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Leiris Michel, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel leiris, jean jamin journal, art et engagement | ![]() Facebook |
Facebook |
30/10/2011
George Oppen, Poésie complète, traduction Yves di Manno

Si tout partait en fumée
cette fumée
demeurerait
la contrée à
jamais sauvage la lumière du poème la lumière
empruntée du paysage et d’une série d’empreintes l’éloge
au loin
dans la foule
proche tout
ce qui est étrange les sources
les puits le poème ne commence
pas avec le mot
ni le sens mais les petites
entités qui nous
hantent dans les pierres et vaut toujours
moins que cela aidez-moi je suis
de ce peuple les brins
d’herbe se
touchent et dans leur peu
d’écart le poème
commence
George Oppen, Poésie complète, traduit par Yves di Manno, préface de Eliot Weinberger, Éditions Corti, 2011, p. 309-310.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george oppen, poésie complète, yves di manno, si tout partait en fumée | ![]() Facebook |
Facebook |
29/10/2011
Yves Bonnefoy, L'heure présente

Bête effrayée
Ils l’ont heurtée dans ces buissons qu’ils écartaient pour se faire voie. À hauteur de leurs yeux dans les branches où elle avait grimpé, maintenant enchevêtrée dedans, prise au piège. Il la voient, elle les regarde. Son regard est un cœur battant , une pensée.
Et voici que tu la prends dans tes mains, la retire de ce feuillage, elle ne se débat pas, dirais-tu même que tout son corps se détend ? Comme si elle se savait déjà morte, avec l’ultime recours, sous le ciel clair, c’est l’après-midi encore, d’essayer de feindre de l’être.
Morte, pour être abandonnée sur ces pierres qui n’ont pas de cesse sous leurs sandales, et là-bas, dans cette garrigue, c’est déjà un peu de la nuit.
Touche ce pelage, c’est doux. Mais attention à ces griffes !
Le pelage est le marron sombre d’une châtaigne tombée, il a même cette étroite bande de blanc qu’offrent, par en-dessous, les châtaignes. Mais c’est aussi la couleur que prend maintenant le flanc de cette colline que jusqu’à présent nous suivions. Bien finies les étincellances qui bougeaient dans ses ajoncs, il y a un instant encore. Monte la terre brune sous le vert sombre et le peu de jaune et de rouge.
Et regarde ces yeux !
Les yeux sont l’énigme du monde. Car est-ce un regard, ce que tu vois dans cette vie que tu tiens dans tes mains, en commençant à te demander ce que tu vas faire d’elle, oui, lui rendre la liberté, mais quoi d’autre, d’abord ? D’autant que ni toi ni moi ne savons lui donner de nom.
Une belette, une baleine, disait Hamlet. Ou rien que la dérive des nuages dans le ciel de la nuit maintenant tombée. Le flageolet a des trous sur lesquels nos doigts ne savent pas se poser ! une belette, dis-tu, un furet ? Qu’est-ce qu’un furet, qu’est-ce qu’un blaireau ? Je voudrais connaître les noms, dis-tu. Moi je voudrais en imaginer, mais le langage est aussi fermé sur ses ajoncs et ses pierres que le sol de cette colline, tout près de nous, même sous nos pieds. Et je ne vois même plus, si, tout de même un peu, ces petits yeux, ce regard.
Et brusquement la bête se débat, se libère presque. Et tu resserres tes mains, tes doigts. Elle est à nouveau tout immobile.
Va la poser sur cette pierre, là, devant nous. Cette pierre qui brille un peu, car voici que la lune s’est levée, elle a quelques formes pour cet affleurement du rocher, une étendue presque nue, et plate, bien qu’elle ait des bosses mais légères. On croirait la table d’un sacrifice.
Je touche le dos de la bête, ne dois-je pas lui dire adieu, avant qu’elle ne s’échappe, dans ce monde qui ne nous a pas enseigné tous les mots qu’il faudrait, tous les gestes qui délivreraient ?
Et déjà tu te penches, mais nous sursautons, l’un et l’autre, un cri a été poussé, là-bas, près de ces ruines où nous étions, tout à l’heure. Un cri, puis, nous écoutons, quel silence, et à nouveau c’est lui, et qui se prolonge, ce hululement, puis s’arrête.
C’est le même, nous disons-nous. Et de même qu’auprès du temple, nous avons peur.
Mais rien, rien d’autre, rien de plus dans le silence de là-bas et de toutes parts, ce silence qui fait corps avec ce qu’il y a de nuit autour de nous, et ne nous. Car c’est vrai, je l’ai déjà dit, qu’il fait nuit maintenant, sauf toutefois sur cette petite étendue de pierre grise, presque brillante.
Distraitement tu as posé sur la pierre la bête qui est sans mouvement. Et d’un bond elle se déploie et déjà elle a disparu dans les broussailles sombres voisines.
Yves Bonnefoy, L’heure présente, Mercure de France, 2011, p. 47-50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, bête effrayée, l'heure présente, inventer des noms | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2011
James Sacré, D'autres vanités d'écriture
À propos du lyrisme
 Le lyrisme : ou l’histoire de la poésie à travers des confusions de formes et de thèmes. Déjà Pindare fait courir l’homme plutôt que les héros au rythme de ses grandes odes. Horace un peu plus tard mesure les siennes aux dimensions familières du quotidien. Une fois les dieux disparus et quelques solides valeurs métaphysiques-morales éboulées, la poésie épique ne sait plus très bien qui elle est et s’habille d’un nouveau nom : poésie lyrique. Ronsard un instant ne s’y retrouve plus et cherche des repères, il veut par exemple réduire le lyrisme à l’exploitation de quelque thèmes ; mais le voilà qui chante l’amour le plus humain en décasyllabes aussi bien qu’en alexandrins, et la fureur divine l’anime autant sinon plus dans ses sonnets que dans la Franciade. Du Bellay comprend bien qu’il n’y a jamais eu qu’une opposition factice entre les vers épiques et les vers lyriques, que ce n’était qu’une affaire de sujet et de conventions formelles jamais bien respectées, et que la fureur divine n’est en somme que la sublimation d’une mélancolie plus qu’humaine. Le dix-septième siècle s’accroche au mot « sublime », mais Boileau s’empêtre en des « je ne sais quoi » et des va-et-vient ambigus (à propos des formes autant que des thèmes) où l’épique se démêle mal du lyrisme. Puis le « véritable » épique se trouve rapporté à un problématique originel commerce des hommes avec Dieu : toute la poésie avec lui d’ailleurs, ce qui embrouille un peu plus les choses. « L’enthousiasme » de Mme de Staël installe enfin l’épique, et la poésie tout aussi bien, en plein mystère du moi. Dans le même temps le mot lyrisme prend place au cœur de toute écriture poétique. Désormais poètes et poèmes se perdent (ou croient se retrouver) en d’inépuisables abandons ou résistances au moi : plongées dans le rêve ou le subconscient, dans le silence ou le bruit du langage (mais comment ne pas y entendre toujours un semblant de cœur qui bat, désespérément magnifique ou dérisoire ?), ou désir d’une impossible objectivité devenant le monde. De toutes façons c’est toujours, autour d’un moi aussi insaisissable que les anciens dieux, la même impression d’un silence vivant mêlé à la magnifique insignifiance des mots.
Le lyrisme : ou l’histoire de la poésie à travers des confusions de formes et de thèmes. Déjà Pindare fait courir l’homme plutôt que les héros au rythme de ses grandes odes. Horace un peu plus tard mesure les siennes aux dimensions familières du quotidien. Une fois les dieux disparus et quelques solides valeurs métaphysiques-morales éboulées, la poésie épique ne sait plus très bien qui elle est et s’habille d’un nouveau nom : poésie lyrique. Ronsard un instant ne s’y retrouve plus et cherche des repères, il veut par exemple réduire le lyrisme à l’exploitation de quelque thèmes ; mais le voilà qui chante l’amour le plus humain en décasyllabes aussi bien qu’en alexandrins, et la fureur divine l’anime autant sinon plus dans ses sonnets que dans la Franciade. Du Bellay comprend bien qu’il n’y a jamais eu qu’une opposition factice entre les vers épiques et les vers lyriques, que ce n’était qu’une affaire de sujet et de conventions formelles jamais bien respectées, et que la fureur divine n’est en somme que la sublimation d’une mélancolie plus qu’humaine. Le dix-septième siècle s’accroche au mot « sublime », mais Boileau s’empêtre en des « je ne sais quoi » et des va-et-vient ambigus (à propos des formes autant que des thèmes) où l’épique se démêle mal du lyrisme. Puis le « véritable » épique se trouve rapporté à un problématique originel commerce des hommes avec Dieu : toute la poésie avec lui d’ailleurs, ce qui embrouille un peu plus les choses. « L’enthousiasme » de Mme de Staël installe enfin l’épique, et la poésie tout aussi bien, en plein mystère du moi. Dans le même temps le mot lyrisme prend place au cœur de toute écriture poétique. Désormais poètes et poèmes se perdent (ou croient se retrouver) en d’inépuisables abandons ou résistances au moi : plongées dans le rêve ou le subconscient, dans le silence ou le bruit du langage (mais comment ne pas y entendre toujours un semblant de cœur qui bat, désespérément magnifique ou dérisoire ?), ou désir d’une impossible objectivité devenant le monde. De toutes façons c’est toujours, autour d’un moi aussi insaisissable que les anciens dieux, la même impression d’un silence vivant mêlé à la magnifique insignifiance des mots.
James Sacré, D’autres vanités d’écriture, éditions Tarabuste, 2008, p. 91-92.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, d'autres vanités d'écriture, lyrisme, ronsard, du belly | ![]() Facebook |
Facebook |
27/10/2011
Pierre Alferi, ET JUDE ?

ET JUDE ?
ET JUDE où est-il ? dans son trou
normand ? mais non ce mur
de verdure est sa couverture
Jude est en l’air pas loin
au ciel ? mais non pas chez le père
alors il reste dans sa tour
d’ivoire ? mais non
Jude n’est pas obscur ni haut
Jude est chépèr il chine
la quincaillerie
du tapin catholique
à la recherche de la perle
à dissoudre dans le vinaigre
du temps menton volé
de gris démarche
chansautilante voix
raclée reprise fluettranchante
regard papillon qui se pose
à peine larme slave à l’œil
lorgnant le guignon
du siècle dernier il nous reste
tant de cartouches pleines
il lâche eh Jude ne nous lâche pas
le guidon il manque verser
dans le fossé de sa campagne grasse
une luxuriance de serre
chaude frayée à la machette
moderne et il en sort content
du sort il a aimé la scène
qu’il a lue dans un nuage noir
morbide fut macabre
serai dit-il bandant
son arc métrique
d’Actéon forcé
de serf pris en flag
avec la tsarine ou la vierge
aux moches seins
lyrique formaliste ironique
Jude est jalousé par les gros
barons de l’avant-scène
car il est là il reste
dans le siècle n’importe
lequel mais à l’arrière
notre champion notre victor
mature dont Marlene disait
si on le cherche il est derrière
dans la roulotte avec les filles
Pierre Alferi, ET JUDE ?, Lnk, 17, 2011, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre alferi, jude stéfan | ![]() Facebook |
Facebook |
26/10/2011
Jacques Roubaud, Dix hommages
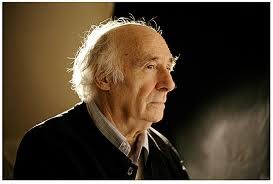
Aux fleurs d’Obermann
Hommage à Jude Stéfan
I
ciel chaotique lacéré cendreux sous
sous les mots chien désœuvrés d’un memento mori
galons, laure blanc pied, bas filés,
trouble-moi, parque : que le temps est un rat,
semblables les vaches dans les années ronsard
et les tourterelles dans les cyprès … jadis jadis
II
heureux, calme ciel, je ne saurais l’être
de 80 poèmes, autant de cyprès
années dédicaces à une lectrice d’arbres
parque, une fille qui pouffe
geste lent des bras de laure dans rousseur
III
pour toi, laure, je m’envole de l’ex-poème
une pierre à mon dos attachée de ciel
la maison et ses vitres lentement tourne sous le cyprès
j’attends la mort des années comme à la selle
IV
in secula avec l’humilité d’un liseron
laure
porte moi comme un cyprès
V
des années, laure, laures
vanités, limon, et de plus en plus loin
VI
vanités, limon, plus loin
Jacques Roubaud, Dix hommages, Lnk, 22, 2011, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaux, dix hommages, jude stéfan, laure | ![]() Facebook |
Facebook |
25/10/2011
Patrick Beurard-Valdoye, Amour en cage

Amour en cage
La parole volante était proscrite
qu’était prison sans parloir ?
dans ses moment perdus l’Europe est une prison
juste un chiriklo qui tend l’espace et le clôt
en effet les tsiganes volaient des poules parfois des enfants ils étaient même des voleurs de langue empruntant où ils passaient des mots et sans les rendre allant jusqu’à corrompre leur sens les savants réputés considéraient l’idiome tsigane comme fait d’éléments de bric et de broc volés aux langues pures l’emprunt étant souvent et explicitement interprété en termes de perte de l’identité linguistique et si l’on avait interdit l’usage de ces mots détournés qu’auraient-ils donc eu à dire à se taire ? aussi les instituteurs faisaient-ils payer une couronne aux garçons surpris parlant le romani les filles on leur rasait la tête.
quant aux gitanes autant jeteuses de sorts que voleuses d’hommes on se souvenait justement de cette affaire du paysan Janik disparu avec la tsigane sans laisser d’autre trace qu’un journal intime versifié publié en feuilleton valache dans le morave Lidové Noviny
le parti agraire prêtait désormais l’oreille aux pétitions paysannes et la loi du 14 juillet combattant la peste tsigane obligeait les nomades et tous mauvestis se livrant à ce mode de vie à se déclarer pour obtenir l’indispensable carnet anthropométrique — la CIKÁNSKÁ LEGITIMACE — avec empreinte des dix doigts mention de noms et surnoms — mais le prénom romani que la mère souffle une seule fois à son nourrisson, l’administration ne l’aurait jamais — et tout détail hauteur poids visage cheveux barbe yeux front menton nez lèvres dents suivi de dix-neuf pages destinées aux observations particulières (à la rubrique profession de ces illettrés qui n’en avaient pas vraiment, le fonctionnaire écrivait TSIGANE) des panneaux d’interdiction fleurissaient accrochés aux branches des êtres ou chênes vénérables parce que les tsiganes illettrés savaient tout de même lire dans l’essence et l’écorce d’un des vingt-quatre hommes-arbres.
Patrick Beurard-Valdoye, Amour en cage, extrait de Gadjo-Migrandt (à paraître), publié dans L’étrangère, n° 26-27, 2011, p. 55-56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick beurard-valdoye, amour en cage, tsigane | ![]() Facebook |
Facebook |
24/10/2011
Jean-Baptiste Clément, Chansons du peuple

Le temps des Cerises
Quand nous en serons au temps des cerises ,
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête.
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur.
Quand nous en serons au temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur.
Mais il est bien court le temps des cerises,
Où l’on s’en va deux cueillir en rêvant
Des pendants d’oreilles,
Cerises d’amour aux robes pareilles,
Tombant sur la feuille en gouttes de sang.
Mais il est bien court le temps des cerises,
Pendants de corail qu’on cueille en rêvant.
Quand vous en serez au temps des cerises,
Si vous avez peur des chagrins d’amour
Évitez les belles.
Moi qui ne craint pas les peines cruelles,
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour.
Quand vous en serez au temps des cerises,
Vous aurez aussi des chagrins d’amour.
J’aimerai toujours le temps des cerises :
C’est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte,
Et dame fortune, en m’étant offerte,
Ne saurait jamais calmer ma douleur.
J’aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur.
Paris-Montmartre, 1866

Jean-Baptiste Clément, Chansons du peuple, Le Temps des Cerises, 2011, p. 59-60.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste clément, le temps des cerises, chansons du peuple, communard | ![]() Facebook |
Facebook |
23/10/2011
Edgar Allan Poe, Un rêve dans un rêve, traduit par Mallarmé
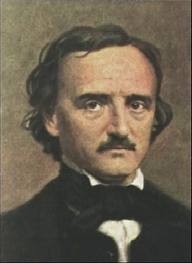
Un rêve dans un rêve
Tiens ! ce baiser sur ton front! et, à l’heure où je te quitte, oui, bien haut, que je te l’avoue : tu n’as pas tort, toi qui juges que mes jours ont été un rêve ; et si l’espoir s’est enfui en une nuit ou en un jour — dans une vison ou aucune, n’en est-il pour cela pas moins PASSÉ ? Tout ce que nous voyons ou paraissons, n’est qu’un rêve dans un rêve.
Je reste en la rumeur d’un rivage par le flot tourmenté et tiens dans la main des grains du sable d’or — bien peu ! encore comme ils glissent à travers mes doigts à l’abîme, pendant que je pleure —pendant que je pleure ! O Dieu ! ne puis-je les serrer d’une étreinte plus sûre ? O Dieu ! ne puis-je en sauver un de la vague impitoyable ? Tout ce que nous voyons ou paraissons, n’est-il qu’un rêve dans un rêve ?
Les poèmes d’Edgar Poe, traduits par Stéphane Mallarmé, Paris, Gallimard, 1928, p. 55-56.
A Dream within a Dream
Take this kiss upon the brow !
And, in parting from you now,
Thus much let me avow —
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream ;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone ?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.
I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand —
How few ! yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep — while I weep !
O God ! can I not grasp
Them with a tighter clasp ?
O God ! can I not save
One from the pitiless wave ?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream ?
Edgar Allan Poe, The Complete Tales and Poems, New York, Vintage Books, 1975.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edgar allan poe, un rêve dans un rêve, stéphane mallarmé | ![]() Facebook |
Facebook |
22/10/2011
Max Jacob, Ballades, Derniers poèmes

Ruine
Trois morceaux de tarte sur un coin de commode et sur une assiette. À cela, on voit que cette boutique fut une pâtisserie. Il paraît qu’il y eut là une boutique. Combien de fois les cloisons de plâtre furent avancées ! Il ne reste plus que la place d’un lit et ce lit même. Trois poils de barbe sur un coin de visage ! Trois coins d’un miroir brisé ! Il s’examine, c’est le fils de la maison : il n’y a plus de maison ! Un veston neuf ajusté à la taille. Un chapeau de paille sur le coin d’une oreille. Trois vieux faux-cols désempesés ont servi de serviette à sa toilette. On sort ? Il regarde... Personne ! le désert avant d’arriver à la plage déserte.
Derniers poèmes en vers et en prose [1961], Poésie/Gallimard, 1982, p. 112.
Nocturne
Sifflet humide des crapauds
bruit des barques la nuit, des rames...
bruit d’un serpent dans les roseaux,
d’un rire étouffé par les mains,
bruit d’un corps lourd qui tombe à l’eau
bruit des pas discrets de la foule,
sous les arbres un bruit de sanglots,
le bruit au loin des saltimbanques.
Max Jacob, Les Pénitents en maillots roses (1925), dans Ballades, Gallimard, 1970, p. 217.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jacob Max | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max jacob, ballades, derniers poèmes, ruine, nocturne | ![]() Facebook |
Facebook |
21/10/2011
Thomas Hardy, À la tombée du jour en novembre

À la tombée du jour en novembre
La lumière de dix heures tombe,
Et un oiseau captif vole,
Là où les pins, comme des valseurs qui attendent,
Relèvent leurs têtes noires.
Des feuilles de hêtre , qui colorent de jaune l’heure de midi,
Flottent aériennes comme des taches sur l’œil ;
J’ai planté chaque arbre au printemps de ma vie,
Et maintenant ils obscurcissent le ciel.
Et les enfants qui flânent par ici
Croient qu’il n’a jamais été
De temps où il ne poussait ici aucun de ces grands arbres,
Que l’on ne verra plus un jour.
Thomas Hardy, Poésies, édition bilingue, traduit par Marie-Hélène Gourlaouen et Bernard Géniès, éditions Les Formes du Secret, 1980, p. 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas hary, poésies, novembre | ![]() Facebook |
Facebook |
20/10/2011
Ezra Pound, ABC de la lecture, traduit par Denis Roche
Ezra Pound a précisé que son A B C de la lecture « ne s’adresse pas à ceux qui sont déjà arrivés à une pleine connaissance du sujet sans en connaître les données ».

QUAND ON SE MET À ÉCRIRE on imite toujours quelque chose qu’on a entendu ou lu.
La majorité des écrivains ne dépasse jamais ce stade.
La véritable éducation ne devrait être confiée qu’aux hommes qui INSISTENT sur le savoir, le reste est affaire de gardiens de moutons.[…] Il faut beaucoup d’expérience pour qu’un homme soit capable de définir une chose dans son propre genre, c’est-à-dire définir la peinture comme peinture, l’écriture comme écriture. On identifie tout de suite le mauvais critique à ce qu’il commence par discuter du poète et non du poème.
Le mauvais poète fait de la mauvaise poésie parce qu’il ne perçoit pas les relations de temps. Il est incapable d’en jouer de manière intéressante, par le moyen des brèves et des longues, des syllabes dures ou molles et des diverses qualités du son qui sont inséparables des mots de son discours.
On ne peut tout mettre en quarante-cinq pages. Mais même si j’avais eu Quatre cent cinquante pages à ma disposition, je n’aurais certes pas écrit un traité convaincant sur l’art du roman. Je n’ai pas écrit de bon roman. Je n’ai pas écrit de roman. Je n’ai pas l’intention d’écrire de romans et je ne dirai à personne comment s’y prendre tant que je n’en aurai pas écrit un moi-même.
Ezra Pound, ABC de la lecture, traduit de l’anglais par Denis Roche, Gallimard, 1967, p. 66, 75, 80 et 179.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, abc de la lecture, denis roche | ![]() Facebook |
Facebook |
19/10/2011
Gilbert Lely, La Femme infidèle, la Sylphide

Écrit à Sainte-Radegonde
Le petit jour d’hiver, tremblant sous ses étoles,
Des tours de Saint-Gratien grisaillait les coupoles.
Amour ! tu m’éveillas dans notre lit bien clos.
Le fleuve Loire en bas roulait ses larges eaux.
Étendu sur le flanc contre Irène-Sylvie,
J’entrai, d’un lent désir, en sa grâce endormie.
Les vitres blêmissaient ; le fils de l’hôtelier,
Une chandelle au poing, descendait l’escalier ;
Et le grand coq lançait, en hérissant sa crête,
Un cri rauque et de pourpre à l’aurore muette.
Gilbert Lely, La Femme infidèle, dans Œuvres poétiques, éditions de la Différence, 1977, p. 111.
Par ce brouillard je dois te parler. Toutes les Buttes-Chaumont meurent toutes les rues avoisinantes les escaliers les impasses quand l’âme de Saint-Just chasse le renard bleu.
Dans mes songes tu es victime.
Le chevreuil était tombé à genoux. Il tremblait excessivement. Je me penchai sur sa blessure. Elle était toute petite. Elle avait la forme d’une étoile. Elle ne saignait pas. Le stylet glissa de mes doigts.Je criai pardon pardon je répétai en sanglotant le nom si doux de l’animal.Il tourna vers moi ses gros yeux où je crus lire plus de pitié pour mes remords que d’horreur pour sa propre torture. Il mourut. Quel silence.
Je me suis vu errer tout un matin d’hiver autour de ton couvent de village lorsque tu étais une petite fille et que je ne te connaissais pas.
Gilbert Lely, La Sylphide ou l’Étoile carnivore, Librairie Le François, 1938, p. 36-37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gilbert laly, le femme infidèle, la sylphide | ![]() Facebook |
Facebook |
18/10/2011
Jean-Baptiste Para, Le dit de l'oiseau

Le dit de l’oiseau
Le soir promet une étrange abondance. Le soleil décret silencieux.
Anges, rentrez chez vous, votre journée est faite.
Je suis l’oiseau qui passe, mon bec est long comme la mort.
*
Aux troncs frais coupés, que disent les sèves ?
Nous étions là pour le triomphe du matin.
Une question se désolait entre les mains des meurtriers.
*
Ce qui reste de ciel, comment le supporter ?
La marche longue des racines, les moitiés d’yeux, les tympans déchirés.
Tu élis pour séjour les villes qu’on assiège.
*
Langues que l’ombre gagne. Les étoiles ne sont plus que plomb de chasse.
Sombrer apprend-il comment l’on sombre ?
*
[…]
Une nuit dans la nuit , et l’aurore n’est pas même conçue, rien qu’un mot, sans nulle tentation. La mort, ta propre mort, un souvenir honteux. Ou peut-être vers la lumière — l’interminable étreinte de la cécité.
*
Oiseau, l’oiseau des cahiers d’enfants.
Les ailes étaient une accolade. Mais aucun vol ne se bâtit dans le regret.
Jean-Baptiste Para, Le dit de l’oiseau, dans Une semaine dans la vie de Mona Grembo, Arcane 17, 1995, p. 47, 48, 50 et 51.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste para, le dit de l'oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |
17/10/2011
Jean Tardieu, Une Voix sans personne

Contre-point-du-jour
Alors alors
encore ? Alors
toujours dans le jour
mon petit ? Toujours dans le
petit jour du dernier
du dernier jour du condamné
à mort le petit jour ?
Toujours dans le
petit jour du condamné à mort
je suis j’étais
je suis j’étais le grincement
de poulie du gosier
dans la gorge coupée
par le pourquoi comment du printemps
À mort le petit jour du premier lilas
du pourquoi comment du pourquoi pas
de la gorge pourquoi de la gorge coupée du printemps
du grincement de la poulie du printemps
de la nuit de la gorge coupée
du petit jour du lilas de la mort
de la mort de pourquoi comment
Et pourquoi pas toujours ?
Et pourquoi pas toujours j’étais je suis
toujours j’étais toujours j’étais
toujours tiré tiré tiré tiré vers le petit jour
par le pourquoi comment
du gai toujours du gai printemps
toujours mon petit toujours !
Le monde immobile
Puits de ténèbres
fontaine sourde
lac sans éclat
présence épaisse
battement faible
l’instant est là
rien ni personne
une ombre lourde
et qui se tait
j’attends des siècles
rien ne résonne
rien n’apparaît
sur ce tombeau
l’espace bouge
c’est ma pensée
pour nul regard
pour nulle oreille
la vérité.
Jean Tardieu, Une voix sans personne, Gallimard, 1954, p. 26-27 et 38-39.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, une voix sans personne, le monde immobile | ![]() Facebook |
Facebook |





