20/04/2014
James Sacré, Ne sont-elles qu'images muettes et regards qu'on ne comprend pas ?

Mais parfois le sourire le pus vivant
Les deux jeunes mères navajos
Qui déjeunaient ce midi à la même table que nous
Sorte de hangar ouvert aux deux extrémités
Pour un peu de fraîcheur
Après la poussière et 38 degrés de chaleur...
Aux puces de Gallup, c'est tous les samedis
Les toujours mêmes stands je suppose, pacotille
Et choses plus ou moins utiles, chargements de bottes de foin
L'endroit pour des pneus neufs ou d'occasion,
Petites pierres de prières, peignes à tisser
Ou crottins de dinosaure pétrifiés...
Là avec chacune leur enfant, avec des rires
Façon d'être et d'éduquer les bambins
Une simplicité et franchise amicale
Le taco bientôt mangé, tout à l'heure
Elles finiront comme nous
De parcourir les deux longues allées du marché
Un pickup truck peut-être les ramènera
En quelque ferme isolée
Dans la campagne environnante ; dans l'au revoir
(Et demande aux enfants d'en dire un)
C'est l'aimable simplicité du monde
De tout le monde (la voilà qui se perd)
Qui nous est servie
[...]
James Sacré, Ne sont-elles qu'images muettes et regards qu'on ne comprend pas ?, lavis de Colette Deblé, Æncrages & Co, 2014, np.
©Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, ne sont-elles qu'images muettes et regards qu'on ne comprend pas, indienne, amitié, enfant | ![]() Facebook |
Facebook |
04/02/2014
James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers

Une semaine avec James Sacré
Animaux
I
Animaux velus sales et grossièrement familiers je vous vois : je lèche un sexe rouge et me réfugie dans vos fourrures et près de vos dents.)
Langage
Nul animal n'y est sauf
Grand cheval rouge ou licorne grande
Misère le mien (lequel ?) m'arrache
Des larmes il traîne à l'envers la charrue
Je rage quoi disparaît
Dans le temps parti je langage
Je vais rêver l'été sera clair il faudra un texte qui prenne régulier le format de la page voilà au centre de l'enfance (l'été s'y abreuve) un cerisier grandit la lumière est l'évidence du bleu je vois par dessus des buissons un bord de tuiles une maison je regarde je désire un poème qui serait du silence le même bleu (j'y bois la transparence de nulle écriture) au centre un cerisier n'y rêve pas que je meurs.
[...]
James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers, André Dimanche, 1993, p. 27-28.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des animaux plus ou moins familiers, été, poème, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
02/02/2014
James Sacré, Donne-moi ton enfance
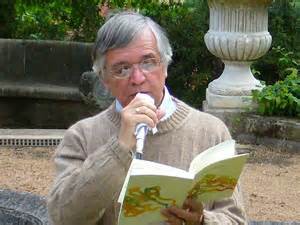
Une semaine avec James Sacré
Un p'tit garçon, je sais plus
Si on cherche bien rien de si puéril ni de vraiment gentil dans ces années disparues. Tous autant qu'on est sait-on pas les gestes surtout méchants, tout le mauvais désir de vivre à la place de l'autre, les jeux cruels poursuivis jusque dans les tendresses qu'on avait ? Et l'indifférence du ciel qui t'emporte en ses tempêtes, l'enfance poussière et paille tout un vol de petits démons dans un grand pet du vent. Forcément que la vie sent mauvais. Faut s'y faire.
*
On finit par se souvenir de choses qu'on n'a peut-être pas vécues quelqu'un t'a raconté vieille femme du village là-bas que tu crois maintenant voir son beau visage qui t'accueille au monde maman t'avait laissé tout seul au bout du champ dans la petite voiture d'enfant, presque rien mais comme si d'un coup la parole t'était donnée avec l'autre et l'ampleur du monde... l'enfance a-t-elle commencé avec le premier souvenir qu'on a ? Et si on l'a quittée en même temps que des culottes courtes ? Personne te dira jamais. La vieille femme du village en savait rien non plus.
James Sacré, Donne-moi ton enfance, Tarabuste, 2013, p. 21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, donne-moi ton enfance, vieille femme, souvenir, mère | ![]() Facebook |
Facebook |
01/02/2014
James Sacré, Parler avec le poème

Une semaine avec James Sacré
Rien de trop solide sur quoi bâtir
(Poésie, lyrisme, modernité)
Poésie
Une poétique oui, si par ce mot on entend façons d'écriture ou style ; mais je n'ai pas de principes a priori, de recettes que je voudrais utiliser ou illustrer. Sans exclure pour autant que cela ne se fasse pas à mon insu. Et quand même, bien sûr, quelques convictions (ou du moins des goûts) : que la poésie par exemple ne met aucun élément du langage à l'écart ; qu'elle ne sait pas ce qu'elle est elle-même entre expérience et langage (y compris entre l'expérience qu'elle fait du langage et les mots qu'elle emploie) ; qu'elle est quelque chose d'aussi vague et fragile que la vie en somme. Oui un signe de vie qui peut-être parfois aussi magnifique que détestable, ou, à l'inverse, aussi misérable que bouleversant. Affaire de relation à l'autre et à soi-même dans le tissage arbitraire (ce qui nous renvoie à nos aveuglements sur nous-mêmes) d'une morale avec nos divers sentiments et nos approximatifs savoirs.
James Sacré, Parler avec le poème, La Baconnière, 2013, p. 141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, parler avec le poème, poétique, langage | ![]() Facebook |
Facebook |
31/01/2014
James Sacré, Portrait du père en travers du temps

Une semaine avec James Sacré
Il n'y a qu'un paysage où j'inventais mon enfance
Qui m'inventait dans ses grands ormes devant la maison
Dans les tas de bûches et de rondins, de fagots
(Les Mouches qu'on appelait l'endroit),
Et le pailler en forme de grande meule dans le vent,
Le foin sous les hangars qu'on était bien dedans...
Il y a que ce paysage a disparu
Les chemins que je prenais, l'arrangement des pâtis, des [prailles, les fontaines
Tout a été défait on ne sait plus très bien
À quoi correspondaient des noms de lieux qu'on a gardés.
Et ça n'est plus que dans le souvenir, de moins en moins [précis,
Que j'en ai.
(29 juillet 2005-17 mars 2007)
James Sacré, Portrait du père en travers du temps, lithographies de Djamel Meskache, La Dragonne, 2009, p. 45.
Photographie Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, portrait du père en travers du temps, paysage, enfance, disparition | ![]() Facebook |
Facebook |
30/01/2014
James Sacré, Trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t'aime

Une semaine avec James Sacré
Le taureau, la rose et le poème
Avec sa fesse en feu souple en soie la femme
Son visage en linges doux avec ses dentelles
Son foin les odeurs sa fouine tiède elle
Travaille à des treillis miraculeux des trames
Elle trame un piège au monde et mine ses atours
(mime ses amours)
Lui crame ses forêts tombent.
Belle elle est la rose
À cueillir au rosier, le projet d'un poème :
Qu'elle porte une épine au cœur de sa splendeur
Le désir en fleurit davantage d'ardeur
De jambes de soleil dans le jeu du poème.
[...]
James Sacré, Trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t'aime, Cadex éditons, dessin de Yvon Vey, 2006, p. 43-44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, trois anciens poèmes mis ensemble pour lui redire je t'aime, rose, femme, aimer, beauté | ![]() Facebook |
Facebook |
29/01/2014
James Sacré, Écrire pour t'aimer ; à S. B.

Une semaine avec James Sacré
Qu'est-ce qu'on fait dimanche ?
Beaucoup de gestes pour aimer sont, tout compte fait, presque rien
Malgré d'extravagantes paroles que des anges ou des chevaux s'ébrouent dedans
T'en souviens-tu comme je t'emporte à jamais dans mon cœur avec ton beau prénom presque rien,
La rengaine d'un amour impossible un dimanche et l'odeur de la brillantine
J'aimerais faire comprendre à travers la qualité rythmique et machine souple
Des mots mis ensemble.
L'effet que produit dans mon corps
La moindre complicité (roublarde ou naïve) que ton sourire accroche
À du temps qui passe entre nous ;
Non pas que je tienne à sauver des sentiments de la ruine
Mais parce que le grand bien-être et force dans le cœur.
À dire tout bonnement que je t'aime, ça ressemble vraiment
À l'ange qui galope dans tous mes poèmes : on le voit mal, mais j'écrirai toujours.
James Sacré, Écrire pour t'aimer ; à S. B., André Dimanche, 1984, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, Écrire pour t'aimer ; à s. b., amour, sentiment, mot, ange | ![]() Facebook |
Facebook |
25/06/2013
James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers
Animaux
4
Quand la pluie. Naïf j'y pressens le bonheur : un pays paraît j'y entre et plus rien ne souffre : le temps devient l'herbe, des toits plus rouges (peu d'herbe : plantain maigre, renouée). Les arbres longtemps sont fans la pluie. Les arbres longtemps sont dans la pluie.
(Dans la lumière que ménage une ouverture de l'écurie (solitude et paille — midi) sous la masse confuse du taureau tout le dessin pesant fin de l'appareil génital tremble (peut-être) ou c'est le jour dans l'été ou la parole du poème : je déchargerais très longtemps tant de foutre ; je devine l'inabordable richesse de mourir.)
Quoi le bonheur ? Le matin naît dans la rencontre d'un gris (pluie, maison délabrée) et d'objets. Un encrier est immédiat — une faïence et des pommes rouges : demandent-ils un poème ? Leur présence est-elle vraie ? J'écris bien ce poème mais où pèse le temps que j'envahis ?
[...]
James Sacré, Des animaux plus ou moins familiers, André Dimanche, 1993, p. 39.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, des animaux plus ou moins familiers, pluie, taureau, poème | ![]() Facebook |
Facebook |
17/02/2013
James Sacré, Un Paradis de poussières

James Sacré a obtenu le prix Max Jacob pour l'ensemble de son œuvre. Il lui sera remis le 21 février au Centre National du Livre.
Au lieu de m'en tenir à des souvenirs jamais précis
(Des choses, de mes sentiments pour ces choses),
A des photographies de mince intérêt, le plus souvent mal prises,
Est-ce que ça serait pas mieux d'oublier tout le détail
De ma rencontre avec des endroits, des moments de ce pays
Avec des gens,
Et de simplement regarder pour écrire
Les images de tant de beaux livres ? n'ont-elles pas
Dans leurs couleurs, dans ce qu'elles donnent à voir
Tous les mots dont j'ai besoin pour dire ?
Ma si pour dire quoi qui me ramène à mon désir
De reprendre un café cassé ?
Le passé mal photographié, demain rien de précis
Je vais continuer de mal oublier.
*
Il y a toujours quelque chose comme une ruine dans ce que
l'œil regarde :
Mur de maison qui s'en va, terrasse qui tombe
Et tout à côté des constructions pas finies, couleur de brique et de béton.
Au loin de grands feuillages d'arbres bougent
(Je pense à ce village en Vendée
Où l'enfance a connu déjà
Ces formes de feuillages muets).
On est à côté de la vie défaite et qui se continue pourtant :
Des bruits de moteurs et le pas des mules,
Une voix qui n'en finit pas de crier je sais pas quoi.
Je pense
A ces grands gestes d'arbres, à l'enfance à jamais solitude
Ça n'aide guère
A savoir se tenir dans le monde en désordre.
James Sacré, Un Paradis de poussières, André Dimanche, 2007,
p. 108-109.
© Photo Tristan Hordé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, un paradis de poussières, maroc et vendée, écrire, mémoire, souvenirs, images | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2012
James Sacré, Le paysage est sans légende (recension)

L'écriture du paysage
Le paysage est sans légende rassemble cinq poèmes, chacun composé de plusieurs suites de vers, qui composent un récit singulier et dont l'unité répond à celle des dessins (encre de Chine et aquarelle) de Guy Calamusa. La particularité du récit provient de son motif, exploré d'autres manières dans une partie importante de l'œuvre : que peut-on écrire (ou dessiner) de ce que l'on a vu ? Qu'est-ce qui, d'une expérience, peut être restitué par les mots ? Le titre semble donner une réponse, si "légende" désigne une note explicative : rien de juste ne sera dit — ce que confirme, inscrit avant la page titre, la mention Le vrai titre s'est effacé.
Le livre s'ouvre sur la description d'un paysage dessiné dans laquelle, pour le lecteur, tout apparaît lisible, soigneusement cerné, visible : le vert y domine et s'y détachent des formes. Cependant, cette reconstruction du paysage par les lignes et les couleurs et par la mémoire n'est guère satisfaisante pour James Sacré ; le temps passant, venu le moment de l'écriture, les mouvements observés avaient perdu de leur réalité et il devenait impossible de leur redonner un sens, comme si tout ce qui avait été vu, vécu, s'était défait, que les différents éléments du paysage — les pentes, les vallées, les arbres — et les femmes qui y travaillaient ne pouvaient être mis en place, que la tentative du regard sur le passé était vouée à échouer : tout se perdrait dans le vert, couleurs à peine présente sur le dessin. On relève au fil des pages les verbes qui traduisent la difficulté, voire l'impossibilité, de tenir ensemble les différents moments du temps, à associer les pièces d'un espace qui se dérobe : brouiller, trembler, déchirer, détruire, (se) défaire.
Plus loin, quand on lit « Je me rappelle très bien », suivi d'un embryon de description, vient rapidement le regret de ne maîtriser que de « fragiles souvenirs » ; on ne peut plus vraiment distinguer les éléments perçus, il s'agit seulement de « silhouettes » — et l'on passe à « J'ai cru reconnaître », mais il ne reste plus qu' « une broussaille / De ratures ni dessin ni rien d'écrit »(1). Il y a une perte irréparable, puisque rien ne peut faire que ce qui constituait un ensemble ne soit pas, dans l'écrit ou le dessin, en désordre. Cette relation du paysage réel, dans lequel on a vécu, et de l'écrit est décevante, et les traits sur la page ne parviennent pas mieux que les mots à approcher la réalité — « Quelqu'un n'est plus/ Qu'un léger dessin de rien ». C'est aussi vers le rien que s'abîment les jours de l'enfance, qu'elle soit ou non mise en parallèle avec le présent ; dans les écrits de James Sacré, un passage s'effectue aisément entre le présent (celui par exemple du travail agricole au Maroc) et le passé (celui de la ferme des parents) : mêmes gestes, rapport aux choses analogue, mais « presque tout / Disparaît dans un poème ».
James Sacré, répondant à la question "Où écrivez-vous ?"(2), précise qu'au moment de l'écriture à sa table, de la reprise de brouillons, interviennent
le souvenir et toute une activité de la mémoire qui mêle à d'anciens sentiments de présence ceux désormais de l'absence et de l'éloignement, de la perte des lieux et des visages, des temps et des espaces ... même quand c'est dans le plus grand effort de continuité avec le "brouillon" d'abord vécu autant qu'écrit. (p. 47)
Sans doute, c'est dire que « Le monde nous échappe. Et puis / Notre désir aussi » ; ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en inquiéter, la poésie n'est pas vouée à fixer les formes des paysages ni à être lieu de mémoire. La re-présentation déçue, le fait qu'écrire n'aboutit — en apparence — qu'à de « minuscules machines de mots pour rien dire », n'empêche pas le poème d'être là, sans qu'il ait pour sujet on ne sait quelle impossibilité de dire quelque chose du réel. Peut-être échoue-t-on dans le désir de fixer une figure stable des choses, mais reprendre inlassablement l'arrangement des mots — des lignes — aboutit à donner un regard sur le monde, si fragmenté qu'il apparaisse ; on pense évidemment à Giacometti qui affirmait : « Tout ce que je pourrai faire ne sera jamais qu'une pâle image de ce que je vois »(3). Il y a toujours chez James Sacré le désir de faire entendre « Le bruit ténu du vivant », et si difficile soit-il à restituer, il est là :
On nomme des endroits de ce monde
L'oued Bouskoura, la rivière Vendée
Un nom de village ou plusieurs choses
Une échelle un puits des noms des mots
Comme pour mieux se tenir au monde
Avec un dessin c'est pas mieux, tout s'éboule
Et pas grand chose
Qui reste dans les mains. Quand même
On est bien.
James Sacré, Le paysage est sans légende, dessins de Guy Calamusa,
Al Manar / éditions Alain Gorius, 48 p., 16 €.
© Photo Tristan Hordé.
1 Ce qui établit une continuité avec les livres précédents : par exemple, Broussaille de prose et de vers (où se trouve pris le mot paysage), publié en 2006 (éditions Obsidiane), abordait aussi, d'une autre manière, le motif de la perte.
2 dans fario, n°11, printemps-été 2012.
3 Alberto Giacometti, Écrits, Hermann, 1992, p. 84.
Publié dans RECENSIONS, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, le paysage est sans légende, souvenir, description, réalité | ![]() Facebook |
Facebook |
06/10/2012
James Sacré, Le paysage est sans légende,

Malgré des mots qu'on y met
Je me rappelle très bien, près d'une ville dont on pourrait dire le nom
La forme d'un village courant sur l'arête d'un long rocher
On le voir à partir d'un autre parvis de pierre
De ce côté-ci de la faille avec du vert qui suit un cours d'eau.
Il y a eu soudain la présence d'un jeune garçon
Dans un vêtement blanc, son invite à traverser. Quelques mots.
On pourrait dire son nom et donner une adresse.
Une autre année le village est resté dans la solitude de nos yeux.
Dans son peu de vert, avec le brillant d'un souvenir.
Une autre année presque tout
Disparaît dans un poème.
*
Je m'en retourne où je ne verrai pas
Ce qui ressemble à du paysage déchiré dans la montagne;
Si le vif des pentes nues
En cette fin d'octobre, et quelques silhouettes dans le lointain
Peut-être une ou deux mules, la pointe d'un capuchon
Ou le geste qui dresse
Un outil agricole dans un endroit plus cultivé du pays
Vont pas quand même
Récrire dans l'œil de ma mémoire
Ce dessin broussaillé qui déchire le temps ?
[...]
James Sacré, Le paysage est sans légende, "Al Manar", éditions Alain Gorius, 2012, p. 20-21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, le paysage est sans légende, paysage, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
29/07/2012
James Sacré, Le paysage est sans légende

Malgré des mots qu'on y met
Je me rappelle très bien, près d'une ville dont on pourrait dire le nom
La forme d'un village courant sur l'arête d'un long rocher
On le voit à partir d'un autre parvis de pierre
De ce côté-ci de la faille avec du vert qui suit un cours d'eau
Il y a eu soudain la présence d'un jeune garçon
Dans un vêtement blanc, son invite à traverser. Quelques mots.
On pourrait dire son nom et donner une adresse.
Une autre année le village est resté dans la solitude de nos yeux.
Dans son peu de vert, avec le brillant d'un souvenir.
Une autre année presque tout
Disparaît dans un poème.
*
Je m'en retourne où je ne verrai pas
Ce qui ressemble à du paysage déchiré dans la montagne ;
Si le vif des pentes nues
En cette fin d'octobre, et quelques silhouettes dans le lointain
Peut-être une ou deux mules, la pointe d'un capuchon
Ou le geste qui dresse
Un outil agricole dans un endroit plus cultivé du pays
Vont pas quand même
Récrire dans l'œil de ma mémoire
Ce dessin broussaillé qui déchire le temps ?
James Sacré, Le paysage est sans légende, dessins de Guy Calamusa,
Al Manar, éditions Alain Gorius, 2012, p. 20-21.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, le paysage est sans légende, nom | ![]() Facebook |
Facebook |
09/05/2012
James Sacré, Si les felos traversent par nos poèmes ?

I
Il y a des noms de villages. De l'ordre dans les champs.
Paysans-masques pour tout chambouler, les voilà
Puis les voilà partis :
Ça se défait d'un coup le carnaval, et comment
C'est là tous les ans, pourquoi ?
Si c'est juste pour que
Tout l'monde un peu rigole ou si
De la vérité soudain te bouscule ?
Pour aussitôt
T'abandonner, silence : le fond d'un pré continue
Ou tel coin de grenier que personne y va plus.
Même à l'occasion des grands défilés fêtards
Organisés tenus selon que c'est prévu,
Bâle ou Rio, Nice et partout, ça s'en va comme à côté :
Un fifre et deux tambours tournent
Le coin de la rue
(Tant pis, t'auras pas ta photo !) ou fifre tout seul
Avec son costume et sa façon têtue
D'avancer dans la ville jusqu'à on se demande, et ça sera
Qu'un retour à la maison, le masque ôté, plus rien.
Si la fête au loin continue ?
Par les chemins de Galice on voit
Les paysans felos
S'en retourner dans les champs
Après qu'il est passé le carnaval,
Passé selon les règles et pas de règles et pas sûr que c'était
Si grande fête au village : façon plutôt de penser
À ça qu'on a perdu, et savoir
Si personne l'a jamais vécu ?
Je pense à des carnavals qui m'emportent
Et qui n'existent plus
Où moi j'ai vécu. Je voudrais venir
Dans un costume de mots
Pour dire à mon village
Qu'on se demande encore, à des endroits qui lui ressemblent
(Châtaigniers, la pluie, quelques paysans),
D'où on vient, qui on est ? Personne a jamais trop su,
Quel sens et pas de sens
En de vieux gestes continués
Parmi ceux de la modernité ?
[...]
James Sacré, Si les felos traversent par nos poèmes ?, photographies d'Emilio Arauxo et James Sacré, éditions Jacques Brémond, 2012, p. 8-15.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, les felos, poèmes, carnaval | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2011
James Sacré, Un paradis de poussière (note de lecture)
James Sacré voyage en s'installant dans une région : il la parcourt sans hâte, observe les paysages, les manières de vivre de se déplacer et d'habiter les lieux, le travail des hommes, et il se nourrit avec les uns et les autres. Ce n'est pas dire qu'Un Paradis de poussières serait un ouvrage d'ethnologue..., c'est bien un livre de poète, construit avec une alternance d'ensembles consacrés au voyage et aux rencontres (18), et des parties lyriques (14) titrées chaque fois "Geste parlé", qui sont des adresses amoureuses à l'Autre.
Il n'est pas nécessaire de connaître l'œuvre de James Sacré pour accueillir cette nouvelle plongée dans le Maroc de Sidi Slimane. On en sort pour des moments à Larache pour la tombe de Jean Genet, un voyage jusqu'à Sakiet Sidi Youssef en Tunisie pour se recueillir en pensant au bombardement de l'armée française le 8 février 1958 ; on revient en France à l'Institut du Monde Arabe ou, à Toulouse, pour un hommage au grand écrivain Edmond Amran El Maleh. Le lecteur des précédents livres ne se retrouvera pas dans du "déjà lu", mais reconnaîtra des motifs propres à ce qui, au fil du temps, est devenu une œuvre : le discours amoureux, la tendresse pour les animaux et les hommes, le questionnement sur la mémoire et sur l'écriture1, les tentatives de nouer les noms de couleur comme sur une toile — ce qui se résout provisoirement par une rencontre avec le peintre Khalil El Ghrib2 —, et sans doute le plus apparent ; le plaisir d'écrire une certaine manière de renaître lors de chacun des séjours au Maroc.
On entre d'emblée dans le livre comme s'il s'agissait d'une relation de voyage. On débute par des notations sur «l'activité marchande» avec «toutes sortes de petites silhouettes», «des camions pleins de couleurs». C'est le jeu des couleurs de ces camions qui arrête le regard, la juxtaposition et l'entrelacement du rouge, du vert, de l'orange, du blanc, du jaune..., « ça fait / Beaucoup de couleurs, et des formes, qui échappent aux mots ». Ce sont les mouvements des uns et des autres, petits marchands d'eau, de figues de barbarie, de beignets, d'escargots, vendeurs de menthe, enfants, chalands oisifs qui sont croqués, et « À vrai dire on pourrait écrire sans fin ». La description ne peut qu'être indécise, toujours à reprendre, à rectifier pour tenter de restituer quelque chose du vivant : une couleur, une forme, un mouvement, des bruits de la rue. Dans chaque "geste parlé", c'est encore la difficulté de parler à l'autre (et de l'entendre vraiment) qui apparaît : « On finit par s'inventer des formules qui ont l'air de dire / Mais on ne sait pas ce qu'elles disent ».
Les deux temps du livre, le récit et le geste parlé, pourraient être perçus comme nettement séparés si l'on se tenait aux titres ; on passe par exemple de "Un soir on a sorti deux chaises devant la porte" à "Ce qu'on mêle en échangeant des mots", ou de "Les gens sont là, pas loin" à "Le mot rien dans le mots vivant". Cependant, dans chaque temps on retrouve une tension analogue : il y a d'une part le désir de "donner à voir", d'autre part celui d'exprimer simplement la complexité d'une relation amoureuse, et le doute de parvenir à noter quelque chose de la réalité telle qu'elle est ou telle qu'elle a été vécue. Dans cette interrogation sur la portée du regard attentif ou amoureux, le lecteur est même introduit dans un poème : « C'est trop descriptif ton poème que tu diras, / Ces vagues mots sur la misère de l'endroit » ; réponse est faite à ce lecteur pour qu'il lise autrement et attache moins d'importance au récit qu'à l'émotion qui en est à la source :
Le poème n'est-il que des mots ? Pour les disposer ainsi, selon un rythme et des arrangements divers,
N'a-t-il pas fallu quelque transport de cœur, fût-ce
Dans le plus grammatical déguisement des phrases ?
Écrire
C'est toujours plus qu'écrire.
Ce qui ne peut venir dans le poème, c'est l'homogène, l'unité de sens. Peut-être l'écrit aide-t-il à ce que le lecteur « s'imagine un peu » ce qui a été vu, mais il ne peut ignorer que le "monde", le rapport à l'Autre n'entrent pas dans les mots. James Sacré ne parvient pas plus à saisir avec la photographie ce qu'il sait devoir toujours lui échapper, il regrette d'ailleurs que ses photographies soient « le plus souvent mal prises ». Ce qui reste, c'est toujours « De la poussière de mots, un poème », la « poussière du poème ». La réalité s'enfuit, même quand est noté ce qui est regardé, et bien plus fragiles encore sont les images du passé : autre poussière, « Poussière du temps, tamis / De la mémoire ». Des moments de la campagne marocaine, des gestes du travail, une couleur de la terre dérangent la durée vécue et rapportent à un temps aboli :
On comprend mieux tout d'un coup que la campagne est pas loin,
Pas si loin non plus (qu'est-ce qui s'en va ?)
Celle que labourait mon père
Avec la même sorte de petit tracteur [...]
C'est aussi le souvenir du village natal en Vendée, le jardin près de la maison, la sieste de la mère qui resurgissent, et les bruits entendus dans la vilel marocaine lui semblent « comme un prolongement des jours de foire aux bestiaux à Coulonges-sur-l'Autize » — « la drôle de charpie que c'est le temps », mais seul 'écrit permet d'évoquer ce « paradis dans la bouche » qu'est le couscous partagé dans un village. Les mots sont « une couture au temps » ; ce sont les mots de l'enfance, régionaux ou appartenant à des techniques anciennes qui viennent à propos des choses du Maroc : "ranche", "cenelle" ou "dorne" : « [...] comme si la terre / Ouvrait sa dorne [= son giron] remplie d'une histoire [...] ».
Sans doute le livre est toujours à faire puisque le poème est là pour « remettre de l'ordre dans le monde »...
James Sacré, Un paradis de poussière, Marseille, André Dimanche, 2007.
Publié dans MARGINALIA, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, un paradis de poussière | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2011
James Sacré, D'autres vanités d'écriture
À propos du lyrisme
 Le lyrisme : ou l’histoire de la poésie à travers des confusions de formes et de thèmes. Déjà Pindare fait courir l’homme plutôt que les héros au rythme de ses grandes odes. Horace un peu plus tard mesure les siennes aux dimensions familières du quotidien. Une fois les dieux disparus et quelques solides valeurs métaphysiques-morales éboulées, la poésie épique ne sait plus très bien qui elle est et s’habille d’un nouveau nom : poésie lyrique. Ronsard un instant ne s’y retrouve plus et cherche des repères, il veut par exemple réduire le lyrisme à l’exploitation de quelque thèmes ; mais le voilà qui chante l’amour le plus humain en décasyllabes aussi bien qu’en alexandrins, et la fureur divine l’anime autant sinon plus dans ses sonnets que dans la Franciade. Du Bellay comprend bien qu’il n’y a jamais eu qu’une opposition factice entre les vers épiques et les vers lyriques, que ce n’était qu’une affaire de sujet et de conventions formelles jamais bien respectées, et que la fureur divine n’est en somme que la sublimation d’une mélancolie plus qu’humaine. Le dix-septième siècle s’accroche au mot « sublime », mais Boileau s’empêtre en des « je ne sais quoi » et des va-et-vient ambigus (à propos des formes autant que des thèmes) où l’épique se démêle mal du lyrisme. Puis le « véritable » épique se trouve rapporté à un problématique originel commerce des hommes avec Dieu : toute la poésie avec lui d’ailleurs, ce qui embrouille un peu plus les choses. « L’enthousiasme » de Mme de Staël installe enfin l’épique, et la poésie tout aussi bien, en plein mystère du moi. Dans le même temps le mot lyrisme prend place au cœur de toute écriture poétique. Désormais poètes et poèmes se perdent (ou croient se retrouver) en d’inépuisables abandons ou résistances au moi : plongées dans le rêve ou le subconscient, dans le silence ou le bruit du langage (mais comment ne pas y entendre toujours un semblant de cœur qui bat, désespérément magnifique ou dérisoire ?), ou désir d’une impossible objectivité devenant le monde. De toutes façons c’est toujours, autour d’un moi aussi insaisissable que les anciens dieux, la même impression d’un silence vivant mêlé à la magnifique insignifiance des mots.
Le lyrisme : ou l’histoire de la poésie à travers des confusions de formes et de thèmes. Déjà Pindare fait courir l’homme plutôt que les héros au rythme de ses grandes odes. Horace un peu plus tard mesure les siennes aux dimensions familières du quotidien. Une fois les dieux disparus et quelques solides valeurs métaphysiques-morales éboulées, la poésie épique ne sait plus très bien qui elle est et s’habille d’un nouveau nom : poésie lyrique. Ronsard un instant ne s’y retrouve plus et cherche des repères, il veut par exemple réduire le lyrisme à l’exploitation de quelque thèmes ; mais le voilà qui chante l’amour le plus humain en décasyllabes aussi bien qu’en alexandrins, et la fureur divine l’anime autant sinon plus dans ses sonnets que dans la Franciade. Du Bellay comprend bien qu’il n’y a jamais eu qu’une opposition factice entre les vers épiques et les vers lyriques, que ce n’était qu’une affaire de sujet et de conventions formelles jamais bien respectées, et que la fureur divine n’est en somme que la sublimation d’une mélancolie plus qu’humaine. Le dix-septième siècle s’accroche au mot « sublime », mais Boileau s’empêtre en des « je ne sais quoi » et des va-et-vient ambigus (à propos des formes autant que des thèmes) où l’épique se démêle mal du lyrisme. Puis le « véritable » épique se trouve rapporté à un problématique originel commerce des hommes avec Dieu : toute la poésie avec lui d’ailleurs, ce qui embrouille un peu plus les choses. « L’enthousiasme » de Mme de Staël installe enfin l’épique, et la poésie tout aussi bien, en plein mystère du moi. Dans le même temps le mot lyrisme prend place au cœur de toute écriture poétique. Désormais poètes et poèmes se perdent (ou croient se retrouver) en d’inépuisables abandons ou résistances au moi : plongées dans le rêve ou le subconscient, dans le silence ou le bruit du langage (mais comment ne pas y entendre toujours un semblant de cœur qui bat, désespérément magnifique ou dérisoire ?), ou désir d’une impossible objectivité devenant le monde. De toutes façons c’est toujours, autour d’un moi aussi insaisissable que les anciens dieux, la même impression d’un silence vivant mêlé à la magnifique insignifiance des mots.
James Sacré, D’autres vanités d’écriture, éditions Tarabuste, 2008, p. 91-92.
Publié dans ESSAIS CRITIQUES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, d'autres vanités d'écriture, lyrisme, ronsard, du belly | ![]() Facebook |
Facebook |







