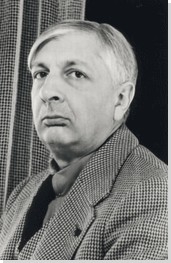30/04/2017
Jacques Prévert, Paroles
Le droit chemin
À chaque kilomètre
chaque année
des vieillards au front borné
indiquent aux enfants la route
d’un geste de ciment armé.
Le grand homme
Chez un tailleur de pierre
où je l’ai rencontré
il faisait prendre ses mesures
pour la postérité.
La bouette ou les grandes inventions
Le paon fait la roue
le hasard fait le reste
Dieu s’assoit dedans
et l’homme la pousse.
La cène
Ils sont à table
Ils ne mangent pas
Ils ne sont pas dans leur assiette
Et leur assiette se tient toute droite
Verticalement derrière leur tête
Jacques Prévert, Paroles, Gallimard,
1949, p. 189-192.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prévert Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques prévert, paroles, chemin, grand homme, brouette, dieu, cène | ![]() Facebook |
Facebook |
29/04/2017
Peter Gizzi, Chansons du seuil
Micro explosion
Juste une petite chanson avec un soupçon de méchanceté.
Un micro chardon sous la ceinture.
C’est ça, tu vois,
ce pincement au sein du céruléen fabuleux.
Ne t’enfuis pas. Tourne-toi vers l’intérieur
à l’aide de ta maigre force.
C’est le plus constant qui gagne l’aventure.
Ce crieur de loto. Ce pont des soupirs.
Et maintenant que tu es là sois brave.
Vis tous azimuts.
Peter Gizzi, Chansons du seuil, traduit par
Stéphane Bouquet, Corti, 2017, p. 44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : peter gizzi, chansons du seuil, stéphane bouquet, explosion, aventure | ![]() Facebook |
Facebook |
28/04/2017
Victor Martinez, Carnets du muet
Le poème, c’est une émeute.
Il faut arracher à la langue son bien, plus grand que la signification.
Le contact est toujours nouveau, à tel point que répétition accroît l’état de la fraicheur.
Contrains tes yeux à ne pas savoir ce qu’ils voient.
Si un mot ne sert pas à mettre à distance les choses, il ne sertà rien.
Victor Martinez, Carnets du muet, fissile, 2016, np.
______________________________________________________________________
Le 7 mai de la patrie et du patron ?
Non, la littérature n’est pas au centre de mes préoccupations jusqu’au 7 mai. Je lis des prises de position d’écrivains qui laissent perplexes ; résumons : les espoirs nés pour eux avec la candidature de Mélenchon ont été déçus, donc ils n’ont pas à choisir entre les deux candidats à l’élection présidentielle. Je ne discuterai pas, c’est maintenant inutile, le programme nationaliste de Mélenchon, mais ceux/celles qui refusent de voter pour Macron le 7 mai ont-ils lu le programme de Le Pen ? l’ont-ils comparé à celui de Macron ? J’en doute, puisqu’ils s’obstinent à prétendre que l’un et l’autre sont des ennemis, d’une nature différente mais des ennemis. J’ai l’impression désagréable d’un retour en arrière et j’entends encore le communiste Duclos en 1969 appeler à l’abstention sur le thème « c’est bonnet blanc et blanc bonnet », à propos de Pompidou et Poher qui s’opposaient alors au second tour de la présidentielle.
Où sommes-nous donc ? Je n’ai pas connu une telle confusion en 2002 (y compris de la part de Mélenchon), Chirac était-il alors moins « le candidat des patrons » que Macron ? L’abstention ne fera peut-être pas de Le Pen une élue — mais rien n’est gagné d’avance —, mais elle obtiendra alors un pourcentage beaucoup plus élevé qu’elle ne le devrait, c’est-à-dire que l’élection sera pour les nationalistes de droite un tremplin pour les élections législatives. Réduire le plus possible le pourcentage des voix, c’est commencer à lutter efficacement contre un parti xénophobe, obscurantiste, tourné vers le passé. Il faut bien commencer et cela, ce n’est pas approuver le programme de Macron, c’est de manière positive commencer à lutter pour qu’un cadre, la république telle qu’elle est, continue à exister : cadre qui permet les luttes, politiques et syndicales.
Je suis gêné d’avoir à écrire de telles évidences.
Publié sur Sitaudis le 27 mai 2017.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor martinez, carnets du muet, le 7 mai de la patrie et du patron | ![]() Facebook |
Facebook |
27/04/2017
Lisa Robertson, Le temps : recension (éditons NOUS)
Deux ensembles alternent dans le livre, l’un formé de proses sur les jours de la semaine (dimanche, lundi, etc.), chacun caractérisé par une météo particulière. L’autre, constitué de vers libres, est plutôt lié aux faits et gestes du "je" présent ; chaque pièce est titrée "Résidence à C [Cambridge]", sauf la dernière, "Porchevers" (après "samedi"), et le livre s’achève par une "Introduction au Temps". En exergue, une citation de Walter Benjamin oriente la lecture : le temps, la mode et l’architecture « se tiennent dans le cycle du même éternellement, jusqu’à ce que le collectif s’en saisisse dans la vie politique et que l’histoire émerge. » Parler du temps qu’il fait est en effet souvent un moyen d’engager la conversation avec quelqu’un que l’on ne connaît pas, et les conversations entre familiers débutent régulièrement par des considérations sur la couleur du ciel, le froid, etc. Ce caractère social du temps est abordé de manière complexe par Robertson.
Est d’abord défini un lieu, « ici », qui peut être n’importe où, « Ici il y a des dermes et des manoirs et des mines et des bois et des forêts et des maisons et des rues [etc.] », et s’y installe un "je". Il faut entendre que les ciels et leurs transformations (vocabulaire abondant et précis concernant les nuages), point de départ du discours de la météorologie, sont aussi figure du temps comme durée, support des fictions. Donc, quoi qui puisse être dit la variabilité du ciel (weather) s’appliquera autant à la succession des jours (time), « Les jours s’amoncellent sur nous » : la phrase est reprise plusieurs fois. Le caractère à peu près imprévisible de l’état du ciel et de ce qui se produira au cours des mois accompagne les mouvements du sujet parlant. La description du ciel en tant que telle n’est pas ce qui importe, mais la relation entre les changements observés par celle qui regarde et ce qu’elle vit, ressent.
L’intrication du temps météorologique et du temps compté est restituée dans la dynamique, fort complexe, du livre. À la succession des deux ensembles en alternance fait écho constamment la construction, à plusieurs niveaux, d’oppositions de forme A vs B, ou A incompatible avec B ; ainsi, deux noms, ou deux adjectifs : « frais et brillants », « crêté et trouble », etc. Aussi souvent, deux domaines hétérogènes sont en même temps liés et séparés : « Un vent vif ; nous sommes du papier projeté contre la barrière » ; il s’agit le plus souvent de formulations renvoyant à la nature et à la culture, associées et opposées, comme weather et time. La répétition (A puis B) est également fréquente, tout comme l’accumulation ou la syntaxe brisée, manières également d’exprimer à la fois la diversité du temps météorologique et la complexité du vécu, le réel et l’imaginé. Le choix de la semaine signifie elle-même la possibilité de la répétition, de la reproduction indéfinie — parallèlement, le compte rendu d’une résidence se termine par une virgule : l’inachèvement et l’inachevable.
L’ensemble des séquences titrées « Résidence à C. », construit autour du "je", n’est pas seulement parallèle aux développements autour du temps, ciel et jour. Outre la présence de la narratrice dans les deux ensembles, d’autres éléments les lient. Quand est relatée la lecture de La bâtarde (de Violette Leduc), lui sont associés des termes relatifs à la météorologie (vent, air) ; par ailleurs la bâtardise, c’est-à-dire l’image d’un temps sans origine, peut être rapprochée d’un passage du premier ensemble constitué d’une interrogation sur des femmes absentes suivie d’une série de prénoms féminins (sans patronyme).
Il faut louer le travail du traducteur qui restitue la vigueur du texte de Lisa Robertson : c’est le poète Éric Suchère qui est ici à l’œuvre, avec le même bonheur que dans sa traduction de Jack Spicer.
Lisa Robertson, Le temps, traduction de l’anglais (Canada) par Éric Suchère, NOUS, 2016, 80 p., 14 €.
Cette recension a été publiée dans Libre-critique en mars 2017.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lisa robertson, le temps (recension) | ![]() Facebook |
Facebook |
26/04/2017
Franz Kafka, Lettres à Felice
20/08/1913 [à Felice]
(…) Je répugne absolument à parler. Du reste ce que je dis est faux à mon sens. À mes yeux la parole ôte à tout ce que je dis importance et sérieux. Il me semble qu’il ne peut en être autrement, étant donné que mille choses et mille pressions extérieures ne cessent d’influencer le discours. Je suis donc taciturne non seulement par nécessité, mais aussi par conviction. L’écriture est la seule forme d’expression qui me convienne, et elle le restera même quand nous serons ensemble.
Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 511.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, parole, écriture, lavage de cerveau | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2017
Étienne Faure, Poèmes d'appartement
De ses nuits à deux corps dans un lit il garde
le réflexe de dormir sur le bord, non pas au centre,
en souvenir de l’autre qui pourrait resurgir,
se lover contre lui, demander asile
un soir de neige à pas feutré traverser la chambre
où le rêve et sa ligne de flottaison persistent
au plus rêche de l’entrée en matière — y a quelqu’un ?
Revient l’épais silence, voix tranchante il répète.
Y a personne.
Comme aux frontières de l’Europe hier
— quelque chose, rien, tout à déclarer —
il écrit, se relève la nuit pour écrire
ce qui pourrait devenir une lettre
sur du papier, juste avant la
Dématérialisation des amours
Et des déclarations qui vont avec
(âmes et hameaux où vivaient les amants qui traversent
à découvert la nuit).
à deux corps
Étienne Faure, Poèmes d’appartement, dans
Rehauts, n° 39, mars 2017, p. 48.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, poèmes d'appartement, rupture, solitude, souvenir, écrire, lettre | ![]() Facebook |
Facebook |
24/04/2017
Giorgio de Chirico, Poèmes
Épode
— Reviens toi ô ma première félicité
la joie habite d’étranges cités
de nouvelles magies sont tombées sur la terre.
Ville des rêves non rêvés
que des démons bâtirent avec une sainte patience
c’est toi que, fidèle, je chanterai.
Un jour je serai aussi un homme-statue
époux veuf sur le sarcophage étrusque
ce jour-là en ta grande étreinte de pierre
ô ville, serre-moi, maternelle.
Giorgio de Chirico, Poèmes, traduits par
Jean-Charles Vegliante, Solin, 1981, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio de chirico, poèmes, épode, ville, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
23/04/2017
Jack Kerouac, Livre des esquisses, 1952-954
Des bruits dans les bois
Caragou Caragine
criastouche, gobu,
bois-crache, trou-ou
boisvert, boisverts
Bzzbeille eskiliagou
arrang-câssez
craké-vieu
vert-oyant bzz
herbzza beille
Fruinionie
Fruiniôme
Démâchetefer
- — Griiazzh
Griayonj —
Ou — une mouche
mutine malmène
un brin d’herbe —
Ou — La fourmi vite
file sur une feuille —
Ou — Village abandonné
ma place dans l’éclaircie
Ou — Je suis mort
Ou — Je suis mort
parce que tout
est déjà arrivé
Je dois aller au-delà
dépasser cette mort
avancer
vers —
le sol
vers —
l’immensité
vers —
la mousse sur les
souches de Babylone
(…)
Jack Kerouac, Livre des esquisses, 1952-1954,
traduction Lucien Suel, La Table ronde, 2010,
- 100-102.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack kerouac, livre des esquisses, des bruits dans les bois, onomatopée, mouche, fourmi, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
22/04/2017
Dino Campana, Chants orphiques
La petite promenade du poète
J’erre dans les rues
Sombres étroites et mystérieuses :
Je vois derrière les fenêtres
Se montrer les Jeannes et Roses.
Sur les marches mystérieuses
Quelqu’un descend en titubant :
Derrière les carreaux luisants
Les commères font leurs commentaires.
…………………………………………
…………………………………………
La ruelle est solitaire :
Pas un chien : quelques étoiles
Dans la nuit au-dessus des toits :
Et la nuit me semble belle.
Et je chemine moi pauvret
Dans la nuit qui me fait rêver,
Mais la salive dans ma bouche
A un goût répugnant. Loin de la puanteur
Loin de la puanteur et le long des rues
Je chemine je chemine,
Déjà les maisons se font rares.
Voici l’herbe : je m’y couche
Et m’y roule comme un chien :
De très loin un ivrogne
Chante son amour aux volets.
Dino Campana, Chants orphiques, traduction
de Michel Sager, Seghers, 1971, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dino capana, chants orphiques, la promenade du poète, nuit, rue, solitude, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
21/04/2017
Giacomo Leopardi, Poèmes et fragments
À soi-même
Or à jamais tu dormiras,
cœur harassé. Or est le dernier mirage,
que je crus éternel. Mort. Et je sens bien
qu’en nous des chères illusions
non seul l’espoir, le désir est éteint.
Dors à jamais Tu as
assez battu. Nulle chose ne vaut
que tu palpites, et de soupirs est indigne
la terre. Amertume et ennui,
non, rien d’autre, la vie ; le monde n’est que bosse.
Or calme-toi. Désespère
un dernier coup. À notre genre le Sort
n’a donné que le mourir. Méprise désormais
toi-même, la nature, et la puissance
brute inconnue qui commande au mal commun,
et l’infinie vanité du Tout.
Giacomo Leopardi, Poèmes et fragments, traduction
de Michel Orcel, La Dogana, 1987, p. 123.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giacomo leopardi, poèmes et fragments, michel oracle, mirage, illusions, désespoir, vanité | ![]() Facebook |
Facebook |
20/04/2017
Au bord de l'eau : Brantôme (Périgord)




Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : au bord de l'eau : brantôme (périgord), reflets, canard. | ![]() Facebook |
Facebook |
19/04/2017
Renée Vivien, La Vénus des aveugles
Chanson pour mon ombre
Droite et longue comme un cyprès,
Mon ombre suit, à pas de louve,
Mes pas que l’aube désapprouve.
Mon ombre marche à pas de louve,
Droite et longue comme un cyprès,
Elle me suit, comme un reproche,
Dans la lumière du matin.
Je vois en elle mon destin
Qui se resserre et se rapproche.
À travers champs, par les matins,
Mon ombre me suit comme un reproche.
Mon ombre suit, comme un remords,
La trace de mes pas sur l’herbe
Lorsque je vais, portant ma gerbe,
Vers l’allée où gîtent les morts.
Mon ombre suit mes pas sur l’herbe
Implacable comme un remords.
Renée Vivien, La Vénus des aveugles, dans Poésies complètes,
Librairie Alphonse Lemerre, 1944, p. 204-205.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : renée vivien, la vénus des aveugles, chanson, ombre, dessin, remords | ![]() Facebook |
Facebook |
18/04/2017
Paul Éluard, Cours naturel
Passionnément
I
J'ai vraiment voulu tout changer
Sur l'herbe du ciel dans la rue
Parmi les linges des maisons
Partout
Elle jouait comme on se noie
Puis elle restait immobile
Pour que je referme sur elle
Les lourdes portes de l'impossible.
II
Le rire après jouer ayant mis à la voile
La table fut un papillon qui s'échappa.
III
Elle déchira sa robe
Elle embrassa
Une toilette neuve et nue.
IV
Dans les caves de l'automne
Elle fut tour à tour
La fleur neigeuse de la foudre
Et le charbon.
V
Dans la ville la maison
Et dans la maison de terre
Et sur la terre une femme
Enfant miroir œil eau et feu.
VI
Sa jeunesse lui donnait
Le pouvoir de vivre seule
Je n'ai pas su limiter
Mon cœur à sa seule poitrine.
VII
Rien que ce doux petit visage
Rien que ce doux petit oiseau
Sur la jetée lointaine où les enfants faiblissent
À la sortie de l'hiver
Quand les nuages commencent à brûler
Comme toujours
Quand l'air frais se colore
Rien que cette jeunesse qui fuit devant la vie.
Paul Éluard, Cours naturel [1938], dans Œuvres complètes I, préface et chronologie de Lucien Scheler, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1968, p. 803-804.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Éluard Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, cours naturel, changement, amour, jeunesse | ![]() Facebook |
Facebook |
17/04/2017
Anna Akhmatova, Requiem
Dédicace
Devant ce malheur les montagnes se courbent
Et le grand fleuve cesse de couler.
Puissants sont les verrous des geôles,
Et derrière, il y a les trous du bagne
Et la tristesse mortelle.
C'est pour les autres que souffle la brise fraîche,
C'est pour les autres que s'attendrit le crépuscule _
Nous n'en savons rien, nous sommes partout les mêmes,
Nous n'entendrons plus rien
Hormis l'odieux grincement des clefs
Et les pas lourds des soldats.
Nous nous levions comme pour les matines,
Dans la Capitale ensauvagée nous marchions,
Pour nous retrouver plus inanimées que les morts.
Voici le soleil plus bas, la Néva plus brumeuse
Et l'espoir nous chante au loin, au loin.
Le verdict... D'un coup jaillissent des larmes.
Déjà elle est retranchée du monde,
Comme si de son cœur on avait arraché la vie,
Ou comme si elle était tombée à la renverse.
Pourtant elle marche... titube... solitaire
Où sont à présent les compagnes d'infortune
De mes deux années d'épouvante ?
Que voient-elles dans la bourrasque sibérienne,
À quoi rêvent-elles sous le cercle lunaire ?
Je leur envoie mon dernier salut.
Mars 1940
Anna Akhmatova, Requiem, traduit du russe par Paul Valet,
éditions de Minuit, 1966, p. 17.
Publié dans Akhmatova Anna, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna akhmatova, requiem, dédicace, malheur, prison, compagne | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2017
Erwann Rougé, L'enclos du vent
la brûlure a une odeur de fleuve
elle bascule sur l’autre rive
noue et délivre
le toucher des genoux et des épaules
guette
ce qui se met en déséquilibre
elle croit qu’elle mène la lumière
sous la langue
veut le retour d’une pluie
Erwann Rougé, L’enclos du vent, photographies
Magali Ballet, éditions isabelle sauvage, 2017, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erwann rougé, l’enclos du vent, brûlure, fleuve, toucher, pluie | ![]() Facebook |
Facebook |