05/03/2016
Emmanuèle Jawad, Faire le mur : recension
Dans les cinq ensembles du livre d’Emmanuèle Jawad, il n’est pas question de construire un ‘’vrai’’ mur : les murs qu’elle énumère existent dans divers pays, elle en rapproche les fonctions et, de cette manière, avive leur réalité par les mots. Par ailleurs, on sait bien que « faire le mur », lorsque l’on est interne, c’est sortir de sa pension sans autorisation; ici, pas de lycéens mais des migrants, des populations recluses, des communautés ennemies qui, pour des raisons différentes, entendent franchir un mur.
Le mur, c’est ce qui, d’abord, interdit le passage, et il est donc de nature variée, en pierre ou de grillage, route frontière gardée ou rivière, « trame de barbelés béton fossés tours, / mines encerclent ». Le plus remarquable sans doute est sa présence en tous points du globe, des murs de Sonora (frontière du Mexique avec les États-Unis), de Melilla, de Ceuta (enclaves espagnoles), de Berlin, à ceux de Pyla (Chypre), de Gaza, de Belfast. Tous ici sont explorés par un regard qui en décrit les caractéristiques ou par une caméra : série de récits de violences faites aux populations, récits qui se déroulent en retenant presque exclusivement ce qui interdit les déplacements — dans trois d’entre eux, une figure féminine, Anna, apparaît, dont on peut se demander si le prénom n’a pas été choisi pour son sens en hébreu, « grâce ».
Au centre du livre, un récit à partir d’un film de Fassbinder, Alexanderplaz, histoire de la ville de Berlin, lui-même adaptation du roman d’Alfred Döblin : ainsi, le texte d’Emmanuèle Jawad se construit en abyme, restituant la complexité de ce qui est à voir. Le mur, partout, empêche le mouvement vers, interdit d’aller voir, et il est garni de tout ce qui permet de surveiller : miradors et caméras qui redoublent son rôle pour empêcher « les circulations libres », qui « hissées filment » et capturent tous les détails, qui prenant images des choses et des gens permettent de décider de leur sort. Il y a d’ailleurs récurrence du mot ‘’capture(r)’’, rien n’échappant à ceux qui interdisent le mouvement, visible ou non : « captures sous terre de bruits et de mouvements »
Le mur peut être détruit, il ne l’est complètement que lorsque le passage entre deux lieux est établi, alors des fragments en sont parfois symboliquement conservés et couverts de fresques, comme à Berlin. Peut aussi être bâti un ouvrage pour conserver la mémoire de ceux qui ont péri à cause du mur :
pierre-feuille-ciseaux
trois tubes fluorescents
poing main plate doigts écartés
la stèle renferme des noms.
On pense au Mur du souvenir (à Struthof), au Mur des noms (Mémorial de la Shoah, à Paris).
La prose d’Emmanuèle Jawad mime la prise du monde par la caméra en en suivant avec précision les mouvements dans l’espace ou par l’énumération de tout ce qui peut être sous l’œil de l’appareil, agglomération telle qu’il suffit de donner un nom en omettant l’article :
double portrait positif négatif, diptyque
onirique, saisie d’un mur, dans le cadre,
mains coupées aux poignets, retenues
à l’arête du mur, superposées, en repos,
dans la montée, se hissant, tête de dos,
[...]
L’unité des cinq ensembles, en vers ou en prose, outre la présence de la caméra, du mur, du prénom Anna, vient aussi de reprises de mots (‘’capture’’, ‘’couture’’, notamment), mais encore d’échos (« s’étend / s’entend », « il sangle centre », « socles sols », etc.) et, régulièrement, de déplacements dans la syntaxe : un nom appartient à deux propositions différentes, comme dans cet exemple : « l’enclos resserre les terres abritent les galeries souterraines » (souligné par moi).
Cette unité travaillée renforce le propos d’Emmanuèle Jawad ; c’est de la violence du monde dans lequel nous vivons dont sa poésie témoigne. Il est rassurant de lire des écrivains pour qui la solitude provoquée par le désastre économique, le sort des migrants d’aujourd’hui ou l’existence hier des camps de la mort est un enjeu : à écrire en poésie — je pense, dans les textes récents, poèmes ou essais, à Philippe Beck, à Jacques Josse, à Jacques Lèbre, à Julien Bosc.
Emmanuèle Jawad, Faire le mur, Lanskine, 2015, 80 p., 12 €. Cette recension a été publiée dans remue.net le 16 février 2016.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : faire le mur, frontière, souvenir, interdit, capturer, emmanuèle jawad | ![]() Facebook |
Facebook |
27/02/2016
Stéphane Korvin, noise ; bas de casse : recension

Jeune écrivain, Stéphane Korvin (né en 1981) dessine, a fondé une revue (Aka), participe au collectif qui publie la revue z : et il a réédité en 2015 Non, rien d’Agnès Rouzier, aux éditions Brûlepourpoint — en attendant de reprendre d’autres titres d’ouvrages jugés importants qui n’avaient pas trouvé leur public au moment de leur parution. Les deux livres publiés en 2015 ont quelques points communs, qu’il s’agisse de la présence forte du corps féminin ou des thèmes de l’oubli, du rêve, de l’invention de la vie, mais aussi du traitement de la syntaxe ou du caractère un peu énigmatique de leur titre. Le vieux mot « noise », ‘’querelle’’, au Moyen Âge aussi ‘’bruit’’ (sens encore de l’anglais), s’utilise rarement seul aujourd’hui ; ici, on lit « un bruit de noises » avec dans le contexte l’évocation du « brouhaha » et des « voix » extérieurs au couple. On relève le sens de ‘’bas de casse’’ (« minuscule »), terme d’imprimerie, dans une image du corps féminin, « ventre, herse, about de hanche // repris / en minuscule sur le pan où se commet / le semis des mots ».
On lit, plus abondamment dans noise que dans bas de casse, des propositions sans lien entre elles, d’autant plus que plusieurs ne peuvent en rien aboutir à une représentation, comme : « les dernières pluies ont causé beaucoup de soufre », « je sommeille longtemps le flanc d’une rivière ». Il ne s’agit pas de reprendre les procédés de quelques surréalistes, mais plutôt de restituer la vision d’un monde éclaté, dans le chaos, où les éléments se chevauchent, perdent la place qui semblait fixée, ce que laissent entendre des passages du texte, ainsi : « je passe pour écrire kaléidoscope » — alors, « les mots sont sans rapport ». Cela ne signifie pas que Korvin privilégie cette forme ; le discours s’organise avec l’introduction du je et du tu et avec la relation amoureuse au corps : « mes doigts qui sentent ton sexe, je ne veux pas les laver ».
Le monde est bien là mais il « est un subtil lointain, l’outil d’une absence ». Il s’impose avec printemps et hiver, forêt, rivière, fleurs (cytise, pulmonaire, iris, achillée), ici un poème est entièrement formé de noms d’oiseaux, là apparaissent les « oiseaux du soir ». Dans ce monde, si « des hommes sont venus », ils semblent appartenir au passé : ce qui occupe l’espace et le temps, c’est avant tout le corps féminin, lié d’ailleurs de différentes manières à la nature, par son odeur de musc, par une relation particulière à l’eau comme si elle devenait ondine, se transformant en pluie ou inventant « un nouveau cours d’eau ».
Le motif de l’invention domine le lien amoureux ; il y a invention d’une bouche, invention d’une journée, et même de partir, comme si la présence ne pouvait se vivre qu’avec l’absence, « nous parcourons des journées entières / à une forêt du corps de l’autre ». L’amour se construirait avec l’effacement des mots et leur répétition, « les mêmes mots répétés / pour tourner la peur » ; la reprise transformée d’éléments donne d’ailleurs une force particulière au lyrisme, comme dans cette suite retenue parmi d’autres : « elle écarte ses jambes sèches » / « je sèche mes jambes dans l’écart de ses jambes molles ». La vie exigerait à la fois l’indistinction du je et du tu — « ma voix dans la tienne » — et la distance, elle « introuvable toujours », sinon dans le rêve.
Le premier livre de Stéphane Korvin (Percolamour, isabelle sauvage, 2012) s’achevait sur un « retour amont », le dernier (bas de casse) sur un promesse d’avenir : « une nouvelle ressource sans / doute ».
Stéphane Korvin, noise, isabelle sauvage, 2015, 88 p., 15 € ; bas de casse, avec 3 dessins de Caroline Sagot-Duvauroux, Æncrages, 2015, np, 18 €. Cette recension a été publiée dans Situais le février 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stéphane korvin, noise, bas de casse, isabelle sauvage, anncrages | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2016
Julien Bosc, De la poussière sur vos cils : recension
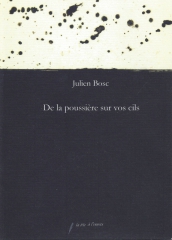
Les vers en exergue extraits de Dans la Conversation, recueil de Jacques Lèbre, orientent la lecture du livre : les corps gazés dans les camps de la mort ont été brûlés et « quelques-uns peuvent dire encore / [...] j’ai vu la fumée s’élever dans le ciel ». Le long ‘’poème prosé’’ de Julien Bosc n’est pas un récit, on y lit des « scories de l’innommable », les traces de ce que des témoins ont écrit, ce qui demeure pour nous de ce qu’ils ont vécu — « quelqu’un cette nuit écrit à partir d’une mémoire qui n’est pas la sienne ». Et d’abord un mur, mur de mémoire, « preuve » du passé et qui porte des noms : pour sa construction, sont énumérés tous les matériaux qui ont été utilisés au cours du temps en divers lieux pour bâtir un mur, marbre, pierre, banco, etc. Rien de tout cela ne convient, et à la question de sa matière une seule réponse : « — Telle la mémoire ? / — Tel le miroir sans tain de la souvenance oui. » Mais la parole sur ce qui fut semble impossible, il n’y aurait que « les mots creusés sur le vide », et cependant personne n’a, aujourd’hui, « le droit d’oublier ce que nous ne pouvons raconter ». C’est à partir de cette impossibilité qu’écrit Julien Bosc.
Ce qui peut être écrit l’est ici dans une forme particulière. Deux personnages, Lui et Elle, dialoguent dans divers lieux ; au début la nuit dans un pré, plus tard dans un hôpital pour la guérir de la folie née du souvenir de l’holocauste (« Elle perdit la raison »), puis dans un village « Entre la montagne et la mer ». Leurs échanges sont parfois accompagnés d’un commentaire et s’achèvent par un fragment en italique, introduit par le « Ô » du lyrisme et reprenant littéralement ou pour le sens ce qui précède. On pense à un livret d’opéra ou à une tragédie, avec dialogues, voix hors champ ou didascalies, intervention d’un chœur, et ce d’autant plus que les répliques sont toujours brèves, la syntaxe et le vocabulaire dépouillés, des fragments de dialogue répétés, la répétition se produisant aussi dans une réplique :
Jamais, jamais je n’ai pu, je n’ai pu jamais, jamais pu, jamais, mais malgré moi tout le temps, minute après minute, nuit et jour sans répit, ni rien, sans répit ni rien, ni rien pouvoir, rien pouvoir faire, rien pouvoir faire taire, à en devenir folle. Folle.
La folie naît du souvenir des camps de la mort, ceux de la ‘’solution finale’’, ce qu’explicite un seul échange :
— Votre nom est-il juif ?
— Oui.
— Êtes-vous juif ?
— Oui.
— Êtes-vous innocent ? Êtes-vous coupable ?
Réponse qui ne peut être entendue : une pierre « est-elle innocente ou est-elle coupable ? ».
La seule amorce de récit du livre est présentée comme un rêve par l’homme, elle décrit un lieu d’où l’on ne peut sortir, un couloir, où des chiens dévorent le visage et le nom, métaphore de l’identité à faire disparaître. Les images de destruction brutale abondent dès l’ouverture ; le dialogue évoque d’abord une porte et des fenêtres, pourtant il ne s’agit pas d’une maison, d’un refuge, la clef est perdue, une main broyée, les yeux aveugles, l’ordre même de la nature défait avec le « givre incandescent ». La poussière sur les cils ? non, ce sont les cendres qui retombent, et avant la mort ce sont les fils barbelés, la langue tranchée, le nom broyé, « les wagons de la mort et la folie dans les wagons ».
Que reste-t-il après « la nuit du retour sans retour » ? Le livre pourrait s’achever sur des questions comme celles-ci, « Quel témoin ? Le témoin du récit ? Quel récit ? » Il reste des noms, des noms inscrits sur un mur, dans la mémoire, et reste donc « le récit d’un mur ». Le hasard des publications a mis sur ma table le livre de Julien Bosc et un entretien de Philippe Beck, ‘’Dialogue de la poésie avec la prose testimoniale’’(1) ; j’en détache pour conclure quelques lignes, qui disent aussi la nécessité pour la poésie d’écrire après les témoins : « Les proses de témoignage (le réel prosant et prosé) en disent toujours plus. C’est l’excès qui demande la poème, selon moi, et en réponse aux vers de Celan : « Niemand / zeugt für den / Zeugen. » (« Gloire de cendres », dans Renverse du souffle). « Nul / ne témoigne pour le / témoin. » Le poète ni le romancier ne témoignant à la place du témoin, et cela se dit en vers libres ; le « témoin » est rejeté après le deuxième vers — le suspens est catégorique. Mais le témoin n’est pas seul et sa prose est précédée, parlée déjà ; elle doit être continuée. »
——————————————————————————————
1. ‘’Dialogue de la poésie avec la prose testimoniale’’, entretien de Philippe Beck avec Frédéric Detue, dans Europe, ‘’Témoigner en littérature’’, janvier-février 2016, p. 221-235. L’ensemble du numéro, dès l’introduction de Frédéric Detue et Charlotte Lacoste, est remarquable.
Julien Bosc, De la poussière sur vos cils, La tête à l'envers, 2015, 13, 50 €.
Cette note a été publiée dans Sitaudis le 5 février 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, de la poussière sur vos cils, jacques lèbre, shoah, folie, mémoire, témoin, juif | ![]() Facebook |
Facebook |
13/02/2016
Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur : recension

Les éditions Verdier puisent pour leur collection de poche dans un fonds patiemment construit depuis 1979 ; dans un format élégant, qui verra bientôt une centième livraison, voisinent Pierre Michon et Varlam Chalamov, Armand Gatti et Jean-Pierre Richard, Rilke et Benny Lévy. L’un des derniers, Julien Letrouvé colporteur, du regretté Pierre Silvain (1926-2009), était paru en 2007, et l’on redécouvre ce récit qui n’est pas étranger, au travers d’une fiction attachante, à l’histoire de la lecture.
Les prophètes à trois sous nous annoncent la fin du livre sur papier, sans savoir, apparemment, que sa diffusion très large aujourd’hui, notamment avec les livres de poche, est très récente. On imagine mal une France, pas si lointaine dans le temps, majoritairement analphabète. À l’époque de Jean-Jacques Rousseau, un succès de vente dépassait rarement 1000 exemplaires, et seuls les livres de la ‘’Bibliothèque bleue’’ étaient connus dans les campagnes — c’est-à-dire dans la plus grande partie du pays : ils y entraient grâce aux colporteurs et ils pouvaient y être lus à voix haute, quand il se trouvait un homme ou une femme instruits. Étrangers aux élites, ces petits livres à couverture bleue réunissaient aussi bien des récits de l’histoire sainte que des recettes de cuisine ou les prophéties de Nostradamus, des condensés des romans du Moyen Âge et des contes de la tradition. Ce sont ces livres que propose Julien Letrouvé dans les villages.
Le nom de Julien Letrouvé est sans ambiguïté : c’est un enfant abandonné à sa naissance ; recueilli dans une ferme, il est gardien de cochons, mais il a passé sa petite enfance au milieu de fileuses, et l’une d’elles, qui maîtrisait la lecture, lisait pour ses compagnes. Qu’à partir de petits signes sur du papier, l’on puisse quitter le moment présent et imaginer d’autres espaces, d’autres temps marque le jeune Julien pour la vie. À la puberté, il devient colporteur mais, négligeant la vente de la mercerie rémunératrice dans ce métier, il se consacre au livre, à ces histoires qui lui ont permis de supporter son sort.
Julien marche et, presque un siècle plus tard, il « eût pu croiser un autre marcheur » dans la région qu’il parcourt, Rimbaud. L’histoire se passe en septembre 1792, le mois de la bataille de Valmy (qui s’est déroulée le 20) et Julien avance sous la pluie vers le lieu des combats. Comme souvent dans les récits de Pierre Silvain, les époques se confondent et, à côté de personnages contemporains rencontrés dans sa marche (l’astronome Laplace, la voiture du roi en fuite), en viennent aussi d’autres, fictif comme Fabrice del Dongo, ou réel comme Chateaubriand. Sont évoqués également les jours de la Terreur de 1793, Gœthe racontant la bataille de Valmy, de petites poupées présentes aussi dans un autre livre, Passage de la morte (2007). Julien, lui, se lie avec un déserteur prussien rencontré lors d’une halte, Voss, qui lit au jeune garçon une des histoires d’un livre bleu ; et le jeune colporteur, penché sur le livre, comme au temps des fileuses, « retrouvait le besoin inapaisable de comprendre ce que lui refusait son ignorance ».
Le lecteur comprend bien qu’il est plongé dans un récit de formation, dans lequel les évocations mêlent de manière convaincante les époques et les lieux, font passer de l’univers du livre à une certaine réalité. Toute initiation connaît des violences ; ici, les soldats prussiens retrouvent le déserteur, le tuent et brûlent les livres, le seul appui de Julien ; ce sont « Le Paradis perdu, l’Âne d’or, Les Voyages de Gulliver, Une vie et Salammbô, Du Côté de chez Swann, Là-bas, Le Bruit et la fureur, L’Odyssée. » Nous sommes sans aucun doute dans le rêve avec cette liste, comme l’est la fin du récit. Julien continue sa route vers nulle part, lui venu de nulle part — sans père ni mère ; il marche tout l’hiver, atteint au printemps une ferme et, à la femme qui l’a accueilli, il affirme qu’il est prêt à poursuivre sa route vers « là-bas ». Mais : « Il n’y a pas de là-bas, ici on est au bout du monde [...]. Et qui pourrait vous attendre, là où vous allez, plus loin que le bout du monde ? » La réponse, si simple, est une superbe manière d’honorer la lecture : « Celle qui lit les livres ». Pierre Silvain, toujours dans une langue précise, maîtrisée, inspirée, n’achève pas le récit sur un échec. L’hiver est terminé et la femme, qui ne sait pas plus lire que Julien, se substituera à la liseuse rêvée, elle ne déchiffrera pas le mystère des mots mais elle deviendra la lectrice du monde.
Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur, Verdier Poche, 2016, 128 p., 7, 50 €.
Cette recension a été publiée sur Situais le 28 janvier 2016.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre sylvain, julien retrouvé colporteur, livre bleu, lecture, rêve, imaginaire | ![]() Facebook |
Facebook |
06/02/2016
Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres, II : recension

Le premier volume des lettres, publié en 2014, était consacré aux lettres de jeunesse, le second a plusieurs caractères particuliers dus à la situation de Beckett : après avoir achevé Watt pendant la guerre, en anglais, il commence à écrire en français, et à être édité par les éditions de Minuit ; alors qu’il a bientôt cinquante ans il connaît en France le succès avec la pièce En attendant Godot, traduite ensuite et jouée dans plusieurs pays, et ses œuvres sont progressivement éditées en Angleterre (Faber and Faber, John Calder), aux États-Unis (Grove Press) et en Allemagne (Fischer Verlag, Suhrkamp Verlag). Une partie seulement des lettres conservées sont publiées — celles qui concernent son œuvre —, et celles de ses correspondants sont parfois données en note quand elles éclairent le texte. Peu de lettres restent de la période de la guerre ; Beckett, résistant, avait quitté Paris et s’était réfugié à Roussillon, village du Luberon, et celles qui subsistent n’ont pu être consultées à la suite du refus du collectionneur.
À partir de 1945 s’ouvre une période très féconde puisque sont écrites une première pièce, Eleutheria, une trilogie romanesque (Molloy, Malone meurt, L’innommable), des nouvelles (réunies plus tard sous le titre Nouvelles et textes pour rien) et En attendant Godot, puis Fin de partie. On retiendra surtout ce qu’écrit Beckett à ses correspondants (notamment, jusqu’en 1954, au critique d’art Georges Duthuit) à propos de ses livres, mais aussi de la peinture — celle en particulier de Bram van Velde — et du théâtre. Il entretient avec son écriture une relation complexe, elle lui est absolument nécessaire et c’est en même temps une épreuve de s’y consacrer ; on retrouvera souvent des remarques analogues à celle-ci, de 1950, « ça vient assez facilement, mais je répugne à m’y mettre, plus que jamais » ; ainsi, un peu plus tard à Barney Rosset, son éditeur aux États-Unis, « Écrire est impossible, mais pas encore suffisamment impossible ». Pour le dire autrement, il y a chez lui, comme il l’écrit à propos de Bram van Velde, « la beauté de l’effort et de l’échec ».
Parallèlement, d’un bout à l’autre de sa correspondance, il exprime constamment sa distance vis-à-vis de ce qu’il écrit, notant par exemple quand il recommence à dactylographier Malone meurt, en juillet 1948, qu’il le fait « en vue de son rejet par les éditeurs » ; cinq années plus tard, il affirme : « J’en ai plus qu’assez de me voir sur du papier imprimé — et autrement » — ce qui ne l’empêche pas d’écrire en français et de traduire ses propres textes en anglais (mais, à propos de Molloy : « ça ne passe pas en anglais, je ne sais pas pourquoi »), d’autres (Éluard, Ponge) pour ‘’Transition’’, la revue de Georges Duthuit. Il suit aussi de près la traduction de En attendant Godot en allemand, en anglais, en espagnol... Mais, comme y insiste le préfacier, Dan Gunn, « personne n’est plus surpris que Beckett lui-même devant le succès auprès de la critique — et encore plus auprès du grand public — qu’obtient son œuvre [En attendant Godot] ».
Surprise, non pas indifférence, même si les réactions vis-à-vis de la pièce l’exaspèrent ; il dira à plusieurs reprises — ici à Pamela Mitchell, en 1955 — « être fatigué de Godot et des interminables malentendus que la pièce semble provoquer partout ». Il refuse presque toujours de répondre aux demandes d’explications, non par mépris mais pour défendre une conception de la littérature ; on lira sa lettre à Michel Polac qui voulait connaître ses idées sur Godot : il y répète de différentes manières qu’il n’écrit pas à partir d’idées. Retenons « Je n’ai pas d’idées sur le théâtre. Je n’y connais rien. Je n’y vais pas. » et, en dernier point, quant au sens à donner à la pièce et « à emporter après le spectacle, avec le programme et les Esquimaux, je suis incapable d’en voir l’intérêt. » Il avait eu une réaction analogue, en 1948, quand des lecteurs avaient avoué leur incompréhension après la lecture de Eleutheria, « Qu’ils prennent de l’aspirine ou qu’ils fassent du fouting avant le petit déjeuner ». Ce qui importe, c’est d’écrire, non d’expliquer ce que l’on a écrit, « À définir la littérature, à sa satisfaction, même brève, où est le gain, même bref ? » Point.
Ce n’est pas pour autant que Beckett n’avait rien à dire à propos de En attendant Godot. Il refuse l’expressionnisme et le symbolisme que suggérer la metteure en scène allemande et insiste sur le « côté farce indispensable » ; à Roger Blin, premier à donner la pièce, il écrit que « rien n’est plus grotesque que le tragique, et il faut l’exprimer jusqu’à la fin », d’où l’exigence, dans la dernière scène, de voir le pantalon d’Estragon tomber à ses pieds. D’où aussi la certitude que le théâtre n’a pas besoin d’adjuvant, qu’il doit être « réduit à ses propres moyens », sans décor particulier, sans rien qui gêne l’écoute du texte et le jeu des acteurs, et il précise dans une lettre à Georges Duthuit : « Quant à la commodité visuelle des spectateurs, je la mets où tu devines ».
Le lecteur reconnaîtra la même absence de concession quand il s’agit de peinture. Il s’indigne (« ce salaud ») quand Maeght ne renouvelle pas le contrat de Bram van Velde, parce que cela prouve que le marchand de tableaux a été incapable de comprendre ce que faisait ce peintre, à savoir qu’il « peint l’impossibilité de peindre », ce que détaille Beckett dans plusieurs lettres et qu’il mettra au net dans Le monde et le pantalon. Il ne respecte pas les convenances et quand des tableaux médiocres de peintres reconnus sont devant lui, il écrit ce qu’il en pense, par exemple à l’occasion d’une exposition de peintres français à Dublin, « Manet navet, Derain inconcevable, Renoir dégob (n’y a pas que Pichette, pardon), Matisse beau bon coça colà ».
On se tromperait cependant si l’on regardait Beckett comme un atrabilaire. L’éditeur Jérôme Lindon affirmait n’avoir pas connu d’homme aussi bon, et on trouvera dans les lettres de nombreux exemples de son souci d’autrui, les preuves aussi de sa reconnaissance envers ceux qui avaient su le lire. Mais il n’acceptait pas les demi mesures, s’en tenant à quelques principes, dont celui-ci : « le respect de l’impossible que nous sommes, impossibles vivants, impossiblement vivants ».
Il faut louer la qualité de l’édition qui mériterait à elle seule un article. Le lecteur apprendra dans l’introduction de Dan Gunn ce qui est nécessaire pour apprécier le grand épistolier qu’était Beckett. En outre, il lira des notices sur les correspondants, feuillettera la bibliographie des ouvrages cités et l’index général, s’attardera sur les 19 photographies (trop peu de Beckett) qui illustrent le volume et, si sa curiosité ne se relâche pas, il suivra le détail des recherches entreprises pour réunir les lettres et les nombreux témoignages qui nourrissent les notes.
Samuel Beckett, Les années Godot, Lettres, II, 1941-1956, traduit de l’anglais par André Topia, Gallimard, 2015, 768 p., 54 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 22 janvier 2016.
Publié dans Beckett Samuel, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : samuel beckett, les années godot, lettres, ii, 1941-1956 | ![]() Facebook |
Facebook |
23/01/2016
André du Bouchet, Entretiens avec Alain Veinstein recension

Alain Veinstein a souvent rencontré André du Bouchet avant de se décider à l’interroger sur sa poésie ; comme il l’écrit dans l’avant-propos, « L’intensité vécue dans mes lectures et nos rencontres, j’ai voulu la partager à la radio ». Les dix entretiens qu’il a réunis, à l’exception de trois pour des journaux, ont été conduits, de 1979 à novembre 2000 (André du Bouchet est mort le 19 avril 2001), pour France Culture.
André du Bouchet a peu commenté la poésie, surtout celle de Reverdy, lu dès son retour des États-Unis en 1948 (où sa famille juive avait dû s’exiler) et dont la poésie lui semblait représenter un « équilibre parfait ». Il a aussi écrit à propos de Baudelaire : sa lecture, dans l’entretien qui ouvre le livre, apprend beaucoup sur ses propres conceptions et pratiques. Baudelaire se serait appliqué à fixer ce qui échappe « à la possibilité de toute expression », et c’est bien également ce que tente du Bouchet. Il s’efforce en effet d’exprimer ce qui déborde le temps, sans cependant être détaché du réel : c’est qu’il y a dans le langage quelque chose qui n’appartient pas à un moment donné. La poésie n’est pas dans un rapport de dépendance par rapport au réel — le poème est le réel, ce que signifie la métaphore « les mots sont debout » —, pas plus qu’elle n’est jeu comme le voulaient la pratique surréaliste ou, plus récemment, l’Oulipo.
Pour du Bouchet, la poésie est le réel notamment parce qu’elle est « tournée vers soi », et c’est pourquoi le lecteur peut rejoindre celui qui écrit : « Vous êtes présent à l’acte de lire, qui vous renvoie à vous-même ». La lecture n’est en effet possible qu’à la condition de faire « confiance aux mots », de faire comme si était engagée et poursuivie une conversation avec quelqu’un. Par ailleurs, la poésie représente par rapport à la réalité vécue une activité de langage « incongrue, inassimilable », parce qu’expression de l’individu dans une société où seule a une valeur la parole collective. L’opposition est d’autant plus marquée que, pour du Bouchet, tout est dans « l’éboulement », la « destruction accélérée », notamment pour ce qui est l’usage de la langue.
La lecture, comme la contemplation d’un tableau, peut être une manière de se mettre, provisoirement, à l’écart, de se protéger « du fracas » ; ce n’est en rien ce qu’implique l’écriture de la poésie où, par le mot, il s’agit « d’être en rapport un instant avec ce qui est en dehors du mot ». Que peut-on atteindre ? Du Bouchet introduit une comparaison avec le jour : il est toujours nouveau mais c’est cette réitération qui nous échappe ; il y a comme un nœud qui ne cesserait pas de se dénouer. Aussi entretient-il par l’écriture un « rapport d’éveil » avec la langue, donc de rupture. Autrement dit, le sens des mots est toujours « au futur, mobile, mouvant à l’infini » chaque fois que l’on en change le contexte, et cette variation conduit à ce que les mots « se requalifiant sans cesse, la conscience critique, qui déloge sans cesse les mots, va de pair avec la notion même de poésie ».
Cette mouvance du sens des mots devient plus que perceptible lorsque l’on se mêle de traduire, et du Bouchet a traduit Celan (avec le poète, qui lui-même a traduit du Bouchet en allemand), Joyce, Mandelstam ; ce qui importe n’est pas ce que les mots ‘’veulent dire’’ mais ce qu’ils disent ; il s’agit chaque fois d’une transposition, écrit-il, « dans l’inaccessible qu’est pour moi le français [...] inaccessible, comme on est inaccessible à soi ». Une démarche analogue se retrouve dans les écrits sur quelques peintres (Tal-Coat, Giacometti, Bram van Velde, de Staël), les tableaux n’étant pas des choses à déchiffrer, à saisir, mais « dont on veut se ressaisir » : dire une expérience, la présence qui s’est imposée, et non prétendre remplacer la peinture par des mots. Les tableaux aident à réfléchir, pour qui a son propre chemin. La voie suivie par du Bouchet a été d’un travail continuel pour parvenir à établir un rapport juste avec le français, « la langue du rapport à soi, avec tout ce qui est de l’ordre du muet » — il faut se souvenir que du Bouchet a fait ses études aux États-Unis. Travail aussi dans l’édition même des poèmes : les blancs dans la page rompaient avec la répétition rythmique de la versification, mimaient l’alternance de la parole et du silence. Dans les premiers livres s’est manifestée aussi l’utopie d’un livre sans commencement ni fin, par l’abandon de la pagination.
On suivra aussi dans les entretiens la pratique, très tôt, des notations sur des carnets ; les notes, toujours hâtivement prises, n’étaient pas pour se souvenir (en ce sens, elles ne constituent pas un journal, comme par exemple le Carnet de notes de Pierre Bergounioux), mais empêchent quelque chose de rester dans l’insignifiance et elles deviennent, parfois, un matériau pour un poème à l’occasion d’une relecture. On suivra encore la relation de du Bouchet au fait d’écrire — beaucoup de livres écrits ? « C’est là, peut-être, la pauvreté d’une vie » — et aux livres : il en gardait peu, « c’est un passé qui encombre »... Et l’on réfléchira à sa réponse sur le rôle de la poésie : « Elle n’a jamais eu de rôle, et c’est ce qui en fait de la poésie. »
André du Bouchet, Entretiens avec Alain Veinstein, L’Atelier contemporain / INA, 2015, 128 p., 20 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 3 janvier 2016.
Publié dans Bouchet André du, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, entretiens avec alain veinstein, poésie, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
22/12/2015
Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes : recension
Emily Dickinson a été largement accueillie en France et, avec des points de vue différents, traduite pour un ensemble de poèmes par Pierre Leyris et Patrick Reumaux, pour une grande partie de l’œuvre par Claire Malroux qui, en outre, lui a consacré un livre(1). Il existe un dizaine d’autres choix dont, à vrai dire, on ne comprend pas toujours le principe, et seulement une traduction complète des poèmes proposée par Francoise Delphy(2). François Heusbourg, lui, retient 60 poèmes parmi ceux écrits en 1863, l’année « la plus prolifique de l’auteur avec près de 300 poèmes écrits, et qui marque le début d’un réclusion progressive qui fera sa légende ». Sa sélection propose des poèmes relativement longs (plusieurs strophes) et de très courts (le premier traduit, 2 vers) ; elle recouvre les thèmes propres à Emily Dickinson, mais choix et traduction aboutissent à lui donner un visage différent, moins sombre, plus varié que celui très souvent proposé.
Dans les poèmes choisis, la mort demeure un thème important et elle garde, ni plus ni moins, les valeurs que lui impose la poésie lyrique et, en particulier, celle de la fin du xvie siècle : elle s’oppose à tout ce qui est mouvement, transformation, passage. Étrangère à ce qui constitue le quotidien, elle est inconnaissable et, donc, n’est en rien l’essentiel de ce qui devrait préoccuper les vivants : « Je pourrais mourir — pour savoir / C’est un savoir insignifiant ». Elle ne peut être qu’imaginée, comme si elle appartenait à l’univers du théâtre, la vie s’apparentant à une fiction sans cesse à construire. Par ailleurs, il y a une séparation totale d’avec les morts dont les tombes n’ont rien à voir avec le vivant, ce que rappelle le poème dont le premier vers est repris pour titre du recueil :
Nous ne jouons pas sur les Tombes —
Car il n’y a pas de Place —
De plus — ce n’est pas plat — ça penche
Le désespoir est beaucoup plus présent que la mort dans le vécu : « Nul Homme ne peut compasser un Désespoir », désespoir aussi violent que celui des naufragés qui ne voient pas le rivage. La métaphore n’est pas indifférente, la mer figurant aussi l’éternité, éternité seulement présente dans la nature, par exemple encore avec les « faces éternelles » des montagnes. S’il y a désespoir, c’est sans doute par absence de Dieu, ou plutôt d’un signe de la divinité créant ici sans peine un Soleil, mais « Là — oubliant un Homme — ». C’est peut-être, tout autant, par impossibilité de comprendre : comprendre pourquoi ‘’je’’ est ; ce qu’exprime avec force un vers, « L’Expression la plus Vitale du Drame est le Jour Ordinaire ». Du désespoir, de l’incompréhension naissent la douleur qui, donc, n’a pas de début ni de fin, « Son infini contient / Son passé ».
Poésie sombre ? certainement si l’on isole certains poèmes, et l’on peut ajouter que l’obscurité, celle de la nuit est toujours crainte, figure par excellence de la séparation. Le choix de François Heusbourg, bien heureusement, engage une lecture plus complexe — plus juste — d’Emily Dickinson. Certes, elle écrit « Je n’ai pas l’habitude de l’Espoir », mais le motif de la joie est souvent associé à celui de la douleur, mais la place du rêve est essentielle dès qu’il y a méditation sur le monde et parce que nous sommes vivants : « Nous rêvons — c’est bon que nous rêvions », mais il y a un plaisir à vivre le quotidien. Il faut aussi apprécier l’humour d’Emily Dickinson quand, par exemple, elle se définit vivante grâce au souffle dans le miroir, mais aussi parce qu’elle est absente du salon et qu’elle n’est pas propriétaire d’une maison, ou ailleurs comparant le jour et elle-même elle constate que tous deux ont leur crépuscule, mais : « Le mien est plus pratique / À porter dans la Main ».
On pourrait aussi lire dans les poèmes de celle qui vécut solitaire (« Seule [...] comme une Église en ruines ») une érotique, toujours exprimée par le biais de figures ; c’est la mer qui s’ouvre, c’est le soleil qui « Cherche longuement — d’un dernier — regard doré — / Une compagnie — pour la nuit —». Et l’amour est un « petit labeur », écrit-elle, « assez grand pour moi ». Et le mouvement vers les autres prend une autre forme ; quand Emily Dickinson énumère ce qui fait sens dans la vie (le soleil, l’été, le paradis), elle en vient à conclure que les poètes « semblent / Comprendre le Tout », et la place de la poésie dans la vie devrait être d’autant plus essentielle qu’est reconnue l’impossibilité de dire exactement ce qui est à dire. Plus largement, « La Province des Sauvés / Devrait être l’Art ».
J’ai choisi des poèmes dans le choix de François Heusbourg et, ce faisant, n’ai évidemment mis en valeur que quelques aspects d’une poésie dont d’autres ont dit la complexité. Je n’ai rien dit de l’avant-propos : vive lecture que le poème en prose de Caroline Sagot Duvauroux, pour qui Emily Dickinson « arpente le bord changeant de la lumière, le roulis, le seuil glissant d’un je à l’autre je, parmi les épaves dont nous sommes ramasseurs. »
Emily Dickinson, Nous ne jouons pas sur les tombes, édition bilingue, traduit de l’américain par François Heusbourg, éditions Unes, 2015, 136 p., 21 €.
Cette note a été publiée dans Sitaudis le 7 décembre 2015.
- On lira les traductions de Pierre Leyris dans son Esquisse d’une anthologie de la poésie américaine du xixesiècle (Gallimard, 1995). Pour Patrick Reumaux : traduction, préface et postface, Emily Dickinson : Le paradis est au choix (Elisabeth Brunet, 1998). Pour Claire Maltoux : traduction et présentation : Emily Dickinson, Une âme en incandescence, Lettres au maître, à l’ami au précepteur, à l’amant (José Corti, 1998) ; Emily Dickinson, Quatrains et autres poèmes brefs, édition bilingue (Poésie / Gallimard, 2000) ; Car l'adieu, c'est la nuit (Poésie / Gallimard, 2007) : Avec amour Emily, Y aura-t-il pour de vrai un matin (José Corti, 2008) ; et Chambre avec vue sur l’éternité : Emily Dickinson (Gallimard, 2005)
- Emily Dickinson, Poésies complètes, édition bilingue, traduction de Françoise Delphy, Flammarion, 2010, 1472 p.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, nous ne jouons pas sur les tombes françois heusbourg | ![]() Facebook |
Facebook |
20/11/2015
Angela Lugrin, En-dehors : recension
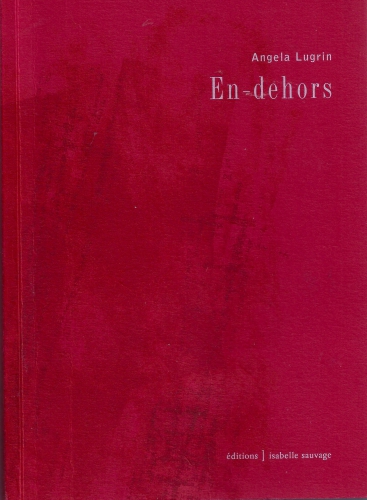
Les prisons ne sont plus des lieux où ceux qui ont été mis à l’écart de la société après jugement sont totalement abandonnés à eux-mêmes ; même si le nombre de prisonniers qui souhaitent suivre un enseignement reste faible, il est en progression. Angela Lugrin a enseigné la littérature à la prison de la Santé pour les épreuves de français du baccalauréat, avec au programme Le Cid et Les Liaisons dangereuses, et c’est ce travail d’un an qui est l’objet de En-dehors. On ne lira pourtant pas un compte rendu des difficultés à enseigner en milieu carcéral : elles ne sont pas plus importantes qu’au collège ; on apprendra plus sur sa manière de faire lire des textes ‘’classiques’’ à des détenus qui, dans leur vie présente, sont fort loin des subtilités de la littérature — l’un d’eux écrit d’ailleurs fort justement : « Mon état actuel ne me permet pas d’avoir les idées claires ». La professeure abandonne les schémas scolaires, fondant la lecture des textes sur les réactions de ces lecteurs particuliers, quitte à longuement argumenter pour mettre en cause des propositions pour le moins conventionnelles vis-à-vis des femmes et de la société. Ainsi, quand ils voient en Chimène le modèle négatif de toutes les femmes, elle explique que les mots sont les seules armes de la jeune femme ; sachant cependant que pour les prisonniers Chimène, comme elle l’écrit, « c’est un peu moi et mes papiers ». Cependant, le fait d’insister sur la validité de toute « lecture libre » qui s’appuie sur le texte, de rejeter la lecture d’autorité finit par avoir des effets : au fur et à mesure que l’étude des Liaisons dangereuses progresse, « on avance [...] dans le texte avec une vérité que je ne connais plus dans les écoles au-dehors des murs. » L’année s’achève avec le succès de plusieurs à l’examen, mais le récit d’Angela Lugrin, d’une certaine manière, relate moins ce qu’a été sa pratique d’enseignante que sa vision des prisonniers et ses propres rapports au monde.
Dans En-dehors, le lieu ‘’prison’’ est ambigu ; pour ceux qui y sont enfermés, ce n’est pas un lieu « où la langue interroge sans fin l’aurore et les ruines » — la littérature — mais où seule la question de la libération a un sens. Angela Lugrin, elle, revient régulièrement à cette idée qu’elle abandonne à la porte de la prison « la précipitation de la vie », et qu’elle entre chaque fois « dans un espace à l’abri, une terre de l’enfance, un lac noir de chagrins d’adultes ». On comprend alors qu’elle écrive, quand elle en sort : « la porte qui s’ouvre sur la rue de la Santé, sur Paris [...], on ne peut pas dire que ce soit un retour à la réalité. Ce serait plutôt le retour à nos enfermements respectifs. » L’enfance qu’elle évoque, c’est d’abord la sienne, quand elle rencontrait les malades que soignait son père dans un hôpital psychiatrique, quand elle se souvient aussi d’un « vieux rêve, un rêve de l’enfance, un rêve de prison », quand elle s’imagine à l’écart de toute institution, un peu « brigand ».
C’est pourquoi elle ne se demande pas pourquoi ses étudiants ont été jugés et enfermés, et ce n’est pas seulement parce que ce savoir risquerait alors de gêner sa pratique d’enseignante : pour elle, ce qu’elle cherche à retenir des prisonniers, c’est « ce qui leur reste, lorsque même le crime les a désertés » ; voyant par exemple dans un rêve deux jeunes détenus, ce qui la frappe c’est que « leur visage est celui d’enfants ». Cette enfance, elle est constamment présente, dans la « fragilité d’un regard », dans une voix, dans la lecture d’un texte ou quand un détenu tombe de sa chaise : sa chute provoque un rire général et « ils sont comme des enfants et j’ai encore le rôle de la maîtresse ». Parallèlement, dépouillés de leur passé, de leur échec à vivre au dehors, tous lui apparaissent beaux ; son frère, médecin, peut lui reprocher d’en faire des « portraits angéliques », elle les voit cependant « comme des pauvres, ou des seigneurs d’un autre âge » et, devant des initiales tatouées (VMI), elle écrit « je trouve ça beau » quand on lui en donne le sens, ‘’vaincu mais indompté’’.
Si l’on ne retenait que ces passages du livre, on parlerait de fascination pour le monde carcéral. Les choses ne sont pas si simples. Angela Lugrin n’ignore pas du tout la violence qui règne dans la prison, pas plus que celle qui y a conduit ses étudiants ; elle observe aussi que l’enfermement marque les corps jusque dans la démarche et elle a en tête cette remarque d’un détenu, « Vous ne pouvez rien pour nous ». Plus encore, elle a vite compris qu’il lui fallait être « en-dehors », refuser toute ambiguïté dans sa relation avec les uns et les autres, pas au nom d’on ne sait quel principe mais pour conserver le regard particulier qu’elle porte sur les détenus, et il faut bien entendre ce qu’elle définit comme ‘’distance’’ ; « La distance comme une pudeur, une prudence face au réel de la douleur. Si la distance est trahie, la beauté disparaît, l’impensable peut surgir. »
Angela Lugrin, En-dehors, éditions isabelle sauvage, 160 p., 18 €.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : angela lugrin, en-dehors, prison, littérature, enseignement, distance | ![]() Facebook |
Facebook |
22/10/2015
Rose Ausländer, Pays maternel ;Été aveugle : recension
"Ausländer" signifie en allemand « étranger » ; étrangère, par force, à son pays et à sa langue, ce fut le sort de cette auteure juive. Rose Ausländer (1901-1988), née Rosalie Scherzer, quitte Czernowitz et accompagne son mari aux États-Unis dans les années 1920, la Bucovine étant devenue roumaine. De retour, elle publie son premier recueil en 1939 ; pendant la Shoah, elle connaît dans sa ville Paul Celan ; en 1946, fuyant l’occupation soviétique, elle retourne aux États-Unis et renonce pour un temps à l’allemand. Elle s’installe enfin à Düsseldorf et paraissent en allemand Blinder Sommer (Été aveugle) (1965) et Mutterland (Pays maternel) en 1978.
Le poème d’ouverture de Pays maternel est un programme avec ses trois strophes qui s’ouvrent par « je crois ». Quand il ne reste qu’une croyance dans les miracles et les rêves, seul vaut d’abord le « miracle des mots » grâce auxquels on peut agir et créer des mondes, ce qui s’énonce également par « Je vis /dans mon pays maternel / Le verbe » — et il s’agit toujours du « mot / Animé du souffle ». Mais importe aussi l’autre, le « frère de vie » ; c’est ainsi la figure du couple qui s’impose dans la poésie de Rose Ausländer, par exemple avec la figure d’Adam (un poème est d’ailleurs titré "Adam") : Adam « N’a pas commencé / D’exister » parce qu’il est seul, et il devient lui-même quand apparaît sa compagne « Pour l’aimer / Et / Le rendre mortel ». Dans Été aveugle, Adam vit « L’œil [...] fixe / le temps sans Ève », et la femme lui jette la pomme, c’est-à-dire la terre, pour le sortir de l’immortalité ; l’image du couple s’y retrouve aussi avec Roméo et Juliette, avec un "je" et un "tu" qui vont ensemble « conversant ».
S’« Il est temps d’en finir avec la solitude et d’aller se coucher », c’est bien que le vivant doit l’emporter. Le pays maternel, comme d’une autre manière la langue maternelle, ont été détruits dans leur esprit, les hommes et les femmes massacrés pendant « le temps[...] gelé », « l’éclipse sans fin », et c’est ce passé qui, écrit Rose Ausländer, « M’a poétiquement composée ». Au cours des années de guerre, c’était le silence, la disparition complète de toute harmonie, celle connue « quand la terre était ronde »
J’ai appris
Le langage du regard
Dans le ghetto
Alors que ma bouche
Devait rester close
Il y a sans aucun doute dans les motifs de la poésie de Rose Ausländer un mouvement, la remémoration d’un passé plus que noir, celui de « l’été de cendre », « aveugle », alternant avec le souvenir de l’enfance, des lieux disparus de la Bucovine, plus largement avec la certitude que tout moment peut être vécu dans la grâce — ce n’est pas un hasard si dans les deux recueils les mots "rêve", "légende", "conte " sont relativement fréquents. Certes, il existe toujours deux mondes, dans l’un on écoute Chopin et dans l’autre on meurt de faim. Certes, « Écris / Il ne te reste rien d’autre ». Mais l’échange avec l’autre est possible, mais la poésie s’impose contre la destruction, ce qui se lit dans l’hommage à Marianne Moore, à Peter Huchel ou, plus clairement peut-être à Cummings :
parfum de jeunesse terrain clair où le
souffle croît dans la
boue de ce Qui-Est
Ces « flambeaux de la vie » sont toujours en péril et, comme bien d’autres, Rose Ausländer a vu dans Israël la terre du salut. Dans Pays maternel, elle évoque « Le destin / resté jeune / Du peuple » et rappelle la figure biblique de Ruth amassant les grains glanés ; dans Été aveugle, le rossignol, dont on sait la valeur lyrique, « chante la Sion des ancêtres » et Israël symbolise « le commencement ». Mais l’espoir d’un autre temps, où l’on pourrait vivre éveillé ses rêves, « le conte de fées de la vie », est beaucoup plus large ; il y a la certitude que l’échange de paroles est le pas pour réinventer, si peu que ce soit, le paradis perdu, et Pays maternel s’achève par ces vers : « Amis revenons / Parmi les hommes. »
On peut regretter l’absence du texte original qui permettrait de mieux apprécier le rythme d’une langue sans apprêt, toujours concise et lumineuse. Mais on loue la qualité de la traduction et de la postface proposée par chaque traducteur. Rose Ausländer est peu lue en France et il faut le regretter ; c’est une grande voix, à l’égal de Nelly Sachs et Else Lasker-Schüler, Ingeborg Bachman et Hilda Domi.
Rose Ausländer, Pays maternel, traduction Edmond Verroul, 80 p., 15 €, et Été aveugle, traduction Michel Vallois,128 p., 17 €, Héros-Limite, 2015.
Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 10 octobre 2015.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rose ausländer, pays maternel, Été aveugle | ![]() Facebook |
Facebook |
02/10/2015
Antonio Porta, Les rapports : recension

On ne connaît pas Antonio Porta (1935-1989) en France. Quelques textes dans la revue Change en 1969 ont été suivis de Choisir la vie, ensemble de poèmes traduits par Joseph Guglielmi, épuisé depuis longtemps, et c’est donc un bonheur de lire aujourd’hui la belle traduction de I rapporti (1966). De l’avant-garde poétique italienne des années 1960 à laquelle appartenait Porta, seuls ont un peu franchi la frontière les œuvres de Nanni Balestrini — pour des romans — et d’Edoardo Sanguineti — dont les éditions NOUS ont donné Corollaire en 2013 ; leur anthologie manifeste I Novissimi reste inconnue, tout comme les activités du "Gruppo 63" qui réunissait de nombreux écrivains (dont Umberto Eco, G. Manganelli, G. Scabia, etc.) et des créateurs de différentes disciplines.
Les rapports est précisément lié aux questions, toujours d’actualité, que se posait le "Gruppo 63" : comment rompre avec la narration classique, comment rendre compte avec des mots de la complexité du réel ? Pour Porta, l’absence de lisibilité du monde aboutit dans les poèmes de la fin des années 1950 et des années 1960, comme l’analyse Judith Balso dans la postface, à « une destruction délibérée de toute lisibilité narrative ou linéaire »(1). Chacun voit en même temps, dès qu’il regarde autour de lui, un nombre très élevé d’événements, d’actions, et la linéarité du langage permet seulement de les rapporter successivement. Porta ne peut rien contre cette contrainte mais, en quelque sorte, la déborde par exemple avec une énumération sans hiérarchie, du moins apparente, de propos :
« oui, c’est ça, drogue, sels pour le bain, la visite
au château, oh les beaux jours, » « lutte
pour la paix, désarmement, mais condamnation de la coexistence,
moins de bureaucrates et plus de soldats, » « pour des milliers
de marins des millions d’objets inutiles, » « il est essentie
de tout entendre, » « le désir vrai est de se blanchir »
L’allusion à Beckett (et sans doute à Kafka dans ce contexte) n’est pas indifférente, référence à celui qui a mis en morceaux des codes du théâtre. Une autre manière de rompre avec la narration et le lyrisme naît de l’emploi, dans nombre de poèmes, d’un "il" qui ne renvoie pas à un sujet identifiable ; ainsi est brisé tout processus d’identification, toute tentation lyrique ; « Il n’y a plus personne. Et toutes les personnes à la fois », comme l’écrit la traductrice à propos de cette « troisième personne impersonnelle » (De Francesco), et l’on sort donc de toute représentation :
Chaque jour il trouve le seuil brûlé,
une paire de chaussure, une prise de ta-
bac, en marge, l’anéantissement, une jour-
née de soulagement [...]
Ce qui est cependant lisible du monde, c’est la violence sous toutes ses formes, et elle est explorée sans détours : coups de fusil, noyade, yeux qui éclatent, éventration, incendie, accident, inondation... ; elle gagne même les animaux, puisque « Des chiens mordent les passants ». Il existe peut-être une autre violence, qui consiste à ne pas choisir de dire ce qu’il est possible de dire, ou plutôt d’écrire quelque chose et son contraire : « Il sème le germe du doute, / tout est clair, tout est o- / bscur », « [...] dans la fente la lumière, l’obscurité, / derrière le rideau il y a la nuit le jour ». Dans cette indécision où aucune forme n’est reconnaissable, le corps humain lui-même peut perdre son apparence et se métamorphose ; il devient animal (« Je fus pris de terreur en devenant lièvre ») ou se défait, se démembre (« le nez fend pour devenir salive la lèvre / en remontant au-dessus des dents [etc.] ». Sortie sans retour du "je" de toute identité et, par là, de la tradition poétique — et l’on peut se demander si le choix d’un pseudonyme (Antonio Porta pour Leo Paolazzi) n’appartient pas aussi au projet poétique.
Le refus de la narration, c’est le refus d’un ordre, la mise en cause d’une poésie (et d’une prose) qui prétend donner des choses une image, donc d’être au fond rassurante : tout pourrait être représenté. On comprend que le projet de Porta, et celui du "Gruppo 63", était politique et qu’il n’avait pas choisi le camp des bien pensants. L’essentiel était de chercher : pour lui, « découvrir, au moins, telle est la fin de l’art, / l’image d’un homme, nous ».
Antonio Porta, Les rapports, traduit de l’italien par Caroline Zekri, préface d’Alessandro De Francesco, postface de Judith Balso, éditions NOUS, 128 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 septembre 2015.
______________________________
1. Sur la question de la lisibilité aujourd’hui, on peut lire les actes d’un colloque : Bénédicte Gorrillot, Alain Lescart, L'illisibilité en questions, avec M. Deguy, J-M. Gleize, C. Prigent, N. Quintane, Septentrion, 2014.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonio porta, les rapports, poésie italienne, poésie et politique, réel | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2015
Bruno Fern, Le petit test

En quatrième de couverture, Bruno Fern renvoie explicitement au Testament, invitation modeste à lire Le petit test comme un prolongement de ceux de Villon ; il repose sur une lecture approfondie du poète du Moyen Âge, non pour imiter, à quelque point de vue que ce soit, mais pour en conserver l’esprit : l’humour, une certaine paillardise, le plaisir de parler des choses de la vie quotidienne et d’être dans une « matière pleine d’érudition et de bon savoir ».
« Voici un livre fait de greffes et d’excroissances », précise Bruno Fern. L’une des greffes consiste à retenir le huitain du Testament — il y en a cent — et à y introduire d’autres éléments, non des ballades mais trois envois, le livre s’achevant par un « renvoi ». Les vers ne sont ni comptés ni rimés, mais il faut tout de suite indiquer les exceptions. Un huitain est en vers de 3 syllabes et rimé, aaaabcbc (93)1, le suivant en vers mêlés, 44544544, avec rimes, abbcbcac (94), et sa seconde version en vers de 4 syllabes, non rimé (94). Le lecteur relèvera ici et là des rimes : elles ont toujours une fonction qui déborde le rôle habituel ; ainsi reprenant « le trou Perrette », qui rimait chez Villon avec « cornette », Bruno Fern développe autrement le thème burlesque (ou paillard, si l’on veut) (59):
préférant (et de loin) le trou Perrette
qui sent pas que la violette
mais le rose nuancé bat
ant jusqu’au sang [..]
On trouvera des variations d’un autre genre. Un poème est uniquement formé de questions prélevées dans Villon ; le premier vers d’un autre, « celer mes amours », vient aussi du Testament (« Je pense celer mes amours, xcv), dans les vers suivants seul le complément est conservé (« mes amours »), le premier mot retenu est homophone du verbe ou en conserve la première syllabe :
celer mes amours
seul et " "
semer " "
seller " "
serrer " "
céder " "
cesser " "
c.v. " "
Une autre greffe, comme on l’a vu ci-dessus, consiste à introduire dans chaque poème un fragment emprunté à Villon, signalé en caractères gras. On situe sans trop de difficulté des vers ou des parties de vers (« Dieu sait quelle sueur », « Les vers n’y trouveront pas graisse »), mais Bruno Fern introduit des grains de sable : par exemple, reprenant le vers de Villon « En petits bains de femmes amoureuses », il remplace "femmes" par "filles" ; par ailleurs, « en », « plus aigu », « des flûtes », etc., présents dans le Testament, pourraient évidemment se trouver ailleurs... Un mot repris dans le Testament est commenté, non pour sa place juste dans le vers original mais en tant qu’élément grammatical adéquat : « rondement / c’est l’adverbe qui convient ».
Comme le faisait Villon, Bruno Fern mêle les registres et le vocabulaire dit populaire, ou familier, est bien représenté : kif kif, fastoche, cool, triquer, tire-larigot, rien à branler, accro, à donf, etc. Mais surtout, il introduit dans presque tous les poèmes des lieux communs, des slogans publicitaires, des formules de mode d’emploi, des syntagmes propres à l’administration, toutes manières complètement usées d’être dans la langue qui, mises ici en évidence, apparaissent pour ce qu’elles sont, marques d’une totale absence d’inventivité : y a pas photo, ça le fait pas, y a comme un défaut, [Pince-mi et Pince-moi] sont sur un bateau, sonnerie personnalisée, intégralement recyclables, etc. — ajoutons ce qui est en relation directe avec l’actualité, par exemple renforcer la lutte contre la délinquance, made in China, vive émotion dans la communauté internationale. Des expressions rebattues sont détournées, ainsi : tombe au champ d’odeurs, la ligne bleue des cours, en mourant par la Lorraine, mais aussi un chant révolutionnaire : c’est la lutte finale grouillons-nous et deux mains ; etc.
Viennent s’ajouter des citations en italique, presque toutes littéraires et dont l’auteur est signalé en note — Kafka, Mallarmé, Nathalie Quintane, Soupault, Beckett, Malherbe —, mais il y a aussi Lacan et le compositeur Steve Reich ; d’autres, non signalées comme telles, passent inaperçues, parfaitement intégrées : on lit « bijoux sonores » et l’on se souvient de Baudelaire ("Les bijoux"), et de Mallarmé dans « la nue à câbles » : avec "accable" on retrouve "À la nue accablante". Entrent aussi dans des poèmes des figures d’écrivains contemporains ; « à J. S. l’ardeur des mots » (62) évoque Jude Stéfan, dont le prénom en toutes lettres et l’allusion à une nouvelle viennent un peu plus tard (69) ; « à Jean-Pierre V. une bouteille » (75) débute un récit à propos de Verheggen, « à Ch.P. cette vigueur qu’il prouve » est l’entrée d’un portrait de Prigent lisant : deux écrivains dont Bruno Fern est proche par certains aspects de son écriture. La "géographie" littéraire est toujours complexe ; sont également présents Petr K.[ral] et ses cigares, Philippe Boutibonnes à qui un poème est dédié.
Parmi les moyens d’ « essayer [...] tous les sens possibles », Bruno Fern emploie abondamment le chevauchement : un mot2 appartient à deux séries syntaxiques différentes ; par cette épargne des mots, la lecture est freinée et, surtout, la polysémie permet des effets comiques. Des exemples : « tendance à sous estimer [le monde] / roule pour lui-même » ; avec bilinguisme : « à tue / [tête] bêche dans le raidillon n° 69 / of [course] au cotillon (page 62) ; en jouant sur l’homophonie : « ténue [= t’es nue] jusqu’aux sourcils / à donf tombe en un comme en / [sans] attendre » (page 63) ; le mot commun est verbe dans le premier ensemble, adjectif dans le second : « se [grise] de préférence dans l’entrejambe / toutes les chattes le sont la nuit » (73) ; c’est un article et un mot-une syllabe qui sont communs : « présents les pieds posés sur [le sol] / stice d’hiver stigmate à son échelle », et remarquons qu’ici p est repris dans le premier vers, sti[c,g] dans le second.
La répétition d’un son est régulièrement un des éléments du burlesque dans Le petit test, comme dans les deux premiers vers du "Renvoi" final : « ainsi se clôt s’exclut s’excla / s’achève la période d’essais [...] » (page 61). On a pour ce registre burlesque une liste d’homophonies, de par mon et par vos et le classique neiges – que n’ai-je à en pur don de soie et toute en R – s’envoyer en l’air, des séries d’à-peu-près comme des mouvements divers et avariés et d’un pas décédé, des anagrammes parfois signalées (parties-patries). À chaque lecture, on découvre de nouvelles pistes dans l’usage plein de jubilation de la langue et, comme chez Villon, s’expriment des « préoccupations diverses » (4ème de couverture), tragique et burlesque liés : dans le huitain 99 adressé à un "tu" (« tu branles carcasse... »), si l’on réunit mots et syllabes en gras, on obtient : « car en amours mourut martyr ».
Bruno Fern, Le petit test, Sitaudis, 2014, 72 p.
Cette recension a été publiée dans Les Carnets d'eucharis, n° 45, printemps 2015.
lescarnetsdeucharis.hautetfort.com/
———————————
1. sauf indication contraire, le nombre entre parenthèses renvoie au numéro d’un poème.
2. noté ici entre crochets.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bruno fern, le petit test, villon, humour, socité | ![]() Facebook |
Facebook |
28/05/2015
Eugène Savitzkaya, À la cyprine : recension

À la cyprine paraît en même temps qu’un roman, Fraudeur, longtemps après les poèmes de Cochon farci, en 1996, chez le même éditeur. On sait que cyprine désigne une espèce minérale, dont une variété de couleur bleue est utilisée comme pierre précieuse, mais il s’agit ici d’un homonyme ; "cyprine", dans ce livre, est le nom des secrétions vaginales provoquées par l’excitation sexuelle, en accord avec un extrait du Corps lesbien de Monique Wittig donné en exergue : « Une agitation trouble l’écoulement de la cyprine ». Donc, ces poèmes ne sont pas à proposer aux jeunes gens pubères ou, au contraire, on en encouragera la lecture, selon ce que l’on imagine que les dits pubères doivent connaître du vocabulaire et des pratiques sexuels.
Sans jeu de mots, Savitzkaya appelle un chat un chat, et l’on relèvera au fil de la lecture couilles, bite, chatte, baiser, cul, vit, con, également des expressions variées pour évoquer les parties du corps, éléments du désir, et les positions et actions des corps amoureux, par exemple "tailler une plume", "chas de l’aiguille", « babeurre suintant de la baratte », « cirer la fleur », etc. Le corps féminin est exalté, et surtout le sexe, parfois dans des vers au ton ronsardien, comme « doucement moussu de bouclettes ton ventre », mais souvent plutôt brutalement : « à grands coups de cul agite la fleurette reine ». Aux classiques métaphores végétales (« touffe », « tige », « rose ») s’opposent l’emploi recherché de « gynécée » au sens de pistil dans un poème où le corps devient fleur, ou l’inattendue qualification du vagin : « au goût de baie de genévrier ». L’homosexualité — masculine — a sa place (« maigre cul masculin / à cheval sur bâton nerveux ») parmi l’universel coït, conçu comme une dévoration : le corps de la crevette est absorbé par le poisson, lui-même par le héron, à son tour par l’air qui, enfin, disparaît dans l’univers, « vaisseau en mouvement ». La liste n’est pas close mais, si développée soit-elle, elle ne justifierait pas la lecture du recueil, la "poésie érotique" (ou prétendue telle) brodant sur quelques thèmes rebattus depuis fort longtemps. Ce sont donc d’autres caractères qui peuvent retenir le lecteur.
Tout d’abord, il peut reconnaître le bestiaire de Savitzkaya, qui définissait les animaux comme des « fragments de terre animés, les véritables esprits du monde, innombrables et la plupart du temps invisibles »1 ; ils sont présents, par leur nom (mouche, pie, hirondelle, lézard, carpe, canard, moustique faisan, merle, brebis, hulotte, etc.), par ce que leur nom suggère (bouc, tourterelle, coq, dauphin — qui porte la coquille de Vénus sortie des eaux), ou comme personnages d’un récit. Ainsi, les trois cochons (l’un mâle, un autre femelle, un troisième « ange porcin ») trouvent un remède à leurs différences : « [...] tout s’aboucha, s’imbriqua / s’emboita, s’adonna, sabota, samedi / quand tout apparut ». C’est ce travail sur le son et le sens qui importe et fait exister le thème choisi. Ici, le jeu de mots d’un premier vers, « Cybèle bêle », ferait sursauter si l’on ne s’apercevait pas que le poème est organisé à partir de la récurrence de la consonne /b/ ; là, tous les vers riment en /ue/, le dernier à l’écart (« demain ») ; ailleurs, un néologisme, cofourchons, suit la série enfourchée, cofourchée, califourchon. Ajoutons l’emploi des quasi homophones (nous deux / nés d’eux), des quasi anagrammes (ovule / olive), la reprise dans un long poème de la cellule (qui + verbe) chaque fois avec le refrain « à ma porte marbrée », les jeux sur la polysémie (matrice, terme d’anatomie et de typographie), la construction syntaxique symétrique (« Si elle me le demande [...] / Si je lui demande [...] ») suivie par la position asymétrique des corps. Ajoutons encore des figures féminines, comme celles inverses d’Eulalie, la sainte violée, et d’Astrée, nom de la constellation de la Vierge dans la mythologie.
Ces éléments, parmi d’autres, donnent leur sens au recueil mais, cependant, À la cyprine n’emporte pas l’adhésion comme, par exemple, Cochon farci. L’univers si particulier de Savitzkaya est bien là, y compris avec des souvenirs d’enfance comme cette vision de l’enfant dans le pré, monté sur un jars, vision reprise dans Fraudeur, avec son obsession aussi caractère éphémère des choses et des sentiments, du temps qui passe, dès les premiers poèmes (« Elle passe, elle passe / la jolie, la jolie vie »). Sans doute est-ce l’absence d’homogénéité de l’ensemble qui gêne ; un poème sur un restaurant bruxellois ou un autre sur une bière, parmi d’autres, détonnent dans un ensemble thématique par ailleurs bien conduit, mais dont on sait qu’il est habituellement mal reçu.
1. Eugène Savitzkaya, dans la revue Recueil, n° 20, décembre 1991.
Eugène Savitzkaya, À la cyprine, éditions de Minuit, 2015, 104 p., 11, 50 €.
Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 18 mai.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, À la cyprine, corps, amour, désir, animaux, végétaux | ![]() Facebook |
Facebook |
29/04/2015
Franz Kafka, À Milena
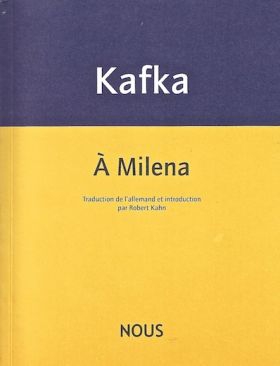
Dans l’introduction de cette nouvelle traduction des lettres de Kafka à Milena Jesenska (seules les lettres de Kafka ont été conservées), Robert Kahn rapporte ce que l’on sait de leur première rencontre, à Prague en 1919. La jeune femme, âgée de 23 ans, fille d’un médecin pragois célèbre, vivait à Vienne avec son mari ; elle avait lu un texte de Kafka et elle souhaitait le traduire en tchèque. Une correspondance commence à partie de mars 1920, elle s’interrompt en décembre mais quelques lettres sont à nouveau écrites, la première fin mars ou début avril 1922, la dernière en décembre 1923, de Berlin, peu de mois avant la mort de l’écrivain le 3 juin 1924. Comme les Lettres à Felice et les Lettres à Ottla(1), les lettres à Milena sont une œuvre littéraire et, cela a souvent été écrit, constituent un portrait complexe de Kafka ; dans l’article nécrologique qu’elle a publié, repris pour clore ce volume, Milena insiste sur un trait majeur : il « voyait le monde avec une telle lucidité qu’il n’a pas pu le supporter et qu’il devait mourir, parce qu’il ne voulait pas faire, comme les autres, de compromis. » (298)
Les lettres, souvent très longues, parfois rédigées à différents moments de la journée, forment une tentative de comprendre ce qu’il en est de la relation à l’autre, en même temps qu’elles construisent une liaison très particulière — Kafka et Milena ne se rencontrent que quelques jours en 1920 —, une passion partagée dans les mots puisque l’on peut déduire le contenu des lettres de Milena par les commentaires détaillés de Kafka. Une certaine intimité naît rapidement, visible par la passage de « Madame Milena » à « Milena » et à « Toi », et parallèlement Kafka signe « FranzK », Milena ayant lu d’abord son prénom « Frank », puis « Ton » et « F » ; il note dès les premières lettres que connaître Milena est « de l’ordre des retrouvailles » (35) et il insiste sur le fait que l’un et l’autre pensent les mêmes choses et éprouvent les mêmes sentiments aux mêmes moments. Il rapporte un rêve du 1er octobre où la relation introuvable est dite, « on s’intervertissait continuellement, j’étais Toi, Tu étais moi » (255). Fantasme de la fusion, donc, et peur constante que le lien fragile de la correspondance se rompe.
De là, une vie faite d’attente, l’absence de la lettre quotidienne, ou du télégramme, provoque l’angoisse, ce qu’écrit Kafka : « (...) toute la journée préoccupé par tes lettres, dans la souffrance, l’amour, le souci et une sorte de peur tout à fait indéterminée devant l’Indéterminé » (216). Chaque lettre, lue et relue, suscitant des questions pour obtenir une nouvelle lettre, est la clé de la relation de Kafka à Milena. Lui conseillant dans une lettre de moins consacrer de temps à la correspondance, il fait marche arrière dans la lettre suivante, « deux lignes suffisent, même une seule, même un mot, mais ce mot je ne pourrais m’en passer qu’en souffrant terriblement » (133). Les lettres sont une présence, faites pour « qu’on y enfouisse le visage et qu’on perde la raison » (52). Non que Kafka ne souhaite pas la proximité physique ; il écrit qu’il lui faudrait venir à Vienne et repartir avec la jeune femme, mais il retarde sa venue, persuadé qu’il « ne supporterai[t] pas la tension mentale » (39). "Amour de loin" ? Robert Kahn remarque justement que Kafka n’écrit jamais « je » devant le verbe "aimer" : il est Kafka, Franz, un nom : pas un sujet. C’est pourquoi il peut écrire qu’il est « incompréhensible que l’on puisse être loin de toi » (90) et que « la vraie Milena est ici » (47, ici c’est-à-dire dans la chambre, par ses lettres.
La distance entre Prague et Vienne pourrait être franchie sans trop de difficultés, mais comme c’était le cas quand il était fiancé à Felice, l’important n’est pas du tout d’abolir la séparation ; tout au long de cette correspondance d’une année, s’expriment le désir de vivre avec Milena et l’impossibilité de le faire, l’impossibilité d’admettre que l’on puisse « se prendre d’intérêt pour [lui] » (58). Le mot, récurrent, qui éclaire son lien complexe à Milena comme, d’une autre manière, au monde qui l’entoure, est "peur" : la phrase « ta relation avec moi je ne la connais pas du tout, elle appartient tout entière à la peur » (65), a pour complément : « cette peur [du monde] n’est pas seulement peur, mais aussi désir d’une chose qui soit plus que tout ce qui produit la peur « (275).
Écrire à Milena (à Felice, etc.) n’aboutit certainement pas à supprimer la peur, écrire étant toujours « se dénuder devant des fantômes » (279), mais cette mise à nu permet de supporter l’insupportable, le fait d’être né (comme il l’écrit), grâce à l’illusion pour un temps de ne plus être entièrement absent au monde. Kafka, qui savait ce qu’était la psychanalyse (dont il refusait la prétention à guérir), affirmait que sa maladie, la tuberculose, n’était pas seulement un mal physique, et la tranquillité — ou « une certaine forme d’intranquillité » — était nécessaire pour recouvrer la santé, et la "présence" épistolaire de Milena valait un séjour dans un sanatorium. Cette présence-absence, en effet, était le moyen de demeurer « seul dans sa chambre » sans l’être, « condition préalable de la vie » (100).
Il faut insister sur le fait que Robert Kahn, outre qu’il traduit l’intégralité des lettres d’après les dernières éditions scientifiques allemandes, respecte au plus près l’écriture si particulière de Kafka, n’adapte pas le texte à son gré, comme l’avait fait Vialatte autrefois (pour ces lettres comme pour Le Procès et d’autres œuvres) — il ne traduit pas angst par « angoisse » chaque fois que le mot apparaît, il conserve la ponctuation très personnelle de Kafka, il restitue son humour, etc. ; les notes sur les événements, les personnes, les lieux, brèves mais précises, facilitent la lecture. On lit ces lettres à Milena comme les récits et nouvelles de Kafka : il « ne cherche toujours qu’à communiquer du non-communicable » (275), ce qui est l’objet de la littérature.
Kafka, À Milena, traduction de l’allemand et introduction de Robert Kahn, NOUS, 2015, 322 p., 18 €.
Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 15 avril 2015
1. Franz Kafka, Lettres à Felice, I et II et Lettres à Ottla, traduction Marthe Robert, 1972 et 1978, Gallimard.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, à milena, lettres, souffrance, présence, littérature | ![]() Facebook |
Facebook |
03/04/2015
Florence Delay, La Vie comme au théâtre : recension

Autour de métamorphoses
On pourrait lire le livre comme l’autobiographie d’une femme "favorisée" (gardons les euphémismes !), fille de Jean Delay, célèbre psychiatre, écrivain, académicien, lui-même fils de ; on relèverait le nom des personnalités du spectacle et de la littérature qu’elle a rencontrées et fréquentées et l’on aurait un index impressionnant ; on lirait et relirait tels développements à propos de Musset et de la poésie espagnole, de Marivaux et de la poésie des Indiens d’Amérique du Nord, et l’on reconnaîtrait (au choix) qu’elle a su se construire une solide culture ou qu’elle enseigné à l’Université (nomination en classe de première à Rouen aussitôt annulée pour un poste à la Sorbonne : « Je soupçonne une intervention, j’en ai même l’explication »). Etc. Tout cela, sans aucun doute, est repérable, mais s’y arrêter et isoler tel et tel aspect serait une lecture myope.
Pour commencer, il faut souligner le fait qu’elle a su ne pas s’arrêter à son statut de privilégiée et, par ailleurs, qu’elle n’a jamais été aveugle sur ce qu’était le monde autour d’elle. Se souvenant d’une représentation d’une pièce de Gorki, Les Enfants du soleil, elle écrit : « comment vivre bien, mener une vie bonne quand elle est si mauvaise autour, comment mener au mieux sa vie quand d’autres vivent au jour le jour et que c’est invivable, quand un abîme existe entre nous et les autres ? » (p. 110). Ensuite, le livre n’est pas une autobiographie ; mais le récit de moments de la vie, essentiellement à partir de photographies, de programmes de représentations, de notes dans un carnet, et ce récit mêle souvent passé et présent. Il suffit qu’un élément inattendu se présente au cours de l’écriture pour que la chronologie ne soit plus observée : de l’évocation de La Barraca de Lorca, la narratrice passe au chariot filmé par Ariane Mnouchkine et, de là, à celui des comédiens qui ouvre Le Roman comique de Scarron, « Ma rêverie confond les temps » (p. 88). En outre, on peut reprendre pour ce récit ce que Florence Delay écrit à propos d’épisodes rapportés par l’écrivain argentin Ricardo Piglia dans son Journal, « [ils] existent dans ce qu’il raconte pas dans ses souvenirs » (p. 83). Ce qu’elle écrit est donc vrai puisqu’elle le raconte. L’invention des jours et du monde grâce au langage et à quelques gestes, voilà bien aussi ce que permet le théâtre.
Dans le jeu théâtral, Florence Delay enfant devient une autre : elle mime, avec Yvette en garçon de café, le client, et les répliques se succèdent, non pas dans la mémoire mais créées aujourd’hui pour faire renaître un moment de l’enfance. Suivront, avec des élèves de sa classe, un acte des Fourberies de Scapin, puis la formation d’une petite troupe, la mise en scène d’une pièce de Musset, plus tard le rôle de Jeanne d’Arc dans le film de Bresson, le travail avec Vilar, puis avec Georges Wilson, la rencontre avec Vitez,..., l’écriture pendant des décennies avec Jacques Roubaud de Graal Théâtre. Ce qui domine, me semble-t-il, c’est la fascination pour la transformation de l’un en l’autre, pour la métamorphose. Dans une séquence titrée "Le coucher du père", la narratrice décrit comme un spectacle la manière dont son père se déshabille et range soigneusement ses vêtements avant d’enfiler une chemise de nuit, spectacle qu’elle appréciait quand elle pouvait y assister ; elle passait ensuite, sans entrer par la porte entre les deux pièces, en prenant le couloir — les coulisses — dans la chambre de sa mère pour un autre spectacle : dans le lit avec la lecture d’Alice, illustré. C’était là le premier théâtre du soir, « dont les rideaux [étaient] des draps blancs. »
On le sait bien, « Le jeu [...] permute les identités », mais le désir d’être (une) autre déborde l’activité théâtrale. La jeune Florence Delay, prise un jour pour Marina Vlady, ne rectifie pas et signe l’autographe demandée ; plus troublant, chez sa correspondante espagnole, une femme âgée la prend pour un homme et elle accepte le rôle. Symbole de la métamorphose, la poupée appelée "Mariquita Pérez", nom de marque, reçue de sa mère, se transforme par la grâce d’un poème de Lorca étudié en classe ; chez lui, mariquita désigne un garçon efféminé et, ainsi, le poème « change la majuscule en minuscule, le nom propre en nom commun, le féminin en masculin. » (p. 11). On comprend pourquoi, lorsqu’elle enseigne la poésie des Indiens d’Amérique du Nord, elle s’arrête à l’animal que les ethnologues désignent par Trickster, « Il change de forme et de nom selon les pays, paysages ou tribus » (p. 147).
Je relèverais vingt autres passages sur ce motif de la métamorphose, lié ici au ravissement d’être autre, là à l’insatisfaction de n’avoir pas réussi, selon elle, un changement. Il faudrait aussi lire selon un autre point de vue, s’attacher à la langue qui crée ces métamorphoses — de l’hommage discret à Gertrude Stein qui débute le livre à l’étonnante évocation des décors et costumes qui le clôt. La vie comme au théâtre ? c’est une vie où sans cesse se compose une personne dans toute sa complexité, à la fois par exemple avec la volonté, toujours, d’aller jusqu’au bout d’un projet et, quasiment depuis l’enfance, « la hantise de ne pas décevoir qui empoisonne [l’] existence » (p. 19). Sans doute, écrit Florence Delay en reprenant à son compte Chrétien de Troyes, « Je cherche ce que je ne peux trouver » (p. 206).
Florence Delay, La vie comme au théâtre, Gallimard, 2015, 254 p., 18, 90 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 23 mars 2015.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : florence delay, la vie comme au théâtre, métamorphoses | ![]() Facebook |
Facebook |
14/03/2015
Marie Cosnay, Le Fils de Judith : recension

Marie Cosnay 2009 ; photographiée par Michel Durigneux
Autour du double et de la métamorphose
Dans la dizaine de livres que Marie Cosnay a publiés, on retrouve quelques motifs communs, notamment ceux du double et de la métamorphose, le retour également de tout l’appareil du théâtre, et ils sont bien présents dans Le Fils de Judith. L’intrigue semble d’abord linéaire, le but du principal narrateur, Helen, bien défini : il s’agit pour la jeune femme d’enquêter pour retrouver les traces d’un homme, mais la quête devient un voyage dans un labyrinthe et révèle tout autre chose que ce qui était attendu.
Helen pense être la fille du vieillard, Quentin Wilner B., qui l’a chargée de sa tâche, et elle est persuadée partir à Hambourg pour reconstituer le parcours d’Eugen, qui serait son frère et qui, de retour à la maison natale en Espagne, s’est tué d’une balle dans la bouche. Elle rencontre deux femmes qui auraient été des amours d’Eugen ; l’une d’elles, Isole, a accompagné ce frère, en 1968, à travers une partie de l’Europe jusqu’en Tchécoslovaquie, précisément jusqu’à Lidice. On sait que ce village avait été entièrement rasé par les nazis et le couple s’y trouve un peu après l’écrasement du Printemps de Prague par les Soviétiques. Retour à Hambourg où Eugen abandonne Isole pour Moscou où, mathématicien génial, il travaille sur la théorie...des probabilités. Isole fait d’Helen son double en lui attribuant son propre prénom. Isole a un autre double en la personne de Magdalena, l’autre amour d’Eugen, qui affirme à Helen être sa mère et qu’Eugen n’est pas son frère mais son père. Qu’est-ce qui est "vrai" ? Helen revient auprès du vieillard, qui meurt rapidement ; la tombe d’Eugen est ouverte et, auprès de ses restes, elle découvre un squelette d’enfant : celui du bébé abandonné par Magdalena ? Comment alors ne pas penser « Je ne suis née nulle part et surtout de personne, d’aucune histoire singulière ».
Le lecteur resterait perplexe si la seule intrigue l’avait retenu, mais il se souvient que, dans la mythologie grecque, Hélène avait une sœur jumelle (Clytemnestre), et d’autres éléments du récit évoquent ce motif du double. Isole et Magdalena sont en tout opposées, figures d’Iseut et de [Marie] Madeleine, chacune d’elles double ; Eugen, en dehors de ses travaux de mathématiques, écrit, ce que Quentin Wilner B. entendait faire sans y avoir jamais réussi, et Helen tire du fond d’une malle un manuscrit, Le Livre de Judith — double de celui que l’on est en train de lire ? Le prénom de la mère d’Eugen est double par nature puisque c’est un palindrome, Hannah, alors que ceux de plusieurs personnages sont, au regard de l’onomastique française, incomplets : (Helen(e), Isol(d)e, Eugen(e). Eugen s’est tiré une balle dans la bouche et Quentin devenu monstre marin avale Helen (« je tombe dans la bouche de Quentin W. B. »), qui est ensuite « crachée sur une plage ». Et sur la scène du théâtre se rejouent les violences de l’Histoire...
La métamorphose du vieillard en poisson est rêvée, mais elle en annonce d’autres, en particulier celle d’Helen qui s’aperçoit que sa voix change et devient masculine, avant de sentir son corps devenir autre – « C’est une sorte d’extase que d’avoir à l’intérieur, possession et prodige, un corps doublé ». Le rêve lui-même est peut-être celui d’un narrateur qui a noté l’histoire d’Helen : on reconnaît en effet dans le début du récit une porte cochère qui ouvre sur d’autres mondes si l’on parvient à l’ouvrir, et c’est la même qui débutait Des Métamorphoses, le précédent livre de Marie Cosnay. Quand Le fils de Judith s’achève, « un jeune homme regarde, assis sur le trottoir, une jeune fille (...) » : l’un et l’autre étaient déjà là à l’ouverture du récit, qui peut donc recommencer.
L’Histoire est présente, on l’a vu, et il faut préciser que Quentin Wilner B. et son épouse ont fui l’Allemagne en 1938, le nom de jeune fille d’Hannah étant Heimann. Ce fond, avec d’inquiétantes lueurs d’incendie, met en valeur l’étonnant jeu entre réel et imaginaire qu’est Le Fils de Judith .
Marie Cosnay, Le Fils de Judith, Cheyne, 2014, 96 p., 16 €.
La recension a paru dans Sitaudis le 5 mars 2015.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie cosnay, le fils de judith, le double, la métamorphose, l'histoire, les noms | ![]() Facebook |
Facebook |





