27/06/2018
Sylvie Durbec, (bien difficile de) transformer la jalousie en ballon rond

Voilà un titre qui accroche le lecteur tant il est déconcertant, la relation entre la jalousie et le ballon rond paraît en effet bien difficile à établir. « Bien difficile », ces mots débutent tous les poèmes ou y sont repris, les liant sans pourtant que se forme un récit.
Le premier poème, après un « Bien difficile » posé comme un titre, se continue par des parallélismes et, également, par des éléments qui s’opposent. Au « café des Miroirs » en face du poète italien Dino Campana — mort en 1932 — que la narratrice ne peut rencontrer que par ses livres ou en rêve, correspond le « Caffè degli Specchi », célèbre café de Trieste que fréquenta notamment Joyce ; mais personne n’est nommé cette fois, ou plutôt un « elle » (« à me demander quoi voir /(…) / à part elle à part moi ») dont la venue n’est pas du tout désirée. Quoi voir dans le miroir ? rien dans le noir, d’autant moins que la narratrice se dit « grise mais les yeux ouverts ». Elle part on ne sait où : un double mouvement s’effectue qui aboutit à l’introduction du ballon, « Y aller (…) / en revenir en repartir / avec un ballon / sous le bras ». Après un blanc typographique, un autre thème, essentiel dans l’ensemble des poèmes, est donné : « c’est une maison / qui commence / son histoire / ici ». Les deux motifs me semblent une illustration du titre de la plaquette ; d’un côté, les miroirs, ces « outils de rêve » selon Bachelard, qui symbolisent l’apparence, le fugitif, les cafés, lieux de passage, de dispersion, et le ballon qui ne reste pas en place, image du changement, de l’autre côté la maison, figure même de la sécurité et de l’intimité. Le poème se construit à partir de ces motifs bien peu conciliables et sollicite du lecteur qu’il les fasse jouer entre eux, faute de pouvoir les raccorder.
L’histoire de la maison n’est pas écrite, seules des bribes apparaissent sans être situées dans le temps ; il y aurait eu trois maisons et l’on passe de ce qui se construit à ce qui se défait : c’est là une figure de la vie. Des enfants viennent dans l’histoire, en accord (la famille) avec la symbolique de la maison, et avec eux le ballon qui roule, après lequel on court. Un autre élément positif est introduit, la porte ; elle relie la maison au monde extérieur, ouverte elle permet de « voir au plus loin / ce qui ne se voit plus ». Cependant, la maison aurait « sept portes / plus une », ce que le lecteur associe à un possible dédale ou à la Barbe Bleue du conte (le mot « sang » est présent). Les couples de mots de sens opposé sont nombreux — stopper / s’enfuir, entrer / sortit, anciens / modernes, ouvertes / refermées, avant / arrière, la nuit / le jour —image de l’instabilité, jusqu’à la relation entre « trahison » et « maison » en fin de vers : l’incompatibilité des deux mots, et les oppositions, signifient que toute quiétude est détruite, que la stabilité est mise en cause.
On peut ajouter d’autres données éparses, l’initiale du prénom des deux garçons (T et B) ou la mention d’un cahier caché, par exemple ; mais Sylvie Durbec sait ben qu’une histoire n’est pas faite que d’une accumulation de fragments et celle-ci, semble-t-il, ne peut s’écrire, faute « de faire tenir tout ça ensemble ». La plupart des histoires tiennent grâce à des inventions quand, ici, le projet est de trouver « bons mots exactes paroles », « bons mots exactes pensées ». De là, un poème-récit troué, plein d’incertitudes, mais qui captive le lecteur justement grâce à ses obscurités.
Sylvie Durbec, (bien difficile de) transformer la jalousie en ballon rond, le phare du cousseix, 2018, 16 p., 7 €.Cette note de lecture a été publiée sur remue.netle 11 juin 2018.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvie durbec, (bien difficile de) transformer la jalousie en ballon rond | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2018
Pierre Mabille, C'est cadeau : recension
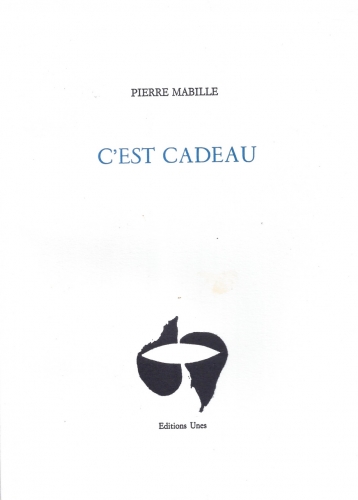
C’est cadeaucomprend deux formes différentes de poèmes, 29 en vers presque toujours courts, 5 beaucoup plus amples écrits, comme le note en avant texte l’éditeur, à partir d’un motif récurrent. Le poème d’ouverture, bref, reprend sous plusieurs formes la séquence « certaines petites choses » : elle se transforme en « certaines / petites choses », puis « certaine / petites / choses ». Les textes plus développés sont construits sur l’énumération, avec une entrée comme « Tout ce qui est à moi » ou « mon poème », ou « mon côté », suivie d’un nom (ou de plusieurs noms, d’un nom qualifié, etc.) ; les noms sont donnés selon l’ordre alphabétique ou l’ordre inverse (de Z à A) comme dans le premier poème de ce type. L’ensemble (donc 26 groupes) s’achève par une formule pour signifier l’abandon des biens désignés — « tout ce qui est à moi / je t’en fais don je te le / donne », « C K DO », etc.
Les listes rassemblent des éléments hétérogènes et un certain humour naît de leur juxtaposition, ainsi : « tout ce qui est à moi mon ordi mon oreiller mon outil mon outillage mon nœud pap mon nuancier mon numéro gagnant ». Pourtant, l’abondance des mots liés à la vie d’aujourd’hui telle que la société consumériste l’impose plus ou moins, oriente parallèlement vers une lecture critique. Ce qui semble n’être qu’un fatras devient en partie un miroir des habitudes courantes, le « mon » renvoie à l’individu qui énumère ce qu’il considère être ses possessions, dans un monde de l’avoir ; on lit au fil d’un poème « mon troisième téléphone mobile », puis « mon quatrième téléphone mobile », avant le premier et le deuxième, puisqu’il faut suivre ici l’ordre Z ®A… Si une partie des objets énumérés distingue une classe sociale restreinte (« mon yacht », « mon avion », par exemple), la plupart est propre au plus grand nombre : sont notés ce que la publicité incite, à un moment donné, à acheter sous peine de "n’être pas de son temps", « t shirt ACDC, t shirt David Bowie t shirt Neil Young, t shirt Virgin Megastore », « Laguiole, Leatherman », etc., sans oublier le zippo.
Il ne faut pas exclure la part de jeu dans ces listes. On y relève notamment des allusions à des chansons (« mon truc en plumes », « mon beau sapin », « mon p’tit quinquin »), à Baudelaire (« mon enfant ma sœur »), à un livre de Michaux (« l’espace du dedans »), et même au premier poème du livre avec « mon poème sur certaines petites choses ». N’oublions pas le jeu culturel avec « mon premier livre de Donald Westlake mon premier livre de Pierre Reverdy ». Plus nombreux sont les jeux avec la langue qui reposent sur l’homophonie (mon nom / mon non), sur la possibilité de construire un mot en ajoutant une syllabe à un autre mot (mou / mouillé ; pass / passeport), en changeant une lettre (vertige, vestige) ou un son (mon blaze/ mon blues ; mon creux / mon cri).
Si les listes sont absentes des poèmes courts, presque tous de forme strophique, on rencontre dans deux poèmes plusieurs vers débutant par un infinitif. Le lien avec les poèmes longs est ailleurs, dans l’attention portée à la vie de l’individu — ici, un "je" — dans la société, notamment à sa solitude. Ainsi, le parcours de la ville dans un bus, le nez collé à une vitre, donne l’illusion d’être derrière une caméra et « personne pour dire / arrête ton cinéma », il n’empêche que, pourtant, « je suis reflet fugitif / éclair doré dans ». Ce qui apparaît souvent, c’est la difficulté d’exprimer des sentiments ; le corps parle dans l’étreinte, sans doute, mais « le mot manque » pour aller au-delà des gestes, « comment te dire / quoi te dire oh ». Même quand la présence de l’autre laisse imaginer une histoire à construire, à raconter — « un récit avec un début / tout le tralala / et une fin » — rien ne se développe, comme si la distance entre désir et réalité était infranchissable, toujours vécue avec un « peut-être ». Quelle issue ?
"Largué", au titre évocateur, reprend un alexandrin d’un poème d’Apollinaire, "Mai", en le transformant : « Le mai le joli mai en barque sur le Rhin » devient « Le mai le joli mai en vélo / bords de marne » ; à l’évocation mélancolique d’un amour ancien fait place le rejet de ce qui symbolise l’intégration dans la société, la connexion permanente et l’argent, avec « le smartphone et le portefeuille ». Les deux objets sont abandonnés dans un fossé avec le vélo, puis c’est le tour du sac, et le narrateur lui-même « se sent largué ce soir » : aucun espoir dans la nuit venue ; alors que les ruines du poème d’Apollinaire étaient parées par le joli mai « De lierre de vigne vierge et de rosiers », ici rien ne peut changer. D’ailleurs plusieurs poèmes reprennent le motif des inégalités sociales (« l’égalité excuse-moi / on l’a pas vu passer ») : elles se maintiennent et restent les images des écrans qui fascinent.
L’amour, quand il est évoqué, semble toujours avoir été connu dans le passé — « ton souvenir en moi / valse dans l’air du soir » ; relisons cependant une déclaration à l’aimée, pudique puisqu’elle passe par une citation
tu es si belle qu’il se met
à pleuvoir écrivait brautigan
Relisons aussi le poème "Aujourd’hui" où le mot « tendre », entre deux strophes, est commenté :
« c’est bien le mot / à isoler afin de / libérer toute sa douceur / et faire voler toutes / ses flèches ». "Aujourd’hui", donc, « n’est pas un poème », mais Pierre Mabille, en isolant un mot chargé de connotations positives, établit un lien avec les poèmes de listes tous présentés comme des dons. Cet avant-dernier poème est suivi d’un adieu au lecteur ; construit avec pour départ la formule finale des lettres administratives, « Je vous prie de », il y a plusieurs essais pour sortir, aucun ne convient parce que la déférence n’est vraiment pas de mise. Alors quel mot final ? « et merde ». Oui, c’est cadeauest à offrir.
Pierre Mabille, C’est cadeau, éditions Unes, 2018, 88 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 27 mai 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre mabille, c’est cadeau, répétition, jeux de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
06/06/2018
Aurélie Foglia, Grand-Monde : recension
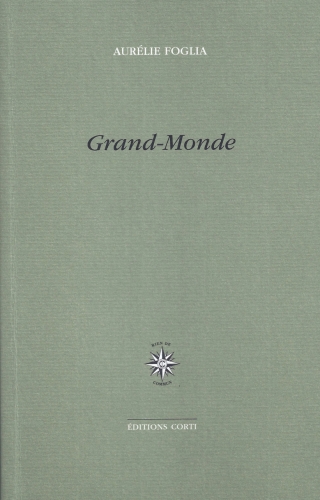
Bien des poètes ont célébré les arbres, de Ronsard à Supervielle, mais un livre entier déborde l’idée même d’éloge. Il ne s’agit pas seulement des arbres et de la manière dont les humains les utilisent, mais du lien étroit, intime que la narratrice entretient avec eux ; elle est surtout présente à partir de la troisième des six parties de Grand-Monde(le néologisme désigne le monde des arbres) et, ensuite, c’est ce lien qui engage sa vie qui occupe une place prépondérante.
C’est essentiellement dans la première partie, titrée "Les Longtemps", la plus développée, que la narratrice précise la manière dont elle perçoit les arbres ; non pas vision de botaniste : ce qu’ils sont au-delà de leur apparence physique. Le nom "Les Longtemps", « au visage vert tendre », leur est donné parce que le temps ne semble pas avoir de prise sur eux — caractéristique classique de la symbolique des arbres, régulièrement reprise (par exemple par Verhaeren, « [l’arbre] voit les mêmes champs depuis cent et cent ans / Les mêmes labours et les mêmes semailles »), mais qui, ici, n’est pas dissociée d’autres aspects qui font des arbres des êtres singuliers. Leur singularité est dite d’entrée : « Ils n’ont pas bougé », notation dans un contexte qui renvoie à des éléments mobiles ; l’absence de mouvement est suggérée comme un choix, répété ensuite avec l’insistance de l’allitération, ils « miment mal le maigre / exploit de marcher ». La majuscule de "Ils" et leurs traits spécifiques les distinguent des humains ; ils forment une communauté, sans qu’il soit question de telle ou telle espèce, dont l’organisation a exclu toute distinction entre les membres : aucun des éléments n’a de prise sur un autre. Sans doute ne parlent-ils pas, ce qui n’empêche pas qu’ils s’expriment de manière non articulée (« un arbre à l’oral est un raclement qui s’éclaircit »), qu’ils peuvent crier (« leurs cris de joie d’oiseaux ») et, quand ils ont perdu leurs feuilles, de faire entendre « des soupirs d’insectes ». En somme, les arbres cumulent ce qui appartient à l’humain, à l’oiseau et à l’insecte ; en outre, s’ils se multiplient grâce aux oiseaux, existent cependant « les femmes des arbres ».
L’arbre serait à sa manière un être complet, opposé en cela à la narratrice qui, par comparaison, se vit comme inachevée, ce que souligne la coupure des mots :
je ne devrais pas avoir droit
à la nudit
é me
réduire à une cuir
rasse casque barbe
lé
[etc.]
Êtres complets également parce qu’ils sont intégrés à un ensemble plus vaste qui comprend, outre les insectes et les oiseaux, l’eau où ils se reflètent « comme peints par Apelle », le ciel puisque par leur position ils vont « vers la lumière dont se faire verts », le ciel et la terre qui ont des qualités complémentaires : les arbres « ont tressé la terre avec l’instable // en brassant le ciel immeuble », le vent avec qui ils ont un rapport de complicité — il les fait « ré / fléchir » — et grâce auquel ils adoptent parfois la figure de la mer — ce qu’appuie l’assonance dans :
tel ancrage de mer vague
sous l’élan caressant du vent cassant
l’ombre
de falaises frémissantes de temps
en temps frénétiques
[etc]
Aurélie Foglia construit une symbolique de l’arbre en inversant un discours dominant à propos des forêts, encore perçues comme des espaces opaques, à l’écart du civilisé, pour l’essentiel ayant une fonction utile : elles sont, d’abord, lieux à exploiter, ce qui les fait disparaître ; les arbres deviennent manches de haches, meubles, etc., ils sont à la disposition des hommes qui y installent une balançoire et laissent leurs chiens uriner contre eux. Que dire d’autre ? Les arbres « sont animaux / qui ne craignant pas l’homme / sauvages / ils ont tort ». Contrairement à lui, ils ignorent ce qu’est la mort et, est-ce bienveillance ?, ils l’aident à se pendre.
Dans la construction de Grand-Monde, les arbres sont étroitement liés à la narratrice, et d’abord par le jeu des mots, "feuille" ne renvoyant pas qu’au végétal, par exemple dans « des mains froissent des feuilles déchirées », et l’arbre pouvant devenir papier : « il paraît / que je viens d’un long voyage de papier » — on ne peut pas ignorer que fogliasignifie « feuille » en italien. Le je, dans la quatrième partie titrée "Hors lieu", déclare « je n’ai pas lieu / la banlieue aveugle », constatant sa rupture avec arbres et terre, se souvenant d’un lieu perdu, le clos des rosiers de la grand-mère, pour ensuite entrer dans une fiction, celle de devenir arbre, ce qui s’opposerait à « je n’ai nulle part ». Entrer dans l’imaginaire, écrire que l’on souhaiterait devenir ce qui dans une grande partie du livre a été présenté comme une forme accomplie, pleine, sans aspérités, cela n’implique pas que l’on quitte la réalité, seulement qu’il faut penser l’impossible — on sait bien que « représenter est théâtral est tuant ». Il y a dans le désir (donc dans ce qui ne peut s’accomplir sans cesser d’être désir) de devenir arbre (« on se demandera // je ne sais pas vous// ce que ça fait d’être / arbre » ; etc.) une aspiration à abandonner les oripeaux du quotidien pour rejoindre le silence des arbres et de l’herbe, confondus en un mot valise : « sous les berces et les ombelles j’ai / jeté mon corps et l’ai laissé / là roulé dans l’harbre à la merci / du soleil et des mouches ».
Aurélie Foglia, Grand-Monde, Corti, 2018, 144 p., 18 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 15 mai 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aurélie foglia, grand-monde, arbre, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
29/05/2018
Jean Ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés : recension
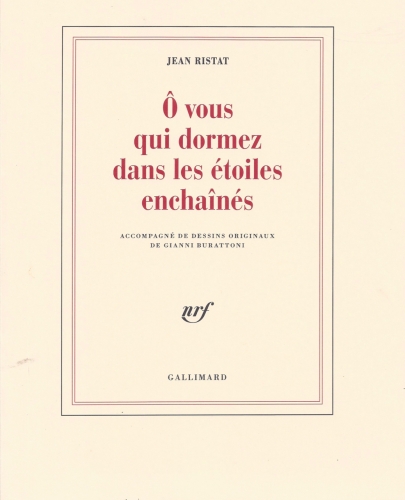
Lisons le dernier vers, « Au plus obscur la nuit rend force et gloire rien », il donne le ton des trois parties du livre, liées, de manière différente, au « théâtre de la mort » : L’"Éloge funèbre à Monsieur Martinoty", consacré à celui qui fut administrateur de l’Opéra de Paris et metteur en scène d’opéras (mort en janvier 2016), précède "Le pays des ombres" et "Détricoter la nuit. Une lecture des Tableaux d’une expositionde Moussorgski ". Deux mots récurrents, ombreet nuit, suffiraient à assurer l’unité des poèmes, à quoi il faut ajouter l’opposition répétée, encore dans le dernier vers, entre « la gloire d’un instant » et « la terre où grouille la vermine ».
Cette thématique classique — on pense souvent à Sponde ou à Chassignet — est revisitée par Ristat, sans qu’il y ait quoi que ce soit à espérer du côté de quelque divinité que ce soit, « les dieux s’ennuient et meurent oubliés ». La mort est toujours présente, emportant sans distinction et sans cesse tout ce qui vit, comme l’ogre des contes qui, jamais satisfait, recommence toujours à dévorer ; cette image de l’ogre apparaît à deux reprises dans le livre : elle marque le caractère inattendu de la mort (« (…) sur la tête du dormeur l’ogre / a posé sa patte griffue ») ou elle permet d’insister sur la violence de sa venue (« (…) l’ogre qui va me dévorer ») — le narrateur ici, comme tout homme, errant dans le labyrinthe du temps sans pouvoir y trouver un repère, sachant seulement que « la nuit avance comme un loup », vivant le moment tragique où « la nuit comme un serpent engloutit le jour ».
Tout semble-t-il subit la destruction, et d’abord le corps : « le voici offert viande / de bouche- rie ». La disparition en mase témoigne de la puissance de la mort ; c’est par la première phrase de Salammbô, donc par l’allusion aux massacres dans la fiction, que sont introduits les camps de concentration : « Ô c’était à mégara faubourg de carthage / À dachau ou ailleurs l’odeur de la mort ». Dans cette vision de Ristat, la mort a aussi pour effet d’entraîner l’anéantissement de toute trace, comme si rien ne pouvait demeurer dans la mémoire : « il pleut dans les plis de la mémoire », ou que ce qui restait était insuffisant pour construire quoi que ce soit : « Ô mémoire comme / Des lambeaux d’étoffe dans le fumier de l’his / Toire ». Comme si tout devait sombrer et s’effacer « dans la barque de l’oubli », dans un silence que rien ne rompra, et tout le vécu ne serait plus que « dans la cendre du souvenir », moments éparpillés qui n’empêchent pas la ruine. N’y aurait-il donc qu’ « absence de sens sauf à perdre la tête » ?
Ce qui se maintient dans ce "théâtre" de la mort et de la vie, malgré le pays des ombres, ce sont les œuvres humaines. J’ai signalé une phrase de Flaubert et, ici et là, on repère d’autres allusions, par exemple avec, à l’ouverture d’un vers, « La mise à mort », titre d’un roman d’Aragon, ou à Tristan et Iseutavec « les amants aux Voiles / Déchirées », à l’opéra de Debussy avec le nom de Mélisande. Hors ceux d’Aragon et de Verlaine, sont cités les écrivains fondateurs dans l’antiquité gréco-romaine, Homère et Virgile, à côté de personnages de la mythologie, Persée, Méduse, Ulysse, Vénus, Apollon, les cyclopes. Il faut aussi voir que le travail sur la tradition métrique inscrit le livre dans un temps vivant.
Ristat, dans la plupart de ses livres n’utilise pas l’alexandrin mais des vers de douze syllabes sans césure régulière et non rimés, parfois de 13 syllabes, comme le vers repris comme titre, ou de 11, ce qui n’interdit pas l’introduction de vers courts de 3, 4 syllabes, etc. ; le douze syllabes est décomposé une fois : « Tout / En moi / Étrangement / S’éteint et / Attend ». Les assonances et les allitérations reprises régulièrement ne sont pas le propre de la poésie classique et elles sont relativement nombreuses dans Ô vous qui dormez…, et même mêlées comme dans ces vers : « (…) les miroirs / La mémoire / Noir / — Noir le grand tamanoir de la nuit au céleste / Reposoir », ou dans « Amère mort que d’aimer la douce morsure / D’amour1 ». Certains rejets brisent quelquefois l’apparente sagesse du vers, ainsi : « appelle / T-on », « balafre é / Carlate », etc., comme interrompt la lecture le fait qu’un mot appartienne à deux groupes syntaxiques différents : « [le feu] déchire les arbres / Ne demandaient qu’à fleurir une année encore ».
On pourrait trouver quelque préciosité dans la présence insistante du Ôde l’élégie ou dans l’emploi de mots aujourd’hui rares (comme pourpris, cascatelle, arondelle, s’aboucher), mais on peut aussi lire dans le jeu avec le vers classique comme avec un vocabulaire suranné ou la référence constante à l’antiquité une volonté de subversion par rapport à quelques opinions sur ce que "doit" être la poésie. N’oublions pas que Ristat, fondateur de la revue Digrapheen 1974, a publié des livres de Mathieu Bénézet et Comment une figue de paroles et pourquoi de Francis Ponge.
Jean Ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés, dessins de Gianni Burattoni, Gallimard, 2017, 64 p., 12, 50 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 6 mai 2018.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean ristat, Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînés, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
17/05/2018
Jacques Roubaud, Traduire, journal
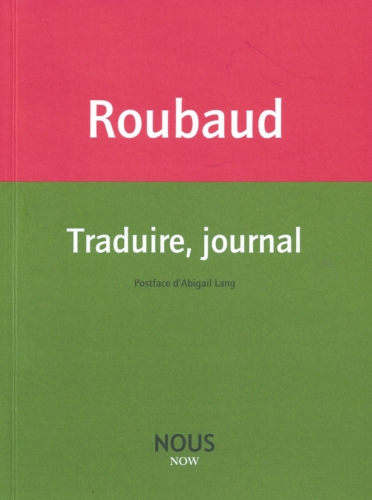
En 1980, paraissait sous la direction de Michel Deguy et Jacques Roubaud un volume imposant de traductions, Vingt poètes américains ; une partie d’entre eux était alors inconnue en France, notamment les poètes objectivistes dont Roubaud avait quelques années auparavant proposé un choix dans Europe (juin-juillet 1977). On ne suivra pas l’ensemble de ses traductions, ni de ses réflexions (voir notamment Description du projet, NOUS, 2013) mais, pour lire avec profit Traduire, journal, le lecteur pourrait reprendre, paru en 1981, Dors, précisément les réflexions qui précèdent les quatre parties de poèmes ; référence y est faite à William Carlos Williams pour la métrique retenue dans le premier ensemble (Dors). Roubaud rompt avec le vers libre "classique" pour ces poèmes qui doivent être dits, poèmes définis comme « des moments de contemplation de peu de mots, vers courts, lignes presque blanches, silences de la voix plus longs que tous les mots » [souligné par moi]. Pour lui, la traduction est une activité critique, elle nourrit l’écriture, permettant par exemple d’expérimenter une métrique.
Si le livre n’avait que cette vertu, il faudrait en conseiller la lecture : il offre une anthologie de la poésie américaine, personnelle certes, qui donne à lire des poètes aujourd’hui connus en France (Gertrude Stein, Keith Waldrop, Louis Zukofsky, Paul Blackburn, Jerome Rothenberg, David Antin, etc.), mais d’autres beaucoup moins, comme Jackson Mac Low, Carl Rakosi (notamment grâce à Philippe Blanchon) ou Christopher Middleton (ce dernier grâce à Auxeméry), ou pas du tout comme Armand Schwerner — avec ici quelques extraits de The Tablet, qui n’a pas trouvé son traducteur —, Clark Coolidge ou Ted Berrigan. La plupart de ces poètes ont, pour le dire vite, transformé dans leur langue la relation à la poésie et c’est aussi le cas du poète de langue allemande Oskar Pastior, dont on lira deux traductions.
En 1981, Roubaud (avec Alix Cléo Roubaud) traduit un texte métapoétique de Gerard Manley Hopkins qui interroge la relation entre vers et poésie, affirmant « La poésie est en fait parole employée seulement pour porter l’inscape(l’intérieur) de la parole, pour le seul compte de l’inscape » et « Le vers est donc parole qui répète en tout ou en partie la même figure sonore » (p. 247 et 248). Les poèmes choisis par Roubaud peuvent l’être pour leur intérêt métrique et, également, pour le fait qu’ils présentent des propositions sur la poésie ; ce n’est pas un hasard si le premier, d’Octavio Paz, donne à lire ceci :
l’écriture poétique c’est
apprendre à lire
le creux dans l’écriture
de l’écriture
Mais sans doute aussi importants que ce genre de textes, de nombreux poèmes permettent de mettre en œuvre dans les traductions des choix métriques. Par exemple, dans un poème de Percy Bysshe Shelley, Roubaud introduit des blancs qui ne sont pas dans l’original : « Ensemble succession de rideaux / que le soleil la lune les vents / Tirent et l’île alors les vents » [etc.] (p. 241). Dans un poème de Cid Corman, c’est l’unité vers-syntaxe et l’identité du mot qui sont mises en cause : « Une fourmi un / instant a / ttentive à / une ombre » (p. 229). Le rôle critique de la traduction joue en même un rôle créatif ; Roubaud "traduit" — transforme — des poèmes de Mallarmé et Hugo pour obtenir de nouveaux poèmes et l’expérimentation le conduit à questionner la langue anglaise en traduisant ses propres poèmes. On retiendra encore la mise en pratique de la proposition de Hopkins — le vers comme reprise de la même figure sonore — avec un long poème dont chaque mot contient le son [a], y compris le titre que l’on voit mal être autrement qu’en anglais (« Wahat a map ! »). Cet exercice oulipien par excellence est en accord avec l’extrait traduit de Palomard’Italo Calvino : le personnage entend regarder le monde « avec un regard qui vient du dehors et non du dedans de lui » (p. 259) ; cette proposition devient vite plus complexe et ne pouvait qu’attirer l’attention de Roubaud : « le dehors regardant du dehors ne suffit pas, c’est du dehors regardé que doit partir le regard qui atteint l’œil du dehors qui regarde. »
La postface d’Abigail Lang, dont il faut rappeler son étude de la poésie de Zukofsky et son activité de traductrice (Lorine Niedeker, Rosmarie Waldrop, David Antin, Elizabeth Willis, Gertrude Stein, etc.), décrit et analyse précisément les principes sur lesquels repose le travail de traduction de Roubaud. Elle retrace ce qu’a été le cercle Polivanov, groupe de recherche fondé par Léon Robel (traducteur de Gorki, Soljenitsyne, Aïgui, etc.) et Roubaud, la réflexion sur les pratiques de Pound et Chklovski. J’extrais de cette excellente synthèse sur Roubaud traducteur les derniers mots de sa conclusion : « Traduire [pour Roubaud] participe du travail de poésie, est pris dans un continuum d’activités de lecture et d’écriture, qui ne sépare pas comparaison et critique, appréhension et réflexion : « J’imagine, je lis, je compose, j’apprends, je recopie, je traduis, je plagie, j’écris de la poésie depuis près de 40 ans. Il m’arrive d’en publier ? » (Description du projet) ».
Jacques Roubaud, Traduire, journal, postface d’Abigail Lang, NOUS, 2018, 368 p., 25 €. Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 28 mars 2018.
Publié dans RECENSIONS, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, traduire, journal, postface d’abigail lang, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
11/05/2018
Étienne Faure, Écrits cellulaires
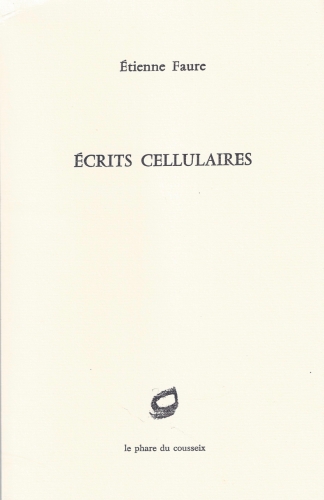
Les Écrits cellulairesrompent avec la forme que l’on connaissait dans les recueils publiés d’E. F. ; les poèmes presque toujours composés d’une seule phrase laissent la place à des poèmes de 4 strophes, le plus souvent de 4 vers libres — un poème cependant est construit avec quatrains et tercets du sonnet, placés dans un autre ordre (4/3/3/4) —, et comprenant une phrase. Ce qui ne varie pas, c’est l’unité de l’ensemble, qui correspond à l’unité qu’a chaque division dans les recueils. Le titre, ici, reprend en partie le dernier vers (« simples écrits cellulaires ») ; il évoque, plus que la prison de Verlaine ou, métaphorique, la cellule d’Emmanuel Bove, tous deux cités en exergue, l’espace clos de la solitude, celui de la chambre présente dans un des poèmes (« D’un habitacle nommé chambre / où l’on aura (…) / subdivisé la vie en cellules »). On peut penser également à l’espace de la mémoire, la voix d’un narrateur faisant revivre le temps de personnes disparues.
En effet, l’effacement constant du "je" dans les poèmes précédents d’É. F. n’est pas de mise ici. Il est présent dès l’ouverture, dans une position lyrique, celle de la perte (« l’espérance a vécu ») et tout est associé à l’hiver, à la mort, à la flamme prête à s’éteindre, à la disparition d’un "nous", opposé à un temps de renaissance, « fleuris » connotant le printemps. Le "je", dans le dernier poème, apparaît dans une position fort différente. S’il lui est encore difficile d’aborder le passé à l’imparfait, s’il reste un peu « empêtré dans le temps », l’atmosphère tragique s’est éloignée. Ce n’est plus, à l’aube, le « bordel des oiseaux » mais, la nuit, « le chat [qui] / fait un concert / à quatre pattes », les jours passés sont revenus à la mémoire, mais devenus des mots, de « simples écrits cellulaires ».
Entre l’entrée du "je" et sa sortie, se développe un récit où dominent d’abord des éléments négatifs avec l’idée de vieillissement (l’automne, les feuilles-lettres mortes) liée à l’exil des aïeux, à leur difficile intégration — et cette figure révérée des aïeux ne mériterait que d’être « couronnée de laurier-sauce », d’être rangée sur l’étagère. On ajoutera la forte présence de l’hiver, de la neige, mais aussi de la guerre, de la séparation du couple ; l’amour s’écrit par lettres, lui sur le front : « Ton amour d’1, 72 m est dans les airs », rappelle le narrateur à la femme. Au calme associé à Verlaine (« par-dessus les toits ») répond « le cri des scies », mais c’est un bruit positif puisqu’il est conséquence de la reconstruction de l’habitat, opposé à la mort de la guerre. Aussitôt après, le mois d’avril dit le printemps vrai et non son imitation par les oiseaux l’hiver.
Par le poème, on tente de redire ce qui fut : le « poème à cet instant […] prétend tout / recoudre », sachant la difficulté de le faire, ce que note la position isolée en fin de strophe du verbe "recoudre" comme la ponctuation qui coupe ici les vers, alors qu’elle est très rare dans l’ensemble du texte. On apprendt sous forme de paroles rapportées (« il disait (…) je l’entends »), quelle image sonore que se faisait le disparu en ville du bruit de la mer. Le poème dit aussi la mélancolie qui naît de la pauvreté (une tasse sans oreille), de l’abandon d’une maison (le matelas sur le trottoir), d’autant plus nettement qu’est repris le « soleil noir » de Nerval et, également (me semble-t-l), une nouvelle allusion à Verlaine : il n’y a pas « de la musique avant toute chose », mais tout se passe « sans musique et sans rien ». Plus avant encore s’impose la mélancolie verlainienne avec : « la pluie / la tête dans les mains / pensées pluie d’intérieur / sur la ville ». C’est encore le passé qui surgit avec un buvard, objet aujourd’hui obsolète, qui porte sur son revers les mots de la Reine, « miroir mon beau miroir », dans Blanche-Neige, le conte de Grimm.
Il n’y a pas de rupture avec les recueils d’Étienne Faure dans ces Écrits cellulaires, le passé — et parfois la guerre — y ont leur place. Cependant, de même que La vie bon trainessayait une autre forme que le vers, est choisie ici la strophe.
Au moment de la parution des Écrits cellulaires, un dossier a été consacré à leur auteur par la revue Phœnix(n°27, décembre 2017). À la suite d’un entretien avec J.-P. Chevais et F. Bordes, on lira des études de J.-C. Pinson, S. Bouquet, G. Ortlieb et M. de Quatrebarbes, un poème d’hommage de J. Bosc, des inédits (poèmes et proses) d’É. Faure. À lire pour mieux connaître ce poète tout à fait à part dans le paysage contemporain.
Étienne Faure, Écrits cellulaires, la phare du cousseix, 16 p., 7 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 30 mars 2018.
Publié dans Faure Étienne, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, Écrits cellulaires, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
02/05/2018
La tête et les cornes, n° 5, printemps 2018 : recension
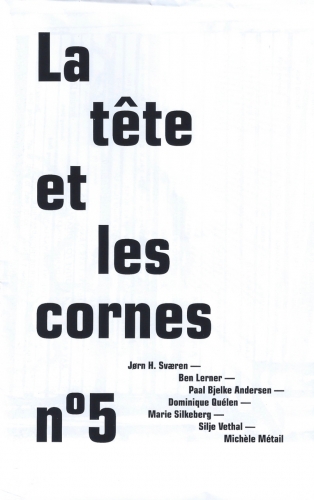
La dernière livraison de La tête et les cornes a sa forme habituelle, soit des pages agrafées (36), sur papier bleu ciel, et une couverture à déplier pour, à l’intérieur, retrouver une vue de la bibliothèque de Claude Royet-Journoud, préparée par Yohanna My Nguyen ; contre les étagères où sont rangés les livres, tous de langue anglaise, est posé un portrait du poète anglais Tom Raworth. Un sort particulier est réservé au texte de Michèle Métail, "Cent vues du Japon" ; il fait l’objet d’un tiré-à-part sur une page bleu Rembrandt, format 21x27, pliée. On compte bien cent "vues", texte continu en capitales, avec caractères en romain et en italique mêlés, le passage d’une vue à l’autre marqué par une esperluète (&) en gras. Les notations portent toutes sur des éléments de la vie quotidienne, aussi bien sur les toilettes publiques maintenant avec tableau connecté (« DÉSORMAISON PISSEHIGHTECH ») que sur la nourriture :
&LEsNOUILLESUDOAUXLÉGUMESDAUTOMNEÇAGLISSEENTRELESBAGUETTESSEDÉROBETOMBEDANSLEBOUILLONASPERGELATABLE
Il s’agit d’un texte ouvert : la dernière vue ouvre sur une suite possible :
&LESTECHNOSTIRENTLESCÂBLE/SCONSOLEÀTRÉTEAUXHAUTSPARLEURSSURPIEDPROJOSDAMBIANCE/ÇACOMMENCEDANS
DEUXHEURES
Cette manipulation de la langue, attentive le plus souvent à ce qui est le plus éphémère dans la vie, perturbe complètement les habitudes de lecture. D’une autre manière le long poème de Dominique Quélen, "La gestion des espaces communs", constitué de strophes en prose de longueur inégale, est tout autant dérangeant. Il commence par une question, à laquelle aucune réponse n’est donnée : « Combien sommes-nous au juste ? On ne sait pas, ni comment opérer » ; ou plutôt à « combien » ne peut répondre que « l’idée de nombre, de quantité, d’absence, de hiérarchie ». Donc, est donné un exemple : « Nous avons quitté la forêt depuis un certain nombre de jours. » Le "nous" est présent tout au long du poème, sans contenu précis, sinon qu’il est constitué d’un certain nombre de « chacun » ; les mots, ou du moins quelques-uns, valent comme choses : « Ce mot, couteau, pour ouvrir le corps en deux », et « choses » s’entend comme « shoes » (=chaussures). Il y a dans ces deux exemples comme un jeu de miroir, une symétrie qui semble être un des principes de construction du texte ; on relève en effet tout au long des "paires" telles que « les mots employés / qui seront employés », « les distances disparaissent / d’autres les remplacent », « rare / fréquent », « avant / après », « un instant / toute la durée », « bonne / mauvaise », etc., et, dans le miroir, A = A avec « « une chose / la même ». La clé de cette construction est d’ailleurs signalée avec « Le goût de la symétrie : un de chaque côté, un de chaque sorte, etc. ».
Les douze poèmes en prose de Ben Lerner, titrés "Angle de lacet" et traduits par Virginie Poitrasson, sont dans la tradition d’une partie de la poésie américaine : sans être du tout des récits, ce sont des variations à propos du monde contemporain. C’est le monde du semblant, des jeux vidéos qui se substituent à la réalité et gouvernent les comportements, « inspirant une éruption de massacres dans les lycées », de la difficulté d’être avec autrui, de vivre le désir, de la solitude : « sans enthousiasme, nous avons préféré l’enthousiasme à la vérité ». Cette sombre vision est assez proche de celle du norvégien Paal Bjelke Andersen, dont les poèmes n’ont un semblant de lyrisme que dans le titre qui les rassemble, "Deux images d’une rose dans l’obscurité". Si le premier poème paraît d’abord mettre en avant le sentiment d’un sujet avec l’anaphore « je ressens », il s’éloigne ensuite de ce qui n’appartient qu’à l’individu : le "je" est avant tout un être social, d’où : « je ressens que la guerre d’Afghanistan est une guerre », « je ressens que je suis une partie d’un système » et le renvoi à une analyse de Jacques Rancière. Le poème développe un va-et-vient entre le "je / tu" (l’harmonie) et le "je" dans la société, qui ne peut être que dans la déception ; le capitalisme donne l’illusion que chacun doit « se sentir chez soi partout », alors qu’en aucun lieu on ne peut se sentir « complètement chez [soi] ». Le dernier vers du poème exprime cette difficulté à être dans le monde d’aujourd’hui, en abandonnant le "je" : « Entrer dans une pièce et nous cogner dans des choses ».
On lira encore d’autres traductions, du suédois avec un poème de Marie Silkeberg, et du norvégien avec des poèmes de Jørn H. Sværen et Silje Vethal. Les choix des responsables (Marie de Quatrebarbes, Maël Guesdon et Benoît Berthelier) sont maintenus d’une livraison à l’autre : ouvrir la revue à toutes les langues et, ajoutons-le, à des poètes pas encore (ou très peu) traduits qui appartiennent aux nouvelles générations. On peut acheter ce numéro 5 (8 €) ou s’abonner.
La tête et les cornes, n° 5, printemps 2018, 36 p + 8 p, 8 €
Cette note a été publiée sur Sitaudis le 30 mars 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la tête et les cornes, michèle métal, dominique quélen, ben lerner, virginie poitrasson, marie de quatrebarbes, maël guesdon | ![]() Facebook |
Facebook |
23/04/2018
Ghérasim Luca, Je m'oralise : recension

Les éditions Corti ont mis sur leur site Je m’oralise, sous le titre "Ghérasim Luca par lui même" et avec la mention "Lichtenstein 1968 ; Introduction à un récital"; c’est, en effet, un texte de présentation de sa manière d’écrire, si dense qu’il est à lire en se reportant à son œuvre. Mais pourquoi l’éditer alors qu’il est connu et, même, commenté ? Parce que c’est la reproduction du manuscrit qui est proposée, accompagnée pour chaque séquence reproduite de dessins de Ghérasim Luca, dessins étranges, abstraits, composés de petits points, qui miment peut-être la mise en pièces des mots, mais aussi des "mouvements" de la voix, le « monde de vibrations » dans lequel l’auditeur baigne lors d’une écoute. À la suite de l’ensemble (qui avait été « écrit et dessiné en deux exemplaires »), le texte est transcrit en caractères romains. Ajoutons que le livre est un petit écrin de format à l’italienne (15cm x 10,5cm).
Relisons Ghérasim Luca.
Ce qu’il expose, c’est le changement radical de la lecture / de l’écoute à quoi oblige sa pratique. Il n’est plus question de « désigner des objets » avec les mots, mais de travailler la forme qu’on leur connaît pour inventer de nouvelles relations et mettre au jour « des secrets endormis ». Ce refus du sens donné évoque une pratique différente qui vise le même objectif, celle de Jean Tardieu qui, dans Un mot pour un autre, fait surgir d’autres sens que ceux attendus. Pour Ghérasim Luca, la « transmutation du réel » est le but à atteindre. Le sens reconnaissable semble s’évanouir et des associations nouvelles se créent, avant elles-mêmes d’être le point de départ d’autres relations ; ainsi dans ce bref passage tiré de Héros-Limite, où du premier mot sortent un quasi homophone puis un second mot par une anagramme, etc. :
C’est avec une flûte
c’est avec le flux fluet de la flûte
que le fou oui c’est avec le fouet mou
que le fou foule et affole la mort de
Le poème est donc, littéralement, selon les mots de Ghérasim Luca, un « lieu d’opération » ; il faut poursuivre la métaphore et comprendre que la langue, considérée comme une « matière », est ouverte, démembrée, recomposée dans un mouvement continu. On pourrait dire que cette violence faite à "l’instrument de communication" commun, insupportable pour beaucoup, est une réponse à la violence des jours, celle qu’implique aussi l’instrument de communication, que Ghérasim Luca a connues, que chacun d’une certaine manière peut connaître. Il fait allusion à une tradition poétique et l’on peut penser aux tentatives, après la Première Guerre mondiale, de Tzara de défaire le sens de la langue.
La violence, ici comme hier, refuse la référentialité ; la répétition et le bégaiement, par exemple, empêchent à la référence de se constituer, la syntaxe et la morphologie sont saccagées par l’inventaire de ce que contient un son (un mot) :
le crime entre le cri et la rime
ou
mou comme « mourir » ou comme
les poux qui grouillent dans « pouvoir »
Dans certains textes, l’attente d’un ensemble reconnaissable n’est pas satisfaite dans la mesure où le cheminement pour parvenir au mot est trop long. On suit ce parcours « inadmissible » dans maints poèmes, comme avec "Passionnément" dans Le Chant de la carpe :
pas pas paspaspas pas
pasppas ppas pas paspas
le pas pas le faux pas le pas
paspaspas le pas le mau
le mauve le mauvais pas
pasppas pas le pas le papa
le mauvais papa le mauve le pas
[etc.]
On comprend que Ghérasim Luca préfère le néologisme « ontophonie » à « poésie » pour parler de ce qu’il écrit / lit — le mot apparaît d’ailleurs dans un de ses titres, Sept slogans ontophoniques *. Le mot valise « créaction » définit assez bien de quoi il s’agit— création par action sur les mots, la matière ; par la répétition et le bégaiement, l’énoncé perd sa structure linéaire et l’auditeur ou le lecteur, eux, perdent leurs repères. De même, le simple déplacement des lettres (« Je m’oralise) aboutit à superposer deux significations, comme si une autre langue vivait dans celle que l’on pratique habituellement ; parmi tous les exemples, je retiens la lecture des voyelles dans Paralipomènes ; il n’y est plus question de couleurs comme dans le sonnet de Rimbaud :
O vide en exil A mer suave
I mage E toile renversée U topique
Ghérasim Luca, avec une force loin de tout consensus, fait comprendre qu’il n’y a pas de représentable, de mimésis en poésie, en littérature. Ne cessons pas de le répéter.
* Tous les textes de Ghérasim Luca sont disponibles aux éditions Corti. Héros-Limite, Le Chant de la carpe et Paralipomènes ont été repris ensemble dans la collection Poésie de Gallimard.
Ghérasim Luca, Je moralise, Corti, 2018, np;, 13 €. Cerre recension a été publiée sur Sitaudis le 26 mars 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, je moralise, jeux de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
18/04/2018
Benoît Casas, L'agenda de l'écrit : recension
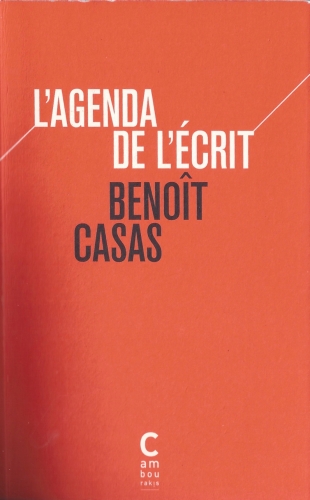
C’est seulement dans la seconde moitié du xviie siècle (1662) que l’agenda est défini comme un petit carnet où l’on note ce que l’on a à faire ; l’agenda proposé par Benoît Casas a d’autres fonctions, la première étant de donner à lire 366 textes de 140 signes — c’est une année bissextile qui est retenue, Félix Fénéon, anarchiste jusqu’au bout, ayant eu le bon goût de mourir le 29 février 1944. Les règles de construction sont données : si l’indication de date correspond au jour de la naissance d’un écrivain, le texte est écrit à partir de mots tirés des deux premières pages d’un de ses livres, s’il s’agit de la date de sa mort, ce sera à partir des deux dernières pages. Aucune division du blanc sous le texte ; l’agenda est d’abord un recueil d’écrits (mais laisse beaucoup de place au lecteur s’il veut, lui, commenter). Le choix des auteurs n’a rien d’innocent, pas plus que celui des citations ; le lecteur actif (mais comment lire autrement ?) peut construire à partir de cet ensemble ouvert une esquisse de pratique et de théorie de la lecture, de manière de se situer dans la société.
Il n’est pas indifférent d’examiner ce qui ouvre et ce qui ferme un livre. Pour le premier jour de l’année, le lecteur attend une naissance ; le nom retenu est celui d’Édouard Levé, et l’on pense aussitôt à son livre, Œuvres, formé de cinq cent trois « œuvres dont l’auteur a eu l’idée, mais qu’il n’a pas réalisées ». Le premier extrait qui débute l’agenda, « un livre de mémoire », définit en partie le projet de Benoît Casas : conserver, au moins dans l’idéal, ce qui constitue une bibliothèque. Le texte du 2 janvier, date de la mort d’Edmond Jabès, complèterait le projet ; une collection de livres n’est pas chose morte, la mémoire n’a de sens que si elle permet d’agir, « l’insistant futur est dans les mots du livre seul ». Ce lien entre le livre et l’action, le lecteur peut à son gré le reconstruire en associant des montages/collages, et d’abord ceux qui se rapportent au contenu des livres.
La littérature ne peut être séparée de la vie quotidienne, de ce que les hommes éprouvent, souffrances et joies, et l’un de ses propos est de rapporter ce qui forme le tissu des jours. Virginia Woolf confiait « Commencer un cahier où je noterai mes impressions » ; Schoenberg entendait dépasser ce cadre et relater toute « expérience (…) en ses moindres détails », tout comme Chateaubriand qui affirmait « J’écris pour rendre compte de la vie ». Cette volonté de dire la totalité du vécu qui animait aussi Saint-Simon, « Écrire (…), c’est se rappeler vif l’ici-bas », n’est-elle pas un leurre ? Plusieurs fragments assemblés par Benoît Casas vont contre l’idée que la notation scrupuleuse du vécu puisse aboutir à la compréhension des choses, parce que « la vie ici-bas, [est] étrange, obscure » (H. G. Wells), qu’ « Écrire la vie est impossible » (Herman Melville), que « l’énigme demeure, sans solution » (Ingmar Bergman). Noter dans un Journal n’est guère suffisant, même si l’on imagine « saisir le meilleur de ce temps », comme le pensait V. Woolf : toujours on demeure « dans la nuit de la parole » (Novarina)
Ce qui importe ne serait pas de relater ce que l’on voit ou vit, avec l’illusion peut-être de rendre compte de cette manière des événements ; on risquerait de n’avoir qu’une vue myope, au mieux on accumule des éléments, mais dans quel but ? Sartre donne une réponse : « Écrire les événements au jour le jour : pour y voir clair » ; cependant cette écriture doit être définie, elle ne peut être neutre : que signifie ici « écrire » ? La réponse de Pasolini est sans ambiguïté, il faut « Transcrire ce parcours terrestre (…) de la façon la plus directe, violente » — et vient à l’esprit pour ce qui est de la violence, un de ses textes, La rage. Cette violence seule aboutirait à dire le vrai d’une société, proposition soutenue par des écrivains de culture et d’époque bien différentes ; pour Goldoni, on écrit pour « ne dire que la vérité » et William Carlos Williams lui fait écho : « La vérité, la lumière — violente — est notre seul recours ». C’est une position militante, que le philosophe adopte, sans concession ; « Programme : il faut lire en vérité », « Je me propose d’éclairer », précise Jean-Claude Milner. La vérité passe par le « déchiffrement » (Jean Bollack) et elle est au centre de la réflexion de qui ne s’arrête pas au seul enregistrement de ce qui se passe — qui n’est jamais neutre ; « Quelque chose est à dire, à dire malgré tout, peut se dire, nécessaire nouveau, quelque chose de vrai : la vie ordinaire révolutionnaire » (Bernard Aspe) — on se souvient que La vie ordinaire est le titre d’un livre de poèmes de Georges Perros. Dire le vrai est la première condition pour changer le cours des choses, ce qui n’entraîne pas ipso facto le changement, comme le rêvait Rimbaud : « au revoir l’exploitation, ce monde cynique a sombré ». Ce monde, on ne le sait que trop, est encore là. Et sa transformation est encore à rêver, en précisant comme le faisait Tristan Tzara ce que sont les données et le but : « Combattre l’ordre économique, la misère morale : c’est l’homme et sa libération qui reste l’enjeu ; la volonté radicale de changer le monde. »
Les montages de Benoît Casas en suscitent d’autres, et c’est là un des aspects intéressants du livre… Le lecteur, crayon en main, pourra composer son recueil autour de l’amour en associant des extraits de Borges, Djuna Barnes, Aragon, Corneille, etc., ou s’attacher à l’ensemble important des textes autour de la nuit ; il trouvera aussi de brefs récits (Desnos, 4 juillet), une manière d’autoportrait (15 décembre) ou s’attardera à l’idée du livre comme énigme (Proust, 10 juillet), etc. Les reconstructions du lecteur peuvent aller dans maintes directions ; si se dessine une figure, celle de Benoit Casas, elle ne peut être que protéiforme, à l’image de la variété des auteurs qu’il a retenus. Une vingtaine sont toujours vivants, écrivains (Emmanuelle Pagano, Anne Portugal, Dominique Meens, Novarina, etc.), philosophes et penseurs de la société, comme Alain Badiou, Michel Foucault, Bernard Aspe, ou de l’art comme Jean-Louis Schefer ; d’autres philosophes sont présents, comme notamment Castoriadis, Marx, Lacoue-Labarthe, Wittgenstein, Spinoza, Kierkegaard. On pourra relever le nom des classiques : si les Français sont majoritaires, les écrivains de langue anglaise sont largement plus nombreux que ceux de langue allemande ou italienne ; on ne fera pas la même remarque si l’on compte les noms cités deux fois dans l’agenda (date de naissance et de décès), la langue italienne étant presque à égalité avec l’anglaise — Benoît Casas la traduit.
Ce qui paraît plus marquant que ces relevés, dont je ne suis pas sûr qu’ils puissent suggérer un commentaire, c’est la place de personnes communément perçues comme éloignées de l’écriture ; peintres (Fromentin, Corot, Cézanne, Bernard Collin), historiens de l’art (Focillon, Baltrusaïtis), cinéastes (Jean Eustache, Ingmar Bergman, Chris Marker), homme de théâtre (Vitez), compositeurs (Schoenberg, Stravinsky, Cage), interprète (Miklos Szenthelyi), psychanalyste non freudien (Groddeck). Il n’y a pas ici de frontière étanche entre différents domaines de la création et il est bon de le rappeler. Il est bon aussi de s’apercevoir que beaucoup d’écrivains sollicités ne sont probablement pas connus des lecteurs, soit parce qu’ils sont trop peu traduits, comme Alfred Kolleritsch, ou un peu oubliés, comme Jean-Paul de Dadelsen ou Carl Sandburg. Bonne occasion d’aller les découvrir.
Certains lecteurs s’étonneront peut-être de lire Honoré d’Urfé et Senancour, Grazia Deledda et Samuel Pepys, alors que Shakespeare et Cervantes, Racine et André Breton sont absents ; c’est oublier que L’agenda de l’écrit n’est pas un recueil visant à donner une vue encyclopédique de la littérature. Qu’il reflète des choix ne fait pas de doute, et c’est heureux : aucun hasard des dates si le livre s’achève avec Lorine Niedeker, morte le 31 décembre 1970 (et pas avec Miguel de Unanumo, mort le 31 décembre 1936), c’est-à-dire avec une des figures majeures de la poésie américaine, largement représentée. On sera plus attentif aux présents qu’aux absents — rien n’empêche d’en faire une liste et de construire à son tour un agenda — et, surtout, à l’abondance des voies ouvertes grâce aux montages, ce qui donne un rôle actif à la lecture. Un extrait, également d’un poète américain, pourrait sans doute servir de règle de conduite, pas seulement à Benoît Casas, « Lutter, chercher, trouver, et ne jamais céder » (Charles Reznikoff).
Benoît Casas, L’agenda de l’écrit, Cambourakis, 2017, 374 p., 14 €.Cette recension a été publiée sur Sitaudisle 25 mars 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoît casas, l’agenda de l’écrit, dates, naissance, mort, écrivain, peintre, musicien | ![]() Facebook |
Facebook |
09/04/2018
Ceija Stojka, Nous vivons cachés, Récits d'une Romni à travers le siècle : recension
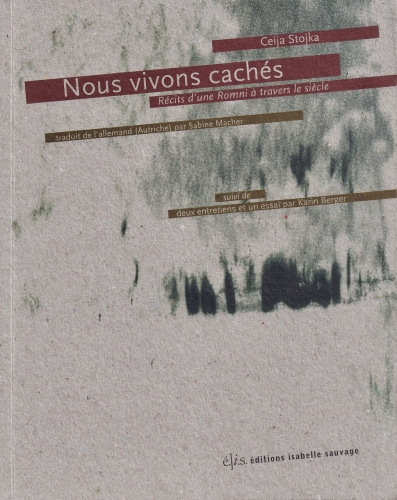
Les Roms ne sont généralement pas bien considérés en France — ne parlons pas de leur sort, par exemple, en Hongrie —, sauf s’ils sont musiciens comme, aujourd’hui, Biréli Lagrène (mais oui ! on aime la musique manouche !) ou, hier, Georges Cziffra (ah bon, c’était un Rom ?). Ceija Stoika vivait en Autriche quand son père a été arrêté, en 1941, et assassiné par les nazis à Dachau ; ensuite, ses grands-parents subirent le même sort, et il y eut un répit : elle et toute la famille ont été déportées à Auschwitz. Elle avait 11 ans.
S ., bien longtemps après, a pris la plume et raconté, s’il est possible de « raconter » ce qu’est un lieu d’extermination : « J’en rêve toute le temps. Des barbelés, des gémissements, des cris des gens », disait-elle dans un entretien en 1987. Ce qu’elle rapporte, sans doute l’a-t-on déjà lu dans d’autres témoignages mais, outre que les écrits des rescapés de la communauté romani sont rares, il est nécessaire que ces temps où des hommes en détruisaient d’autres au nom d’une imaginaire pureté raciale ne soient pas oubliés.
Ce qui doit rester en mémoire, c’est que le rejet de ceux qui étaient différents — des nomades comme les Roms, ou des Juifs — conduisaient à élever des poux à typhus dans des couvertures, à jeter des hommes et des femmes vivants dans des puits emplis d’huile et à y mettre le feu quand les crématoires ne suffisaient plus à les brûler, à affamer les déportés, à plonger l’hiver dans l’eau glacée une femme pour la punir de ne pas marcher assez vite. Etc. Et C. S . rapporte que les femmes SS ne le cédaient en rien aux hommes pour la cruauté.
Après Auschwitz et Ravensbrück, C. S. et sa mère ont connu Bergen-Belsen, où les morts, tant ils étaient nombreux, étaient laissés en tas à côté des baraques. Les déportés durent creuser de longues fosses, selon les SS pour qu’ils disposent de latrines, mais les déportés surent au moment de la libération du camp qu’elles devaient être leur tombeau. Les Anglais les libèrent en avril 1945, s’occupent des rescapés qui, après un repos nécessaire, retournent par leurs propres moyens chez eux. C. S. et sa mère retrouvent Vienne et, rapidement, une des filles, puis les deux garçons les rejoignent. Une autre vie commence.
S. n’a pas alors quatorze ans et elle apprend à mieux lire et à écrire le temps passé à la ville ; ensuite, c’est le long temps du voyage en roulotte. Retenons quelques épisodes de leur vie qui éclairent sur la manière dont, très souvent, étaient perçus les Roms. Une fermière leur donne un poussin, qui vit en bonne entente avec les chevaux mais qui provoque régulièrement les questions des gendarmes, au point qu’une fois C. S. doit retourner à la ferme pour avoir un "certificat de naissance". Lorsqu’elle a eu besoin d’une carte d’identité, le fonctionnaire lui fait « très bien sentir toute la haine qu’il avait pour » elle. Enfin, sur un marché, la mère de Ceija, alors qu’elle vendait des tapis, un homme ayant vu son tatouage de déportée lui cracha qu’Hitler n’en avait pas assez supprimé. À l’inverse, la famille est chaleureusement reçue dans des fermes l’hiver ; alors, « deux mondes différents se rencontraient, celui de la Romni voyageuse et celui de la femme enracinée » et ces deux mondes s’acceptent sans difficulté.
Les changements dans la société conduisent C. S., comme d’autres Roms, à abandonner la vie en roulotte et à s’établir à Vienne. Beaucoup plus tard, au début des années 1980, elle entreprend de raconter ses expériences, d’abord sur des bouts de papier ; Karin Berger, qui recueille des témoignages de femmes sorties des camps nazis, la rencontre et l’encourage, conduit des entretiens (deux sont présents dans ce livre), écrit ensuite sa biographie et tourne deux documentaires avec elle (Ceija Sojka, portrait d’une Romni a été diffusé sur Arte). Parallèlement, C. S. dessine et peint — une partie de ses œuvres a été exposée à Paris. Ce besoin de laisser des traces des années terribles de l’enfance, de peindre est lié à la nécessité, comme elle le dit dans un entretien, « de sortir au dehors » : « nous devons nous ouvrir sinon un jour, il peut arriver que tous les Roms disparaissent dans un trou ». On ne saurait mieux dire.
Le livre est accompagné de photographies, de C. S. et de sa famille. Sabine Macher avait traduit, pour le même éditeur, Je rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen (2016) et elle restitue avec bonheur la précision et la simplicité de l’écriture de C. S. Un livre à introduire dans toutes les bibliothèques publiques et scolaires.
Ceija Stojka, Nous vivons cachés, Récits d’une Romni à travers le siècle, traduction de l’allemand Sabine Macher, isabelle sauvage, 2018, 296 p. 27 €. Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 21 mars 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céija stojka, nous vivons cachés, récits d’une romni à travers le siècle, traduction sabine macher | ![]() Facebook |
Facebook |
17/03/2018
Catastrophes, revue numérique de poésie

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, très peu de revues exclusivement, ou presque, consacrées à la publication de poèmes sont publiées sur internet, comme par exemple, ce qui reste. Catastrophes, depuis octobre, a fait ce pari : pas de notes de lecture, pas de commentaires, seulement un éditorial en accord avec le titre retenu pour chaque livraison : "Octobre 17", "Zombies ou fantômes", "Noël au ball-trap", "Hautes résolutions", "L’esprit du bas". Chaque fois, les textes sont regroupés en ensembles dont la désignation n’est pas faite, volontairement, pour orienter le lecteur, mais participe de l’esprit de la revue ; qu’on en juge : pour le premier numéro, "Boum", "Tilt", "Shebam", "Dring", "Wizzzz", pour le dernier, "fous", "lubriques", "cornards", "bateleurs". De plus, des poèmes publiés en feuilleton passent dans des rubriques différentes d’un mois à l’autre.
Pour l’esprit, il y a d’abord le titre, qu’on peut lire comme une provocation dans notre monde en crise — tout comme le logo de la revue (en tête de cet article) — ; mais "catastrophes" est au pluriel, et c’est un « pluriel optimiste » : pour paraphraser les responsables de la revue, l’écriture doit pouvoir bouleverser le cours des choses et créer en même temps, dans la voix, autre chose. Relisons la fin de l’éditorial de la première livraison, il y a à l’œuvre « un puissant désir de tout recommencer. (…) Comme si l’on reparlait, enfin, après la catastrophe. Comme si tout était à construire de nouveau. Comme si c’était Octobre 17. »
On pourra estimer le projet trop ambitieux, on peut aussi penser qu’il est nécessaire. Est bienvenue une revue de création qui « s’intéresse à toutes les voix », pour laquelle la poésie n’est pas exsangue, mais bien au contraire vivante, inventive, comme le prouvent l’abondance des éditions, la quantité de lectures publiques et de manifestations, le nombre de revues critiques sur internet — répétons avec Catastrophes qu’internet est un moyen qui facilite l’expérimentation. Dans toutes les directions : l’éditorial du n° 5, le dernier paru, souligne que « La poésie fait parler le corps de la langue, pas seulement la tête. Son corps qui jouit, mange, défèque, gonfle risiblement jusqu’à accoucher d’un renouvellement du temps. » Lisons encore une autre proposition, avec laquelle il serait difficile de ne pas être d’accord, pour dire ce qu’est le poème — de Nerval ou de Michaux, d’Emily Dickinson ou de Rose Ausländer : il « relève la part d’inconnu qu’il y a dans les choses », il est toujours du côté de « l’indécidable ».
Pour mener à bien ce projet, trois écrivains, Laurent Albarracin, Guillaume Condello et Pierre Vinclair travaillent ensemble, retiennent les textes et en sollicitent, choisissent les illustrations, toujours superbes (une pour chaque poème publié). Ils traduisent aussi : G. C., l’anglais, P. V., l’anglais, notamment celui de Singapour. Catastrophes est évidemment une revue ouverte à toutes les langues et, dans ces premiers numéros, le lecteur relira Gabriela Mistral (Chili), découvrira Leónidas Lamborghini (Argentine) et plusieurs poètes des États-Unis de la nouvelle génération (Leslie Harrison, Alan R. Shapiro, Muriel Rukeyser, Solmaz Sharif ). Mahomet, un essai d’Eliot Weinberger, écrivain d’une autre génération (né en 1949), n’était pas traduit, pas plus que Pound pour The Classic Anthology Defined by Confucius, dont la traduction par Auxeméry1 est accompagnée par celle de Pierre Vinclair du Shijing, anthologie de poésie chinoise d’avant notre ère. Auxeméry enrichit sa traduction d’une étude ("L’invention de la lumière ") sur la lecture du chinois par Pound, étude qui éclaire aussi la lecture que l’on peut faire des Cantos et, également, ce qu’est l’acte de traduire, « à la fois se ressembler et se rassembler. Devenir soi, le même de soi, dans le miroir, par l’entremise du miroir exigeant de l’autre en sa diversité. » Pierre Vinclair donne à lire des poètes de Singapour tout à fait inconnus en France (Christiane Cia, Madeleine Lee, Joshua Ip) et, en feuilleton, Claire Tching a entrepris de rassembler des poèmes souvent en français à Singapour ("La poésie française à Singapour"), le plus souvent par des inconnus.
Il faut reprendre l’ensemble des numéros parus pour voir en quoi Catastrophes, comme je l’ai noté, est une revue de découverte et de création. Outre la traduction de textes inédits en français, outre des poèmes des responsables de la revue, le lecteur rencontrera une "épopée papoue" en tercets de Florence Pazzottu et un poème en prose de Fabrice Caravaca, des sonnets (rimés) de Christian Prigent et un long poème — annoncé de 260 pages — signé Pierre Lenchepé2 et Ivar Ch’Vavar, Serge Airoldi et Alexander Dickow, les échanges de Julia Lepère et Fanny Garin, etc. Sans omettre une discussion entre Laurent Albarracin et Pierre Vinclair à propos de la haine de la poésie : à lire leurs livres, ils s’accordent sur le fait qu’on peut lire dans cette formulation de Bataille le fait que le poème « va dire enfin ce qui est, et qui ne peut être dit autrement » (P. Vinclair), que « la poésie mène du connu vers l’inconnu » (Bataille, Œuvres complètes, V, p. 158)
Catastrophes est mis en ligne chaque mois, mais il est bon de s’abonner : les contributions arriveront dans votre boîte avant d'être réunies : revuecatastrophes.wordpress@com
- Auxeméry a publié récemment un recueil de poèmes, Failles /traces (Flammarion, 2017).
- enchepé, en Picard, signifie « maladroit » — ce qui s’applique mal à Ivar Ch’Vavar…
Catastrophes, revue numérique de poésie, février 2018, n° 5, np.
Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 9 février 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catastrophes, revue numérique de poésie, pierre vinclair, laurent albarracin, guillaume condello | ![]() Facebook |
Facebook |
27/02/2018
Isabelle Lévesque, Voltige ! (recension)

Les vers d’Apollinaire cités en exergue — « C’est la chanson des rêveurs / Qui s’étaient arraché le cœur / Et le portaient dans la main droite » — annoncent le thème de l’amour (le couple présent-absent) et celui de l’imaginaire. Tous deux, avec le motif du temps (la fleur éphémère, les saisons, le passé), charpentent le recueil, dont le lyrisme se lit d’entrée dans l’abondance d’éléments qui connotent la naissance du monde. Le premier poème commence avec l’aurore, le matin, le chant du coq, l’ouverture des fleurs, mais également avec la présence d’un couple qui semble surgir d’ailleurs (« nos pieds nus / sur la terre »). La nourriture même apparaît première : « les blés le pain la couleur ». La couleur, c’est celle, symbolique de la vie, le rouge ; rouge de la crête du coq, rouge du coquelicot.
Une narratrice sollicite le regard de l’Autre (« Vois mes mains ») et son acquiescement (« Sais-tu », « Veux-tu »), sans qu’une présence continue au cours du livre soit assurée, peut-être réelle, peut-être rêvée. C’est le lieu présent qui signifie l’existence du couple (« ici / nous unissait ») ou, d’une manière différente, la couleur. Le bleu, c’est celui des yeux de l’Autre, mais aussi celui du bleuet, qui croît toujours dans les mêmes champs que le coquelicot, c’est-à-dire la fleur attachée à la narratrice (« Je suis / coquelicot »). L’association des deux fleurs figure une union source de vie, la parole amoureuse même est liée aux fleurs par la couleur et l’épanouissement (« Sur tes lèvres / mes mots fleurissent »).
Cependant, la fleur est aussi le symbole de l’éphémère, de l’impermanence ; « le vent faucheur » les emporte, le temps les tue. Quand vient le matin, c’est la pensée que le soir sera bientôt là qui domine, et les saisons se succèdent dans le recueil, l’hiver, le printemps et ses « fruits verts », l’été. La neige, élément récurrent, signale aussi l’engourdissement de la nature, image de la fin et, par ailleurs, renvoie sans ambiguïté à un passé lointain : « neiges d’antan » ne peut évoquer que Villon. Le couple formé ne vainc pas le temps et c’est ce que signifie, à sa manière, le lai du chèvrefeuille auquel il est fait allusion. Dans le texte de Marie de France, en effet, Tristan et Iseut se rencontrent grâce à une absence du roi Marc, leur complémentarité n’est donc que passagère, vient rapidement la séparation et l’attente d’une nouvelle circonstance favorable pour d’autres retrouvailles, comme si toute stabilité était exclue, « jamais toujours : seule proposition ».
Pourtant, la vie l’emporte. Le temps, au moins provisoirement, serait vaincu par la trace gravée sur l’arbre, un cœur percé d’une flèche, figure de l’union comme l’étreinte : « Ce soir, cercle clos // tes bras m’entourent ». Mais la vie n’est pas dans l’immobilité pour Isabelle Lévesque, bien plutôt dans la « danse folle » : le titre « Voltige ! » évoque les déplacements rapides, comme ceux de l’acrobate qui sans cesse cherche-trouve-perd son équilibre. La danse est image de la vie, comme le coquelicot dont les pétales s’envolent, « Danse coquelicot ! / Le vent ne peut rester debout, je cesse et libre. // Voltige. » D’un bout à l’autre du livre, on lit le passage de la présence à l’absence, de l’ « ici maintenant » de plénitude à la quête du moment « qui confond le passé le présent ».
Le passé est un temps analogue à celui du rêve : tout désir y a été réalisé, et le passé le plus riche est celui de l’enfance. Revisitée, elle offre le plaisir de revivre ce qui est ordonné, sans épines, « aubaine / à miracles espérés ». Il suffirait de s’y transporter avec l’aimé pour connaître l’accomplissement ; cependant, la proposition « Prendre ta main, nous sommes enfants » n’est qu’un désir qui ne fait pas disparaître le « désarroi de vivre », ni le fait que le vent disperse du coquelicot « les pétales nus loin des blés ». Le caractère souvent rêvé de la plénitude de la femme est restitué par Colette Deblé, qui allie le rouge et le bleu dans ses lavis d’après des figures peintes dans le passé.
Françoise Ascal, dans sa postface, rapproche la thématique d’Isabelle Lévesque des romantiques allemands, notamment pour sa quête « réconciliant le réel et l’imaginaire » et la place particulière faite aux fleurs. Elle note aussi le caractère souvent elliptique des vers ; ce caractère oblige avec bonheur le lecteur à construire ses images, comme dans ce vers parmi d’autres : « Gestes, souffles, prières, rester, poursuivre, garder la fièvre » — on relève ici une régularité du rythme (2/2/2/2/3/4) que l’on retrouve dans l’ensemble du livre. On sera également sensible aux récurrences de quelques mots (vent, rouge, bleu, coquelicot, par exemple) et aux homophonies (rive, rires, rythme ; laisse, lai ; signe, saigne, etc.) qui, comme le rythme, contribuent à l’unité du livre. Voilà une voix singulière à découvrir.
Isabelle Lévesque, Voltige !, peintures de Colette Deblé, L’herbe qui tremble, 2017, 96 p., 14 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 27 janvier 2018.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle lévesque, voltige !, colette deblé, coquelicot | ![]() Facebook |
Facebook |
21/02/2018
Fabienne Raphoz, Parce que l'oiseau (recension)
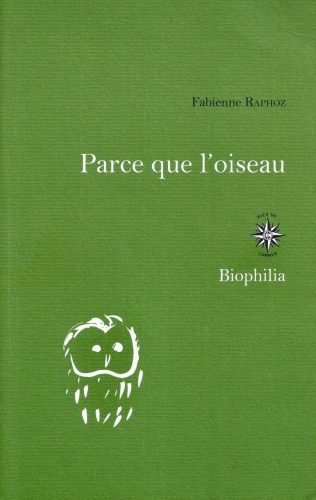
Un exercice de jubilation
Même si Fabienne Raphoz distingue fort bien de nombreuses espèces d’oiseaux par leurs cris ou leur apparence, même si un enregistreur et la paire de jumelles ne la quittent guère dans ses promenades, dans ses voyages en Afrique ou en Amérique, elle ne se voit pas autrement que comme une ornithophile, donc comme « celle qui aime les oiseaux », et la page de titre précise, après Parce que l’oiseau, « Carnets d’été d’une ornithophile » — extension de l’emploi d’un mot qui qualifie des plantes pollinisées par des oiseaux. Amour des oiseaux ? Un mot revient plusieurs fois dans le livre, "jubilation", et c’est cette jubilation que souhaite faire partager l’auteure.
Le livre ressemblerait à un Journal de bord, si l’on ne retenait que quelques dates liées à l’écriture du livre (« Depuis le 29 juin », « 20 juillet »), mais d’autres renvoient à un Journal plus ancien (« 27 février (dans le journal de l’année 2015) » et ce qui est présenté comme « une ballade au bois » ne se limite pas aux faits observés un été. Plusieurs séquences sont consacrées aux oiseaux du lieu de vie, le Colombier, dans le Lot, mais aussi à sa faune, d’autres se rapportent à des lieux éloignés. On lira, par exemple, un développement concernant l’Égypte ancienne et la colonne d’un tombeau qui porte les dessins d’une Pie-grièche, d’un Front-blanc, d’une Huppe fasciée. Avant une brève « coda », où deux motifs sont rappelés, celui de la présence d’une Hulotte près du Colombier et celui des migrations, un conte dont on verra la fonction(1). S’ajoutent un index des individus et espèces cités, et une bibliographie.
La joie profonde, Fabienne Raphoz l’éprouve évidemment grâce à l’observation des oiseaux, de leurs déplacements, de leur nids (celui du tisserin, par exemple), de la relation étroite d’un oiseau (le Pic à face blanche) avec son environnement (le Pin des marais ), de la comparaison des chants (celui de l’Hypolaïs polyglotte avec celui de l’ictérine) : il y a dans l’écoute attentive le plaisir immédiat, notamment, de distinguer des chants très proches, à l’occasion « une grande jubilation d’ajouter un son inconnu à [sa] petite encyclopédie sonore » et, en outre, « tous les espaces sonores ont (…) la force évocatrice d’un souvenir d’enfance ». L’enfance en Bretagne et le lien vécu alors à la nature sont évoqués, et il existe une continuité entre les souvenirs et les sentiments éprouvés lors de certaines observations : « attendre, de nuit, l’éveil du vivant dans une forêt équatoriale d’Afrique (…) expérience originelle unique de tous les sens (…) du paradis (…) premier. »
Un autre motif de joie vient de la relation à la langue. Parlant d’une espèce, le Rouge-queue à front blanc, Fabienne Raphoz passe à la définition de "espèce", ajoutant « Les noms savants sont souvent plaisants », autant que les noms de la langue vernaculaire ; le plaisir de la nomenclature, vif ici, se retrouve dans les poèmes de Jeux d'oiseaux dans un ciel vide, augures. Le plaisir d’établir des listes (ainsi par exemple la liste des Pouillots) a probablement un rapport avec l’enfance, mais nommer est également une manière d’ « ineffacer ce qui nous entoure » ; c’est encore « naître de concert avec ce qui nous (…) distingue » de ce que nous nommons. L’établissement de la nomenclature importe d’autant plus que certains noms sont prétexte à rêveries étymologiques, que la méthode linnéenne de classification a pour Fabienne Raphoz une « puissance poétique » qui la « fait toujours rêver ».
Rêveries, mais aussi questions insolubles. Il y aurait à comprendre ce que signifie chants et cris ; chacun reconnaît un cri d’alerte pour protéger le nid, par exemple, mais tous les chants sont indéchiffrables. Quant à la perception qu’ont les oiseaux des humains, elle nous est obscure : sans doute savent-ils reconnaître qui les nourrit l’hiver, mais pour le reste ? L’ornithophile, les observant, peut écrire « pour se rapprocher un peu plus d’ « eux », c’est-à-dire de toi », lecteur. C’est bien au lecteur aussi d’aller vers tout ce qui nourrit le livre, textes littéraires cités ou auxquels il est fait allusion (auteurs grecs anciens, Dante, Lewis Carroll, Melville, Paul Louis Rossi, etc.), films (Thelma et Louise, L’homme qui tua Liberty Valance, Soylen Green) et, nombreux, essais des naturalistes.
Les rêveries, comme la jubilation, sont cependant gâchées par la réalité : 20% des 10 000 espèces d’oiseaux sont en voie d’extinction. Au xviiie siècle, le Conure de Caroline, la Colombe voyageuse, comme ailleurs le Dodo, ont été exterminés ; dans une île australasienne, des bateaux débarquent, pour pouvoir ensuite trouver un approvisionnement, des cochons et des chèvres — mais aussi des rats, et une espèce endémique est éradiquée. Le Jabiru et l’Ibis chauve survivent dans des parcs… On multiplierait les exemples : « Notre espèce a peut-être d’autant mieux détruit « son » milieu, qu’il n’était justement pas le sien. »
Il faut donc protéger, certes, les espèces d’oiseaux qui demeurent — et pas seulement les oiseaux —, et apprendre à les observer ; l’amateur, même moins "savant" que Fabienne Raphoz, a sur le spécialiste l’avantage d’être toujours un « éternel débutant » et son peu de savoir l’aide peut-être à rêver. Le conte autour de Jean-Denis le forgeron nous y encourage : installé dans un arbre pour se rapprocher des oiseaux, il s’endort, rêve et disparaît dans leur monde. Toujours éveillé, le lecteur de Parce que l’oiseau suit les voyages de l’ornithophile, voyages autour de sa maison ou dans les forêts lointaines. Avec jubilation.
- La réunion de contes est une des activités de Fabienne Raphoz, qui en a rassemblé (L’aile bleue des contes, l’oiseau) et qui a créé une collection (collection Merveilleux). Fabienne Raphoz, Parce que l’oiseau, Corti, 2018, 192 p., 15 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 20 janvier 2018.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, parce que l’oiseau, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
11/02/2018
Jacques Lèbre, L'immensité du ciel (recension)
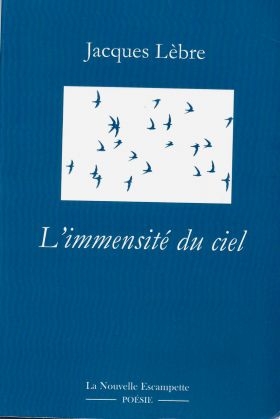
« la succession des jours est une étrange mitraille »
Le livre, en trois ensembles titrés, s’organise autour de quelques thèmes qu’annonce le poème d’ouverture, "Un matin" ; il débute par ce qui ouvre la journée, le lever et la douche, c’est-à-dire un nouveau commencement, moment propice au vagabondage de l’esprit et aux questions. Jacques Lèbre en pose une qui introduit les thèmes de la mort et de ce qui la suit : « Le dernier souffle d’un mourant doit bien partir quelque part / et comme un fétu se poser dans le giron d’une naissance ? ». De là découlent d’autres motifs, celui de l’oubli du passé, de la vie des disparus, celui aussi de la solitude des humains dans la nature, de l’impossible échange avec les autres êtres vivants. Si la métempsychose existait, cela ne changerait rien mais, quitte à ce que l’esprit — « l’âme » — migre, mieux vaudrait pour le poète devenir bouton de fleur pour ne pas « durer ou (…) durcir ».
Ces thèmes lyriques sont revisités en tous sens, fortement à partir de la mort du père, « réduit, désormais, à l’immensité du ciel » — vers qui achèvent la seconde partie et lui donnent son titre. Il est d’autres réductions. Ainsi, le nom du père est suivi de l’année de sa naissance et de sa mort, comme sur une pierre tombale, résumé lapidaire du temps de passage sur la terre. Ce qui reste et est énuméré, ce sont les objets liés au loisir, la canne à pêche, l’établi, l’outillage pour bricoler, mais le jardin qu’il cultivait a disparu. L’urne même du columbarium ne contient pas plus de cendre que n’en fournirait une bûche. Ce qui demeure encore vif et suscite l’émotion, ce sont quelques moments vécus avec lui, quand ils reviennent brusquement à la mémoire un jour, au marché, devant des girolles : le père initiait l’enfant à leur recherche. Mais comment vivre quotidiennement l’absence ?
Un poème ("Mère"), consacré à la vie de la mère, suit immédiatement l’évocation de l’urne cinéraire. Les repères de la journée, comme par exemple l’heure des repas, construits au cours des années avec le compagnon sont perdus, et ne se maintiennent que les gestes qui permettent de continuer à être là, à vivre normalement (« si jamais la vie est une chose normale »). On sait bien que le temps vécu n’est pas celui des horloges, l’absence introduit un dérèglement et rien de concret, comme l’étaient les échanges avec le mari, ne signale maintenant son écoulement. Tout ce qui était partagé, ou pris en charge comme le déplacement d’un meuble, incombe à celle qui reste ; il n’y a plus d’autre temps que celui de la solitude, que les souvenirs ne peuvent rompre.
La mort, en effet, efface tout, le corps pouvant même disparaître totalement comme ce fut le cas avec les fours crématoires des nazis. Au mieux, elle « laisse un cadavre / dont il faut se défaire au plus vite », et il ne demeurera rien non plus de son passage : les noms inscrits dans un cimetière n’apprennent rien de ceux qui les ont portés. On peut éprouver une sorte de vertige à lire ces noms — Jacques Lèbre en recopie —, tout comme à voir exhumer, au cours de fouilles, des ossements d’une nécropole. Une fois le corps voué aux vers, rien ne demeure « de sa vie, de ses pensées, de ses sentiments », et plus l’on remonte dans le temps, moins ce que fut la majorité des hommes garde de traces. Jacques Lèbre remarque que, dans le brouillard du Moyen Âge, seuls semblent subsister la mémoire des conflits qui opposaient les seigneurs pour agrandir leurs domaines : rien n’est conservé des ouvriers qui construisirent les églises romanes. Cependant, ce que l’on retient du passé n’est pas limité à quelques noms de roitelets et leurs luttes d’intérêt, et le texte de L’immensité du ciel en témoigne, avec les citations de fragments de Nelly Sachs, Ossip Mandelstam, Dante, Pierre Morhange, Fernand Deligny, Alfred Gong, Joseph Joubert, W. C. Sebald…
L’art du sculpteur qui représente dans la pierre le chant, les textes des écrivains nourrissent le présent, mais sans pour autant supprimer la solitude des humains ou, plutôt, ils vivent entre eux, coupés définitivement de la nature, donc dans leur silence. Pour les animaux, notre langage n’a pas de sens, pas plus que leurs cris (chant, meuglement, aboiement, etc.) n’en ont pour nous ; quand on croise le regard de telle ou telle bête, « on dirait des appels auxquels nous ne savons pas répondre ». N’y a-t-il pas d’issue, sinon de vivre sans illusion le temps qui nous est alloué, la perspective d’une résurrection étant écartée avec ironie : manque de place pour tous les revenants et chacun « déféquant sur ses talons, se pissant sur les pieds » ? C’est le sort commun, et il faudrait le vivre avec le chant du chardonneret : alors, avec l’oiseau, comme l’écrit Mandelstam, « nous regarderons le monde tous les deux » — réconciliation lyrique, dans ce dernier vers du livre, de l’homme avec la nature, qui suit la demande faite à l’oiseau, « suspends notre dévalement vers la mort » par ton chant.
Jacques Lèbre, L’immensité du ciel, La Nouvelle Escampette, 64 p., 13 €.
Cette note a été publiée sur Sitaudis le 7 janvier 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, l'immensité du ciel (recension) | ![]() Facebook |
Facebook |
26/01/2018
Antoine Emaz, Limite : recension
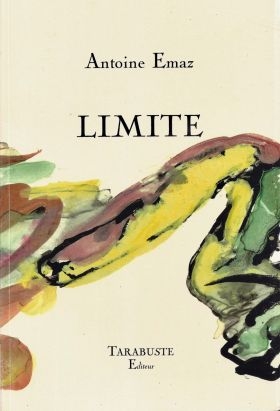
« une lumière d’être / malgré »
Limite débute sous la forme d’un journal, noté « sans date », avec sept poèmes en prose ; les six premiers sont numérotés, un "etc" termine les quatrième et cinquième, ouvre et clôt les suivants, titrant le dernier. Le passage du paysage maritime — paysage récurrent d’un bout à l’autre de Limite — à l’écriture est assuré ici par le glissement de « plage » à « page ». Cette entrée répète d’un bout à l’autre le recommencement, celui de la mer, mais elle met aussi en évidence le changement qu’elle provoque, analogue à ce que modifie l’écrivain aux prises avec la langue. On peut y lire la figure de ce qui, d’un poème à l’autre, est repris, l’image de la mer sans limite, du ressassement, tout comme le texte, obstinément, conserve des « stèles bornes balises ». L’érosion provoquée par la mer a lieu avec le temps et ce temps vécu dans la maladie, « même s’il n’y a pas de sens au bout », temps de l’attente, laisse des « traces graphes de vie ». Le dernier poème du livre est également titré « sans date » ; si la guérison n’est pas acquise, ce n’est plus le temps de la répétition mais celui de « l’air le temps ouverts », celui du temps comme « une vaste nappe d’eau calme ».
Maladie, guérison : le livre est en effet, sous une forme privilégiée par Antoine Emaz, celle de poèmes en vers libres datés, le récit d’une vie « en attente », d’une lutte contre une fin possible avec, toujours, la volonté chaque jour de « ne pas être / momie » comme on le lit dans Plaie (2010). Il est daté du 10.08.2013 au 13.07.2015, avec un nombre élevé de textes l’année 2013 (35 pour 39 au total), les moments d’écriture en continu du 20 au 29 octobre et les premiers jours de novembre, sans rien de restitué entre le 23 février et le 6 décembre 2014, sans que l’on sache si des pages ont été écrites pendant ces jours dominés par la répétition. Cependant le récit évite les redites et quand il y a retour sur le même, c’est pour creuser, comprendre ce que le temps de la maladie modifie.
Dès les premiers moments, le corps n’a plus sa place dans l’espace et dans le temps social ; du quotidien demeurent des bruits, des odeurs, la forme et la couleur d’une fleur, des « bouts de réel », mais tout se passe comme si le corps s’était retiré. Ce qui est éprouvé, c’est la limite du corps, fragile, et viennent pour le dire des images liées à la mer. Le corps ressemble à un « canot vide après naufrage », défait et qui s’éloigne du vivant avec le temps qui passe : « la barque est déjà partie / sa voile est noire ou blanche », comme celle du navire qu’attend Yseut sur la rive. Plus loin, le corps est « moitié radeau / demi épave » et, la maladie vaincue, n’est plus que « vieille barque ». Ce qui s’impose dans ce repli non choisi, c’est une autre limite, l’ « arrêt / du désir / de l’élan du désir ». Que reste-t-il dans ce qui apparaît comme un « temps de fin », une "fin de partie", comme écrit Beckett ?
« reste du présent malingre », « des bribes de rien »…, et tout ce à quoi on tenait s’effiloche, perd de sa réalité puisqu’ « on va vers ce qui s’en va ». La pensée vive de la disparition entraîne la conscience que toute relation sera, bientôt, perdue ; aussi, rien de ce qu’a été le passé ne peut prendre sens : quoi faire venir des jours anciens ? Antoine Emaz écrit justement, « de l’eau du sable ». Reviennent des fragments d’une lettre d’Emily Dickinson, autumn leaves interprété par Miles Davis, et souvent les verbes ne sont plus conjugués comme s’il était impossible, ou inutile, de se situer dans le temps ; ainsi : « tout évacuer laisser filer dans l’illisible de nuit magma même plus ciel sol dissoudre le tout […] ». Quel sens alors peut avoir l’écriture dans un tel contexte ?
Pour Antoine Emaz, il ne s’agit pas de laisser du sens mais, le mot est repris, des traces, comme ces « empreintes de mains » que laissèrent dans quelques grottes des préhistoriques. Ou encore « un petit feu de langue », parce que malgré la fin annoncée, les changements du corps, « reste une peau de mots qui bat / comme du linge sur la corde ». Peu de textes disent aussi fortement l’importance que peuvent avoir les mots pour « tenir », « durer », quand la vie s’échappe, contre l’approche de la « dame de pique ». C’est un leitmotiv qui charpente le livre. Dès le début est exprimée la crainte qu’à un moment donné les mots manquent ; ce que l’on a connu, aimé n’est plus, d’une certaine manière, que « débris déchets poussière » sans les mots qui font, malgré tout, reparaître ce qui fut. Un jour, proche ou non, le corps ne sera plus mais, en cet instant, il y a « toujours des mots sous la main », des mots parce que, comme dans Jours (2009) le « vide est à dire ».
Limite poursuit — « creuse », comme la mer — ce qui est dit dans tous les livres d’Antoine Emaz. Il y a toujours quelque chose à vivre, avec autrui, le nouveau matin, le « bruit du frigo », les fleurs : le dernier poème s’ouvre ainsi : « sur la table un bouquet d’anémones […] ». C’est cette vie, dans ce qu’elle a de plus "évident", le réel, qui est à dire, et quand la maladie s’éloigne, « ce n’est pas la vraie vie qui commence il n’y a pas d’ailleurs ».
Antoine Emas, Limite, Tarabuste, 2016, p.,, 15 €. Cette note a été publiée dans Sitaudis le 5 janvier 2017.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, limite | ![]() Facebook |
Facebook |





