08/10/2013
Edoardo Sanguineti, Corollaire : recension

Corollaire réunit la traduction de 53 poèmes, suivie du texte original, dans un format carré (20x20) qui permet de publier les vers d'un seul tenant. Spécialiste de Dante, lié au compositeur Luciano Berio, au peintre Enrico Baj, fondateur du "gruppo 63" avec Nanni Balestrini, Giorgio Manganelli, Umberto Eco, etc., Sanguineti est encore peu connu en France(1). On lira avant d'entrer dans le livre la courte préface de Jacques Roubaud situant précisément l'activité d'écriture du poète et Corollaire dans un ensemble dont on espère maintenant la traduction.
Stendhal écrivait dans son Journal qu'il faut « tirer les corollaires [d'un] fait », et c'est bien un des aspects du livre. Chaque poème rapporte un souvenir de voyage, relate une soirée ou part d'une anecdote, toujours introduits avec précisons sur le moment (« le dimanche 28 au soir ») et le lieu (« dans une salle du Café Diglas »)[à Vienne] ; un récit est construit, qui se déroule grâce à une succession de détails et de commentaires entre parenthèses. Cette succession est articulée par une ponctuation particulière, deux points, pour introduire une explication, presque toujours une relation de conséquence (un corollaire) entre deux énoncés. On remarque que ces deux points terminent chaque poème qui, donc, pourrait être continué ou est lié au suivant, d'autant plus aisément qu'aucune majuscule n'est présente. On s'attardera sur deux exceptions. La première concerne un poème écrit à la suite d'un voyage à Jérusalem ; après avoir constaté le « puzzle si fou » de la ville et les oppositions religieuses, Sanguineti conclut « je peux comprendre même Moïse et Mahomet : (je peux même leur pardonner, tu vois) : mais de là à nous dire chrétiens, quelle honte ! » — impossible de poursuivre ensuite, pas de corollaire possible...
On repère la seconde exception dans un court récit où le narrateur descend une rue comme « un revenant vivant », ce qui conduit à la conclusion « quelle étrange extravagance, une survivance ! » Le fait lui-même ne peut susciter de suite, le temps vécu pleinement occupant la plus grande place dans la poésie de Sanguineti. Une partie des poèmes se termine par un vers détaché, corollaire à propos de la vie ; ainsi, ce qui peut rester, puisque tout est infiniment petit et sans mystère vis-à-vis du néant, c'est une leçon épicurienne : « c'est vraiment vrai, que j'ai aimé ma vie : (la vie) », « j'en ai joui, moi, de ma vie ». Et il s'agit de la jouissance amoureuse. Le poème d'ouverture part d'une définition de l'acrobate, développée pour explorer toutes ses manières de faire, plus ou moins périlleuses, et se conclut par l'analogie entre l'artiste du cirque et le poète : « (ainsi je me tourne et saute, moi, dans ton cœur) » ; on peut bien lire dans ce vers un art poétique — la phrase de Sanguineti sans cesse bifurque, se reprend, se repent — mais autant un hommage à l'aimée.
Il y a, jusqu'au poème final, un défilé vertigineux de femmes à séduire, et ce qui semble faire vivre le narrateur tient en quelques mots, notés par son père sur un petit morceau de papier conservé précieusement, « copulo ergo sum », formule reprise dans un autre poème. Mais à côté d'anecdotes de drague, l'aimée — « toi », sans nécessité du prénom tant elle est présence — est celle à qui le narrateur écrit, l'unique dont l'absence est inimaginable, celle avec qui on rêve de fusionner : « m'engloutir tout entier, dans ton doux enfer vaginal ». Le thème de l'amante élue opposé aux amours non accomplies, de passage, pour être un lieu commun permet néanmoins à Sanguineti de s'en prendre à une morale hypocrite, en multipliant les esquisses de séduction de toutes les jolies femmes qu'il rencontre et, à l'opposé, en écrivant ce qui est réputé intime, ainsi : « que tu as de longs doigts, chérie, toi, housse poilue de ma pine, si ferme, [...] », puis « nous sommes sur le point de nous accoupler (de nous assassiner, peut-on même / soupçonner), [...]».
Refuser un lyrisme éculé et fonder un tout autre lien amoureux est un parti-pris politique, autant que la critique du commerce capitaliste qui annule, par exemple, ce que pourrait être la découverte de l'autre par le voyage : le narrateur croise à Paris « une armée de japonaises saoules, répugnantes indécentes ». Quant à ceux qui gouvernent l'Italie, Sanguineti appelle à se protéger « contre les noirs recours des seconds barbares de retour, de salon et de Salò », rageant contre « notre pays bordelisé berlusconisé, cette serve Italie forzitaliénée »(2). Il constate aussi la perte de la conscience de classe des prolétaires et ne désespère pas de relever « les vieux drapeaux ».
Dans Corollaire, Sanguineti mêle d'autres langues à l'italien, mais cette introduction n'est pas faite au hasard. Si les mots anglais appartiennent le plus souvent au globish, le latin est présent souvent pour évoquer la tradition classique (y compris dans son usage pour masquer le vocabulaire considéré socialement interdit), le français dans un contexte parisien et les formes colombiennes et mexicaines de l'espagnol lors de voyages en Amérique. Comme le jeu complexe des allitérations, l'emploi de mots valises et de rébus(3), d'allusions à déchiffrerou d'une ponctuation inhabituelle, cette jubilatoire exhibition de la mosaïque des langues, freine la lecture : il s'agit bien de tenir éveillé le « cher lecteur coélecteur », manière de poser aussi, dans notre société, la question de la lecture. Un autre motif parfois s'ajoute : ainsi, l'emploi de l'espagnol permet de mettre en retrait (ou en évidence ?) la question du temps qui passe : après avoir évoqué l'enfance (« muchacho, no partas ahora »), le narrateur ajoute : « entonces [cependant] c'est vrai que je ne peux pas le rêver, vieillard, el regreso [le retour] ». C'est revenir au problème du temps et à la manière dont le "je" se situe dans le livre : un composé incernable, sans cesse occupé par l'odor di femina et se définissant à la fois comme « œnomane érotomane » et « vieux sot et fatigué ». Sanguineti, encore une fois, propose une poésie qui défait l'ordre du vers pour donner aussi à voir le désordre du monde, ce qui se dit : « tout avan[ce] dans le sens dont tourn[e] mon discours, au hasard, en boucle, au point mort, à vide ».
Edoardo Sanguineti, Corollaire, traduit de l'italien par Patrizia Atzei et Benoît Casas, préface de Jacques Roubaud, éditions NOUS, 2013.
1 Ont été traduits pour les romans : Capriccio italiano (collection "Tel Quel", Seuil,1964 ; Le noble jeu de l'oye (id., 1969) ; et pour la poésie : Renga, avec Octavio Paz, Jacques Roubaud et Charles Tomlison (Gallimard, 1971), Postkarten (L'Âge d'Homme, 1985), dont on peut écouter un extrait lu par Sanguineti sur le site Centre international de poésie / Marseille : (http://www.cipmarseille.com/auteur_fiche.php?id=337).
Sur le gruppo 63, voir Nanni Balestrini : www.nannibalestrini.it/gruppo63/prefazione.htm
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : edoardo sanguineti, corollaire, patrizia atzei, benoît casas, jacques roubaud | ![]() Facebook |
Facebook |
19/07/2013
Ghérasim Luca, L'extrême occidentale, sept rituels

Édité en petit nombre d'exemplaires en 1961, à Lausanne, L'extrême occidentale, écrit en 1954 par le poète, peu après sa venue en France, était inconnu des lecteurs d'aujourd'hui On peut écouter Ghérasim Luca lire ses textes (Ghérasim Luca par Ghérasim Luca, CD, Corti) avec son « prodigieux bégaiement » (Deleuze), mais ces proses sont d'écriture différente, sans que le projet change : s'il est un art poétique de Ghérasim Luca, il se résume ainsi : « Luxe âcre que de crier ou de taire l'indicible ! ». Le livre est composé de sept "rituels" en prose : Avant-Propos, L'échelle, Les statues, Le rideau, le sang, La forêt, Le catalyseur, chacun illustré par un peintre — les reproductions rassemblées au centre du livre sont magnifiques.
Ce qui toujours est à la racine de l'écriture de Ghérasim Luca, c'est le rejet de la "communication" aliénante, de la signification toute faite des mots, de l'utilisation non réfléchie de la langue. Ce refus conduit à se défaire des contraintes d'une pseudo logique dans le discours, par exemple grâce à l'accumulation de noms, d'adjectifs ou de schémas syntaxiques : dans "Les statues", une longue phrase reprend vingt fois la forme "tout ce qui" suivie d'un ou de plusieurs verbes. Le procédé, différent de la répétition d'une syllabe, comme dans Passionnément (poème à écouter et voir sur Youtube), est tout aussi efficace : ce n'est qu'après plusieurs lectures que le lecteur construit un sens et peut (croire) maîtriser l'ensemble de la phrase. La construction du sens devrait procurer une certaine « joie de l'égarement », analogue à ce que serait pour Ghérasim Luca le transmission de la beauté : elle doit « percer littéralement les ténèbres » et être vécue comme « un poison ressuscitant ».
Une autre manière d'empêcher le ronronnement du discours consiste à employer des oxymores. Il suffit d'entendre ou de lire les commentaires scolaires, qui s'efforcent de traduire ce qu'est l'obscure clarté ou le soleil noir, pour comprendre la nécessité sociale d'araser cet usage de la langue. Ghérasim Luca introduit ces confrontations de mots toujours inattendues, par exemple avec la « vertigineuse immobilité » de la flèche de Zénon d'Élée ; en même temps, il prend au mot une image pour commencer « une cérémonie irrationnelle » et ouvrir à l'égarement. Ainsi le fleuve d'Héraclite devient un vrai cours d'eau qui entre dans la chambre amoureuse et l'emplit, tout en demeurant image... C'est le même objectif qui est visé avec la mise en œuvre de la polysémie des mots : rapprocher les emploie égare le lecteur et chaque fois l'invite à réfléchir sur la (sa) pratique de la langue ; ainsi du lit du vent, du lit de la chambre et du lit de la rivière « où hommes et femmes nagent, entre deux étreintes, vers les sources mêmes de leur amour ». Et ces corps qui nagent, s'éprouvant « comme agent soluble dans un milieu exemplaire [...] brouillent les cartes du moi et abolissent d'un seul coup territoires et frontières.»
Toujours il s'agit d'entrer dans les ténèbres (notamment par le rêve) — c'est de là que l'on comprend ce qu'est la lumière — de savoir que derrière le rideau est un autre rideau, qu'il y a « deux côtés du miroir », qu'il ne faut pas craindre le « dialogue d'hiéroglyphes » et « d'écouter les visions ». Les rituels de "voyance" de Ghérasim Luca nous y invitent et aident à « rendre sinon déchiffrable du moins couramment lisible la terrifiante écriture de notre passage sur la terre. »
Ghérasim Luca, L'extrême occidentale, sept rituels illustrés par Jean Arp, Victor Brauner, Max Ernst, Jacques Herold, Wilfredo Lam, Matta, Dorothea Tanning, éditions Corti, 2013, 64p.
Cette recension a d'abord paru dans Sitaudis.fr
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, l'extrême occidentale, sept rituels, rituel, voyance, oxymore | ![]() Facebook |
Facebook |
03/07/2013
Benoît Casas, L'ordre du jour (recension)

En 2012, Benoît Casas et Luc Bénazet avaient réuni dans Envoi des poèmes échangés par courriel, l'un répondant à l'autre1 ; L'ordre du jour est un livre aussi singulier. Il s'agit d'un journal, tenu scrupuleusement du 1er janvier au 31 décembre, ce qui laisserait le lecteur perplexe (qui a tenu un journal avec cette régularité ?) s'il ne lisait pas la quatrième de couverture : Casas y donne le mode d'emploi : ce journal « imaginaire et synthétique » est construit à partir de fragments tirés de lectures. Recopier une remarque du Journal de Jules Renard du 9 octobre 1893 permet de la réutiliser (en la modifiant un peu) pour la journée du 9 octobre ; la construction littéraire se nourrit également de correspondances variées — les familiers de celle de Flaubert, par exemple, reconnaîtront des passages devenus célèbres (« je dors comme / un caillou / je mange comme / un ogre / et je bois comme / une éponge. ») — de recueils de poèmes ou de réflexions philosophiques, de Michaux ou d'Adorno.
C'est bien toute une bibliothèque qui est traversée dans ce journal écrit en vers libres ; Casas, comme beaucoup de lecteurs, relève ce qui peut susciter sa réflexion, l'inciter à écrire (« lire un paragraphe / de Wittgenstein par jour / pour y méditer et écrire / ou un passage de Benjamin », 241) et ce qui s'accorde avec ses choix. On pourrait, ici et là, repérer une source, parce qu'une formulation éveille un souvenir (Flaubert, ci-dessus), qu'une œuvre citée est un livre de chevet (le Journal de Jules Renard) ou qu'une phrase, par hasard, a été relue récemment (« la poubelle de Babel », dans Rangements de Daniel Oster). Mais c'est là un jeu qui, outre qu'il serait vite décevant, ne conduirait qu'à rassembler une liste de noms, à ajouter à ceux que donne Casas, trace de ses lectures (Marx, Perec, Lorca, Zorn, Proust, Mathiez, Spinoza) et de projets (« démolir / Heidegger »), de ses choix en peinture (Picasso, Fragonard, Goya, Giotto, Rembrandt, Caravage, Bosch) et en musique (Bach, Bartok, Monteverdi, Schumann).
L'essentiel n'est pas dans la reconstruction de listes, ce qui importe est la réflexion que l'on peut engager à propos de ce type de journal, et les notes de Casas à ce sujet sont nombreuses. Il indique la manière dont il a construit le livre : « ce qui me surprend : /que ce que j'ai écrit / soit fait presque entièrement / de citations. de syncopes. / la plus folle mosaïque / qui se puisse imaginer. (p. 248) ». Cette mosaïque met à la fois en évidence la dispersion dans les notations et l'unité d'une vie. Si un ordre du jour est une liste de sujets qui sont classés dans un certain ordre, il est certain que le livre ne remplit pas le programme, sauf si l'on considère que les notations parfois se suivent avec une absence de continuité reflétant ce qui se passe dans la vie ; ainsi : « beau soleil après pluie. / j'aime la blancheur de la lotte. (p. 164) ». On multiplierait les exemples de ces rencontres, mais elles répondent à un souhait de Casas : « cette juxtaposition se voudrait / cubiste mise en forme. (p. 151) » Et il faut alors entendre "ordre du jour" autrement : « passons à l'ordre du jour. / programme d'une vie libre. (p. 12) »
L'unité se construit par la reprise régulière de quelques motifs. Deux sont dominants dans le Journal, bien délimités, « travailler et aimer. (p. 41) ». De là découle toute une série de thèmes qui charpentent L'ordre du jour, accroissant le plaisir à se repérer dans cet « emmêlement [...] de petits riens tressés. (p. 207) ». "Travail" et "travailler" sont deux mots clés ; de quoi s'agit-il ? lire, sans cesse, pour apprendre et se transformer, et de là rejeter tout ce qui néglige la formation de l'esprit ou s'y oppose — on ne s'étonnera pas que soient soulignées « la bêtise la crasse ignorance / des bourgeois. (p. 227) » Écrire aussi, activité qui n'est pas séparée de la lecture, et peut-être L'ordre du jour est-il le livre qui se construit dans la « petite usine d'écriture. (p. 87) », comme certains passages le laissent imaginer : « j'ai l'impression de ne faire qu'accumuler / des notes pour un livre sans savoir /si je trouverai jamais / le courage de l'écrire. (p. 232) » À ce travail sont liées de nombreuses questions relatives à la langue et à la poésie, dont beaucoup sont d'ailleurs au cœur des textes de Casas.
La relation à l'autre dans l'amour est complexe, on s'en doute. Elle apparaît, souvent, seulement sexuelle — « seule compte l'étreinte des corps (p. 40) » — et Casas emprunte à Flaubert l'expression sans détour de la sexualité : « fouteur sentant / le sperme qui monte / et la décharge qui s'apprête. (p. 40) ». Il y a des histoires de séduction, de désir violent et, parallèlement, les bribes d'un récit plutôt romantique où la femme aimée est d'ailleurs liée à ce qui absorbe en partie la vie de l'auteur : « il n'y a que l'amour réciproque. / elle assise sur le lit / lisant un livre.(p. 164) ».
Ni le monde extérieur, le politique mais aussi fleurs et couleurs du ciel, ni les rêves, ni les notations sur l'Italie, de Turin à la Sicile, ne sont absents de ce journal partiellement inventé — mais, note Casas, « quoi que j'écrive / cela raconte mon histoire / sans que je le sache. (p. 229) ».
Benoît Casas, L'ordre du jour, Seuil, 2013.
Cette recension a été publiée en juin sur Sitaudis
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benoît casas, l'ordre du jour, journal, bibliothèque, citations, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2013
Cole Swensen, Le nôtre, traduction Maïtryi et Nicolas Pesquès : recension

Après L'Âge de verre en 2010 et Si riche heure en 2007, Maïtryi et Nicolas Pesquès proposent la traduction d'un troisième ensemble de Cole Swensen sur la "matière" française. Le plus ancien prenait pour prétexte Les très riches heures du duc de Berry, livre d'heures achevé à la fin du XIVe siècle, et le second livre s'attachait aux tableaux de Pierre Bonnard ; Le nôtre — jeu sur le nom pour le titre en anglais Ours — est construit à partir de la création par André Le Nôtre de nombreux jardins au XVIIe siècle. Le livre s'apparente à un livre d'histoire, avec ses divisions ("Histoire", "Principes", "Vaux-le-Vicomte", etc.) ; on suivrait donc l'invention du jardin à la française avec d'abord la création de Vaux-le-Vicomte en 1666 — « les femmes jaillissaient des carrosses, en plumes d'autruche et en rivalités / chatoiements / inclinaisons » — qui entraîna la disgrâce du surintendant Fouquet. Il y aurait ensuite Versailles, sommet de l'art de Le Nôtre, mais aussi Saint-Cloud, Chantilly, Les Tuileries, Saint-Germain-en-Laye, d'autres encore. À côté de la figure de Louis XIV, d'autres personnages apparaissent, comme Charles Le Brun, et, en remontant le temps, Marie de Médicis, Colbert. Ajoutons, quand sont évoquées les orangeries construites au XVIIe siècle, des réflexions sur l'évolution générale des sociétés (« L'histoire des fruits exotiques est parallèle à celle de l'ascension des classes moyennes »).
Cependant, même si les faits rapportés sont exacts, ils ne constituent qu'un matériau et, très rapidement, ce n'est pas la partie historique, volontairement lacunaire, qui retient le lecteur : il s'aperçoit que dans Le nôtre le temps est comme déréglé, qu'il y a glissement dans une phrase d'une époque à une autre. Tout se passe comme si, ouvrant une porte, un personnage traversait les siècles ; ainsi pour Marie de Médicis au Palais du Luxembourg :
Sortant au premier jour de l'été 2007, Marie
voit des centaines de gens jouer sur les pelouses et dans les allées
qui ont été entièrement redessinées, et les chaises métalliques vertes,
leur bruit particulier quand on les traîne sur le gravier [...]
Marie hurle, sans que les gens se soucient d'elle — mais s'agit-il bien de Marie de Médicis, puisque « [c]hacun a un geste ou une expression qui le montre hors du temps » ? Et pourquoi ne pas croire ces deux anglaises qui, au début du XXe siècle, s'égarant dans les allées des jardins de Versailles, se retrouvèrent vivre pendant quelques moments au lendemain de la Révolution de 1789 ?
L'art du jardin consisterait à reconstruire le monde, ou peut-être même à le contenir : le jardinier doit parvenir à « ouvrir l'espace » pour que le jardin n'ait plus de limite et procure une « illusion d'infini ». L'espace est totalement transformé, de manière bien plus vive que « peint sur une tasse de porcelaine » : on reconnaîtra toujours la tasse pour ce qu'elle est, alors que le jardin de Le Nôtre avec ses multiples allées, pièces d'eau, bosquets, plans lointains, est un monde en lui-même ; les sous-titres le suggèrent, "Un jardin est un visage", "une marée", "une approche infinie", etc, c'est-à-dire « tout un jeu / dans lequel les pièces s'ajustent ».
Les temps et les espaces se mêlent, et s'engouffrent dans la fiction d'autres jardins éloignés du jardin à la française, ceux vus par Montaigne en Italie et celui lié, après la Passion, à la mort et à la renaissance — qui pourraient définir le jardin —, quand une autre Marie s'approche du jardinier :
On nous avait promis
et Marie tend les bras au jardinier
que par l'humilité du toucher
qui recule d'un pas
Cole Swensen parle d'anamorphose, et le mot rend compte des jeux d'illusion qu'elle propose, y compris dans le poème titré "Paradis" : l'homme et le jardin n'existeraient pas l'un sans l'autre et ils disparaîtraient sitôt séparés, mais leur liaison ne serait-elle pas aussi une perte de soi, ce que suggère les derniers vers : « On appelait oubliettes les premiers jardins publics de l'histoire. Sitôt entré, on ne vous distinguait plus des animaux ».
Ce ne sont pas seulement les repères spatio-temporels qui, ici et là, sont atteints et mis à mal. Le dessin que forme souvent le poème sur la page s'éloigne de l'image toute faite du jardin à la française transparent, sans mystère : les vers peuvent être alignés en milieu de page, les blancs tronçonnent la syntaxe, les enjambements désarticulent le vers, la phrase qui s'est développée, reste inachevée, seul le début d'un nom est écrit, des phrases s'interpénètrent, "nous" renvoie aussi bien à des contemporains de Le Nôtre qu'à des personnages du XXIe siècle, etc. On suit dans le livre la confusion des temps et des espaces, le passage parfois inattendu d'une réalité reconstruite à un monde imaginé, le jeu du continu et du discontinu, on reconnaît le passé comme énigme autant que le présent... Le dernier poème a pour titre "Garder la trace de la distance" : si le lecteur y consent, il prendra au mot ce que proposent les deux derniers vers : « Tu pourrais revenir / le long d'une voie inconnue. »
Il faudrait s'attarder sur les réflexions croisées de Nicolas Pesquès et de Cole Swensen à propos de ce qu'est traduire, ce serait un autre article — je retiens de l'auteur : « Si écrire, c'est présager sa propre mort, et dépasser l'horizon de cette limite, alors traduire c'est entrer dans la mort d'un autre, et devenir deux fois étranger. »
Cole Swensen, Le nôtre, traduit de l'américain par Maïtryi et Nicolas Pesquès, éditions Corti, 2013, 120 p., 17 €.
Cette recension a été publiée en ligne dans Les carnets d'eucharis de Nathalie Riéra au mois de mai.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
05/04/2013
Luc Benazet, La Vie des noms
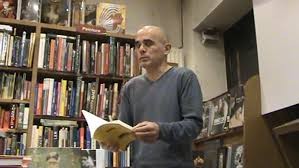
Le titre La vie des noms s'inscrit dans une tradition ancienne, puisque La vie des mots étudiée dans leur signification d'Arsène Darmesteter a été publié en 1877, et La vie du langage d'Albert Dauzat en 1911. Mais si le livre de Benazet traite bien du statut des noms, de leur relation aux objets qu'ils désignent, il n'est pas pour autant un ouvrage de linguistique. Des propositions sont avancées sous la forme d'assertions, type "les noms sont...", qu'il serait malaisé — ou, en apparence, trop aisé — à réfuter quand elles jouent avec les catégories grammaticales classiques, comme dans « attenter est un nom d'action ». C'est bien que le livre déborde les réflexions sur la langue : il mêle des références diverses, souvent fort éloignées de l'étude des noms et pas toujours repérables : c'est un poème de prose dans son écriture comme dans son organisation.
Après un liminaire qui pose la nécessité du lecteur (« une phrase ne serait pas sans adresse, quand même le langage ne serait pas un ») et le refus de la propriété (dont celle des noms), trois parties titrées. La première, "La respiration véritable", — « la respiration qui entre et sort par les noms et par la phrase n'est pas la respiration véritable, mais le rythme véritable du souffle est en relation avec elle » —, peut être entendue comme approche de ce qu'est la lecture à voix haute. Par la mention d'une « ancestrale force » s'opère le passage à "Piété filiale", piété analogue au son d'une cloche parce qu'elle est fabrique d'échos. S'engagent dans ce second ensemble des développements sur la filiation ("On a / son père comme il a lui- / même son père, lequel etc., aussi / s'épuise le savoir qu'on a / des pères") et sur le nom de personne, et d'abord sur celui de "Benazet" : il est écrit verticalement sans ses voyelles ("b n z t"), « les fentes du monde » étant formées par l'espace entre les consonnes — nom image comme en hébreu, et ce n'est pas hasard si le nom "Hamor", qui renvoie à un épisode tragique de la Genèse, se trouve dans la première partie. Le troisième sous-titre, "Une marche de la réalité", apparaît dans un poème de cette seconde partie.
L'écriture mime ici et là celle du discours philosophique — distante, "objective", avec une dominante des assertions —, mais elle est sans cesse rompue par la reprise de propositions, la présence d'anaphores, et les séquences s'achèvent parfois par : [...], comme si le texte était inachevable, à poursuivre ailleurs de même qu'il avait été commencé dans un autre livre : des esquisses sur les noms sont dans Envoi, échanges de courriels datés de 2010 avec Benoît Casas(1). En outre, la mention des références indique au lecteur à la fois qu'il n'a pas affaire à un traité et que la question des noms ne s'arrête pas aux noms "communs". Si l'on reconnaît Rousseau dans "Jean-Jacques R." (avant un extrait de son "Essai sur l'origines des langues") ou l'allusion à Rimbaud avec « l'horrible travail », il est moins aisé de savoir qui est Lucie B. dont est cité le syntagme « voix de l'estomac » ou situer l'auteur du « Requiem for what's name (guitare, M. R.) », titre d'un disque de Marc Ribot, dans lequel un des morceaux s'intitule "Motherless Child" — mais ce sont les pères qui sont le motif du poème de Luc Benazet. Plus transparent est le renvoi au traité de sexualité taoïste, en rapport avec l'association de la Lune et du Soleil (avec majuscule) qui « suivent le souffle originel » — présence de l'Orient (déjà dans Nécrit, 2011), comme de la psychanalyse et de l'opposition dedans/dehors.
Le nom n'existe que prononcé, ce qui lui donne vie, force, sinon il n'est que « pensée de corde éteinte ». Dans les poèmes où les lettres ne sont pas à leur place dans les mots, ou viennent les parasiter, les mots prennent un aspect inhabituel, même s'ils sont toujours reconnaissables (comme le nom de "Benazet" sans consonne) : « Mobn fildrougr et bleu / Pas mamobn on zurz cimporis / Ni ma moto nonplusd / De rien / De rrien ». Il est remarquable que cette transformation soit aussi dans un poème titré "LET-RRES DE / L'AMOUR " où est inscrite l'impossibilité d'une rencontre : « nous ne nous rencontrerons jamais, ni dand la vie, ni dans la mort », et où "dand", "dans" deviennent "dent", puis « Dla, galand / Gland, dans ».
On comprend que ce livre complexe, qui roule des matériaux variés, exige un engagement dans la lecture ; il éloigne le lecteur du lyrisme à fleur de peau qui sévit toujours, et ce n'est pas la moindre de ses qualités ; avec lui, « On ne voudrait pas ne pas être en dehors des choses ».
Luc Benazet, La vie des noms, "collection Antiphilosophique", éditions NOUS, 2013, 88 p., 14 €.
Cette note de lecture a d'abord été publiée sur le site Sitaudis.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc benazet, la vie des noms, nom du père, philosophie, lecteur, langue, souffle | ![]() Facebook |
Facebook |
20/03/2013
Lorine Niedecker, Louange du lieu et autres poèmes (1949-1970)

Après Poésie complète de George Oppen et en même temps que L'Ouverture du champ de Robert Duncan, les éditions Corti publient dans leur "Série américaine" une partie importante de l'œuvre poétique de Lorine Niedecker (1903-1970) — les poèmes de sa dernière période (1957-1970) et une sélection d'un recueil précédent. Elle était jusqu'à aujourd'hui quasiment inconnue en France (comme l'ont été longtemps beaucoup de poètes américains), présente seulement par quelques traductions en revues, par Abigail Lang, notamment dans Vacarme en 2006 et 2008, et Sarah Kéryna dans Action poétique en 2001. Les traductions d'Abigail Lang, Maïtreyi et Nicolas Pesquès, qui donnent une idée très juste de la poésie de Lorine Niedecker, sont précédées d'une préface mêlant biographie et étude précise de l'œuvre.
Découvrant en 1931 dans la revu "Poetry" Louis Zukofsky, Lorine Niedecker a adopté ensuite dans son écriture quelques principes de ceux qui furent réunis sous le nom de poètes objectivistes : le refus de la métaphore, l'attention aux choses quotidiennes de la vie, le choix de l'ellipse (jusqu'à aboutir parfois à des poèmes difficiles à déchiffrer). Elle a rencontré les poètes (George Oppen, Charles Reznikoff, Carl Rakosi) qui se réclamaient peu ou prou de l'objectivisme théorisé par Zukofsky, mais c'est avec ce dernier qu'elle s'est surtout liée et qui sera jusqu'au bout un interlocuteur privilégié.
Le titre Louange du lieu a été retenu pour l'ensemble traduit parce que ce recueil, « synthèse de précision et de fluidité », « hymne et flux et autobiographie poétique », est bien, soulignent les traducteurs, la « somme de son œuvre ». La louange, c'est celle de la région natale, le Wisconsin, où Lorine Nediecker est restée l'essentiel de sa vie, sans pour autant vivre en recluse. Elle présente ainsi son environnement : « Poisson / plume / palus / Vase de nénuphar / Ma vie » et, dans un autre poème, elle évoque de manière un peu moins lapidaire sa vie dans ce pays de marécages et d'eau : « Je suis sortie de la vase des marais / algues, prêles, saules, /vert chéri, grenouilles / et oiseaux criards ». L'émotion est toujours retenue, mais présente cependant dans de nombreux poèmes à propos des saisons, notamment de l'automne (« Brisures et membranes d'herbes / sèches cliquetis aux petits / rubans du vent »), de l'hiver avec ses crues (« Assise chez moi / à l'abri / j'observe la débâcle de l'hiver / à travers la vitre ».
Les poèmes à propos de son environnement laissent percevoir une tendresse pour ces terres souvent couvertes d'eau, et l'on relève de multiples noms de plantes et de fleurs, une attention vraie aux mouvements et aux bruits de la nature :
Écoute donc
en avril
le fabuleux
fracas des grenouilles
(Get a load / of April's / fabulous // frog rattle)
Ce sont aussi des moments plus intimes qui sont donnés, sans pathos, dans des poèmes à propos de ses parents ou de son propre mariage ; il y a alors en arrière-plan, sinon quelque chose de douloureux l'expression d'une mélancolie : « Je me suis mariée / dans la nuit noire du monde / pour la chaleur / sinon la paix ». Cette mélancolie, toujours dite mezzo voce, est bien présente quand Lorine Niedecker définit la vie comme un « couloir migratoire » ou quand, faisant de manière contrastée le bilan de ses jours, elle écrit : « J'ai passé ma vie à rien ».
Dans des poèmes "objectifs", elle note de ces événements de la vie quotidienne qui ne laissent pas de trace dans la mémoire : « Le garçon a lancé le journal / raté ! : / on l'a trouvé / sur le buisson ». Cependant, il n'est pas indifférent qu'elle soit attentive à de tels petits moments de la vie ; elle est, certes, proche de la nature, mais cela ne l'empêche pas d'être préoccupée par la vie de ses contemporains, par le monde du travail. À la mort de son père, dont elle hérite, elle constate : « les taxes payées / je possèderai un livre / de vieux poètes chinois // et des jumelles / pour scruter les arbres / de la rivière ». On lira dans ces vers quelque humour, il faut aussi y reconnaître son indifférence à l'égard des "biens" (« Ne me dis pas que la propriété est sacrée ! Ce qui bouge, oui »), qu'elle exprime à de nombreuses reprises sans ambiguïté : « Ô ma vie flottante / Ne garde pas d'amour pour les choses / Jette les choses / dans le flot ». Sans être formellement engagée dans la vie politique, elle écrit à propos de la guerre d'Espagne, du régime nazi, sur la suite de la crise économique de 1929 (« j'avais un emploi qualifié / de ratisseuse de feuilles ») ou sur Cap Canaveral et sur diverses personnalités (Churchill, Kennedy). Elle se sait aussi à l'écart de son milieu de vie, sans illusion sur la manière dont elle serait perçue si l'on connaissait l'activité poétique qu'elle a en marge de son travail salarié : « Que diraient-ils s'ils savaient / qu'il me faut deux mois pour six vers de poésie ?».
C'est justement une des qualités de la préface de reproduire des documents qui mettent en lumière la lente élaboration des poèmes, depuis la prise de notes jusqu'au poème achevé. Il s'agit toujours pour Lorine Niedecker de réduire, de condenser encore et encore : elle désignait par "condenserie" (condensery) son activité. Son souci de la « matérialité des mots » l'a conduite à privilégier des strophes brèves (de 3 ou 5 vers) qui ne sont pas sans rappeler les formes de la poésie japonaise — Lorine Niedecker rend d'ailleurs plusieurs fois hommage à Bashô. Il faut suivre le cheminement des premiers poèmes proposés dans ce recueil (le premier livre publié, New Goose, 1946, n'a pas été repris) aux derniers, à la forme maîtrisée : c'est une heureuse découverte.
Un poème :
Jeune en automne je disais : les oiseaux
sont dans l'imminente pensée
du départ
À mi-vie n'ai rien dit —
asservie
au gagne pain
Grand âge — grand baragouin
avant l'adieu
de tout ce que l'on sait
Lorine Niedecker, Louange du lieu et autres poèmes (1949-1970), traduit par Abigail Lang, Maïtreyi et Nicolas Pesquès, éditions Corti, 216 p., 21 €.
Cette recension a d'abord été publiée dans la revue numérique "Les carnets d'eucharis".
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lorine niedecker, louange du lieu et autres poèmes, abigail lang, maïtreyi et nicolas pesquès, nature | ![]() Facebook |
Facebook |
14/02/2013
Christian Prigent, La Vie moderne —recension
(à un poète)
C'est quoi mecton ton identité rock et tu
la construis comment ta postérité ? Vu
Vite fait dans les actus ou zig zag zap
Pé partout jusqu'à l'épileptique clap
De fin ? People sur(face)nooké, non ? Plu
Tôt le strip absent Maurice Blanchot du
Paf ? Désaffecté de la nébuleuse Hype ?
No picturale youtubiquité ? Aïe p
As facile assurer face ou pile une i
Mage au choix pur poète incrusté en marge
Ou survoltant overlooké star slam i
Cône à "roupies fan d'effet sexe au sens large.
Christian Prigent, La vie moderne, P. O. L, 2012, p. 137.
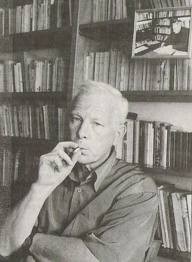
Une représentation de la société
La Vie moderne, ce sont dix séquences titrées — la société, la politique, la santé, l'amour, le sport, les sciences, la gastronomie, nature et climat, la mode, la culture —, chacune contenant des poèmes (5 pour la politique, 17 pour la culture) de trois quatrains de onze syllabes. Le livre s'ouvre sur un extrait de la quatrième satire de Juvénal (celle qui rapporte l'anecdote du turbot monstrueux offert à César), qui annonce fermement la véracité de ce qui suivra, annonce reprise dans le poème donné en avant dire : « Calliope, assis ! vazy ! hop ! pas de bel / Canto sur la lyre : ici c'est du réel ». Après la dernière séquence, un "Portrait de fin" est précédé d'une citation de Blaise Cendrars : « Et le soleil t'apporte le beau corps d'aujourd'hui / Dans les coupures de journaux / Ces langes », qui suggèrent ce qu'est le matériau de La Vie moderne, ce que confirme la quatrième de couverture : les thèmes retenus, et le vocabulaire pour une bonne partie, sont empruntés aux rubriques des journaux, « chacune recomposée en vers satiriques (..) pour dire, bouffonnement, une stupéfaction un peu effrayée. »
Comment utiliser ce matériau ? Christian Prigent s'est expliqué autrefois sur sa pratique du "cut up"1 et il y revient dans L'archive e(s)t l'œuvre e(s)t l'archive ; pour ne pas tout citer de cet essai2, je retiens la description des étapes de la construction d'un livre :
Je suis toujours parti de documents (écrits ou images). Ensuite : extraction des documents de leur contexte [ici, journaux] ; insertion dans un autre contexte (le texte en cours) ; articulation à une composition d'ensemble ; et, la plupart du temps, transformation par diverses manipulations rhétoriques, descriptions décalées, commentaires méta-techniques, déplacements homophoniques, etc.
C'est ce qui est mis en œuvre dans La Vie moderne, qui présente un tableau sombre de la société d'aujourd'hui, attachée à des riens, auto-destructrice, ouverte à la sottise, satisfaite d'elle-même ; entendons ce qui est écrit : la société n'est pas que cela, mais l'infantilisme s'étale et c'est ce que Prigent saisit : au lecteur de réfléchir sur des causes. Son propos n'est pas d'un sociologue et il utilise d'autres techniques, comme je l'ai rappelé en le citant. Ses matériaux, ce sont les articles de journaux dont il extrait en particulier le vocabulaire : il est impossible de lire la presse sans y trouver quantité de mots anglais ; rien de nouveau depuis le Parlez-vous franglais d'Étiemble paru en 1964, si ce n'est que tous les domaines sont touchés et, surtout, que la distinction exige l'emploi de l'anglais pour parler d'actes communs de la vie quotidienne et de ce qui concerne le corps et ses gestes. Il y a, souvent, drôlerie par l'accumulation — ainsi, titré (pour vos étrennes) : « For Booz : amazing increase in thickness / of his penis (pin) up to 30 with our / Miracle pills [etc] »—, mais en même temps mise en scène avec une portée politique de ce qu'est un mode de vie ; cet aspect est d'autant plus net que l'emprunt à l'anglais renvoie aussi à des pratiques qui se répandent depuis peu, par exemple celle qui fait l'objet d'un poème titré (bedazzle your vagina) — pratique décrite sur internet.
Les seuls relevés du vocabulaire (qu'il ne s'agit pas de multiplier, comme l'avait fait Étiemble pour "défendre" le français) ne suffiraient pas pour faire entendre la bouffonnerie des discours dominants dans la presse. L'essentiel est à mes yeux dans le travail du vers : on y reconnaît vite une « virtuosité pince-sans-rire »3, analogue à celle des Grands Rhétoriqueurs. Les vers sont des hendécasyllabes, mais cela n'empêche pas que deux, dans un poème, soient des décasyllabes et, clin d'œil, quand un vers d'un quatrain est un alexandrin, un autre, qui rime ou non avec lui, n'a que dix syllabes : le compte est bon. Relevons encore que les possibilités d'alternance de rimes dans les trois quatrains de chaque poème sont systématiquement explorées ; par exemple, aabb-abba-abab (p. 55), aabb-abab-aabb (p. 56), aaaa-abba-abba (p. 57), abab-abba-abab (p. 58), etc. À partir de ce cadre strict, appartenant à la poésie classique (que Prigent n'a jamais rejeté) — même les majuscules en début de vers, signe du poétique, sont respectées —, le vers est réinventé.
Compter les syllabes, pratique rigoureuse, n'exclut pas les jeux possibles (comme on parle du jeu de deux pièces) : "etc" vaut pour une syllabe, le signe "=" pour deux, "ADN" pour une, mais "Pvc" pour trois et "50%" pour cinq — et "Li/1" se lit bien "lien" et "Q" "cul". Si cela est nécessaire une diérèse, indiquée par un tiret au lecteur, est introduite dans un mot pour gagner une syllabe ("la pertubati—on") ou une des anciennes licences permet de ne pas dépasser le nombre de 11 ("Ô pro de l'excellence excite encor moi"), de même que l'élision ("en-dsous). Se lisent des rimes riches "vidéoscope a / télescopa"), d'autres cocasses ("aux zones / ozone"), des quatrains monorimes ("va / déplora / à pas sa / desiderata" ) et des rimes avec inversion phonétique ("or" rimant avec "pro"). Dans beaucoup de quatrains, le mot à la rime enjambe sur le vers suivant, ce qui ne nuit pas à l'autonomie du vers, même si certaines coupes rendent — ce qui est évidemment volontaire — la prononciation ardue :
ou / Trageusement épurée quasi même u
Niverselle. Et si mère allaiteuse ou né
E génétiquement [...]
Beaucoup ont une fonction critique ; un exemple : dans le premier poème "(on mange quoi demain ?)" de la séquence "la gastronomie", la rime "ca / ca" exprime nettement ce qu'il en est de la cuisine proposée — on en relèvera quantité d'analogues. Le mot coupé à la rime, en écho à un mot du vers, exprime un jugement sur ce qui vient d'être dit ; ainsi dans "(journée des femmes)" :
« Aux femmes faudrait leur lâcher la grappe » ou
« Lui couper les choses à ce con » c'est con
Tradictoire au plan physiologique non ?
L'action critique s'exerce par la néologie (cf l'ironique "hormon mâle"), par formation de mots valises comme "emberlifricotées", "gesticulaction", "youtubiquité", etc. ; elle passe aussi très souvent par le caractère jubilatoire des répétitions sonores ; parmi d'autres, ce vers avec une allusion à La Fontaine, "Dans ces moments maman heureux amants vous", ou cette première strophe de "(une fille pop)" dans la séquence "l'amour" :
Flic floc c'est tip top la fille pop en botte
Qui flippe hic & nunc en spot splash sous la flotte
Mais va surtout pas t'y flotcher les crocs ! stop !
C'est pas ton lopin ! Pas d'galop ! Gare au flop !
D'autres procédés sont mis en œuvre, les poèmes accueillant aussi bien le verlan ("à donf") et l'anglicisme familier ("dope") que le moyen français ("emmi", "ire"), des formes graphiques chères à Queneau ("xa", "steu") ou qui évoquent des prononciations dites "populaires" avec accentuation du e en fin de mot ("ça dou / Bleu"), des formules propres à la ballade ("Prince si...."), etc. Bref, c'est toute la langue qui est en émoi, et pour que les emprunts à l'anglais apparaissent dans leur pauvreté, Prigent introduit dans La Vie moderne des fragments de latin — souvent ; reprenant même pour titre du premier poème, dans la séquence "la santé", la formule de Descartes, "larvatus prodeo" —, d'allemand, d'italien, d'espagnol — citant alors Thérèse d'Avila.
Le discours critique se construit aussi à partir d'un prélèvement de matériaux qui, sortis de leur contexte (la petite annonce) et légèrement modifiés, deviennent une charge : comment entendre ce qu'est l'amour quand on lit ceci :
Moi debout costume anthracite vous as
Sise et féline oh ce sourire si as
Sassin sans retenue sur 3 w
Vudans le métro point com on se télé
Phone ?
Dans certains cas, la satire passe simplement par le descriptif de ce qu'annonce le titre du poème ; ainsi pour (Auschwitz Tour), dans la séquence consacrée à la culture, les quelques éléments retenus suffisent pour dire ce qu'est la marchandisation de l'horreur4. C'est encore « le monde vrai » que celui de « wiki cul / Ture » ou celui de la proposition d'élevage dans chaque foyer d'un porc — « et chacun son azote ». On lira dans la même séquence sur la gastronomie, sous le titre ironique (hippisme, histoire & gastronomie), un rappel de ce qu'est Poutine :
ça / Vous ravigote l'idéologie : mords
Poutine en treillis torse à poil sur roncin
Sibérien car c'est du steak de russe mort
Sous sa selle ou hachis tchétchène au cumin.
Ces quelques exemples pour montrer que Christian Prigent, comme dans ses précédents livres, appelle un chat un chat et poursuit le lent travail pour transformer les représentations qui nous sont proposées, ici dans la presse. On pourra trouver que ses vers se rapprochent souvent des vers de mirliton : on a reproché la même chose à Queneau... Ils sont d'une grande efficacité pour dire dans la parodie quelque chose des ruines d'une société dominée par "le marché".
Christian Prigent, La Vie moderne, P.O.L, 2012 ; L'archive e(s)t l'œuvre e(s)t l'archive, "Le lieu de l'archive", Supplément à la Lettre de l'IMEC, 2012.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Prigent Christian, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, la vie moderne, le vers, à un poète | ![]() Facebook |
Facebook |
30/01/2013
Caroline Sagot-Duvauroux, Le livre d'El, d'où

Caroline Sagot-Duvauroux, Le livre d'El, d'où, José Corti, 2012.
C'est perdu qu'on écrit, perdu pour l'enfance et la chérissant partout où l'insolence avant 20 ans délivre du sérieux du monde injuste.
(Le livre d'El, d'où, p. 144)
Le titre du livre de Caroline Sagot-Duvauroux est explicité dans un avant-dire, véritable prélude, isolé du reste par une page blanche et d'un seul tenant. Premier d'un ensemble à constituer — toujours « le livre est à venir » — Le livre d'El d'où1 se déploie autour de l'absence, celle de l'être aimé, est aussi un livre pour vaincre la douleur de la perte, en même temps qu'il se développe à propos de ce qu'est l'écriture.
El, devenu mot, est la fin du prénom de l'homme disparu, michel, et est présent dans d'autres prénoms de personnages cités, celui du peintre catalan Miquel Barceló et du joueur de tennis Raphaël Nadal. Nadal renvoie par ailleurs à nada, "rien" : rien apparaît dès la citation de Bernard Noël en exergue (« comment dire ? cela crie mais ne dit plus rien »), et rien est également associé dans les premières pages à Racine et Bérénice (« Un vers de Racine, un vers de Bérénice, de rien à rien »). Rien se transforme en cendre plus avant, avec la même référence : « L'embâcle de cendre fige une ombre menue qui menace. Qu'est-ce ? Racine peut-être ou bien Bérénice seule. Sans que de tout le jour menace » ; le vers entier enfin est lié à « caroline et michel » : « Il faut rester ahuri par l'insignifiance de deux prénoms qui furent prononcés pour que se puisse écrire : / sans que de tout le jour je puisse voir Titus »2. La mort ne brise pas ce qui peut encore, et toujours, s'écrire « Elle aime El ».
El est également joint à Buffre, mot du causse Méjean pour "battu par les vents", pris en 2010 par Caroline Sagot-Duvauroux pour titre d'un livre où des motifs du Livre d'El d'où apparaissent, la violence, le gouffre du passé, l'enfance et la relation au "rien" : « Il n'y a rien ici [sur le causse] (...). On a passé l'enfance à convoiter ce rien. On y est. On a quitté la pensée. Rien est imprenable quelle délivrance. Rien vous tient. »3 L'enfance est présente dans Le livre d'El d'où, mais aussi l'enfant qui « ie à l'éperdu » El et elle, qui est du côté de la cendre et, donc, de la mort4. Quant au mot buffre, qui aurait peut-être signifié autrefois "beffroi" — tour d'où l'on guette — est qoulignée plusieurs fois sa proximité avec bulbe et buffle, proximité phonique mais aussi avec ce qui, souterrain, donnera une plante, et avec l'animalité.
Le second élément du tire est en rapport ave cun tatouage de michel : ce qui est inscrit est ambigu, à cause de la maladresse du tatoueur lisible aussi bien j'ai que d'où ; cette confusion des lettres, l'impossibilité de fixer un sens à ce qui est inscrit sur le corps, pourrait être manière de dire ce qu'est la poésie : non pas absence de sens, mais seulement le fait d'accepter l'ambiguïté, peut-être l'indécidable. Il faut ajouter que le livre est dédié sous la forme « à = toi », à signifiant "vers", le mouvement, et toi « contient tous les tu du monde ». Liaison de à et de buffre (= vent) : « c'est la préposition qui fait la phrase, c'est à. Et le vent. Dans la folie prédatoire de rejoindre. » Rejoindre dans l'absence le corps perdu — car c'est bien du corps qu'il s'agit (corps amoureux et "corps" de la langue), ce pourquoi la première citation est empruntée à "Mauvais sang" de Rimbaud, « Faim soif cris, danse danse danse », un temps où l'extérieur est absent.
Si complexe soit la composition du Livre d'El d'où, ce n'est pas un labyrinthe comme le laisserait d'abord penser l'apparence du texte : différentes dimensions de caractères sont mises en œuvre, des décrochages isolent des fragments, des bribes de dialogue entre caroline et michel sont intégrés, des signes de ponctuation ou des mots qui font tenir la phrase en tant que telle sont repris à la suite d'un paragraphe, dessinant le squelette de ce qui vient d'être lu, une espèce de calligramme ; etc. La composition s'apparente, semble-t-il, à celle d'une pièce musicale, avec le retour de "thèmes" — lieux (Tanger, Rochefourchat, villes de l'Inde), motifs du nom, de la douleur, mots, formes, y compris pour questionner l'ordre de la langue (« Ah ce génie des langues à purger d'ambiguïté les choses »), et comment faire autrement puisque « La phrase cherche à exister quelque chose plus qu'à exister ». Le texte de Caroline Sagot-Duvauroux s'ancre dans la littérature et se construit par elle, de L'Annonce faite à Marie à Au-dessous du volcan, et entre dans cet ensemble ses propres textes, Le Buffre, mais également Hourvari dans la lette, plus ancien.
La lecture du Livre d'El d'où est exigeante, l'écriture qui entend s'avancer vers l'inconnu de nous-même n'est jamais aisée à lire, mais ce qui est connu n'a pas besoin d'être écrit, « La phrase noue la gorge d'une illisible vision. // Si la vision était lisible on cesserait d'écrire. » Le mouvement contre l'absence — quoi de plus violent parce qu'impossible à penser ? — ne peut être que violent pour vaincre ce à quoi aboutit la disparition de l'Autre : la perte d'un regard, de mots. De là la douleur, « D'où vient tla douleur ? / D'être rendue à la foule des insignifiances ? Innommée donc innommable. Beckettienne soudain rendue au milieu précisément indifférent ». Donc il faut continuer, « tant qu'il y a des mots » (Beckett, L'innommable), aller à, vers, sinon pour être nommée, pour résister à la déroute, ce qui se dit par exemple par un de ces jeux phoniques du livre où « le son réalise le sens dans l'insens : À l'abordage. Aux abords d'à, je ».
Cette recension a été publiée dans Sitaudis (www.sitaudis.fr) en décembre 2012.
1 On pense de suite avec ce titre aux résonances bibliques ( El, présent dans des prénoms d'origine hébraïque, signifie "dieu") aux titres des livres d'Edmond Jabès (Le Livre de Yukel, El, ou le dernier livre, etc.).
2 Il y a dans la Bérénice de Racine (acte IV, scène 5) une réciprocité impossible ici :
« Que le jour recommence et que le jour finisse, / Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, / Sans que de tout le jour je puisse voir Titus ? Mais quelle est mon erreur, et que de soins perdus ! »
3 Caroline Sagot-Duvauroux, Le Buffre, Barre-de-Cévelnnes, éditions Barre parallèle, 2010.
4 voir notamment « Que fuyons-nous si résolument ? Sous les monts l'enfant mort ?»
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caroline sagot-duvauroux, le livre d'el, d'où, absence, enfance, poésie, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
15/01/2013
Marie Étienne, Haute lice

Rien de plus efficace que l’exergue tiré de Rimbaud, « Moi, j’ai toujours été stupéfait ! Quoi savoir ? » ("Remembrances du vieillard idiot") pour lire ce livre singulier ; c’est dire d’entrée de jeu que le lecteur aura à construire quelque chose — donc à lire ; « Faut-il tout dire afin qu’un jour il ne reste plus rien que la lucidité ? » (p. 124) : certes non. Haute Lice est partagé en sept ensembles de courtes séquences et se ferme sur une postface bien en relation avec l’exergue, sorte de "mode d’emploi" où l’auteur esquisse une poétique : « À proprement parler, le sens ne compte pas vraiment, ou bien ni plus, ni moins, que la sonorité, le rythme et le suspens, c’est ainsi que les choses se passent. » (p. 171) De quoi s’agit-il pour que le lecteur n’ait pas à se préoccuper du sens ?
Les ensembles sont liés grâce à la présence du début à la fin d’un personnage, Ava, c’est-à-dire Ève, narratrice des brefs récits dans lesquels elle a un rôle ; ajoutons qu’elle-même devient à l’occasion auteur : « Pour vaincre la tristesse, je m’inventais des fables troubles, dont j’ignorais la signification. » (p.20) Autrement dit, dans cet emboîtement les histoires ne se distinguent pas les unes des autres. Elles mettent en scène Ava, de l’enfance à l’âge adulte, et de nombreux personnages qui n’apparaissent qu’une fois, comme Joachim l’Italien ou Seringa le chimpanzé, ou reviennent à intervalles réguliers, comme Stone (mari d’Ava) ou Nel. Tous font n’importe quoi, le n’importe quoi ne pouvant être toujours défini, et leur apparence même n’est pas fixe. Ainsi, Ava, dans un récit est exhibée au bout d’une laisse, serait-ce dans un cirque ?, et le lecteur retrouve cette laisse bien plus loin, cette fois Ava peut-être sous une forme animale : « La laisse de ma mère, de mauvaise qualité, va céder sous mes crocs. » (p. 117)
Tout peut arriver : les oiseaux ont des dents, des fillettes sont dans des cages suspendues pour le plaisir des curieux, Ava perd sa mère dans un train ou reçoit devant sa porte « face cachée, nuque exposée, une tête sans corps » (p. 94). On multiplierait les exemples, mais ce serait recopier Haute Lice…Si une partie du livre évoque un lieu désigné par Lajenès (à lire "la jeunesse", en créole haïtien), la narratrice se trouve aussi à Paris, monte dans un étrange autobus aux vitres aveugles qui l’emporte nulle part, « dans le milieu d’une étendue d’eau grise, crêtée de loin en loin par une touffe d’herbe. » (p.166) Le lecteur renonce vite à la tentation d’organiser le tourbillon des changements d’apparence, de chercher quelque équilibre dans des récits qui, si minuscules soient-ils, le conduisent dans l’inexploré. On verrait aisément un monde à la Lewis Carroll, une Alice dans Ava, et l’auteur semblerait nous engager dans cette voie, mais il l’exclut immédiatement :
Petite sœur me conduit au miroir.
—Passe derrière, me dit-elle.
—Eh, quoi, ne me conduiras-tu ?
Elle rit, fleur goyave. (p. 124)
Le monde de Lewis Carroll a ses lois, qui relèvent somme toute d’une certaine logique, celui de Marie Étienne, qu’on pourrait lire comme relevant uniquement du rêve, est pour beaucoup un univers de mots, j’y reviendrai.
Cependant Le monde de Lewis Carroll a ses lois, qui relèvent somme toute d’une certaine logique, celui de Marie Étienne, qu’on pourrait lire comme relevant uniquement du rêve, est pour beaucoup un univers de mots, j’y reviendrai.
Cet univers n’est pas totalement coupé de l’Histoire ; on y croise par exemple un maçon « admonesté et sous-payé comme c’était la coutume » (p. 39), et les femmes, qui savent distinguer la satisfaction du désir sexuel et l’amour, peuvent surtout être elles-mêmes par le rêve ou l’écriture ; « Je commençais d’écrire c’est-à-dire de migrer vers mes terres intérieures « (p. 75) indique Ava. Mais quand elle entend bien refuser d’être dans le temps (« Je refuse de survivre à l’instant annulé en m’accrochant avide aux basques du suivant »), sa sœur se moque d’elle : « Allons, allons, tu racontes des histoires ! » L’Histoire est présente aussi par les allusions littéraires ; par exemple, "La Ravaudeuse" évoque Margot la Ravaudeuse de Fougeret de Monbron et "Nel" peut-être un personnage de Fin de partie de Beckett, "Marigda" est sans doute une allusion au livre de Viviane Forrester Le corps entier de Marigda, etc. Quant au premier récit, "La dictée", dans lequel Ava se laisse aller à uriner en classe au point que le liquide forme une grande mare, sans d’ailleurs que l’institutrice s’étonne outre mesure, il renvoie directement à "Remembrances du vieillard idiot" et donc à l’exergue :
[…] Quand ma petite sœur, au retour de la classe,
[…] Pissait, et regardait s’échapper de sa lèvre
D’en bas, serrée et rose, un fil d’urine mièvre… !
La postface introduit un jeu entre lice et lisse, d’où les termes techniques de peausserie lisser et chagriner ; dans les deux cas, le travail de l’artisan — la tapisserie, montage complexe de fils, la préparation des peaux — permet de passer d’une apparence à une autre : impossible de reconnaître dans l’œuvre achevée les matériaux travaillés. Et c’est heureux. De même, les mots sont associés non pas comme dans une fatrasie, mais pour construire des ensembles pas encore vus, pas encore imaginés, pas du tout impossibles … puisqu’ils sont décrits. Voici par exemple le début d’une scène dans la loge d’une maison d’Ava :
« La femme est belle, moi je sucre, elle a les doigts qu’il faut, on lui en mangerait son cratère de plaisir, d’autant qu’elle sait ce qui convient : détecter en dansant mais sans colle ni buée les écrans de fumée qui séparent du bleu, et lire dans les yeux le tintamarre des culs. » (p. 97)
Le seul changement de position des mots (qui entraine modification du statut grammatical) produit des effets, ainsi dans ce passage : « or voilà que la terre se bombe, or voilà que les bombes se terrent » (p. 30) ; on notera les nombreux jeux avec les sons, minuscules (« je suis en pantalons, pantoise ») ou non : Ava aime une femme qu’elle nomme "Missive" ou "Mélisse" ou "Réglisse", noms qui portent le sens « de délice (ou supplice ?) », et il n’est pas surprenant que la rivale de cette femme ait pour nom "Céline" — la finale ne peut entrer dans la série….Au jeu des sons s’allie le rythme ; on prendra plaisir à entendre le mouvement de la voix dans ce passage :
« Musique en fête, en tête, en crête, en kiosque, en dents calquées sur les montagnes, en tournevis, en tour de roue, musique saoule sur les terrains poudreux, éclatée à dessein, flûtes en verve. Musique verte. (p. 80)
Il y a dans Haute Lice un amour de la langue (comment dire autrement ?) que l’on voudrait plus répandu, une jubilation que l’on partage sans peine, un humour constant — et une manière malicieuse de l’auteur d’être présente : "Marie" et "Ava/Ève" sont deux origines culturelles, et ne reconnaît-on pas "Marie" dans les noms de personnages "Mariquido" et "Marigdar" ?
Marie Étienne, Haute lice, José Corti, 2011.
Paru dans Les Carnets d'eucharis en 2011.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie Étienne, haute lice, jeu des sons, allusions, lewis carroll | ![]() Facebook |
Facebook |
02/01/2013
Eugène Delacroix, Journal

Pourquoi commencer la rédaction d'un Journal quand on a 26 ans et que l'on se voue à la peinture ? Dès les première lignes écrites en 1822, Delacroix se fixait un objectif : « Ce que je désire le plus vivement, c'est de ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seul ; je serai donc vrai, je l'espère ; j'en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes variations. ». Le projet de se contrôler, de s'éloigner du monde extérieur pour réfléchir sur le moi, échouera relativement vite puisque la rédaction sera interrompue après trois années et ne sera reprise qu'en 1847. Ce n'est plus alors le même Delacroix qui prend des notes dans des carnets. Il a une œuvre de peintre derrière lui, il a voyagé notamment au Maroc et en Andalousie, il a beaucoup lu, il est devenu selon Baudelaire (Salon de 1846) un « grand artiste, érudit et penseur » et son souci n'est plus de s'interroger sur son identité. Baudelaire encore, rendant compte de l'exposition universelle de 1855, le définissait ainsi : « Il est essentiellement littéraire [...] par l'accord profond, complet, entre sa couleur, son sujet, son dessin, et par la dramatique gesticulation de toutes les forces spirituelles vers un point donné ». Ce lien établi entre le littéraire et le pictural est un des motifs récurrents du Journal.
Tourner autour de ce qui distingue la peinture de l'écriture répondait pour Delacroix au projet d'élaborer une écriture de peintre. Michèle Hannoosh analyse précisément en quoi il rompt avec les idées dominantes ; elle résume la théorisation faite au XVIIIe siècle par Lessing, pour qui la « temporalité de la littérature permet la narrativité, la causalité et donc l'unité » alors que la peinture, entière devant le spectateur, ne pourrait engendrer que des impressions confuses et sans ordre. Pour Delacroix, au contraire, le tableau donne en même temps la vue de la réalité et sa représentation expressive, ce qui provoque « une perception unie de la matière et de l'esprit », idée que souligne M. Hannoosh. Ces réflexions de Delacroix ont des rapports avec la manière dont il rédige son Journal. L'éditrice décrit les manuscrits comme un « document complexe, hybride, chaotique, labyrinthique » ; c'est que la construction du Journal donne au lecteur cette liberté qu'il a devant un tableau, sans suivre les règles d'un genre, règles vigoureusement rejetées dans tous les domaines : « Sur la ridicule délimitation des genres. Rétrécit l'esprit. L'homme qui ne fait que le trou d'une aiguille toute sa vie ».
Lisant le Journal, on se repère dans le temps grâce aux dates de rédaction, mais la chronologie est très souvent en défaut dans la mesure où Delacroix laisse parfois plusieurs jours entre ce qu'il a vécu et l'écriture, introduit dans son texte des documents (listes d'adresses, coupures de journaux, billets de chemin de fer, etc.), traces de la vie quotidienne à côté de ses développements sur son travail de peintre, sur ses rencontres, sur les événements. En outre, il renvoie régulièrement à un autre endroit de ses carnets, n'hésite pas à modifier ce qui a été écrit plusieurs mois auparavant et à le commenter.
Ces pratiques brisent la narrativité et construisent une temporalité complexe ; éloignées de l'écriture habituelle du journal intime, elles aboutissent à multiplier les points de vue du lecteur, ce qui répond à l'idéal de Delacroix, qui notait qu'« Un homme d'esprit sain conçoit toutes les possibilités, sait se mettre, ou se met à son insu, à tous les points de vue ». Défendant sans cesse, à l'exemple de Montaigne, le caprice de la pensée, la nécessité de prendre en compte le caractère divers de l'esprit, il affirmait en moraliste « Il y a dix hommes dans un homme, et souvent ils se montrent dans la même heure ». En outre, la réécriture de notes font du passé un matériau qu'il est possible d'utiliser dans le présent. La chronologie devient relative, ce qui importe alors est de penser un temps souple, sujet à variation : la continuité temporelle — c'est-à-dire la croyance au progrès ou à la décadence — est exclue, et Delacroix affirme à diverses reprises « la nécessité du changement. Il faut changer : Nil in codem statu permanent ».
Ce point de vue implique que l'activité intellectuelle occupe une place importante. Certes, Delacroix vivait dans l'institution, fréquentait les cercles officiels, appartenait au Conseil municipal de Paris, mais il allait aussi au concert, à l'opéra, au théâtre, lisait ses contemporains français (Baudelaire, Sand, Balzac) ou non (Dickens, Poe, Tourgueniev), recopiait des extraits, et il écrivait « Je me suis dit et ne puis assez me le redire pour mon repos et pour mon bonheur — l'un et l'autre sont une même chose — que je ne puis et ne dois vivre que par l'esprit ; la nourriture qu'il demande est plus nécessaire à ma vie que celle qu'il faut à mon corps. » Noter ses impressions, c'est en les approfondissant développer ses idées, non pas pour "inventer" du nouveau, mais pour comprendre comment les exprimer de manière nouvelle. Cette vie de l'esprit a parallèlement un autre rôle, souvent souligné dans le Journal, lutter contre l'ennui ; Delacroix vit dans le siècle du chemin de fer, qui réduit les distances et fait "gagner" du temps, ce qui ne change rien au sentiment d'ennui que beaucoup éprouvent. Ces lignes de 1854, « Nous marchons vers cet heureux temps qui aura supprimé l'espace, mais qui n'aura pas supprimé l'ennui », font écho à cet aveu de 1824, « Ce qui fait le tourment de mon âme, c'est la solitude ».
Écrire, c'est retenir ce qui est vite perdu, la mémoire ne pouvant tout emmagasiner ; un tri s'opère et la plus grande partie de ce qui est vécu, éprouvé, sombre dans l'oubli. Delacroix note à plusieurs reprises l'intérêt de pallier la faiblesse de la mémoire — « Il me semble que ces brimborions écrits à la volée, sont tout ce qui me reste de ma vie, à mesure qu'elle s'écoule ». Ne rien avoir noté, c'est n'avoir pas existé... C'est la mémoire du Journal qui établit une continuité en fixant ce qui est par nature éphémère, l'expérience du temps, notre « passage d'un moment ». Pour le lecteur d'aujourd'hui, le Journal de Delacroix ne fait pas que livrer le visage d'un peintre, il est aussi un tableau varié et complexe, sans doute partial et lacunaire (et intéressant pour cette raison), de la vie de la bourgeoisie et de milieux intellectuels au XIXe siècle. Il est aussi très souvent l'ouvrage d'un moraliste, sans complaisance pour lui-même et sans illusion sur ses contemporains ; même s'il devient plus mesuré avec l'âge, il ne varie guère dans le jugement noté en 1824 : « Le genre humain est une vilaine porcherie ».
Au Journal proprement dit, l'éditrice a ajouté une masse considérable de textes, qui donnent un éclairage indispensable pour la connaissance de Delacroix. Pendant la rupture d'un peu plus de vingt ans — interrompu en 1824, le Journal ne reprend qu'en 1847— sont écrites les pages du "Voyage au Maghreb et en Andalousie" et de très nombreux textes qui prolongent les réflexions du peintre : carnets et notes variées sur des peintres, des voyages, des lectures, des expositions, carnets et notes parallèles ensuite à la rédaction du journal jusqu'à la mort en 1863. Des pages de Pierre Andrieu, principal assistant de Delacroix et qui joua un rôle important dans la conservation du Journal, rapportent des propos du peintre. Outre les variantes du Journal (dont on connaît plusieurs copies), Michèle Hannoosh a préparé une série d'annexes qui font désormais de cette édition un grand ouvrage de référence, avec notamment un imposant répertoire biographique, un index des œuvres de Delacroix, un autre des noms de personnes, une bibliographie qui complète les indications données dans les notes. Les notes, quant à elles, abondantes et précises, apportent toutes les renseignements nécessaires à la compréhension d'une époque.
Eugène Delacroix, Journal, nouvelle édition intégrale établie par Michèle Hannoosh, 2 tomes, José Corti, 2009.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène delacroix, journal, peinture, point de vue, genre | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2012
James Sacré, Le paysage est sans légende (recension)

L'écriture du paysage
Le paysage est sans légende rassemble cinq poèmes, chacun composé de plusieurs suites de vers, qui composent un récit singulier et dont l'unité répond à celle des dessins (encre de Chine et aquarelle) de Guy Calamusa. La particularité du récit provient de son motif, exploré d'autres manières dans une partie importante de l'œuvre : que peut-on écrire (ou dessiner) de ce que l'on a vu ? Qu'est-ce qui, d'une expérience, peut être restitué par les mots ? Le titre semble donner une réponse, si "légende" désigne une note explicative : rien de juste ne sera dit — ce que confirme, inscrit avant la page titre, la mention Le vrai titre s'est effacé.
Le livre s'ouvre sur la description d'un paysage dessiné dans laquelle, pour le lecteur, tout apparaît lisible, soigneusement cerné, visible : le vert y domine et s'y détachent des formes. Cependant, cette reconstruction du paysage par les lignes et les couleurs et par la mémoire n'est guère satisfaisante pour James Sacré ; le temps passant, venu le moment de l'écriture, les mouvements observés avaient perdu de leur réalité et il devenait impossible de leur redonner un sens, comme si tout ce qui avait été vu, vécu, s'était défait, que les différents éléments du paysage — les pentes, les vallées, les arbres — et les femmes qui y travaillaient ne pouvaient être mis en place, que la tentative du regard sur le passé était vouée à échouer : tout se perdrait dans le vert, couleurs à peine présente sur le dessin. On relève au fil des pages les verbes qui traduisent la difficulté, voire l'impossibilité, de tenir ensemble les différents moments du temps, à associer les pièces d'un espace qui se dérobe : brouiller, trembler, déchirer, détruire, (se) défaire.
Plus loin, quand on lit « Je me rappelle très bien », suivi d'un embryon de description, vient rapidement le regret de ne maîtriser que de « fragiles souvenirs » ; on ne peut plus vraiment distinguer les éléments perçus, il s'agit seulement de « silhouettes » — et l'on passe à « J'ai cru reconnaître », mais il ne reste plus qu' « une broussaille / De ratures ni dessin ni rien d'écrit »(1). Il y a une perte irréparable, puisque rien ne peut faire que ce qui constituait un ensemble ne soit pas, dans l'écrit ou le dessin, en désordre. Cette relation du paysage réel, dans lequel on a vécu, et de l'écrit est décevante, et les traits sur la page ne parviennent pas mieux que les mots à approcher la réalité — « Quelqu'un n'est plus/ Qu'un léger dessin de rien ». C'est aussi vers le rien que s'abîment les jours de l'enfance, qu'elle soit ou non mise en parallèle avec le présent ; dans les écrits de James Sacré, un passage s'effectue aisément entre le présent (celui par exemple du travail agricole au Maroc) et le passé (celui de la ferme des parents) : mêmes gestes, rapport aux choses analogue, mais « presque tout / Disparaît dans un poème ».
James Sacré, répondant à la question "Où écrivez-vous ?"(2), précise qu'au moment de l'écriture à sa table, de la reprise de brouillons, interviennent
le souvenir et toute une activité de la mémoire qui mêle à d'anciens sentiments de présence ceux désormais de l'absence et de l'éloignement, de la perte des lieux et des visages, des temps et des espaces ... même quand c'est dans le plus grand effort de continuité avec le "brouillon" d'abord vécu autant qu'écrit. (p. 47)
Sans doute, c'est dire que « Le monde nous échappe. Et puis / Notre désir aussi » ; ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en inquiéter, la poésie n'est pas vouée à fixer les formes des paysages ni à être lieu de mémoire. La re-présentation déçue, le fait qu'écrire n'aboutit — en apparence — qu'à de « minuscules machines de mots pour rien dire », n'empêche pas le poème d'être là, sans qu'il ait pour sujet on ne sait quelle impossibilité de dire quelque chose du réel. Peut-être échoue-t-on dans le désir de fixer une figure stable des choses, mais reprendre inlassablement l'arrangement des mots — des lignes — aboutit à donner un regard sur le monde, si fragmenté qu'il apparaisse ; on pense évidemment à Giacometti qui affirmait : « Tout ce que je pourrai faire ne sera jamais qu'une pâle image de ce que je vois »(3). Il y a toujours chez James Sacré le désir de faire entendre « Le bruit ténu du vivant », et si difficile soit-il à restituer, il est là :
On nomme des endroits de ce monde
L'oued Bouskoura, la rivière Vendée
Un nom de village ou plusieurs choses
Une échelle un puits des noms des mots
Comme pour mieux se tenir au monde
Avec un dessin c'est pas mieux, tout s'éboule
Et pas grand chose
Qui reste dans les mains. Quand même
On est bien.
James Sacré, Le paysage est sans légende, dessins de Guy Calamusa,
Al Manar / éditions Alain Gorius, 48 p., 16 €.
© Photo Tristan Hordé.
1 Ce qui établit une continuité avec les livres précédents : par exemple, Broussaille de prose et de vers (où se trouve pris le mot paysage), publié en 2006 (éditions Obsidiane), abordait aussi, d'une autre manière, le motif de la perte.
2 dans fario, n°11, printemps-été 2012.
3 Alberto Giacometti, Écrits, Hermann, 1992, p. 84.
Publié dans RECENSIONS, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, le paysage est sans légende, souvenir, description, réalité | ![]() Facebook |
Facebook |
17/10/2012
Yves Bonnefoy, Notre besoin de Rimbaud (recension)

Rimbaud est toujours resté très présent dans la réflexion d’Yves Bonnefoy sur la poésie. Ce fort volume le prouve qui réunit, avec Rimbaud par lui-même paru pour la première fois en 1961, divers textes : préfaces, articles, conférences — dont les plus récentes ouvrent le livre en indiquant pourquoi Rimbaud et Baudelaire ont marqué l’existence de Bonnefoy : « révélation de ce qu’est la vie, de ce qu’elle attend de nous, de ce qu’il faut désirer en faire. » Qu’un écrivain de cette grandeur dise que Rimbaud a été pour lui un guide, et en quoi il l’a été, cela suffirait pour désirer le lire attentivement.
Dans les deux premières conférences qui donnent leur titre à l’ouvrage comme dans son Rimbaud, Yves Bonnefoy construit par touches successives un portrait intérieur de Rimbaud et de l’examen attentif de l’œuvre tire une leçon de vie. L’analyse met en valeur l’acharnement de Rimbaud à toujours vouloir extraire le vrai des choses, et découvre l’insatisfaction continuelle du jeune poète allant vers autrui, toujours à dénoncer la misère et toujours dans l’utopie, toujours déçu et toujours repris par des chimères. Par dessus tout, Rimbaud est occupé par la question de l’écriture ; ce qu’il écrit dans sa lettre à Demeny du 15 mai 1871 (dite "lettre du voyant"), c’est ce que représente à ses yeux la poésie. Elle est, comme le résume Yves Bonnefoy, « accès à nos vrais besoins, lesquels sont d’assumer notre finitude, d’en reconnaître l’infini intérieur, ramassé sur soi, de nous ouvrir de ce fait à des rapports de plus d’immédiateté avec nos proches dans une société qui pourrait en être transfigurée ».
Sans doute cela est-il devenu clair aujourd’hui pour beaucoup. Ce qui l’est moins peut-être, et il faut savoir gré à Yves Bonnefoy de l’écrire à plusieurs reprises, c’est que travailler dans la langue de manière à en modifier l’ordre, c’est toucher profondément l’ordre des choses. C’est la leçon que donne sa lecture du sonnet Voyelles, où le chaos introduit dans la perception permet de voir ce sur quoi le regard ordinaire passe sans s’arrêter. « Épiphanie de l’indéfait », Voyelles enterre le lyrisme romantique, « le désordre qui se répand dans l’emploi des couleurs va ruiner toutes les figures de l’être au monde ancien et avec celles-ci balayer les espérances que Rimbaud jusqu’alors avaient fait siennes, dans l’espace de la pensée d’autrefois. » Yves Bonnefoy suit la volonté de Rimbaud de mettre à bas les manières de comprendre le monde, notamment celles du milieu parisien de la poésie qu’il ne supporte pas. Contrairement aux poètes qu’il rencontre, et c’est pourquoi sans doute l’œuvre de Rimbaud garde toute sa force aujourd’hui, la poésie était pour lui « une expérience directe de l’unité, de sa présence au cœur de tous les actes de l’existence et de tous les emplois de mots, dans ce seul vrai infini qu’est la réalité quotidienne ». Leçon toujours et encore à répéter, contre la pression incessante qui pousse à ne pas penser et à ne pas agir autrement que dans la norme. "Notre besoin de Rimbaud", il est, dans « l’éternel effondrement », de comprendre que « si l’esprit est souvent, ou toujours, illusionné, il n’est pas, comme tel, dans son essence, illusoire ».
Le livre dense qu’était Rimbaud par lui-même, ici sous le titre Rimbaud, rompait en 1961 avec les lectures de Rimbaud. On était peu habitué à l’époque — l’est-on nettement aujourd’hui ? — à une lecture, à un commentaire qui s’efforcent de penser l’œuvre comme une « biographie spirituelle ». On retient ici de l’analyse précise des poèmes comment s’opéra le rejet de la poésie subjective, et en quoi Les Illuminations furent la « reconnaissance d’un échec » : la vie vécue comme opaque, noire. Rimbaud, à la fin de 1874, entreprend l’apprentissage de plusieurs langues (allemand, italien, russe, arabe) et Yves Bonnefoy rappelle que « la poésie ne se fait qu’en portant à l’épreuve de l’absolu une langue », et qu’il faut « en voir la secrète et active dénégation dans cette étude de la parole ». Renoncement ? oui, mais l’œuvre est toujours là pour « témoigner de l’aliénation de l’homme, et l’appeler à passer du consentement sans bonheur à l’affrontement tragique de l’absolu ».
Les huit études qui composent le reste (un tiers) du volume offrent notamment des lectures de poèmes ("Les Reparties de Nina", "Ce qu’on dit au poète à propos de fleurs") et un examen détaillé des rapports complexes de Rimbaud à sa mère. On relira en particulier la comparaison des poétiques de Mallarmé et de Rimbaud, et ce que ce dernier a un moment rêvé du rôle social du poète — rêve dont on peut se demander comment il serait reçu aujourd’hui quand on en lit la synthèse de Yves Bonnefoy :
Le poète : celui qui apportera aux délibérations de la société son expérience de la subjectivité toujours en désordre, de l’imaginaire toujours en proie aux fantasmes, autrement dit son affrontement des désirs sans mesure et des visions chimériques. Tout cela désormais non plus idolâtré ni dénié, mais traversé, malmené, accepté, compris.
Yves Bonnefoy, Notre besoin de Rimbaud, Seuil, 2009, 23 €.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, notre besoin de rimbaud | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2012
Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur : recension

On oublie que la large diffusion du livre est récente au regard de l’histoire de l’écrit. Un grand succès de libraire au milieu du XVIIIe siècle était vendu à 1500 exemplaires et l’immense majorité de la population n’y avait pas accès. La lecture n’avait pas les mêmes formes qu’aujourd’hui ; peu savaient lire et seule la pratique de la lecture à voix haute permettait une large diffusion de certains textes, ceux surtout de la Bibliothèque bleue, ainsi nommés parce que les livrets, brochés, portaient une couverture bleue1. Il s’agissait de petits recueils, méprisés alors des élites, qui abordaient les thèmes les plus divers : miracles, prophéties, recettes de cuisine, économie domestique, histoire sainte, etc. ; ils proposaient aussi des choix de contes et des romans de chevalerie abrégés. C’est cette dernière catégorie de titres que transporte dans sa boîte, de villages en hameaux, le jeune Julien Letrouvé.
Le récit de Pierre Silvain rappelle dans une belle fiction cette histoire de la lecture. Julien Letrouvé, abandonné à sa naissance comme son patronyme l’indique, devenu très jeune gardien d’un troupeau de cochons, a passé la petite enfance au milieu de fileuses qui travaillaient dans une écreigne – une habitation souterraine. L’une des femmes, qui avait failli devenir religieuse, lit pour ses compagnes : « tous écoutaient la liseuse tenant son petit livre à la lueur d’un falot posé sur une hotte renversée, les esprits vagabondaient vers des horizons toujours bleus, des lointains tout de douceur et de promesses ». Le jeune Julien, après la puberté, quitte ce refuge et devient colporteur, mais il laisse la mercerie à ses confrères et se voue à la seule diffusion du livre. Le lecteur le suit quand il quitte le libraire chez qui il remplit sa boîte avec L’Histoire de Fortunatus, Mélusine, La Complainte du Juif errant, Till l’espiègle et des fabliaux.
Le récit se déroule pendant une période bien troublée, à la veille de la bataille de Valmy en septembre 1792, et c’est dans la direction du champ de bataille que se dirige Julien sans le savoir. Il avance sous la pluie et dans le vent, et au cours de sa marche apparaissent des personnages contemporains — l’astronome Laplace arrête son cocher qui monte le colporteur à ses côtés, la lourde voiture du roi en fuite le dépasse. S’ajoutent, comme dans un livre, la confusion des temps, et surgissent dans le récit Fabrice del Dongo à Waterloo et Chateaubriand enrôlé dans l’armée des Princes, mais aussi les jours de la Terreur de 1793 et l’image de poupées, qui sont d’ailleurs mis en scène dans un autre livre de Pierre Silvain2 … Julien marche et, presque un siècle plus tard, « eût pu croiser un autre marcheur » dans cette région, Rimbaud. Gœthe est également convoqué, racontant la bataille de Valmy et, dans l’histoire de Julien, au début de la retraite, un soldat prussien, Voss, déserte. Après une longue errance, il se lie avec l’adolescent. Ce soldat à la vie romanesque parle et lit le français. Julien lui ouvre vite la boîte aux merveilles, celle des livres, et Voss s’enfuit dans la lecture – au point que Julien craint de ne pas le retrouver : « J’ai eu peur, tu étais parti si loin dans les mots, mais tu es revenu ». Le soldat lit ensuite, cette fois à voix haute, et Julien, qui suit les mots lus, « retrouvait le besoin inapaisable de comprendre ce que lui refusait son ignorance ». L’histoire qu’il écoute, c’est la dernière qu’il a entendue dans l’écreigne.
Il s’agit bien d’un récit d’initiation, de formation, et tout apprentissage est difficile. La soldatesque abattra le déserteur et brûlera les livres, ces livres au milieu desquels Julien vivait « caché, protégé » : « Le Paradis perdu, l’Âne d’or, Les Voyages de Gulliver, Une vie et Salammbô, Du Côté de chez Swann , Là-bas, Le Bruit et la fureur, L’Odyssée. » Construction onirique ? Oui, comme la fin du parcours de Julien. Lui, l’enfant venu de nulle part (sans père ni mère), reprend sa route vers nulle part. Il marche tout un hiver, dans la neige et le gel, s’arrête au printemps dans une ferme et, quand il assure qu’il va continuer sa route vers « là-bas », la femme qui l’a accueilli : « Il n’y a pas de là-bas, ici on est au bout du monde […] Et qui pourrait vous attendre, là où vous allez, plus loin que le bout du monde ?». Alors ? Réponse bouleversante : « Celle qui lit les livres ». C’est la fin du parcours, et cette femme qui, comme lui, ne sait pas lire peut se substituer à la liseuse de l’écreigne qui déchiffrait le mystère des mots, devenir la lectrice du monde.
Je n’ai retenu que des bribes, rapporté sommairement une intrigue sans assez dire la force des évocations qui font croire aux temps mêlés, à la fusion d’une certaine réalité avec l’univers des livres, sans dire aussi le charme d’une langue déliée, précise, maîtrisée, inspirée : impossible de ne pas lire d’une traite ce bref "roman", superbe manière d’honorer la lecture, le livre.
Pierre Silvain, Julien Letrouvé colporteur, Verdier, 2007, 11 €.
©Photo Tristan Hordé
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, julien letrouvé colporteur, livre, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |
12/09/2012
Jacques Roubaud : rencontre avec Jean-François Puff — recension
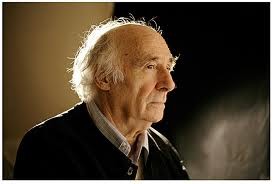
Rappelons ce qu’est la collection "les Singuliers" dirigée par Catherine Flohic. Chaque livre reconstitue le parcours d’un écrivain grâce à une série d’entretiens, le jeu des questions et des réponses au cours de la rencontre variant selon les uns et les autres. L’entretien est accompagné d’un choix de textes, anthologie qui constitue une introduction à l’œuvre sous ses divers aspects. Des photographies évoquent l’histoire personnelle (photos de famille, d’amis, de lieux) et celle des écrits (couvertures de livres de l’auteur et des écrivains admirés, manuscrits), quelques-unes en pleine page, la plupart sous forme de vignettes en belle page dans une colonne qui reçoit également des extraits d’œuvres lues par l’auteur. Chaque ouvrage se clôt par une bibliographie de l’auteur (livres, textes en périodiques, études le concernant) et une autre de son interlocuteur.
Voilà décrite la construction de l’ensemble consacré à Jacques Roubaud (1). On sait bien qu’une série d’entretiens ne peut être reprise comme telle et Jean-François Puff a organisé la matière en cinq chapitres : Enfance et Provence, La tradition poétique, Histoire de l’œuvre, Arts, Un ermite amoureux. L’étendue de l’œuvre excluait d’en retenir tous les aspects et la rencontre est concentrée autour de quelques axes. Sont rappelés à grands traits les moments de la formation, depuis les poèmes de l’enfance, imprimés par les proches, aux poèmes engagés écrits dans la mouvance surréaliste jusqu’à epsilon (1965). Ont compté l’influence de Raymond Queneau, y compris pour la fascination numérologique, et la participation à l’Oulipo. Sont rappelés les rapports avec différents groupes et revues (Tel Quel, Action poétique, Change) et la création du Cercle Polivanov (1969) avec Léon Robel voué à l’étude formelle des textes poétiques. Jacques Roubaud, dont les parents avaient terminé leurs études à l’école normale supérieure, avait entrepris une licence d’anglais avant de se tourner vers les mathématiques, qu’il enseigna ; c’est en relation avec l’entrée dans ce domaine qu’il choisit la forme sonnet dans un de ses premiers livres. S’inscrire dans la tradition lointaine de la poésie en langue d’oc (langue que ses parents ne pratiquaient pas) a aidé Jacques Roubaud à rompre avec le surréalisme et avec l’avant-garde qui lui a succédé pour qui rien n’existait en dehors de ce qu’elle produisait. Mais les troubadours ont eu un autre rôle : ils lui ont fait comprendre l’importance de la notion de communauté ; comme plus tard les rhétoriqueurs, ils ont travaillé dans le même sens et c’est ce mouvement commun qui enrichit la tradition poétique, créant le sentiment que chacun inséré dans un groupe fait quelque chose d’important. Jacques Roubaud insiste sur la nécessité de lire les troubadours, et tous les poètes du passé, comme s’ils étaient nos contemporains : c’est un moyen efficace de réfléchir sur la notion de temps, sur ce que signifie la poésie « mémoire de la langue » et sur le lyrisme. Reprenons ici son amorce d’analyse de quatre vers de Bernard Marti :
ainsi je vais enlaçant
les mots et rendant purs les sons
comme la langue s’enlace
à la langue dans le baiser
qui ouvrent à la réflexion sur deux points majeurs : « d’une part le lien l’amour la poésie, et d’autre part, en ce qui concerne la construction formelle, la question de l’entrelacement, entrebescar, qui est au centre de la première grande prose narrative française, le Lancelot. Voilà ce que je trouve extraordinaire : condenser en deux trois vers des concepts poétiques extrêmement importants. » (2)
Lecture des troubadours par Pound : Jacques Roubaud est aussi lecteur des poètes anglais et américains, qu’il a traduits, de Lewis Carroll à Rosemary Waldrop (elle-même traductrice notamment de Roubaud et de Jabès). À ses yeux, la nouveauté dans le domaine du vers vient des États-Unis où la dimension orale est demeurée vivante (3) et a abouti à un traitement novateur du vers, et non plus seulement à un vers libre en réaction au vers traditionnel. Sur ce point, toujours peu ou pas analysé aujourd’hui, les remarques de Jacques Roubaud sont à poursuivre quand il affirme que « le vrai vers libre, c’est le vers de Reverdy. Quand Reverdy a envie de rimer, il rime, quand il a envie de faire un alexandrin, il le fait » (4). Avec la réflexion sur le vers, qui a notamment conduit Roubaud à étudier les formes de la poésie japonaise classique, comme le renga, on tient l’un des quatre aspects, indissolublement liés, de son activité : composer des poèmes, traduire, construire des anthologies, réfléchir sur la façon dont les poèmes sont composés.
On renvoie à cette rencontre pour préciser la relation établie entre poésie et musique, ce qu’est chez Roubaud l’image-mémoire dans la poésie, comment il construit la "théorie des nuages" en œuvre chez le peintre Constable (auquel il a consacré un livre (5), que l’on peut résumer par la formule « donner forme à l’informe » : dans la poésie, « les nuages auxquels il faut donner forme sont des nuages de langue […] et l’ « on peut considérer que la langue comme elle se produit ordinairement et même comme elle se produit dans la poésie en un certain sens est informe ». Mais surtout l’ouvrage devrait inciter à lire ou relire Roubaud, la poésie, les proses narratives, les traductions, les essais.
Jacques Roubaud : rencontre avec Jean-François Puff, collection les Singuliers, éditions Argol, 25 €.
1 Après, dans cette collection, des entretiens avec Jude Stéfan, Paul Nizon, Philippe Beck, F.-Y. Jeannet, H. Lucot, Christian Prigent, Raymond Federman.
2 Les troubadours, anthologie bilingue (Seghers, 1971) et La Fleur inverse. Essai sur l’art formel des troubadours (Ramsay, 1986).
Publié dans RECENSIONS, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud : rencontre avec jean-françois puff | ![]() Facebook |
Facebook |
22/08/2012
Antoine Emaz, Plaie, encres de Djamel Meskache : recension

Avant la table des matières qui reproduit l'incipit des 28 séquences du livre, deux dates indiquent la durée de la rédaction, 2. 09. 07 - 23. 11 07. L'ensemble a été écrit dans un laps de temps assez bref, comme d'une seule coulée, ce qui assure une homogénéité forte autour du seul motif, une rupture. On n'en lira pas le récit ; Plaie ne reconstitue rien de l'événement lui-même, attaché seulement au parcours qui le suit : comment vivre l'après ?
La rupture défait complètement la personne, et comment le dire sinon par l'analogie avec une atteinte au corps ? Il n'y a pas ici de division entre l'"esprit" et le corps, c'est ce qui constitue le sujet qui est en cause, et ce sont les termes évoquant la béance, le choc, qui peuvent rendre compte de la violence vécue : plaie plusieurs fois, lèvres [de la plaie], blessure, brûlure sans fin. Cette plaie évolue, elle suppure, en sort du pus, il faut en couturer les bords, la guérir, elle devient boursouflée ; il restera une balafre, une ride — cependant, la plaie fermée, la faille demeure, la rupture est cause d'un « trou d'être ». Et ce qui s'est passé « dedans » a modifié la relation à l'extérieur, au « dehors ».
Le bouleversement du moi entraîne de profonds changements dans la perception du monde. Il y a d'abord le sentiment vif de ne plus appartenir à une communauté : l'extérieur est ressenti seulement comme lieu du bruit, donc de l'indifférenciation, quand le silence occupe toute la place en soi. Les choses perdent leurs couleurs, semblent comme de la « cendre », la distinction entre le beau et le laid est abolie ; tout apparaît « sale » (le mot revient plusieurs fois), comme touché par ce qui a atteint le moi, et c'est cette transformation négative qu'il faut dépasser. Dans les moments les plus forts de cette solitude non voulue, toute appréhension du dehors disparaît : « muet / aveugle // monde vide », il est alors impossible d'échanger des mots avec autrui.
Ce n'est pas qu'autrui soit absent : la "plaie" est devinée et le risque est d'attirer la compassion, la pitié, ce qui accroît la difficulté à recouvrer un équilibre, à « s'en sortir sans sortir » comme l'écrivait Ghérasim Luca repris par Antoine Emaz. Raidissement ? Plutôt position éthique souvent affirmée dans l'œuvre et redite ici : « on est encore debout », « digne / c'est debout » qui éloigne le déversement lyrique auquel on s'attend avec ce genre de situation. Il s'agit donc d'aller seul « au bout de la nuit » et pour ce faire dissimuler, faire aux yeux d'autrui comme si rien n'était arrivé, mais la feinte pour le dehors laisse intacte la douleur du dedans : les pensées qui ramènent à l'innommable — la rupture — sont là, obsédantes, dans la tête, la "cage", la "cave", les "quatre murs", et sur elles se greffent de très anciennes peurs, venues de l'enfance, celle du chien qui agresse, incontrôlable, impossible à dominer comme est impossible à comprendre la rupture ; elle n'était « ni évitable ni inévitable » :
pour la énième fois
on repasse la séquence
pour voir l'erreur
la cause
ça a
eu lieu
parce que
parce que
parce que
rien
on ne voit pas
Il n'y a pas d'explication et la difficulté consiste à intégrer le fait dans la série des événements vécus, à le chosifier, tout en sachant que l'oubli est impossible, que rangé dans la mémoire la "chose" sera toujours là, qu'on ne peut la recouvrir de « sable vase lie ». Comment sortir du labyrinthe ? La fuite, c'est le sommeil, c'est-à-dire l'absence à soi, pour ne pas vivre le vide des jours ; le recours, c'est poursuivre vaille que vaille les gestes de la vie quotidienne, les gestes mille fois répétés (« faire la vaisselle »), ces tâches « sans passé / sans futur », et plus encore la vue du jardin qui redonne l'idée du temps qui passe. Ce n'est que ce mouvement du sujet dans le temps qui conduit progressivement à la "guérison", et si à un moment de la reconstruction on lit « poser que c'est / ne repose pas », à son terme le constat est accepté : « [...] rien à juger / pas de morale / c'est ». Mais l'engagement nécessaire dans le "dehors" n'est efficace que soutenu par le travail d'écriture.
Les mots, les mots éloignent la douleur, comblent le vide — parce qu'il y a bien le vide si fortement dit par Lamartine : « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » ; ici :
poésie usée à cœur
juste dire
seul
pour n'être pas tout à fait seul
« les mots comme pierre de poucet » donnent le moyen d'un va-et-vient entre le passé qu'il faut, de toute manière, intégrer dans la mémoire, et le futur, ne serait-ce que parce qu'ils permettent de penser le temps, d'anticiper : « on sera fera dira ». Les mots ne peuvent pas combler ce « creux noir » de l'absence, mais suivre leur chemin « tordu tortueux tors » conduit à abandonner le masque, le fard, le mensonge avec les autres, à n'avoir plus à écrire « on ne sait plus qui on est / peut-être on » ;
au moins les mots sont au travail
on les entend s'affairer
recoudre la nuit
faire leur besogne de nains
dans la tête
Longue besogne, non pour retrouver la vie comme "avant", mais pour vivre à nouveau le temps, ce que disent les derniers vers :
l'eau du temps maintenant
non plus boue
ou pus
Il y a bien dans Plaie une situation lyrique ("l'absence de l'aimée") mille fois mise en mots, ce qui n'a pas d'importance : les motifs ne sont guère nombreux et seule compte la manière de dire. On apprécie l'étendue du poème, les reprises d'une séquence à l'autre de quelques points (le repli, la feinte, le dedans/le dehors, l'écriture), leur entrelacement et un approfondissement qui renouvelle l'approche d'un thème commun. On retrouve le vers bref d'Antoine Emaz, la respiration posée avec les silences (les "blancs" de la page) dans la diction, le goût pour un vocabulaire réduit jusqu'à la sécheresse, la distance forte aussi vis-à-vis de l'épanchement — position éthique — jusqu'à faire du thème de la rupture une épure à laquelle font subtilement écho les encres de Djamel Meskache.
Antoine Emaz, Plaie, avec des encres de Djamel Meskache, éditions Tarabuste, 2009, 12 €.
Publié dans Emaz Antoine, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plaie, avec des encres de djamel meskache, éditions tarabuste | ![]() Facebook |
Facebook |





