23/01/2018
La tête et les cornes : recension
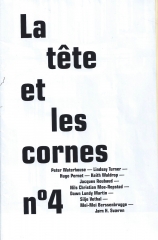
Les revues, il faut le répéter, sont un des lieux importants où la littérature se crée. La Toile offre évidemment des possibilités que les lecteurs d’aujourd’hui connaissent mais, bien que moins visibles qu’autrefois dans les librairies, la revue sur papier résiste. Certaines, bien établies, ont leur public (Europe, Rehauts, PO&SIE par exemple), d’autres le cherchent : c’est le cas de La tête et les cornes, animée principalement par deux jeunes poètes, Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon. Après un n° 3 consacré au cinéaste Alain Cavalier, le n° 4 revient à la poésie avec beaucoup de traductions.
Quatre poèmes de Keith Waldrop (traduction Bernard Rival) tournent autour de la maison, un cinquième plutôt du corps, malgré son titre ("L’esprit de la maison" / "The Locality Principle"). Ce sont des maisons de mots, toutes lieu du désordre (« à aucun prix je ne mettrai / chez moi de l’ordre », « Voici mon foutoir (…) »), donc images de la vie. Ils sont représentatifs de l’ensemble de ce numéro, c’est peut-être en effet la difficulté, ou parfois l’impossibilité, de construire un ordre qui domine dans les différents textes.
Les poèmes, qu’on reconnaîtra différents les uns des autres, ont un point commun, chacun met en évidence que la langue ne peut restituer que des bribes de ce qui est vécu, sans jamais qu’une continuité s’établisse. Cette incapacité à écrire autre chose que des fragments est bien lisible dans le poème d’ouverture de la revue ; Peter Waterhouse, que traduit de l’allemand Lucie Taïeb, accumule des mots dans le vers sans construction d’une phrase,
Langue. Dit. Arbre. Est. Haute lune. Vole. Bouche. Vient. Commissure.
Ou énumère des propositions contradictoires dans un groupe de vers :
Estompe. Rien ne s’estompe.
Voler. Aucun ne vole.
Vocabulaire. Aucun vocabulaire.
Cœur. Fin du cœur.
Bleu. Bleu tout juste perdu.
Ces vers, repris ensuite dans le poème, laissent entendre que l’on peut écrire A et, immédiatement après, non-A.
Le rapport à la langue est analogue dans le poème de Hugo Pernet, comme dans ceux traduits de l’anglais de Lindsay Turner (trad.. Stéphane Bouquet), de Dawn Lundy Martin (trad.. M. de Quatrebarbes et M. Guesdon), de Mei-Mei Berssenbrugge (trad.. Virginie Poitrasson), et du norvégien (trad. Emmanuel Reymond) de Nils Christian Moe-Rempstad, Silje Vethal et Jørn H. Sværen.
Totalement différents semblent être les 36 poèmes de trois vers de Jacques Roubaud qui, d’une certaine manière, présentent un excès d’ordre. Le haïku compte 3 vers de 7 /5 / 7 syllabes, on lit ici des vers de 5 / 3 / 5 syllabes. Chaque poème apparaît comme un tout fermé et peut se lire sans le titre noté en caractères gras ; ainsi « composition » :
face au souvenir
je pivote
et fait face au sombre
Cependant, d’autres poèmes incluent le titre comme élément, comme « Claude Royet-Journoud (08 / 09 : 2017) » :
possède la page
plus profond
que nul jamais sut
On pense encore au poème titré « "L’instant fatal" », allusion claire à un recueil de Raymond Queneau, à celui titré « Gilbert et George » ou à deux autres liés par le sens, le premier tourné vers le passé, le second étant au présent : « je pouvais // rouler dans la pluie / savonner / mes yeux de ces neiges », « et je perds // à la fin extrême / de ma vie / tout mon temps ou presque ». Etc.
Jacques Roubaud s’impose une règle qu’il ne suit donc que partiellement : on pourrait dire que le désordre est ici maîtrisé. Comme l’est une image d’un désordre classé montré par la couverture intérieure de la revue : elle est composée d’une photographie (de Yohana My Nguyen) d’une partie de la bibliothèque de Claude Royet-Journoud.
On ne peut que souhaiter longue vie à une revue inventive, qui donne à lire un grand nombre de traductions, rappelant ainsi que la poésie, elle, n’a pas de frontières.
La tête et les cornes, n°4, novembre 22017, 32 p., 6 €. Note publiée sur Sitaudis le 19 décembre 2017.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la tête et les cornes : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
14/01/2018
Xavier Girard, L'éléphant de mon père : recension
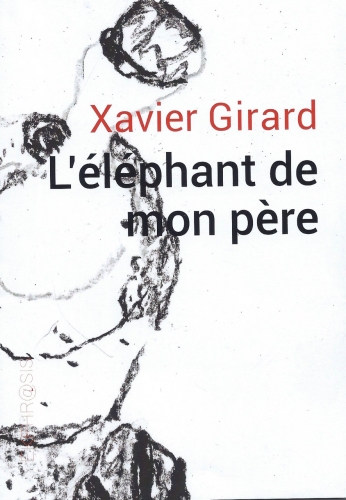
On connaît Pierre Parlant écrivain — Ma durée Pontormo a paru en décembre 2017 aux éditions nous — et fondateur de la revue Hiems (1997-2003) ; cette année il a publié une collection de livres de petit format (14,8 cm x10,5), intitulée Ekphrasis. On se souvient que le mot s’est d’abord employé pour la description du bouclier d’Achille dans l’Iliade : donc, il se dit d’une description d’une œuvre d’art par l’écriture. Pierre Parlant le prend dans un sens élargi et l’ekphrasis peut alors concerner un lieu, une personne, un objet mis, littéralement, sous les yeux. Les trois premiers textes proposent la description d’un ami disparu (Cyril, Didier da Silva), d’une sculpture du Bernin (Le doigt dans l’œil, Sébastien Smirou) et d’un jouet (L’éléphant de mon père, Xavier Girard). C’est ce dernier texte que je retiens. Un quatrième titre a paru, Le Pistolet, de Liliane Giraudon.
Le récit s’ouvre sur une interdiction : un objet, dont on comprend qu’il s’agit d’un éléphant, un jouet en bois placé sur le bureau du père, échappe aux enfants de la maison : « Nul ne devait l’ôter de là, un point c’est tout. » Il s’agit bien d’un objet « tabou » et c’est cette fonction qui importe, plus que l’objet lui-même qui n’est plus en bon état, après avoir été un "vrai" jouet : le père avait professionnellement dessiné des jouets, mais qui semblaient plus destinés à être des éléments de décor que des jouets. La distance exigée vis-à-vis de l’éléphant est analogue à celle entre le père et les enfants ; aucun échange entre eux, aucune caresse, et tout se passe comme si l’absence de contact physique devait être étendue aux objets. Rien ne devait bouger dans l’univers fermé du père quoi qu’il arrive, « Laisser le chaos en place mais, surtout, surtout : ne toucher à rien. » Parallèlement, le narrateur semble aussi absent pour sa mère : sur l’autel qu’est devenu le marbre de la cheminée du salon, sa photo ne figure pas auprès de celles de ses frères, l’image écartée symbolisant la différence de statut dans la famille — sans doute n’est-il pas comme les autres si l’on en juge par le « regard désapprobateur » de sa mère quand elle le voit lire le Journal de Gide.
Le lecteur ne saura rien de plus à propos de la mère, fermée sur la famille étroite. C’est la mort du père qui change la relation à l’éléphant : lors du partage des biens, le narrateur obtient le jouet. S’est construit auparavant une relation complexe avec le jouet, qui était devenu d’une certaine manière aussi proche que s’il était animé, « Je l’aimais parce qu’il était agonisant, abandonné », écrit le narrateur et, plus avant dans le récit, « Il m’était cher parce qu’il était perdu » ; par ailleurs, l’histoire du jouet, qui a « vécu une autre vie », reste ignorée parce que, selon le narrateur, jamais « personne ne songe à le questionner ». Si l’on écarte l’agonie (l’éléphant n’est plus entier), l’animal semble un double du narrateur qui, à partir du moment où il l’emporte, multiplie les notations ambiguës : « l’éléphant n’avait pas l’air mécontent de quitter le bureau », « Ses yeux (…) me fixaient », etc., pour enfin le définir comme « éléphant sans famille », ce qui pourrait s’appliquer à lui.
Dans l’appartement, le jouet était omniprésent puisque visible « en quelque endroit du salon que l’on se tienne » et sa description a commencé alors qu’il était encore sur le bureau du père. Elle était cependant sommaire, elle se développe seulement quand le narrateur peut le manipuler à loisir. Il en prend précisément les mesures — 25 cm de longueur, 18 de hauteur —, le photographie sous tous les angles — pour compenser la photo manquante ? —, le dessine, relevant que « meurtri par le temps », l’éléphant a perdu ses oreilles et qu’à leur emplacement restent des traces de peinture rouge, « comme si l’arrachement l’avait éclaboussé de sang ».
Les dessins, commente le narrateur, « levaient l’interdit de mon père » ; sans aucun doute si l’on se souvient que dessiner des jouets était la profession paternelle ; l’origine du jouet demeure inconnue et l’on peut se demander si le père ne l’avait pas conservé depuis son enfance. Le récit s’achève justement avec un retour vers un passé perdu : les dessins « ouvrant (…) le paradis de l’éléphant aux aventures du crayon. » Récit troublant dont on découvre à chaque relecture la profondeur sous l’apparence de la simple évocation d’un souvenir.
Les récits de la collection Ekphrasis, de grande qualité, sont malheureusement peu visibles dans une librairie. On peut les commander (5 €) sur le site : collectionekphrasis.bigcartel.com
Xavier Girard, L’éléphant de mon père, collection ekphrasis, 28 p., 5 €. Cette note a été publiée par Sitaudis le 23 décembre 2017.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : xavier girad, l'éléphant d mon père, ekphrasis | ![]() Facebook |
Facebook |
02/01/2018
Jean-Luc Sarré, Apostumes : recension
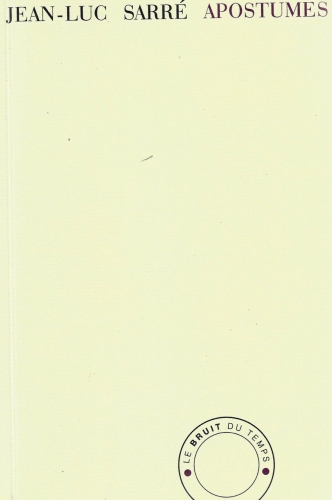
Apostumes ? ce terme médical ancien désignait un abcès, une tumeur et Littré, après deux citations de Saint-Simon avec ce sens, ajoute : « Il faut que l’apostume crève, se dit figurément de quelque chose qui doit éclater ». L’abcès crevé, tout va mieux : il s’agit bien de noter ce qui, à un moment précis, a retenu l’attention, tout en sachant que le fait relevé serait probablement oublié sans le carnet ou le cahier à spirale et le crayon. C’est ce que répète à plusieurs reprises Jean-Luc Sarré, « La note est vouée à la précarité, elle ne vaut même que pour ça. » Il y a chez lui, ici comme dans les carnets précédents(1), une mise à distance de ce qu’il écrit et les manières de le dire sont nombreuses ; apostume, note ou encore apostille, chaque fois c’est leur caractère fragile qui est mis en avant : « Si on peut trouver parfois quelque attrait à ces apostilles, c’est à leur précarité qu’elles le doivent ». On note le refus de la cohérence de l’ensemble, les carnets ne seraient la trace que de ses « velléités » ; rien de construit donc, le lecteur se trouve devant des « fragments » et l’idée même que l’accumulation de ses livres finisse par constituer une œuvre irrite l’écrivain. Alors, pourquoi écrire ? La réponse est proposée dès la première page, établissant ainsi une continuité avec les livres déjà publiés ; il me faut poursuivre, écrit J.-L. Sarré, sinon « je perds pied sans le recours des mots ». Perdre pied, c’est ne plus savoir où l’on en est, et l’écriture donnerait une stabilité manquant par ailleurs, d’autant plus absente qu’une part importante des « apostumes » a été notée à l’hôpital.
Les carnets prennent parfois la forme d’un journal (« Voici quelque temps déjà que je reproche à ce carnet les allures d’un journal ») : pas de dates mais l’ « état précaire » du malade ; ils rapportent alors une expérience inattendue, celle de la clinique, puis de l’hôpital, et de la souffrance. Une opération immobilise J.-L. S. plusieurs semaines et l’oblige ensuite à se déplacer avec une canne, mais il doit retourner vers les médecins, atteint d’un cancer. La lecture, de Loti par exemple, occupe le temps, mais c’est un temps dans un lieu clos où le malade est soumis à un ordre qu’il ne choisit pas, où le regard est borné et se perd — « le retrouverai-je à la sortie ? » La vie dans la chambre fait oublier rapidement ce qu’est l’extérieur, non pas seulement la vie sociale dont J.-L. S. se tient habituellement à l’écart, mais les arbres, les oiseaux, les saisons : c’est cela qui est volé, et la perte importe quand la vieillesse vient, « L’automne, ma saison préférée, est en train de me passer sous le nez sinon totalement sous les yeux. » Les arbres, ce sont le plus souvent ceux qu’il regarde de la fenêtre de son appartement, comme les oiseaux dont certains, mésanges et fauvettes, viennent jusqu’à son balcon pour se nourrir. Cependant, l’hôpital n’est pas un lieu où rien ne se passe.
J.-L. S. observe et écoute les uns et les autres, indigné par les manières de dire de certains médecins, pour qui les malades sont des choses, des « on », agacé de voir un nonagénaire arpenter le couloir d’un pas alerte quand lui marche difficilement, attendri par un monologue de la femme de ménage. Ce qu’il note, toujours, ce sont les "choses vues", entendues, ce qui dans le quotidien n’a rien de remarquable mais fait de la vie ce qu’elle est : de tout cela, rien ne devient souvenir, tout s’échappe, « cimetière sans sépulture ». Aussi recueille-t-il les conversations dans une salle d’attente, les remarques d’une infirmière, les gémissements et les cris d’une folle dans une chambre proche et, chez lui, le mouvement des oiseaux dans un arbre, les changements du ciel, le bruit insupportable d’une tondeuse à gazon ou des cigales et celui, quasi inaudible, d’une épingle à cheveux — bruit qu’il commente avec humour, « Tu n’as pas honte de prendre ton crayon pour souligner une telle banalité ? ». Cet humour aide à s’accommoder de l’invivable ; J.-L. S. reprend l’anagramme "cancre" / "cancer" et passe de "notules" à "nodules", détaille un rêve (celui de ses obsèques), joue sur le sens de "souffler" (« Que fait le vent entre deux bourrasques ? Il souffle un peu ») et, quand il sort de l’hôpital très amaigri, il projette de grossir plutôt que de racheter des pantalons (« Je ne vais tout de même pas, après les médecins, me coltiner les commerçants ! »).
Ce qui résiste à l’oubli, au moins pour un temps, ce sont les livres. Ils sont très présents dans les carnets par le biais des citations qui, presque toujours, sont là comme pour confirmer la justesse du contenu d’une note. Commentant ce qu’il découvre dans le visage d’une femme de service, J.-L. S. recopie un extrait du Miroir de l’âme de Lichtenberg (« Le plus divertissant des surfaces de cette terre est, pour nous, le visage humain »). C’est un des écrivains qu’il affectionne, comme Reverdy, La Rochefoucauld, Perros, Montaigne, Proust, Jules Renard, Scutenaire… Ce qui demeure aussi, d’un livre à l’autre, c’est le sentiment très fort d’être en exil parmi ses contemporains et ce qui l’emporte, c’est l’idée d’avoir « le plus souvent vécu » « à la périphérie ». Il ne néglige pas la compagnie d’amis et son amour des chevaux est intact — même s’ils apparaissent peu dans Apostumes —, mais il se sent et se vit en retrait, à côté de, ce qu’il écrit : « L’évitement serait-il mon truc ? Peut-être bien le truc même de toute une vie ». Ce qu’aurait pu prendre à leur compte presque tous les moralistes.
- 1. Voir les deux derniers, Comme si rien ne pressait (La Dogana, 2010), Ainsi les jours (Le Bruit du temps, 2014)
Jean-Luc Sarré, Apostumes, Le Bruit du temps, 2017, 248 p., 15 €. Cette note a été publiée dans Sitaudis 28 novembre 2017.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, apostumes : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2017
revue KOSHKONONG : recension

C’est toujours avec le même plaisir que l’on découvre un nouveau numéro de la revue dirigée par Jean Daive. En page de couverture débute, cette fois, la traduction d’un poème d’Elizabeth Willis par Martin Richet. La seconde strophe commence par « la première phase est le chaos » et le poème semble en effet inorganisé, incohérent par la succession d’éléments disparates — dès l’ouverture du poème, passage de l’insomnie à l’inquiétude et aux gens normaux pour finir par « que faire ». Mais le poème n’est pas une liste, il explore avec des formes variées tout ce qui concerne la vie humaine et ce qui paraît d’abord obscur pour le lecteur s’organise. On sait qu’il y a toujours un commencement et une transformation : « D’abord la pupe, puis les ailes » ; cependant, à côté de ce qui sera reçu sans discussion — l’amour, le plaisir, le travail, le rêve, la langue, etc., composantes de la vie —, il y a aussi une indécision à propos de nombreux points, et le poème joue avec ce qui ne peut être résolu qu’avec un choix idéologique. Joue : Elizabeth Willis introduit un humour décapant, par exemple dans la série « Qu’est-ce qui vint en premier », avec
Qu’est-ce qui vint en premier les pompiers ou les flics
Qu’est-ce qui vint en premier la conquête ou la découverte
La fourchette ou la cuillère
L’accusation ou l’alignement
Le FBI ou la CIA
"Intrigue "se termine par des questions au lecteur avec ce dernier vers, « Prenez tout le temps que vous voudrez. » L’inventivité de ce poème mise en valeur par une excellente traduction * fait souhaiter qu’un recueil d’Elizabeth Willis soit enfin traduit en français. Martin Richet, traducteur aussi d’autres poètes américains, comme par exemple Gertrude Stein, Robert Creeley, Robert Duncan, donne en quatrième de couverture, titrés "Aide-mémoire", des souvenirs à propos du poète Robert Grenier (qu’il a traduit).
La livraison comprend également un long poème, "D’Albuquerque", de Stéphane Korvin dont on a pu lire plusieurs recueils en 2017, et des poèmes de Claude Royet-Journoud : la revue accueille ainsi à la fois un auteur qui se construit et, fidèle de Koshkonong, un autre qui ne cesse d’inventer. On s’attardera sur les quatre pages de la philosophe Michèle Cohen-Halimi (qui a notamment écrit à propos de la poésie de Royet-Journoud), elle aussi souvent au sommaire de Koshkonong. En suivant l’histoire de la revue néerlandaise De Stijl, publiée de 1917 à 1928, elle donne une lecture de son rôle dans l’histoire de l’art et des idées. De Stijl fut créée par Theo Van Doesburg après sa rencontre avec un architecte familier de plusieurs peintres, et avec Mondrian. Dès l’origine, écrit M. C.-H., « La loi de la revue est le défi, celui de produire une nouvelle collectivité et un idiome universel. » Mondrian est une figure de défi, lui qui vise à « amorcer une réorganisation de l’espace », ce qui sous-tend sa peinture et qu’il défend dans ses articles. La revue ne publie pas que des Néerlandais, loin de là, et elle reçoit des contributions de peintres et écrivains italiens, d’un compositeur américain, d’un architecte australien, d’un écrivain russe, également du cinéaste allemand, Hans Richter, dont les films sont « pionniers de l’abstraction cinématographique » et qui met en relation Van Doesburg et Kurt Schwitters. À la suite d’un descriptif précis, M. C.-H. détache les positions de De Stijl ; citons : 1. Pour la revue, « Le centre de gravité de la pensée passe hors des corps individués, hors de l’espace illusoire où se discernent un premier et un second plan » ; 2. La volonté de « la synthèse néo-plastique des arts » de « gagner la totalité du monde », d’introduire dans l’époque « la force destructive-constructive de l’art réalisé, c’est-à-dire devenu réalité » marque la limite de l’utopie. Article à lire et relire.
* On pourra trouver l’original sur la Toile et juger de la qualité de la traduction.
KOSHKONONG, n° 12, éditions Éric Pesty, 2017. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 17 novembre 2017.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : koshkonong, n° 12, éditions Éric pesty, jean daive, elizabeth willis, michèle cohen-halimi | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2017
Jean-Baptiste Cabaud, La folie d'Alekseyev : recension
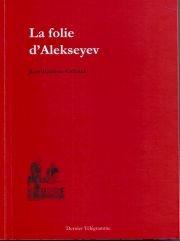
Le revers de la quatrième de couverture précise que Jean-Baptiste Cabaud choisit notamment pour lieux de ses récits « des territoires et espaces isolés (zones arctiques, paysages de montagne, vide stellaire…) », et La folie d’Alekseyev se passe en effet principalement en Sibérie et près du pôle Nord. Le première partie du livre concerne l’Union soviétique du goulag, les deux suivantes, très liées, l’ingénieur Alekseyev et son assistant Evguéni, cette fois dans la période d’après la seconde guerre mondiale — une date est donnée, 1957 —, mais la relation s’étend sur plusieurs années. Récit historique, donc ? ce n’est pas si simple, même si les éléments relatifs aux lieux et aux faits qui s’y sont déroulés sont précisément décrits ou rapportés, et l’auteur pratique la langue russe, ce qui facilite la connaissance des informations.
Dans la première partie, "Petites taïgas", alternent des ensembles sur les lieux, la saison et des tombeaux, c’est-à-dire des proses à la mémoire d’un écrivain. Il s’agit d’abord de la steppe sibérienne, paysage « atone immobile », « univers plan » où vivent les détenus des camps de concentration. C’est dans cet espace immense qu’est la Sibérie qu’a été créé le goulag, camp qui, par nature, ne dure pas : les détenus y meurent de froid, de faim ou d’épuisement ; leur présence fait que la Sibérie est « grouillante, effervescente », « immobile mouvement, mouvement permanent de relégation ». L’activité y est intense, cependant tout se passe comme si aucun sujet humain n’y prenait part, ce que Cabaud donne à comprendre avec une liste de verbes à l’infinitif : les détenus, dans la forêt et la neige, ont sans fin à « extraire, scier, excaver, débarder, fouir, déraciner, effondrer, ouvrir, forer, arracher, souder, terrasser ». Il n’y a pas d’ordre dans cette suite, toutes ces tâches sont accomplies quasi en même temps par la multitude des prisonniers, qui ne verront rien de ce qu’ils construisent, villes ou voie de communication.
En hiver, la saison la plus longue qui emporte nombre de détenus, les travaux s’effectuent sans le matériel le plus simple, par exemple la neige s’enlève sans pelle ; on retrouve dans la représentation de la vie quotidienne dans cette « éternité sibérienne » ce que les témoignages des rescapés du goulag ont appris à qui voulait savoir. Quelques noms de ces lieux de mort sont donnés, la Kolyma, les îles Solovski, la Vichéra — on relie deux mers, on extrait le minerai, on construit une ville. « Tout est loin. Rien ne perturbe l’immense tranquillité de [ces lieux] » ; ce qui les caractérise pour les détenus, c’est l’absence d’avenir, ce qu’ils y apprennent, c’est « comment s’effondrent les visages ». Dans le dernier texte de cette partie, un narrateur s’adresse à l’un d’eux et lui indique quelle sera sa fin : « Une plaque à ton pied matriculé tu auras, camarade, et couché sous ton poteau de bois tu seras. »
Les tombeaux, hommages à des écrivains soviétiques détruits par le système, ne sont pas des poèmes, ils relatent plutôt quelques aspects de leur vie. Anna Akhmatova voit tous ses proches fusillés ou envoyés dans des camps, Khlebnikov succombeen 1922 à la gangrène, Mandelstam meurt de froid et de faim en Sibérie, seul Chalamov survit à des années de Kolyma et raconte ce qu’il a vécu. : le tombeau qui lui est consacré a pour thème la manière dont le pin nain se prépare à résister au froid de l’hiver. À côté d’un portrait terrible de Mandelstam imaginé dans ses derniers jours, le lecteur lit une allusion à son œuvre, avec « comme un bruit dans le temps ». Un autre tombeau, celui d’Essenine, mort mystérieusement en 1925, est présent dans la seconde partie et la relie de cette façon aux "Petites taïgas" ; Cabaud y cite un de ses poèmes en russe et en donne une traduction. Enfin, un tombeau d’un général du début du xixème siècle, Davydov, est en rapport avec Alekseyev : pour tous deux, boire beaucoup de vodka et fréquenter les prostituées font partie de la vie.
Le titre de la seconde partie, "Samokhodnaya Model SM.0", évoque un modèle d’avion, l’ekranoplane, qui se déplace sur un coussin d’air et a été conçu par Alekseyev : c’est de ce personnage, qui a existé (1916-1980), que des fragments de vie sont racontés. Qu’il s’agisse d’une fiction ou que l’ensemble repose sur une documentation importe peu : le récit s’achève avec le premier essai sur une grande distance d’un prototype qui se perd dans le froid sibérien avec son pilote, l’assistant de l’ingénieur, Evguéni ; la dernière partie imagine ses réflexions, notamment quand l’engin volant quitte la taïga et qu’il vole dans « l’immensité d’une steppe vide ».
Plus de la moitié du second ensemble est consacré à Alekseyev qui se raconte ; sa folie est entière dans son projet : observant la lente descente d’une feuille, planant grâce à la petite quantité d’air restée sous elle, il pense que l’on peut construire un engin volant qui utiliserait cette caractéristique. Pensée en accord avec les convictions qu’il expose : pour lui, le ciel est « une perle de pouvoir, militaire, commerciale » et il croit toujours, dit-il, en « la nouveauté, l’imagination, l’expérimentation, la découverte » au service de son pays. En même temps, ses recherches s’effectuent dans un lieu qui n’est sur aucune carte, lieu secret autant absence de lieu que la steppe sibérienne. Les seuls dérivatifs, ce sont la vodka et la prostituée, Svetlana (hasard ? c’est le prénom de la fille de Staline), , qui ne peut avoir d’autre activité parce que fille d’un « ennemi du peuple »… Alekseyev n’est pas dupe du vide de sa vie et cherche à l’oublier, ce que, ivre, il dit à la jeune femme : « Buvons ensemble, que s’arrête un instant le monde et rencontrons tout à l’heure dans la nuit des corps ».
On regrette quelques développements à propos de l’histoire de la Russie qui, s’ils donnent un arrière-plan, ressemblent trop à une leçon, tout comme ceux sur l’histoire de l’aéronautique avec le rôle de Konstantin Tsiolkovski. Un rêve qui ne peut s’accomplir qu’en acceptant l’enfermement, des voix que l’on fait taire quand elles s’écartent de la norme du pouvoir : les deux motifs sont liés par le lieu (la Sibérie), mais les uns pour vivre ont besoin de l’alcool (Alekseyev, Essenine) alors que les autres ont compris que l’on doit vivre la liberté de l’esprit, qui suppose comme le dit Evguéni, la « victoire sur la peur ».
Jean-Baptiste Cabaud, La folie d’Alekseyev, Dernier Télégramme, 2017, 80 p., 12 €.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-baptiste cabaud, la folie d'alekseyev, mandelstam, akhmatova, khlebnikov, chalamov, kolyma | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2017
Dominique Maurizi, Vacarmes (recension)
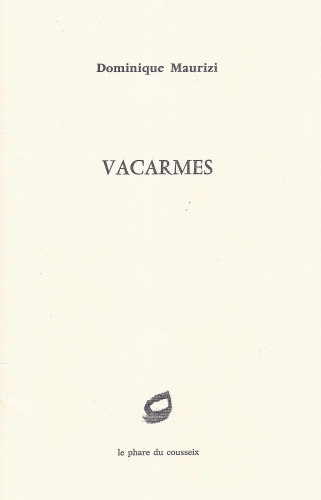
Vacarmes comprend des poèmes en prose et de courts poèmes en octosyllabes, extraits d’un recueil à paraître. Comme dans les autres recueils de Dominique Maurizi, l’ensemble forme un récit, conduit par un "je" toujours présent. On sait que le mot "vacarme" s’emploie pour un grand bruit, mais il peut aussi désigner une violente protestation ; les deux sens sont mêlés dans l’usage qui en est fait au pluriel. Vacarmes nombreux qui suscitent l’écriture : il y a d’abord des vacarmes dans le corps, venant des airs (« l’oiseau qui claque des ailes dans mon corps ») ou de la mer, mais "mer" appelle "mère" (« Est-ce la mer que tu entends en moi ? »). Tout aussi présent sont les vacarmes de l’enfance (« les bruits fous de l’enfance ») qui font revenir les moments toujours vifs de l’abandon, celui du père qui n’est que dans les mots (« nous ne nous sommes jamais rencontrés que dans mes phrases »). D’autres vacarmes interdisent à toute vie de s’épanouir, parce qu’impossibles à faire disparaître, ceux des morts dont les « bruits trépignent dans mon sommeil ».
Ces vacarmes suscitent le retour de « ça parle », de l’écriture ; ils en sont la matière même, motifs qui nourrissent la vie intérieure, qui emplissent le temps de vivre. En même temps ils mènent à la rupture avec les bruits du monde, du moins avec ce qui risquerait de troubler le monologue intérieur (« Je voyage dedans ») qui passe par l’écriture la nuit. Si, au fil du texte, des figures apparaissent, comme celle du père, il ne s’agit que de mots, des pronoms derrière lesquels aucun sujet n’est visible : vous, toi, elles, les.
Cependant, dans un poème en vers comptés où est dit le retrait du "je" (« chacun seul »), est exprimée une relation privilégiée à Emily Dickinson, ou plutôt à un aspect de sa poésie. Comme pour mimer un dialogue entre elle et la poétesse américaine, Dominique Maurizy cite les deux premiers vers d’un poème célèbre, en en traduisant en français un fragment, : « I’m Nobody ! Qui es-tu ? Are you — Nobody — Too ? ». Citons la première strophe entière :
I’m Nobody ! Who are you ?
Are you — Nobody _ too ?
Then thre’s a pair of us !
Dont tell ! they’d banish us you know !
Je ne suis personne ! Et vous ?
Personne — non plus ?
Alors nous faisons la paire !
Chut ! on nous bannirait — savez-vous ? (1)
Une autre écrivaine apparaît dans Vacarmes, dans le poème de clôture. Le choix est significatif puisqu’il s’agit d’Ingeborg Bachmann qui, d’un point de vue féministe, entreprit de renouveler la langue allemande. C’est aussi dans ce poème de clôture que sont évoqués des éléments de la nature (mer, eau, fleurs, branche d’un arbre) ; ils sont « donnés » à Bachmann par un "je" qui dit être née par la « voix du poème », et à la poétesse est associé le prénom de Celan, avec une allusion à sa volonté de rénovation de l’allemand (« pour Lenz, pour Paul et la montagne »).
Emily Dickinson et Ingeborg Bachmann, deux pôles différents de l’écriture, deux voies/voix dont on lit des échos chez Dominique Maurizy qui, d’un recueil à l’autre, pose la question de la création poétique à partir de la lente construction d’un univers particulier. Lisons maintenant Vacarmes avant de le retrouver intégré dans Plein feu, à paraître.
———————————————————————————————————
- Emily Dickinson, Y aura-t-il pour de vrai un matin, édition bilingue ; traduit et présenté par Claire Malroux, José Corti, 2008, p. 252-253
Dominique Maurizi, Vacarmes, le phare du cousseix, 2017, 16 p., 7 €. Cette note d lecture a été publiée sur Sitaudis le 5 novembre 2017.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique maurizi, vacarmes (recension) | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2017
Georges Perros, Henri Thomas, Correspondance 1960-1977 : recension
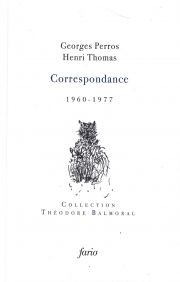
Une bonne partie de la correspondance de Georges Perros (mort en 1978) a été publiée à partir de 1980 et son œuvre est rassemblée en un volume (Quarto / Gallimard, novembre 2017) préparé par Thierry Gillibœuf, à qui l’on doit déjà l’édition de la correspondance avec Jean Paulhan (éditions Claire Paulhan, 2009). Il est bon de lire les lettres de G. P. échangées avec Henri Thomas (1912-1993), dont les poèmes, romans, récits et essais — une quarantaine de volumes —, presque tous chez Gallimard, n’ont pas encore été rassemblés.
Henri Thomas enseignait la littérature française aux États-Unis, à Boston, quand il a reçu Papiers collés à leur parution en 1960, second livre publié par G. P. après Poèmes bleus, tous deux dans la collection "Le Chemin" fondée par Georges Lambrichs chez Gallimard. Cet envoi marque le début de la correspondance entre les deux écrivains. Ils se rencontrèrent peu, quelquefois à Paris, H. T. différant à plusieurs reprises un séjour à Douarnenez où vivait G. P. ; il se demandait en 1964 quand il ferait le voyage et écrivait en août 1967, « Douarnenez me reste inconnu pour un temps encore », et six ans plus tard, « Je fais toujours le songe d’aller vous voir à Douarnenez ».
Il s’y est enfin rendu en 1975, après que G. P. eut appris qu’il était atteint d’un cancer de la gorge. Cette année-là, G. P. avait obtenu une année sabbatique. Il a subi une ablation de cordes vocales à Marseille, où il était soigné ; rééduqué, comme d’autres malades, pour que soit rétablie une forme élémentaire de communication, il racontait les tentatives « pour retrouver une parole œsophagienne », en concluant « On s’est parfois plaint de ma parole. On pourra maintenant s’énerver de mon silence. » H. T. est revenu à Douarnenez en décembre 1977, un mois avant la mort de son ami, le 24 janvier 1978. L’amitié entre eux s’est d’abord fondée sur la reconnaissance réciproque d’une écriture. G. P. se retrouvait dans les études critiques de H. T., celles par exemple de La Chasse aux trésors dont il écrit, « Vous avez la dureté des poètes. Et leur tendresse » ; recevant Le Parjure, il y lit « ce déchirement d’être là plutôt qu’ailleurs » et regrette de si peu connaître son auteur, ajoutant « Je me sens moins seul, à vous imaginer ».
Tous deux avaient également des manières analogues de voir et de penser les choses du monde. Les considérations de G. P. sont d’un homme sans illusions, « La vie, ça tient dans un dé à coudre. Mais, faut se taper tout le reste », et les conclusions de H. T. à propos de son activité ne le sont pas moins quand il confie, « écrire est mon seul mode d’être en vie ». La proximité de vues n’a pourtant conduit que fort tardivement au tutoiement et ce n’est qu’à partir de juillet 1975 qu’il est devenu de mise, G. P. sollicitant alors un article sur Corbière pour une revue amie, Ubacs.
Leur correspondance a été relativement peu importante : 32 lettres de G. P., 26 de H. T., aucune par exemple entre 1964 et 1967, entre 1969 et 1972, peut-être parce qu’aucune n’a été retrouvée pour ces périodes. La maladie de G. P. change la relation épistolaire, puisque 16 lettres ont été écrites par l’un et l’autre de 1976 à décembre 1977. Comme plusieurs de G. P., celles de H. T. ont été alors plus développées ; il rapportait, notamment, les déboires amoureux de sa fille en Grande-Bretagne, donnait des nouvelles de la Nouvelle Revue Française (Lambrichs en a pris la direction en 1977), ou brodait autour des aventures d’un chat qui, recueilli dans son appartement et apporté en banlieue chez Pierre Leyris, avait finalement disparu — anecdote que connaissait G. P. : elle lui avait été relatée par Paul de Roux. L’amitié passait par la correspondance, dont H. T. souligne régulièrement l’importance pour lui ; ainsi : « Je reçois tes deux lettres qui font ma joie. Il me semble que je vis, ça ne m’arrive pas si souvent » (25 février 1977), et un peu plus tard, il s’émeut de « cette flambée d’amitié, qui me vient de toi, et me fait croire à la vie. C’est plus étrange que je ne le dis là » (8 mars 1977). Mais l’amitié se manifestait aussi autrement ; invité à l’émission de Claude Royet-Journoud, "Poésie interrompue »", G. P. lit des poèmes de H. T. et il écrit, en 1977, la 4ème de couverture de La Nuit de Londres repris dans la collection "L’imaginaire".
On lira la préface de Jean Roudaut *, qui définit finement sa relation aux deux hommes, « nous nous plaisions non par la similitude de ce que nous étions mais de ce qui nous manquait ». Dans la postface il propose un portrait de l’un et l’autre ; ils sont suivis d’une évocation de G. P. par H. T., parue dans la revue Ubacs en 1984, et d’un extrait des Papiers collés, 2 (1973) consacré à H. T. L’établissement d’une telle correspondance est affaire délicate : des lettres ne sont pas datées, les événements passés sont plus ou moins compréhensibles, etc. ; Thierry Bouchard fait revivre ces lettres sans les surcharger d’explications mais, toujours précis, il suggère par ses notes d’autres lectures. Cette édition est une réussite qui complète heureusement les volumes de correspondance déjà parus de Georges Perros — on ne connaît qu’un Choix de lettres de Henri Thomas (Gallimard, 2003).
Georges Perros, Henri Thomas, Correspondance, 1960-1977, collection Thierry Bouchard, Fario, 2017, 166 p., 15 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 7 novembre 2017
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, henri thomas, correspondance, 1960-1977 | ![]() Facebook |
Facebook |
18/11/2017
Bernard Groethuysen & Alix Guillain, Lettres 1923-1949 à Jean Paulhan & Germaine Paulhan
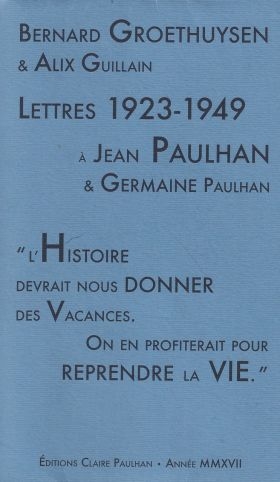
Les noms de Bernard Groethuysen et d’Alix Guillain, tous deux un peu oubliés aujourd’hui, précèdent ceux de Jean et Germaine Paulhan : leurs lettres, surtout celles du premier nommé, constituent l’essentiel de la correspondance, tout simplement parce que celles des Paulhan n’ont pas été retrouvées. Groethuysen (1880-1946), philosophe érudit, Allemand naturalisé français, était un passeur soucieux de faire connaître ce qui lui semblait important bien au-delà de son domaine. Il a notamment publié de son vivant Origines de l’esprit bourgeois en France et son Anthropologie philosophique, posthume (1953), a été rééditée dans la collection Tel de Gallimard. Alix Guillain (1876-1951), sa compagne, traductrice entre autres de Rosa Luxembourg, adhérente de la première heure au Parti communiste, travaillait notamment à la réunion de documents pour Moscou. Tous deux étaient proches des Paulhan : l’un commence ses lettres par « Cher Paulhan » avant de passer à « mon cher ami », « mon cher Jean », pour l’autre Germaine Paulhan est « mon petit ».
Groethuysen enseignait à Berlin ; il venait souvent à Paris mais ne s’est établi définitivement en France qu’en 1932, comprenant que la situation politique en Allemagne se dégradait rapidement ; il aidera d’ailleurs ensuite des réfugiés allemands, comme la photographe Gisela Freund. Pendant ces années, il demandait à Paulhan de lui écrire plus souvent, par exemple en 1926 : « Ne gardez pas tout pour vous tout seuls, mais donnez-moi un peu de votre vie, puisque je vous aime bien tous les deux. » Il souffrait beaucoup de n’avoir pas suffisamment d’échanges avec son ami, terminant une lettre, « Il est temps qu’on se revoie pour parler de tout cela » (1929).
Collaborateur de la Nouvelle Revue Française dès 1920, donc en même temps que Paulhan qui dirigera la revue à partir de 1926, il a été l’un des fondateurs de la Bibliothèque des Idées de Gallimard. Tous deux ont par ailleurs largement contribué à l’élaboration des sommaires des revues luxueuses qu’étaient Commerce et Mesures, financées par des mécènes, et les lettres de Groethuysen sont souvent relatives à ces travaux de revuiste. Il donne par exemple en 1927 un compte rendu des Douze petits écrits de Ponge parus l’année précédente, où il écrit : « Une parole est née dans le monde muet » ; il sollicite l’avis de son ami à propos d’une note sur Les Conquérants de Malraux. Plus largement, dans une lettre (21 septembre 1938), il aborde toute une série de sujets : travaillant à un sommaire de Mesures comprenant plusieurs écrivains allemands (Hölderlin, Möricke, Musil, Döblin), il le note et le commente pour Paulhan ; il passe ensuite à une rubrique de la NRF (L’Air du Mois), puis aux livres que Paulhan lui a mis de côté, à l’enterrement de Jean Longuet (petit-fils de Karl Marx), à sa relation à Sartre — « Fascination d’un dialogue » — qu’il a rencontré en 1926.
La correspondance entre les deux amis porte également sur des questions philosophiques (vérité et sincérité, esprit critique et esprit de négation) et, en lien avec Les Fleurs de Tarbes en cours d’écriture sur des problèmes de langage, notamment sur la relation entre pensée et parole. Un autre objet de débat qui revient dans la correspondance pendant des années, porte sur l’opposition entre singularité et totalité ; B. G. rouvre cette question d’une manière humoristique en 1946 après la publication par J. P. de ses Entretiens sur des faits divers (1945). Ce fut sa dernière lettre ; venu au Luxembourg pour y soigner un cancer du poumon, il meurt le 18 septembre de la même année ; A. G. décrit à J. P. les souffrances des derniers jours de son compagnon.
Les lettres d’Alix Guillain à J. P. sont d’une militante qui défend les positions de Moscou, quelles qu’elles soient, et qui ne comprend pas les doutes de son correspondant sur le bien-fondé de la politique soviétique ; en juillet 1939, donc un peu avant la signature du pacte germano-soviétique, elle lui fait la leçon : « jamais elle [l’URSS] n’a été pour une guerre de conquête et jamais cela ne sera, vous le savez bien d’ailleurs », et un peu après : « Vous ne voulez croire à Rien, Jean, et vous aimez à exercer votre esprit dissolvant sur les idées ». Aveugle sur la politique de Staline, elle reste ensuite fidèle aux choix du Parti communiste français qui se cherche une virginité en boycottant tout écrivain qui ne s’est pas élevé contre l’occupant pendant la guerre ; elle écrit à J. P. en 1947 pour interdire la publication d’un article de B. G. dans le n° 2 des Cahiers de la Pléiade à cause de la présence d’un texte de Marcel Jouhandeau. J. P. lui rappelle que B. G. n’y aurait pas été opposé et rompt avec elle, qui en est très affectée.
Des annexes rassemblent des hommages à B. G. (de Paulhan, Jouve, Malraux, Cassou, Ponge, etc.) et une biographie d’A. G. par Bernard Dandois. Comme tous les livres publiés aux éditions Claire Paulhan, cette correspondance est accompagnée de notes précieuses : elles rétablissent le contexte des lettres, développant ce qui n’est qu’allusif. La documentation photographique, abondante (une quarantaine de reproductions) offre des images de chacun des correspondants à différents moments de leur vie, plus riche pour B. G. On y voit par exemple les participants dans les années 1920 aux décades de Pontigny, qui ont précédé les colloques de Cerisy, ou le groupe de la NRF en 1937 (Audiberti, Supervielle, Calet, Malraux,
Bernard Groethuysen & Alix Guillain, Lettres 1923-1949 à Jean Paulhan & Germaine Paulhan, édition préparée et commentée par Bernard Dandois, éditions Claire Paulhan, 2017, 240 p.
Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 27 octobre 2017.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
25/08/2017
Paul de Roux, Un rêve : recension
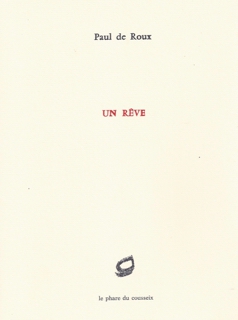
Paul de Roux a principalement publié des ensembles de poèmes ; ses Carnets, vrai journal de bord recouvrant les années 1974 à 2005, constituent l’essentiel de son écriture en prose (mais s’y lisent aussi des poèmes), avec un roman (Une double absence, 2000) et une étude sur Simon Vouet (Visites à Simon Vouet, 1993). Il a en outre donné, comme le précise l’éditeur, en 1977, dans la revue Port-des-Singes fondée par Pierre-Albert Jourdan, une prose brève, sorte de fable qui, accompagnée de son portrait dessiné par son fils, était restée inédite.
Un narrateur rapporte un rêve dans lequel, devenu à sa grande surprise enseignant, il transmet à de jeunes auditeurs attentifs, non des éléments du bagage scolaire, mais des conseils pour bien vivre : la vie est présentée comme un parchemin qui « se dévide » et chacun risque d’être tenté par des frivolités au lieu de s’en tenir à la voie proposée par les « belles lettrines enluminées ». La leçon est suivie par un public attentif, à l’écoute : « mine recueillie », « yeux (…) limpides », « tête de côté ».
Cependant une double rupture intervient dans le récit du rêve : ces enfants aux « âmes pures et candides » qui composent la classe sont des ânes, de vrais ânes aux longues oreilles et, par ailleurs, le narrateur avoue être mal à l’aise de n’avoir aucun titre pour exercer le métier d’enseignant. On connaît quel caractère négatif a, couramment, la figure de l’âne — bêtise, ignorance, obstination, etc. ; cependant, c’est à une toute autre tradition que renvoie la fable ; à la demande du narrateur, trop décontenancé pour continuer son discours, un des élèves prend la parole : les ânes représenteraient les « bons sentiments » du rêveur, mais qui n’auraient pas abouti à des actes dans la vie réelle. Aussi les ânes-sentiments seraient voués à se renforcer sur les bans de l’école pour être efficaces… sous la forme de chèvres.
Aucune leçon à lire dans cette énigme qui clôt le récit, si ce n’est peut-être que le lecteur retourne au parchemin et à la difficulté de lire et comprendre les « lettres enluminées », celles de la vie, celles du rêve..
Paul de Roux, Un rêve, le phare du cousseix, 2017, 8 p., 10 €.
Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudis le 9 août 2017
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, un rêve, école, âne, sentiments | ![]() Facebook |
Facebook |
27/06/2017
Françoise Clédat, À ore, Oradour : recension
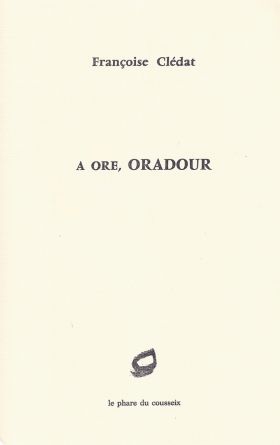
Les camps d’extermination ont été motif à écriture, témoignages de ceux et celles, peu nombreux, qui ont survécu, parmi d’autres Robert Antelme, Charlotte Delbo, Primo Levi. La génération suivante a recherché des traces, par exemple Georges Didi-Huberman (Écorces, 2011) ). Les massacres localisés dont été responsables les soldats nazis pendant leur fuite, s’ils ont laissé des plaies vives dans les mémoires, n’ont pas suscité beaucoup d’écrits hors ceux des historiens. Pour Oradour, on se souvient du poème de Jean Tardieu, écrit en septembre 1944, publié dans des journaux clandestins, puis repris en 1947 dans Jours pétrifiés ; pour la première strophe :
Oradour n’a plus de femmes
Oradour n’a plus un homme
Oradour n’a plus de feuilles
Oradour n’a plus de pierres
Oradour n’a plus d’église
Oradour n’a plus d’enfants
Revenir aujourd’hui sur cette tragédie ne pouvait être par la seule évocation des faits. Françoise Clédat part d’abord du nom de lieu, de son étymologie et de ce qu’elle suggère : Oradour = oratoire, donc lieu de prière, de retenue, de méditation, de silence : tout ce qui fut rompu par les soldats allemands. Elle s’attache également à la lettre initiale du nom, O, à sa forme, et construit le poème avec des mots liés au regard (œil, oculaire, orbite), donc à l’ouverture sur le monde ; s’ajoute la bouche, celle ouverte des enfants qui crient : on n’oublie pas que 207 enfants ont été brûlés vifs.
Maintenir béant
l’effacement
de cette bouche qui crie
Les enfants ont appris avant tout savoir ce qu’était l’approche de la mort, ce qui ne devrait être que savoir de vieillard : Françoise Clédat cite quelques vers des Tragiques d’Agrippa d’Aubigné, vison crépusculaire du « corps ruiné de bresches ».
Une second poème, "Oradour (2)", s’ouvre en suivant le déroulement de la tragédie du 10 juin 1944, en rappelant le partage opéré entre les hommes parqués dans une grange, les femmes et les enfants enfermés dans l’église. L’essentiel est consacré aux enfants, avec focalisation sur ce qui pouvait être entendu (« dernier cri ») et vu, la « dernière image » du corps « brûlé vif » — plutôt : ce qui aurait pu être entendu et vu par la mère de chacun des soldats. De là, la reprise de la lettre O, cette fois initiale de mots de sens opposés à ceux du premier poème : ils connotent la violence, la mort (Offense, Occis) ou la sortie de ce qui est considéré comme humain (Ogre, Obscène, Ordure), ils conduisent à évoquer tous les massacres perpétrés par les hommes, avant et après Oradour : d’où une suite de noms de pays.
La durée du massacre lui-même est hors de toute description, les actions des soldats semblent hors du temps et Françoise Clédat accumule les noms et les groupes de noms =
Fagots paille foin sur les corps
Fagots paille foin dans l’église
Grenades à main produits incendiaires
Embrasement
Embrasement
Fournaise
Cris dans la fournaise
Le massacre d’Oradour, comme tout massacre, déborde toute compréhension et exclut d’être décrit avec des verbes, qui supposent un sujet humain ; il ne peut y avoir que des « Non-dits d’indicibles détails » et ce qui était visible après ne peut être aujourd’hui restitué que par l’énumération, « Ruines fumantes / Maisons effondrées (étages et toits) / etc. » ; seuls ceux qui ont vu de leurs yeux « Ont raconté décrit fait récit /…/ (Ont raconté l’odeur) ». Les tâches à entreprendre après la destruction des choses et des humains prennent aussi la forme de l’énumération, série sous la forme infinitive du catalogue ; la dernière : « — compter (long difficile) recompter 642 victimes 246 femmes 207 enfants 10% identifiés ».
Un dernier poème dit encore que « ce qui s’écrit échoue à écrire ». C’est pourquoi les vers s’organisant à partir des mots "vide", "absence" et d’autres qui disent le vide ou l’absence du vivant, du jour, du lieu : sans, ruines, noir, obscurcissant, néant, destruction. Ce que dit enfin Françoise Clédat, c’est que les traces maintenues du massacre sont monument pour que la mémoire vive.
Françoise Clédat, À Ore, Oradour, le phare du cousseix, 2017, 16 p., 7 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 8 juin 2017
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françoise clédat, À ore, à oradour | ![]() Facebook |
Facebook |
20/06/2017
Jean-Pierre Chevais, Le temps que tombent les papillons : recension
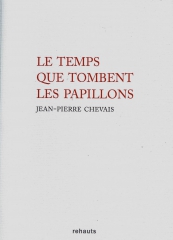
Perros, dans ses Papiers collés, notait : « Les poètes écrivent mal. C’est leur charme. Si tout le monde écrivait comme Anatole France, lire ne serait plus et définitivement qu’une entreprise maussade. Ils écrivent mal, n’ayant qu’un obstacle mais cet obstacle impossible à franchir. Ils le retrouvent partout. C’est le mot. »1 Le mot, les mots, c’est le matériau de la poésie de Jean-Pierre Chevais.
Le livre est divisé en six ensembles, et le premier est fondateur : un seul poème, qui s’ouvre par : « Maman a / vant elle / pelait les mots » ; si l’on pèle restent des pelures et, à travers les images des pelures utilisées comme bandages, je lis l’apprentissage de la langue, de la langue maternelle. La mère disparue, « les papillons a /lors ont / commencé » : vers sibyllins, comme l’est le titre, si l’on oublie que le papillon symbolise le changement ; dans l’usage, c’est la continuelle transformation des sens, non maîtrisable, et une absence de relation entre les mots et les choses : arbitraire analogue aux mouvements du papillon. Ou mots comme la poussière, ainsi chez Inger Christensen2,
quand la poussière
se lève un peu
elle dit que c’est
l’envol des pa
pillons du monde
moi quand je
souffle sur les mots
ça tient pas ça
bat des ailes
c’est bien la preuve
pas dur d’en at
trapper trois quatre
avant qu’ils ne re
tombent
Et il faut ajouter avec Mahmoud Darwich que « la trace du papillon / ça s’efface pas ».
Les mots sont bien un « obstacle impossible » et, en même temps, la condition pour la poésie de dire ce qui échappe au sens. Il est loisible de passer d’un mot à un autre, par exemple par l’étymologie ou par les jeux de ressemblance. Le nom de Ramuz évoque-t-il par le latin la branche, alors peut-on dire « Ramuz c’est /un endroit feuillu / ça fait drôle de / le voir avec / des feuilles autour / des feuilles avec / dessus des mots » ; le nom la Lucania venu de Carlo Levi (dans Le Christ s’est arrêté à Eboli), entraîne le mot "lucane", sans qu’il y ait dans la réalité un rapport quelconque entre le lieu et l’insecte. Voilà bien une leçon, « Les mots il faut / pas trop mettre / les doigts dessus », leçon que le poète ne suit évidemment pas.
Un mot en appelle un autre et l’on peut aussi remonter dans le temps pour prendre en compte les mouvements de la langue ; est ainsi recopiée et datée la première forme de dégringoler, "desgringueler, 1595", ce qui suscite « je dévale (…) la gringole », jeu avec l’étymologie, puisque dé- indique bien dans le verbe le point de départ. Les liaisons qui s’établissent entre les mots sont complexes, d’autant plus que dans certains cas « il ne se passe rien » ; par ailleurs, la langue de l’écriture n’est plus aisément lue dans la mesure où, affirme le je, « j’/ écris dans / une langue / mi / morte ». L’affirmation paraît paradoxale, le vocabulaire employé appartenant, comme on dit, à un registre courant, et les constructions grammaticales mimant parfois ce que l’on attribue à l’oral, avec par exemple l’élision du ne de la négation (« ils aiment pas ») ou l’usage répété de ça. Mais les mots « fendent cassent » et les vers (rarement plus de trois syllabes) se déglinguent, jusqu’à ne pouvoir être articulés :
Je préfèrerais pas
tout
compte fait sur
vivre à
mon c
orps il est d
ans un é
tat
on me dit ç
a
(…)
On (sans que l’on sache qui est ce "on") reproche par ailleurs au je ces vers trop courts, ce qui accuse démesurément la part du blanc dans la page ; la réponse introduit un autre aspect du livre, l’humour : « ça je sais / je n’ / arrive / pas ». Lorsque viennent dans un poème « bethsabée au bain » et « diane au bain », ce sont moins les allusions mythologiques qui importent que la possibilité, ensuite, d’écrire « tout tombe à l’eau » et de signaler que tout part « à vau-l’eau ». Jeu avec la culture, certes encore quand, dans une série de poèmes s’ouvrant par « Je préfèrerais pas », l’un d’entre eux se poursuit par « qu’on m’ap / pelle bartle /by » : il faut alors se souvenir du personnage de Melville et de son "I would prefer not to".
Mais les allusions culturelles, si elles ont pour fonction de lier le poème à l’histoire, appartiennent surtout, me semble-t-il, au vaste réseau d’associations dont font partie les mots de la langue et qui ne peut être épuisé. Mots de la langue qui sont ancrés dans le temps, et de même les noms de personne : écrire des noms comme "Béatrice" ou "Bérénice", c’est encore évoquer des livres, c’est-à-dire des relations dans l’Histoire. L’épaisseur du temps rend difficile l’appréhension de ce que chacun a vécu, et s’il est malaisé d’écrire le rapport à l’autre — le je renonce à dire ce qu’est le vous —, il l’est tout autant de dire quoi que ce soit de soi, ce qu’exprime ici la perte du nom : le mot lui même disparaît dans son unité (« mon n / om ».
On n’a fait que parcourir ce livre qui avance avec ses papillons en faisant comme si l’essentiel était de jouer avec les mots (la grammaire, le vocabulaire, les associations), avec le vers, avec le temps. On pourrait lire autrement, se préoccuper de la très forte composition de l’ensemble et de son contenu ; un aperçu : au premier poème isolé succède une séquence de 19 poèmes, puis de 5 commençant tous par « Je préfèrerais pas », ensuite on lit un ensemble identique pour la forme, en miroir, donc : 19 + 5 + 1. On découvre aussi dans un poème le père — mais ce n’est pas lui qui transmet la langue… Un livre réjouissant et qui donne à penser à ce qu’est notre relation aux mots, à l’autre.
Jean-Pierre Chevais, Le temps que tombent les papillons, Rehauts, 2017, 84 p., 13 €.
Cette note a été publiée sur Sitaudis le 26 mai 2017.
- Georges Perros, Papiers collés, Le Chemin/Gallimard, 1960, p. 80-81.
- Jean-Pierre Chevais a édité Inger Christensen (Herbe, Atelier La Feugraie, 1993)
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre chevais, le temps que tombent les papillons, écriture, humour | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2017
Rehauts, n° 39

Connaissez-vous David Constantine ? Poète et nouvelliste, né en 1944, il est aussi traducteur de Hölderlin, Kleist, Brecht, de Michaux et Jaccottet ; on a pu lire en 1992 Sorlingues (La Dogana) dans une belle traduction de Yves Bichet et quelques poèmes, dans la revue en ligne Recours au poème grâce à Delia Morris et André Ughetto. Rien d’autre alors que l’œuvre compte plus d’une dizaine de titres. Rehauts, qui propose toujours en ouverture une traduction, en donne 12 poèmes, traduits par Perrine Chambon et Arnaud Baignot : c’est un choix varié qui va de l’observation d’un nuage et de rêverie devant une photographie au thème de la fenêtre miroir.
Des peintures de Stéphanie Ferrat, dont on connaît par ailleurs les livres poèmes, accompagnent un long poème de Caroline Sagot Duvauroux, "au commencement longtemps déjà" ; on y retrouve, pour le dire vite, ce qu’elle poursuit depuis ses premiers écrits : questionner l’ordre de la langue dans ce qu’il a d’indécidable, d’ambigu et, en même temps, faire que la vie, le visible, soient toujours présents dans l’écriture, jamais comme représentation — on se souvient qu’elle écrivait que « Si la vision était lisible on cesserait d'écrire. »1 :
Un lac vert dans les yeux d’un homme. Deux
barques s’y croisent. Sur l’une, deux meurent de
honte. Sur l’autre, un peuple meurt d’espoir. Un
détroit de silence.
Le numéro publie également des poèmes d’Étienne Faure ; on y reconnaît le ton mélancolique qui affleure dans plusieurs de ses recueils, mais ici sur un motif nouveau : le narrateur se souvient d’un amour perdu. Remémoration du temps passé, de la lecture commune de Trakl, solitude de la vie présente comme dans ce début du premier poème :
Je dors dans un caisson nommé chambre,
suis là-dedans
et meurs tous les jours sous le sceau du secret
puis vais en ville essaimer des paroles,
amorcer la joie toujours après la peine (…)
On voudrait citer encore, au hasard dans ce riche numéro, Max de Carvalho ou les alexandrins rimés de William Cliff, qui poursuit l’exploration de son enfance, les poèmes de Stéphane Korvin et ceux de Bruno Grégoire, les souvenirs de Jacques Josse. On lira aussi les notes de lecture de Jacques Lèbre ; la première est consacrée au très beau livre d’Antoine Emaz, Limite (Tarabuste, 2016) la seconde permet de découvrir le poète danois Soren Ulrik Thomsen, traduit par Pierre Grouix (Les arbres ne rêvent sans doute pas de moi, Cheyne, 2016).
- dans Le livre d’El, d’où (Corti, 2012).
Rehauts, n° 39, mars 2017, 112 p., 13 €.
Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudis le 5 mai 2017.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rehauts, n°39, david constantine, stéphanie ferret, sagot duvauroux | ![]() Facebook |
Facebook |
01/06/2017
Sofia Queiros, sommes nous : recension

Sommes nous est le troisième livre de Sofia Queiros publié dans la petite collection à couverture noire, "présent (im)parfait" des éditions isabelle sauvage. Le premier ensemble, "nid", est un récit où sont rapportés (respectivement page paire et page impaire) les façons d’être, toujours opposées d’un je féminin et d’un elle ; « je suis sur les genoux comme souvent à la fin d’un jour aime le silence (…) » appelle l’énoncé d’un comportement inverse, « elle toujours flamboyante lorsqu’il s’agit de parler de tout et du reste (…) ». À la présence des morts répond la nécessité de vivre, la vie de vieille enfant seule a pour parallèle l’agitation d’une femme toujours en mouvement, l’une s’efforce de « passer inaperçue », craint la foule quand l’autre la souhaite et veut être au centre d’un groupe ; des souvenirs d’enfance surgissent à l’évocation, en face, de la vieille dame aujourd’hui ; etc. Les deux sont cependant en accord dans la manière de vivre l’amour : si l’une aspire à « s’oublier dans les bras d’un homme », l’autre « ne désire rien de plus que corps nus apaisés ». Y aurait-il une seule femme à des moments différents ?
Le je laisse échapper : je « m’invente une vie que je n’ai pas », change sa place avec le elle dans les pages, puis apparaît un il bien ambigu ; peut-être un avatar du je féminin / elle puisqu’il « aimerait pisser debout comme ses congénères » et, ailleurs, « aimerait avoir un corps qui n’enfante pas ». Deux pages blanches séparent tous les propos contradictoires, du côté du féminin et du masculin, et sans trop de surprise je, elle et il sont donnés comme étant une seule figure, « elle il je partagent la même maison (…) le même corps la même vie la même ». À lire ces courtes proses, m’est revenu un passage d’une lettre de Kafka à Grete Bloch, où il lui expliquait connaître sa fiancée Felice sous quatre formes différentes, l’une d’ailleurs, celle qui lui écrit des lettres, étant elle-même multiple.
Cette vision de la complexité de la personne, à la fois unique et éclatée, est reprise sous une forme très différente dans un second ensemble, "brins et débris", récit encore, composé d’une série de trois courtes séquences par page. Pas de rupture avec "nid", puisque la première débute par "et" comme pour affirmer une continuité — mais la totalité des séquences s’ouvre ainsi pour lier tous les "brins" d’un passé : une vie. Une vie, dans le désordre de ce dont on se souvient, « les monstres de l’enfance », « l’effroi des ombres nocturnes », le père, ses colères et ses coups, la mère, les « cris de ménages en scène et tragédies du quotidien », un garçon, une fille, l’école, les amoureux, les morts sur la route, les femmes d’un village : celle dont on se moque, celle qui vieillit seule, celle qui surveille le couple adultérin, celle qui manque d’argent pour terminer le mois ; bref, les moments de la vie dans leur diversité, dont la relation ne peut qu’être inachevée, et c’est pourquoi la dernière séquence, isolée, se termine par "et".
Il y a dans ces proses une attention aiguë aux petites peurs que l’on garde pour soi, aux petits gestes de l’enfance, aux petits mouvements de tendresse que l’on n’oublie pas, à tous ces petits riens dont la vie est construite, qui façonnent chacun. Ce sont tous ces moments que rassemble Sofia Queiros dans Sommes nous — l’absence de trait d’union n’est pas fortuite —, tout en sachant que cette somme ne vise pas à dire une unité impossible, ou s’il y a unité elle est de choses disjointes : « le merle moqueur (…) jamais ne se posait plan plan pour construire nid brins et débris ».
Sofia Queiros, Sommes nous, éditions isabelle sauvage, 2017, 72 p., 13 €. Cette note d lecture a été publiée sur Sitaudis le 26 avril 2017.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sofia queiros, sommes nous, éditions isabelle sauvage | ![]() Facebook |
Facebook |
25/05/2017
Fabienne Raphoz, Blanche baleine : recension
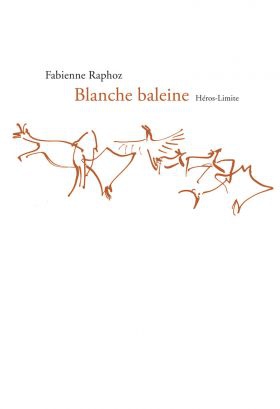
Blanche Baleine peut être rapproché du précédent recueil de Fabienne Raphoz, Terre sentinelle, pour sa thématique, annoncée par deux citations en exergue (George Oppen, David D. Thoreau) : tout est à connaître de la Terre — donc terre et eaux — et tout ce qui existe est à découvrir. On lira le livre comme une exaltation du vivant, de tout le visible, pierres, plantes et animaux dans des espaces variés : le livre s’ouvre sur la péninsule du Yucatán, mais l’on sera aussi proche du Mont Blanc. Il faut cependant, en même temps que ce voyage lyrique, ajouter d’autres parcours, le premier dans les langues avec l’introduction de l’anglais, de l’allemand, du latin scientifique et, pour le français, de néologismes, le deuxième dans le temps avec la présence de l’antiquité et les allusions à des ères géologiques, le troisième dans la littérature avec des citations de poètes contemporains (à l’exception de Byron), que des notes reprennent et attribuent.
Ces éléments variés, distingués ici, se fondent dans une composition rigoureuse. Si l’on commence par un ailleurs (le Mexique), on rejoint dans la troisième séquence, la plus développée, la région natale de la narratrice, la Haute-Savoie, et il faut lire dans son titre, "mon-t Fuji", le possessif « mon ». Les deuxième et quatrième séquences, de dimensions égales, portent des titres qui marquent leur parallélisme, "Buisson premier" et "Buisson sonore" ; le livre s’achève par une séquence d’un vers, titrée "Tell de terre", détournement donc d’un terme d’archéologie puisque "tell" évoque habituellement un amas de ruines de constructions humaines.
Le lyrisme de Baleine blanche se manifeste d’abord dans le plaisir d’écrire les noms, « il importe de nommer » écrit Fabienne Raphoz ; et à côté de noms familiers (baleine, singe, criquet, tortue, fouine, etc.), d’autres renvoient à un ailleurs, et peut-être à ce paradis que chacun porte en lui où le nom de l’animal semble dire ce qu’il est, comme toupaye, chrysomèle, lepture ou sirli — et ajoutons hors du domaine animal des mots dont le lecteur cherchera le sens, comme ololuga, cénote ou pachyte. On découvre à d’autres endroits du texte l’image d’un lien étroit avec la plante et l’insecte, avec la pierre et l’oiseau. Le passereau vu un matin (un accenteur alpin) est décrit à touches rapides, croquis pris sur le vif, ce qui s’équilibre avec le plaisir de « la ritournelle aimée de la liste », celle des différentes variétés de traquets — motteux, pâtre, des prés, tractrac, brun, commandeur, etc., liste qui conduit à nommer les pays où vit chaque variété… Sont également donnés les noms d’espèces de pommes cultivées par le père, noms qui, par leur sonorité, sont aussi liés à un ailleurs, celui de l’enfance, et ils sont isolés pour que chacun forme un vers : « Idared / Metsu / Melrose ».
L’enfance mais aussi d’autres moments de la vie de la narratrice sont présents. Les premiers vers, sibyllins, font allusion à un épisode douloureux (« me suis / écrasée jeune / sur l’asphalte / (vers Manhattan) », écarté (« ai survécu / passons ») : l’expérience intime n’a pas à être motif de poème, ce qui peut être écrit et partagé est autre. Ainsi, les moments vécus dans la région natale qui, bien qu’autour de ce qu’est le "je", sont pour l’essentiel rattachés au motif général du livre ; par exemple, dans une forte ellipse, la narratrice se définit à la fois par rapport à un lieu, un élément, la couleur d’un oiseau :
Je suis faite de la
pierre de mon pays
la rousseur du
gypaète aussi
De même, quand un membre de la famille Raphoz paraît dans les poèmes, c’est pour mettre en relation ce qu’il fait avec la vie animale ; un grand-oncle avait été cocher de fiacre à Paris : cette « migration » s’apparente à « Migration » des oiseaux, et les deux mouvements suivis d’un retour se répondent, page de gauche-page de droite.
Les mouvements sont incessants dans Blanche baleine, à commencer par ceux de la transhumance ; les vers alors deviennent quasiment un calligramme, dessinant un chemin. Quant à la baleine on peut suivre ses déplacements dans le temps, puisque qu’on la découvre fossilisée dans le désert (« voici les bêtes / revenues de loin ») et qu’elle est présente chez Homère et dans la Bible. Mais elle avance aussi sur terre, imaginée avoir donné forme à la grotte, et l’on se souvient qu’elle-même fut pour Jonas ce lieu accueillant qu’est la grotte dans l’imaginaire ; accueillante et bienveillante, qui rejeta le prophète sur la côte. L’image de l’ouverture dans la roche ou le sol (donc horizontale ou verticale) est récurrente dans le livre, favorable ou non selon qu’il s’agit du « trou », de la « balme » (« baume » en Provence, pour « grotte ») ou du cénote (sorte de gouffre). La dernière séquence, titrée "Tell de terre", fait disparaître tout caractère dangereux : elle ne comprend qu’un vers, où revient la grotte, associée à un symbole de renaissance (faon) et de liberté (oiseau) : « le faon des grottes se retourne sur l’oiseau » — ce symbole d’ouverture a été retenu par Ianna Andréadis pour illustrer la couverture.
Fabienne Raphoz, Blanche baleine, Héros-Limite, 2017, 96 p., 16 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 18 mars 2017
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, blanche baleine, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
27/04/2017
Lisa Robertson, Le temps : recension (éditons NOUS)
Deux ensembles alternent dans le livre, l’un formé de proses sur les jours de la semaine (dimanche, lundi, etc.), chacun caractérisé par une météo particulière. L’autre, constitué de vers libres, est plutôt lié aux faits et gestes du "je" présent ; chaque pièce est titrée "Résidence à C [Cambridge]", sauf la dernière, "Porchevers" (après "samedi"), et le livre s’achève par une "Introduction au Temps". En exergue, une citation de Walter Benjamin oriente la lecture : le temps, la mode et l’architecture « se tiennent dans le cycle du même éternellement, jusqu’à ce que le collectif s’en saisisse dans la vie politique et que l’histoire émerge. » Parler du temps qu’il fait est en effet souvent un moyen d’engager la conversation avec quelqu’un que l’on ne connaît pas, et les conversations entre familiers débutent régulièrement par des considérations sur la couleur du ciel, le froid, etc. Ce caractère social du temps est abordé de manière complexe par Robertson.
Est d’abord défini un lieu, « ici », qui peut être n’importe où, « Ici il y a des dermes et des manoirs et des mines et des bois et des forêts et des maisons et des rues [etc.] », et s’y installe un "je". Il faut entendre que les ciels et leurs transformations (vocabulaire abondant et précis concernant les nuages), point de départ du discours de la météorologie, sont aussi figure du temps comme durée, support des fictions. Donc, quoi qui puisse être dit la variabilité du ciel (weather) s’appliquera autant à la succession des jours (time), « Les jours s’amoncellent sur nous » : la phrase est reprise plusieurs fois. Le caractère à peu près imprévisible de l’état du ciel et de ce qui se produira au cours des mois accompagne les mouvements du sujet parlant. La description du ciel en tant que telle n’est pas ce qui importe, mais la relation entre les changements observés par celle qui regarde et ce qu’elle vit, ressent.
L’intrication du temps météorologique et du temps compté est restituée dans la dynamique, fort complexe, du livre. À la succession des deux ensembles en alternance fait écho constamment la construction, à plusieurs niveaux, d’oppositions de forme A vs B, ou A incompatible avec B ; ainsi, deux noms, ou deux adjectifs : « frais et brillants », « crêté et trouble », etc. Aussi souvent, deux domaines hétérogènes sont en même temps liés et séparés : « Un vent vif ; nous sommes du papier projeté contre la barrière » ; il s’agit le plus souvent de formulations renvoyant à la nature et à la culture, associées et opposées, comme weather et time. La répétition (A puis B) est également fréquente, tout comme l’accumulation ou la syntaxe brisée, manières également d’exprimer à la fois la diversité du temps météorologique et la complexité du vécu, le réel et l’imaginé. Le choix de la semaine signifie elle-même la possibilité de la répétition, de la reproduction indéfinie — parallèlement, le compte rendu d’une résidence se termine par une virgule : l’inachèvement et l’inachevable.
L’ensemble des séquences titrées « Résidence à C. », construit autour du "je", n’est pas seulement parallèle aux développements autour du temps, ciel et jour. Outre la présence de la narratrice dans les deux ensembles, d’autres éléments les lient. Quand est relatée la lecture de La bâtarde (de Violette Leduc), lui sont associés des termes relatifs à la météorologie (vent, air) ; par ailleurs la bâtardise, c’est-à-dire l’image d’un temps sans origine, peut être rapprochée d’un passage du premier ensemble constitué d’une interrogation sur des femmes absentes suivie d’une série de prénoms féminins (sans patronyme).
Il faut louer le travail du traducteur qui restitue la vigueur du texte de Lisa Robertson : c’est le poète Éric Suchère qui est ici à l’œuvre, avec le même bonheur que dans sa traduction de Jack Spicer.
Lisa Robertson, Le temps, traduction de l’anglais (Canada) par Éric Suchère, NOUS, 2016, 80 p., 14 €.
Cette recension a été publiée dans Libre-critique en mars 2017.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lisa robertson, le temps (recension) | ![]() Facebook |
Facebook |





