25/08/2019
Anne Parian, Les Granules bleus : recension

Bien peu de lecteurs citadins ont la chance de découvrir une petite limace grise dans leur salade, même étiquetée "bio", quand ils la lavent ou dans leur assiette, seuls ceux qui disposent d’un jardin ou ont un voisin jardinier et généreux, ont ce privilège. La narratrice d’Anne Parian, elle, en trouve des petites et des grosses, orange ou noires, et c’est le rapport qu’elle construit avec elles qui est l’objet de ce récit à la première personne.
Une entrée en matière très générale évoque des « puissances anonymes » qui interviendraient largement dans la vie de chacun : destructrices, elles seraient plus ou moins visibles. Semblant se comporter en ignorant la présence de la narratrice, l’une d’elles en gâte les jours ; nous n’en saurons pas plus, seulement qu’elle laisse des traces et se multiplie. Le second chapitre est consacré à des animaux — la souris, le rat, le mulot — dont peu de personnes apprécient la présence, à tort selon la narratrice : ils sont en effet susceptibles, parce que mammifères, de « nous rappeler la mère qui peut-être nous allaita » : il faut noter le " peut-être " et apprécier l'humour à propos d'un anthropomorphisme répandu aujourd'hui. Le risque d’être envahi oblige, dit-elle, à les supprimer, en employant des moyens discrets. Elle mentionne la tapette, la glu et des produits chimiques dont certains à action lente permettent à la souris, selon le mode d’emploi « de regagner son nid avant de mourir ». Ce qui suscite un commentaire, « Ce à quoi je ne serais pas insensible non plus. Quel ingrat ne le voudrait pas ? » Le lecteur commence à penser qu’il lit l’histoire de quelque folie ou un récit comme en affectionnait Swift, dont on retrouve le ton neutre, distant, pour parler des faits les plus dérangeants.
Le doute n’est pas levé avec le décalage entre le propos (comment se débarrasser des souris ?) et le contenu d’une note à propos de la tapette : on apprend le nom de son inventeur, James Henry Atkinson, et comment elle fonctionne. D’autres notes viendront au fil du livre ; toutes sont données au mode conditionnel alors que l’on peut vérifier l’exactitude des renseignements qu’elles contiennent, par exemple sur la nature du mucus des limaces que la narratrice préfère désigner par « bave », ce qui rapproche l’animal de l’humain. Le contenu des notes, souvent scientifique1, contraste avec ce que fait ou dit la narratrice, surtout préoccupée par la présence des limaces.
Ce n’est qu’au troisième chapitre que ces animaux apparaissent, introduits par l’usage de « granules bleus »2, apportés par un certain Chales qui réapparaît à la fin du livre, sans que l’on apprenne quoi que ce soit à son propos ; d’autres personnages, apparemment familiers de la narratrice, n’existent que par leur prénom. À partir de là, le récit est entièrement consacré aux limaces : ce sont les variations sur la nécessité de s’en débarrasser qui conduit la narratrice « à écrire pour venir à bout de la confrontation » qu’elle a construite. « Sans limaces plus de texte », et elle note plus loin, « Je ne recule devant rien pour écrire et je les tue plutôt que pas. » On lit souvent qu’écrire serait une manière de lutter contre la mort : ici, c’est en tuant qu’elle est rendue possible…
Les limaces deviennent une obsession et il leur est supposé des intentions, une « tactique » et de la « malignité », la capacité de conceptualiser ; les interrogations à leur sujet relèvent d’une anthropologie, il s’agirait par exemple de comprendre les relations de parenté à l’intérieur d’un groupe, savoir si elles ont du plaisir à glisser. Par ailleurs, la narratrice trouve nécessaire de les apprivoiser, « au moins un peu », par crainte qu’elles viennent à bout d’elle. Cette crainte se manifeste constamment, d’une part parce que les limaces se multiplient sans cesse et pourraient revenir venger celles qui ont été tuées, d’autre part, écrit-elle, « elles savent ce que je mange, peuvent venir jusque dans la salade que je leur vole, […] elles ont appris surtout que j’écris à leur propos. » L’idée la traverse d’en élever dans un enclos et d’organiser des courses entre elles, mais il faudrait alors les réunir en les prenant avec des pinces : l’énumération oriente vers l’humour puisqu’il s’agit de pinces à épiler, à linge, à limaces — et de « pinces sans rire ».
L’essentiel semble pourtant de les supprimer par divers moyens, on peut « les donner aux poules (…), les brûler dans le sens du vent ou encore les plonger dans de l’eau savonneuse ou de l’alcool à friction » ; la narratrice rapporte qu’une dame allemande — atteinte de la maladie d’Alzheimer…, — parcourait son jardin en les coupant au sécateur. Mais cette manière de faire présente des dangers dont la narratrice est consciente : découper une limace en rondelles est possible mais, écrit-elle, « en commençant par l’arrière pour qu’elle ne s’en rende pas compte tout de suite, et alors qu’elle ne me voit pas », susceptible dans ce cas de se changer en bête féroce. Les limaces sont dessinées, classées, empaillées même, cuites, mais elle précise « Je ne les mange pas toujours ». À d’autres moments, la proximité avec l’animal est mise en avant, la narratrice souligne « la beauté de les prendre avec les doigts », remarque que ses doigts ont la même consistance que le corps des limaces, et elle s’adresse à elles (le texte est alors en italique), déçue par l’absence d’échange (« Ce qu’il y a pour moi de plus difficile, c’est leur air de m’ignorer ») alors qu’elle accepte de les voir dans son assiette.
Les notations sur les sentiments qu’on peut éprouver en tuant des limaces (« Je ne sais pas si une mère a tué des limaces avant moi, si elle les a pleurées »), la mention insistante du lien entre suppression des limaces et écriture, la présence à plusieurs endroits de jeux linguistiques3, éloignent de mon point de vue "l’histoire d’une folie". Tout comme le choix même des animaux en scène (la souris, la limace), fort éloignés aujourd’hui du quotidien d’un lecteur citadin — d’où le sentiment de gêne de certains à la lecture de certaines descriptions : se débarrasser d’une souris, pourquoi pas, mais discrètement. Récit métaphorique sans doute, mais aussi pour tous ceux qui apprécient l’humour de Swift, auquel Les granules bleus font souvent penser.
1 Par exemple, à la suite d’une liste des sortes de limaces (« petite, jaune, orange, grise, rouge, brune, ou plus grande, rose, bleue ou noire »), une note précise que les bleues « se seraient trouvées plutôt dans les Carpates (Bielza coerulans), les roses en Australie ».
2 Appât à base de phosphate de fer, présent dans la nature
3 La fin de l’un d’eux : « Ne plus tenir au lien entre dire et faire, entre ce que l’on voudrait dire, ce que l’on pourrait dire, ce que l’on saurait dire, ce que l’on aurait à dire, ce que l’on ferait dire, et ce que l’on ferait. »
Anne Parian, Les Granules bleus, P.O.L, 2019, 96 p., 12, 50 €. Cette note a été publiée sur Sitaudisle 26 juin 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne parian, les granules bleus, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
22/07/2019
Julien Bosc, La demeure et le lieu : recension
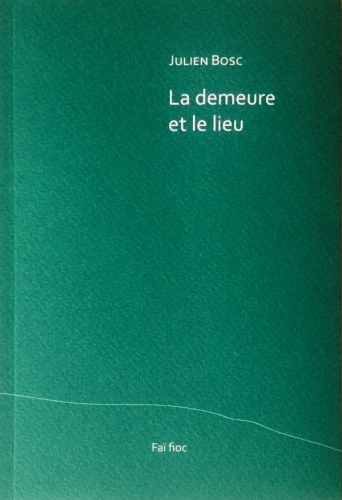
Le livre, recueil posthume dont quelques extraits avaient été publiés dans Rehauts, avait été préparé par son auteur, tout comme Le coucou chante contre mon cœur qui paraîtra en 2020 aux éditions Le Réalgar. On y reconnaît la voix de Julien Bosc (1964-2018), par la présence d’allusions à tel livre précédent et au retour de quelques motifs — celui de la mer et du départ, et, qui donne son esprit à l’ensemble, celui d’une identité introuvable et de la détresse qui l’accompagne. La postface de Jacques Lèbre situe précisément La demeure et le lieu par rapport aux autres livres de Julien Bosc et en donne une lecture sensible et approfondie.
Quelles qu’aient été les variations dans l’écriture des différents livres publiés, une caractéristique réunit la plupart d’entre eux, l’attention au dehors, à ce que l’on hésite à noter, à ce que l’on oublie parce que partie du quotidien le plus ordinaire. Julien Bosc, sans cesse, relève les menues découvertes au cours des marches, les mouvements des oiseaux, la pousse des bourgeons, les couleurs changeantes du ciel, son étonnement quand il saisit quelques bribes de la vie nocturne du hérisson ou de la hulotte, l’épanouissement des fleurs, la préparation des fagots et des bûches à fendre — travail nécessaire quand on se chauffe avec un poêle dans une région aux hivers rudes, la Creuse ; etc. Poèmes de la vie ordinaire, où l’on apprend ce que font les chats Pépère et Minette comme on lit les compliments refoulés de l’auteur devant une jolie marchande légumes ? Oui, si la lecture ne retient que la répétition de petits gestes : il n’y a alors que les traces de moments de la vie, une manière de journal. Non, si le lecteur prend en compte ce qui suit une série d’énumérations et, de là, reprend l’ensemble sous un nouveau jour.
Les vers de plusieurs poèmes débutent par un verbe à l’infinitif, suivi ou non de compléments, comme dans « marcher / regarder / attendre / écouter / laisser dire / effacer / plusieurs fois reprendre / aller dans la nuit / réessayer / croire un instant que oui / or non déjà demain et rien ». Les actions sont ici données sous la forme la plus générale, pas du tout situées dans le temps, ce qui signifie que l’échec à écrire évoqué n’est pas lié aux circonstances. Comme si « forcer les ferrures de la langue » ne permettait que rarement de fixer « les rares mots rescapés du naufrage ». Ce qui s’exprime sous différentes formes, c’est la quasi-certitude de ne pouvoir (ou savoir) restituer ce qui devrait l’être ; une fois le poème écrit en ayant eu « la sale sensation / parfois / de faire feu de tout bois », alors « preuve est là rien n’a été dit ». Le doute de soi est rarement surmonté et il est lié à une relation difficile aux choses du monde.
Julien Bosc observe les oiseaux autour de sa maison, les manœuvres (qui échouent) des chats pour les attraper, marche près de la rivière, dans les bois où il surprend une biche, réunit des fleurs des champs : toutes actions qui le réconfortent, mais commence-t-il à brûler feuilles et « vieux genets », les « voir partir en fumée » entraîne une vive mélancolie, « (penser qu’on pourrait se pendre / allez savoir pourquoi à ce moment-là) ». Le lecteur retourne à un livre précédent, De la poussière sur vos cils, où était évoquée la fumée des crématoires, et lit d’ailleurs une autre allusion à ce livre avec « les cendres sur ses cils ». S’arrêtant pour rêver aux figures que le temps dessine sur un vieux mur, Julien Bosc reconnaît une fleur et diverses figures d’animaux mais aussi « la face d’un gisant bouche-bée » et, non pas une silhouette mais « le portrait d’un homme » (souligné par moi) dont les traits « expriment une immense tristesse ». Aussi l’idée de la disparition habite-t-elle le livre, le matin au réveil ou lorsqu’un travail physique occupe la journée, toujours sont présents les « anciens galets dans la gorge », galets déjà dans le poème d’ouverture. Cependant, dans le temps même où tout semble vaciller, être noué, existent une échappée, la possibilité de quitter ce qui provoque la détresse.
Le lecteur revient alors à un autre livre de Julien Bosc, La Coupée, récit en vers d’un court voyage sur un navire conteneur qui l’a fait « passer (…) de l’autre côté du miroir » et, le voyage achevé, il prend soin d’écrire qu’il faudra « prendre garde à ne sombrer ni toucher le fond ». La mer libératrice et le vocabulaire de la marine sont sans cesse présents dans La demeure et le lieu et aux endroits ou aux moments les plus inattendus. De l’évocation de la nuit et d’arbres en hiver on saute à celle de poussière de coquillage : de là à « un esquif pris dans la tempête », une mouette. La mer est également là quand le vent est fort, « il suffit de fermer les yeux (…) », et c’est le rivage et, la nuit, la lune devient phare pour guider
vers le large la côte
l’aventure ou sa nostalgie
Un poème est remarquable pour suivre la transformation des éléments du quotidien en paysage marin : une énumération — nom + qualification — de choses vues « de bas en haut » permet de passer d’un ruisseau à des cumulus qui « très lentement dérivent
sur la voie du retour
des feux là et là entre la ligne des arbres
le bourdonnement des mouches
les stridulations des grillons
un phare enfin
un port d’attache
et
assis sur une étroite jetée
un vieux pêcheur (…) »
Seul le départ pourrait écarter « la pensée d’en finir », sortir de la répétition et de la présence du passé que rappellent de petites actions de la vie de chaque jour. Pourtant, on peut aussi lire dans le souci de les rapporter, comme le sait bien Julien Bosc, « une manière parmi d’autres de conjurer la mort / ou / plus simplement / de déjouer les sempiternelles incertitudes de l’existence ». Certes, sa disparition conduit à lire dans les poèmes des signes de son choix de tout quitter, on peut cependant lire et relire La demeure et le lieu sans rien connaître du destin de son auteur et l’on est fortement touché par sa manière d’empoigner la vie.
Julien Bosc, La demeure et le lieu, Faï Fioc, 2019, 80 p., 9 €. Cette recension a été publiée sur Sitaudisle 19 juin 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, la demeure et le lieu | ![]() Facebook |
Facebook |
04/07/2019
Marie de Quatrebarbes, Voguer : recension
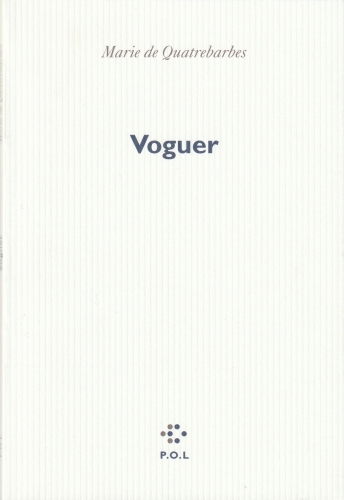
On se rapportera, pour le titre et le point de départ de l’écriture de Voguer, à sa présentation par Marie de Quatrebarbes sur le site des éditions P. O. L : il est inspiré « entre autres du film Paris is burning de Jennie Livingston (1991) sur la vie des danseurs de « voguing » à la fin des années 1980. ». Voguer succède donc, parus en 2018, au roman John Wayne est sous mon lit et au livre de poèmes Gommage de tête, tous deux également liés au cinéma américain, mais aussi à la traduction de Discipline, poèmes de Dawn Lundy Martin, auteure noire dont l’univers n’est pas très éloigné des adeptes du voguing.
Les cinq poèmes du livre sont présentés comme des prières : on peut entendre le mot comme la célébration de chaque personnage retenu, son prénom donnant le titre du poème. Les deux premiers sont consacrés à Venus Xtravaganza, transgenre, et à Pepper LaBeija, dragqueen, les deux derniers sont du côté de la littérature — Ninetto Davoli, acteur, a été aimé de Pasolini, Henrich von Kleist est un des écrivains du romantisme allemand lu et relu par Marie de Quatrebarbes ; le troisième poème célèbre un anonyme, un « garçon disparu (…) un soir d’août 2017 », mais il a pour titre un prénom féminin, "Thérèse". La construction apparaît d’autant plus rigoureuse que plusieurs éléments thématiques renforcent l’unité du livre ; ainsi, la danse et les oiseaux très présents dans le premier poème reviennent dans les suivants ; par exemple, dans le troisième, le garçon anonyme dit « qu’il a trouvé refuge dans une maison dont il est l’oiseau » et le quatrième s’ouvre avec l’image de « Nuées d’oiseaux dans les arbres. Nuées folles et folle envie de danser ».
Le choix des deux premiers personnages est politique, il rappelle que le voguing a été une forme de recherche et d’affirmation d’identité par des hommes en marge aux États-Unis — les adeptes de cette danse étaient « Jeunes, pauvres, homosexuels, noirs et latinos ». On lit aussi des allusions à la vie contemporaine, notamment à la culture de masse (la saga Twilight, les enfants Fisher-Price), mais aussi au rêve de changer de statut social (être un cadre — un « executive ») ; les luttes pour les droits civiques sont rappelées avec la mention de l’écrivain Jimmy [James] Baldwin. Plus largement, c’est la difficulté de vivre dans les sociétés contemporaines qui est évoquée à diverses reprises dans les poèmes, et tous les personnages pourraient se demander : « Sait-on où l’on est ? »
Voguer, le livre le plus achevé de Marie de Quatrebarbes me semble-t-il, peut être lu comme une longue élégie sur l’image du double ou parfois du trompe-l’œil, sur l’apparence et l’ambiguïté. Venus s’imagine en petite fille et l’un de ses désirs serait de se « déplacer sur un char tiré par des moineaux — comme la Vénus antique. Les « poses des mannequins des magazines féminins (notamment le magazine américain Vogue dans les années 1960, et les défilés de mode) » sont reprises et mises en mouvement par les danseurs de voguing, copie décalée d’un genre particulier d’images qui renvoient au luxe et, donc, à tout ce qui les exclut. Il s’agit dans ce cas d’un double impossible, le corps masculin porte ce qui socialement est dévolu au féminin, sans en avoir les attributs pour être reconnu comme femme, « ils défilent dans des costumes inventés et dansent à l’extérieur de leur corps inventé ». Et MdQ prête au garçon disparu— le poème le concernant est titré "Thérèse" — des propos qui insistent sur l’ambiguïté de tout corps, « il dit mon corps est un mélange d’homme et de femme » — ce pourquoi il donne à sa main la forme d’un miroir dans lequel on rectifie son maquillage. De là, cette proposition : « L’idéal serait de ne plus avoir de corps », que seule la mort rend possible pour annuler l’ambiguïté. D’une certaine manière, Heinrich von Kleist, en se supprimant après avoir tué son égérie, réalise la fusion du masculin et du féminin en les faisant disparaître. Une autre forme du double est proposée par l’introduction de l’automate, susceptible de reproduire les gestes humains, qui « concentre en lui tous les systèmes », et de la marionnette qui mime en déformant plus ou moins. Le garçon-Thérèse est supposé vivre « dans un théâtre de marionnettes » et, à la suite de "Ninetto", il est rappelé que Pasolini a imaginé un Othello joué par des marionnettes auxquels des « comédiens (…) donnent corps et vie ».
Voguer est aussi un livre autour de la mémoire, en particulier avec le poète grec Simonide dont la présence récurrente attire l’attention : ici, il « pleure un vieux souvenir / attablé devant les décombres / d’un festin abandonné aux oiseaux » ; de quoi s’agit-il, que rapporte Marie de Quatrebarbes ? sortant d’un banquet avant l’effondrement de la salle où il avait lieu, il sut donner un nom à tous les corps écrasés parce qu’il « se rappelait les places qu’ils occupaient à table. (…) Et cette aventure suggéra au poète les principes de l’art de la mémoire (…) il comprit qu’une disposition ordonnée est essentielle à une bonne mémoire » (Frances A. Yates, L’Art de la mémoire, Gallimard, 1975, p. 13). On pense notamment dans Voguer aux danseurs qui inventent leurs mouvements à partir d’images et Ninetto qui se souvient de sa vie avec Pasolini, « Parfois, je me demande ce qu’aurait été ma vie (…) »*. Il n’est pas surprenant que dans les fragments de théorie que donne Marie de Quatrebarbes, la mémoire ait une place privilégiée ; ici, c’est une cascade d’auteurs qui se souviennent (« Dans son journal, Kierkegaard cite Leibniz citant Horace ventriloquant Tirésias (…) »), là, si le nuage est le signe même de la beauté, il ne l’est que dans le souvenir puisque, écrivait Brecht (cité)dans un poème, « ce nuage, lui, n’est qu’un instant ». Enfin, dans le tout dernier texte, à la suite de "Heinrich", sont réunis une citation de Simonide sur danse et poésie, et une allusion aux marionnettes et à la mémoire : « Peut-être ne danse-t-on qu’à partir des fils qui nous retiennent, et n’écrit-on que depuis les lambeaux d’une mémoire que l’on récite comme un perroquet ».
Le jeu de la mémoire entre évidemment dans la composition de Voguer. On a signalé la construction autour d’un axe, le poème consacré à celui qui n’a pas laissé de trace ; à côté du retour de Simonide, il faut ajouter plusieurs éléments thématiques qui renforcent l’unité du livre ; ainsi, la danse et les oiseaux très présents dans le premier poème reviennent dans les suivants ; dans le troisième, le garçon anonyme dit « qu’il a trouvé refuge dans une maison dont il est l’oiseau » et le quatrième s’ouvre avec l’image de « Nuées d’oiseaux dans les arbres. Nuées folles et folle envie de danser », etc.
La rigueur dans l’ordre des poèmes est d’autant plus nécessaire que les formes adoptées par Marie de Quatrebarbes semblent hétérogènes à la première lecture : poème récit en prose, prose lyrique construite autour de deux mots, "main" et "moineau", séquences brèves lues à l’oral sans reprise de souffle et séquences plus longues où la voix se repose, vers libres, prose comme en aparté pour des éléments théoriques. On lit dans ces variations une volonté de privilégier le mouvement, le choix d’utiliser les ressources variées de la langue : ce n’est pas hasard si, dans un poème, sont introduits « ô massifs, ô pluriels » : on peut retourner au poème de Ponge** d’où vient cet extrait, il s’accorde aux recherches de Marie de Quatrebarbes :
Ô draperies des mots, assemblages de l’art littéraire, ô massifs, ô pluriels, parterres de voyelles colorées, décors des lignes, ombres de la muette, bouches superbes des consonnes, architectures, fioritures des points et des signes brefs, à mon secours ! au secours de l’homme qui ne sait plus danser.
* Ce début de phrase est emprunté à Ninetto Davoli ; on en trouvera la suite dans Pasolini, Sonnets, Poésie / Gallimard, traduction René de Ceccatty, 1972.
** Ponge, " Promenade dans nos serres ", " Œuvres Complètes, I ", Pléiade / Gallimard, 1999, p. 176.
Marie de Quatrebarbes, Voguer, P. O. L, 2019 , 96 p., 13 €. Cette note de lecture a été publiée dans Sitaudisle 8 juin 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, voguer, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
25/06/2019
Édith Azam, Bernard Noël, Retours de langue : recension
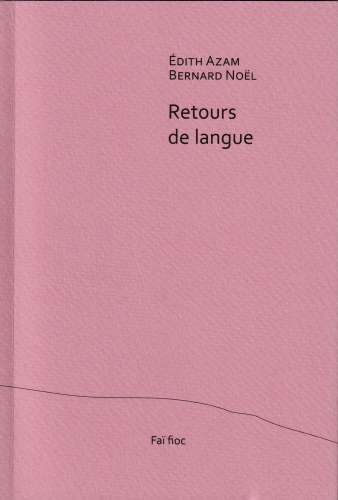
Fort peu de livres de poèmes ont été écrits à quatre mains — on pense aux Champs magnétiques en 1920 de Breton et Soupault, à L’Immaculée conception de Breton et Éluard en 1930 ; plus proches de nous Jacques Izoard et Eugène Savitzkaya ont publié Rue obscure en 1975 et Plaisirs solitaires en 1979. Édith Azam elle-même a écrit avec Valérie Schlée (Un objet silencieux, 2008) et avec Jean-Christophe Belleveaux (Bel échec, 2014), la part de chacun étant distinguée par la couleur des caractères ou la différence romain / italique. Dans Retours de langue, quand intervient le passage d’une voix à l’autre à l’intérieur d’un poème, un changement de police l’indique et quelques éléments permettent d’attribuer tel poème ou telle partie d’un poème à l’un ou à l’autre. Les considérations sur la vieillesse orientent vers Bernard Noël, ce qui par soustraction permet de reconnaître les deux voix. On ajoutera que des éléments propres à l’écriture de chacun sont lisibles, par exemple l’usage particulier des deux points par Édith Azam (« aller (…) / y accueillir : ton évidence »), constant dans sa prose et sa poésie.
Les cinq premières séquences sont en strophes de cinq octosyllabes non rimés, des strophes de dizains sont choisis pour la sixième (avec une dominante du vers de 4 syllabes), et ces formes régulières disparaissent ensuite pour des vers libres en continu. D’une séquence à l’autre, l’unité naît de la reprise de mots et de l’échange entre les deux voix : à partir de la première proposition sur le temps destructeur, un dialogue se construit.
Ce que sont les atteintes du temps, comment ne pas les reconnaître ? Est d’abord transformé ce qui est le plus visible pour l’Autre, le visage, « le miroir ne peut vous changer / en celui qu’un jour vous étiez ». De cette évidence peuvent suivre des considérations sur l’identité même (« qui suis-je dans le sac de peau »), puisque le changement du corps introduit une rupture avec le passé, laisse penser qu’un fossé s’est creusé impossible à combler,
on croit pouvoir recouvrir d’ombres
le grand fracas de la mémoire
C’est, toujours, dans ce passé que le monde était vivable, le temps plein ; aujourd’hui, répète la poésie lyrique, « le paradis est bien perdu » et l’on se retrouve devant le désert, le « néant », « le rien finalement le rien / est le seul costume inusable ». On apprécie ces variations que l’on peut suivre depuis le Moyen Âge — on se souvient de ce passage de la "Complainte Rutebeuf", « Que sont mi ami devenu/ Que j’avoie si près tenu/ Et tant amé ? » —, variations toujours renouvelées. Elles aboutissent d’abord ici à douter de la possibilité dans le présent de construire un Nous, d’engager un temps commun du "je" et du "tu". Ce sont les échanges qui modifient le point de vue.
Sans rejeter du tout le passé, Édith Azam refuse la possibilité de se cramponner « aux vieilles images », celles notamment d’un corps autre qui n’est plus. S’il faut se souvenir, ce sont les gestes, les mots qui doivent revenir à la mémoire, ce qui a permis au Nous d’exister. Reprenant le titre d’un livre de Bernard Noël*, elle conseille : « ouvre un peu la peau et les mots » et, plus loin, affirme le primat du corps d’aujourd’hui, du présent contre le passé — « si le présent n’a pas de place / alors la vie : quoi en faire ».
Il s’agit bien d’avancer, sachant que les « graines perdues de la mémoire », ne doivent en rien empêcher le mouvement, que les corps ne cessent de s’inventer dans la fusion amoureuse, c’est-à-dire indéfiniment dans le présent. Le désir change la perception du temps, le rencontre du "je" et du "tu" est, chaque fois, « le début de la clarté ». Il y a dans l’échange un pari dont l’enjeu est un rapport au temps vécu, ce que résume clairement cette strophe :
mais pourquoi verrait-on là-bas
s’inventer soudain l’origine
des raisons de vivre et d’aimer
il n’est pas de commencement
pour ce qui n’aura pas de fin
Il faut toujours tenter de « retrouver / les vieux gestes / du vertige », et même si les mots apparaissent trop souvent comme des « crève-misère », le poème qui dit le vertige, la rencontre, le désir à sa manière arrêtent le temps. Peut-être écrit-on le plus souvent « pour du vent », note Édith Azam, cela cependant contribue à « se tenir / face au chaos », de savoir que « tout change et ne se perd pas ».
Rien de serein dans cet échange, rien d’achevé et c’est peut-être l’aspect le plus attachant du livre. Toute rencontre, tout échange amoureux sont dits fragiles et susceptibles de se rompre, certes, et la rupture entraîne la solitude : c’est alors qu’il faut « résister dedans ». La vie est faite de « choses illisibles » qui aident à avancer parce qu’elles sont peu à peu comprises ; alors, « C’est un langage neuf / et c’est bien pour cela / qu’il ouvre / tous les possibles ».
Édith Azam, Bernard Noël, Retours de langue, Faï Fioc, 2018, 64 p., 8 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 1erjuin 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, bernard noël, retours de langue : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
01/06/2019
Simone Weil, Joë Bousquet, Correspondance 1942 : recension
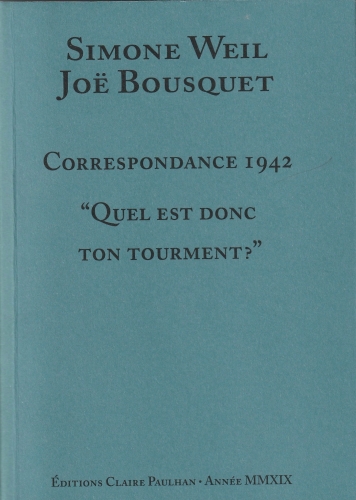
Simone Weil (1909-1943) et Joë Bousquet (1897-1950) se sont rencontrés sans doute le 28 mars 1942 la première fois, la philosophe collaborant à une livraison des Cahiers du Sud sur le thème "Le Génie d’oc et l’homme méditerranéen". Logée à Marseille en attendant son départ pour les États-Unis via Casablanca, elle désirait se rendre à l’abbaye d’En-Calcat, pas trop éloignée de Carcassonne, pour écouter le chant grégorien, et elle souhaitait l’appui de Joë Bousquet pour un projet de corps d’infirmières. Il y eut probablement deux entretiens avec Joë Bousquet, dans la chambre où il vivait alité depuis sa blessure qui, en 1918, l’avait rendu invalide, et les échanges ne furent pas, loin de là, limités au programme de Simone Weil, comme le prouve le contenu des lettres publiées (5 de Simone Weil — la dernière depuis Casablanca —, 2 de Joë Bousquet). Elles ne sont pas seulement resituées dans leur contexte et précisément annotées : les éditeurs renvoient toujours sur chaque point évoqué à des textes de l’un et l’autre et analysent minutieusement dans leur présentation les idées exposées. Il est intéressant de lire d’abord la correspondance avant la lecture qui l’étudie : on y retourne en l’abordant autrement.
Simone Weil avait lu des chroniques et des poèmes de Joë Bousquet qui, lui, avait beaucoup apprécié son article pour les Cahiers du Sud ; il écrivait à Jean Ballard, directeur de la revue, qui accompagnait Simone Weil à Carcassonne, « Je suis ravi de connaître Émile Novis1. Nous avons beaucoup de choses à nous dire ». Simone Weil voulait entretenir Joë Bousquet de son projet ; il s’agissait de créer un corps d’infirmières de "première ligne" qui chercheraient les blessés sur le front ; elles auraient ainsi risqué leur vie, mais les pertes possibles faisaient partie du projet, l’« effet produit sur les combattants et la population » pouvant être, selon elle, des plus bénéfiques contre la poursuite de la guerre. Elle insiste dans le projet définitif sur ces « facteurs moraux » — point absent de sa demande au poète. Le soutien de Joë Bousquet, couvert de médailles, permettrait de faire accepter le projet et, après leur rencontre, elle lui rappelle dans sa première lettre du 13 avril l’utilité d’une recommandation. À partir de là, elle aborde des questions qui la préoccupent, notamment celles de la souffrance, du bien et du mal.
Avant cette première lettre, elle a lu Traduit du silence de Joë Bousquet, livre paru en 1941 et, par ailleurs le Timée, St Thomas d’Aquin et Nicolas de Cues ; plus important pour les échanges avec J. B., elle a découvert les romans du Graal grâce à sa rencontre avec René Nelli2. Elle en a surtout retenu l’histoire du roi Anfortas qui, privé de l’usage de ses jambes, guérit quand Perceval lui pose la question : « Bel oncle, quel est donc ton tourment ? ». Elle voit dans la légende « une clé de lecture de la vie » de Joë Bousquet. Pour poser la question, selon Simone Weil qui compare Joë Bousquet à Perceval et non à Anfortas, « Il lui faut passer par des années de nuit obscure où il erre dans le malheur (…). Au bout de tout cela il reçoit la capacité de poser une telle question, et du même coup la pierre de vie est à lui ».
Elle est revenue sur la question de la souffrance physique — elle dont les maux de tête lui interdisaient parfois toute activité intellectuelle —, affirmant à Joë Bousquet qu’il était, d’une certaine manière, privilégié : « vous avez la guerre logée à demeure dans votre corps », or, « Pour penser le malheur, il faut le porter dans sa chair » : c’est la condition selon elle pour « connaître dans sa vérité, […] contempler dans sa réalité le malheur du monde ». Elle insiste sur le fait que le malheur ou la joie « comme adhésion totale et pure à la parfaite beauté » impliquent « la perte de l’existence personnelle » et, par là-même, donnent le moyen d’entrer dans « le pays du réel ». Il faut refuser tout ce qui est consolation, qui éloigne de la réalité, et en particulier la rêverie ; pour Simone Weil, Joë Bousquet n’aurait pas reconnu, et ne pouvait reconnaître, la distinction entre le bien et le mal, parce qu’il rêvait sa vie.
Dans leurs échanges, le fait mystique est détaché de la religion, la philosophe cherche le surnaturel, pas une Église. Si Joë Bousquet conseille à Simone Weil d’écrire sous le signe d’un « abandon mystique », lui veut trouver le « passage de la poésie à la spiritualité », même s’il oppose régulièrement voie spirituelle et voie poétique ; c’est bien la recherche du surréel que rejette violemment sa correspondante comme étant « mensonge » qui détourne de toute vérité. Joë Bousquet ne répondra pas sur ce point, mais écrira à Jean Ballard qu’il accepterait de vivre dans la peau de Simone Weil, mais avec « plus de complaisance envers le mal ».
Il y eut une de ces rencontres rares où l’amitié naît immédiatement — l’amitié, « source de vie », écrivait la philosophe —, et désir d’échanger, il y eut aussi incompréhension de part et d’autre, les chemins suivis étant sans doute trop différents. C’est cette relation vécue le temps de deux longs entretiens et de quelques lettres, que suivent avec chaleur Florence de Lussy et Michel Narcy dans leurs commentaires qui apprennent sur la personnalité de Simone Weil et Joë Bousquet. Ils ont accompagné les lettres, selon l’esprit des éditions Claire Paulhan, de nombreuses illustrations (photographies, reproduction de manuscrits et de documents), d’annexes et de traductions que choisissait Simone Weil pour Joë Bousquet.
1 Émile Novis, anagramme partielle de Simone Weil, était par sécurité son pseudonyme.
2 René Nelli (1906-1962), ami de Joë Bousquet et vivant à Carcassonne, était un spécialiste de la poésie d'oc du Moyen-Âge.
Simone Weil, Joë Bousquet, Correspondance 1942, réunie par Florence de Lussy et Michel Narcy, éditions Claire Paulhan, 2019, 200 p., 27 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 22 avril 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : simone weil, joë bousquet, correspondance 1942, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2019
Luc Bénazet, Rainal ! : recension
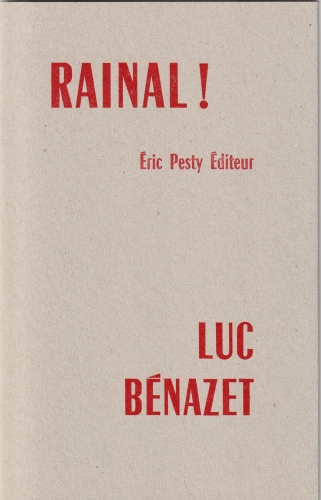
Rainal !, "renard" en langue d’oc, se présente comme un conte et est précédé d’une annonce : « Nous avons recueilli par des méthodes clairement définies et selon un plan précis, des témoignages directs et véridiques sur le personnage du film de court métrage de Chiama Malta et Sébastien Laudenbach, Les Yeux du renard » — film de 2012. Manière de dire « Ceci n’est pas un conte », ou de prévenir le lecteur qu’il ne lira pas un conte traditionnel. Le personnage du film, que je n’ai pas vu, est représenté sur une affiche et une photo par un humain avec une tête stylisée de renard ; le synopsis propose seulement des questions : « Et si le chien n’avait pas pissé ? Si le renard n’avait pas traversé la forêt ? S’il n’était pas passé par la caverne ? Aurait-il pu regarder avec ses yeux vrais ? » Plusieurs de ces éléments sont présents dans Rainal ! : outre l’humain à tête de renard, le chien, la forêt, la caverne, les "yeux vrais", mais Luc Bénazet les introduit en jouant avec les règles précises attachées au conte. La mise en forme de ces contraintes par Vladimir Propp dans Morphologie du conte (1928 en russe, traduction en 1965), ont été critiquées et amendées par divers structuralistes, laissons-là le débat et retenons les principes.
Doivent être d’abord présentés le cadre et les personnages ; un événement ou un personnage vient défaire une situation stable : l’action peut commencer et met en scène un "héros", qui doit surmonter diverses épreuves (réparer un méfait, par exemple, avec ou sans aide) et le récit s’achève, avec un retour, ou non, à la stabilité, quand toutes les difficultés sont résolues — par exemple, l’ogre ne continuera pas à manger des enfants. Dans Rainal !, le lecteur est vite déçu, le conte s’ouvre immédiatement par un discours du personnage principal ("je") qui coupe court à tout récit développé : « Je suis sorti ce matin. Qu’est-ce qu’il y a à dire d’autre ? » ; seule concession aux contraintes, une précision sur le moment, « C’était le printemps ». Cependant, le cadre général est donné plus loin, sous forme de réponses à des questions que pose un "tu" — lecteur curieux insatisfait des maigres données ?… ; d’où, après l’indication « Je suis d’un pays de France », un ensemble de précisions : « (Tu me demandes où […], pourquoi […], avec qui […], si je suis allé avec eux […], qui m’a amené dans la maison […], ce que je veux faire plus tard […] », et d’autres éléments et personnages apparaissent alors : « les Mandras », — "mandra", mot désignant le renardeau en langue d’oc (cf. mandrat dans Mistral, Tresor dou Felibrige), le costume (le masque de renard ?), la maison (que l’on découvre au début du conte).
Relisons ce début. Dans une maison — il y en a plusieurs — il reçoit un livre illustré qui rapporte l’histoire d’un roi malade qui guérit : c’est là un conte classique, mais notre héros ne fait que le lire. Dans les autres maisons, un enfant se déclare le maître et une mère reconnaît ce rôle à notre héros ; plus loin dans le texte, c’est la séparation d’avec la mère qui est relatée — elle pleure le départ — et le héros se substitue au père : nous lisons (ce qu’est régulièrement un conte) une histoire d’initiation. Il rencontre un chien affamé à qui il cède son croissant ; l’animal, pour le récompenser lui offre le don de voir les choses « en vrai », mais il doit ne jamais en parler (comme dans Les Yeux du renard), amis nous ne saurons pas s’il fait usage de ce don.
Il y aura d’autres déceptions. Grimpant au sommet d’un épicéa pour dénicher des pigeons, le héros, effrayé par les cris des petits qui attendent leur nourriture, est « ivre de peur » et erre jusqu’à ce qu’il puisse se cacher dans une grotte, puis une autre. Il a marché, dit-il, « jusqu’à ce que je sois arrivé », et le récit perd alors toute cohérence : au "je" se substitue un "on" (pour les renardeaux ?), qui cherche et trouve « une laisse de chien » et le "je", à nouveau présent, clôt le conte en invitant un "tu" à lui « raconter une histoire. »
Rainal ! n’est pas ce que l’on classe habituellement dans le genre « conte », ne serait-ce que par sa forme : le texte a plus la forme d’une suite de vers libres que de prose continue — même si les contes en vers existent, ce n’est pas la forme courante ; d’autre part, les divers moments du récit sont fort peu reliés entre eux, c’est au lecteur de reconstruire un fil : le personnage ne part sans doute jamais autrement que dans les livres. C’’est ce voyage dans l’imaginaire que nous découvrons.
Luc Bénazet, Rainal !, Éric Pesty éditeur, 2019, 16 p., 9 €. Cette note a été publiée dans Sitaudis le 2 avril 2019.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luc bénazet, rainal !, conte — recension | ![]() Facebook |
Facebook |
12/04/2019
Sándor Weöres, filles nuages et papillons : recension
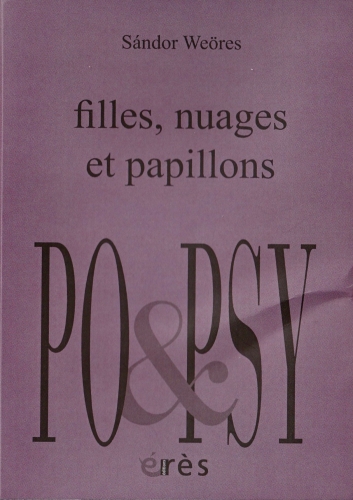
La littérature hongroise contemporaine est peu connue en France, même si l’on peut citer des exceptions comme les récits d’Imre Kértesz (1929-2016), rescapé des camps d’extermination nazis, ou la poésie d’Attila József (1905-1937) dont l’œuvre poétique a été largement traduite. Pour les éditions des quelques poèmes traduits de Sándor Weöres1(1913-1989), elles sont épuisées ; il faut chercher un peu pour lire des traductions en ligne, dont celles de Cécile A. Holdban. Elle donne à la fin de filles, nuages et papillons un aperçu de la vie de ce grand représentant de la poésie hongroise, qui publia très jeune son premier livre grâce au compositeur Zoltán Kodály ; beaucoup de ses poèmes ont d’ailleurs été mis en musique par des compositeurs d’avant-garde comme Peter Eötvös et György Ligeti (qui parle du poète dans son livre L’atelier du compositeur). La traductrice a choisi de présenter, avec le texte original, des extraits, chaque fois brefs, tirés de livres édités de 1933 à 1977, l’ensemble de 1975 étant privilégié pour le nombre de poèmes retenus.
Bien des poèmes constituent de courts récits, sans cependant, le plus souvent, de rapport avec la réalité. Par exemple, avec "Les enfants perdus", le lecteur passe très vite de l’autre côté du miroir ; les enfants avancent en pays connu et, sans transition, la route suivie disparaît et, avec elle, tous les repères : ne demeure qu’une nature luxuriante, l’horizon a disparu — donc, toute possibilité de sortie — et « nous ne retrouverons / plus jamais la route ». Les limites du monde visible sont régulièrement franchies dans la poésie de Sándor Weöres et l’on évolue dans un univers où rien ne se passe qui puisse rassurer ; un pommier surgit d’un coffret, admettons, mais il produit une pastèque ! et la petite Sára (mais qui donc est Sára ?) « en sautant / a cassé le joli coffret ».
Magie de l’enfance qui rend toute chose possible à partir du moment où elle est souhaitée. On peut bien lire de multiples blasons dans la forme des nuages — on se souvient de Baudelaire — et, si l’on oublie la logique qui prévaut dans la réalité, rien n’interdit d’attraper une étoile, de faire route avec un dragon, de rapporter les rêves des chevaux. On ne s’étonnera pas non plus du recours au récit de rêve, le poète jouant en même temps avec la forme ; dans "Infinitif", la même syllabe d’un verbe à l’infinitif revient en fin de vers (« ni »), le poème s’ouvre et se ferme avec « ébredni » (= s’éveiller) : le personnage, devenu oiseau, après une échappée dans la nature revient en ville à son point de départ (« par une fenêtre entrer »).
L’absence de délimitation entre réalité et imaginaire aboutit assez régulièrement à des énoncés à l’écart de toute possibilité de représentation, parfois de tout sens. Il ne s’agit plus alors d’un récit où évoluent des éléments soumis à d’autres règles que celles communément admises, mais bien d’un parti pris de non-sens. D’où des propositions qui sont des énigmes sans réponse, comme « Je viens d’une forêt / où je ne suis jamais allé […] », ou « La porte close regarde la porte close. / Ils sont tant à habiter entre les deux, innombrables ! » ; etc. On pense évidemment à Lewis Carroll et, pour rester avec les écrivains anglais, on relit Chesterton sur le sujet : le non-sens,
« C'est de l'humour qui abandonne toute tentative de justification intellectuelle, et ne se moque pas simplement de l'incongruité de quelque hasard ou farce, comme un sous-produit de la vie réelle, mais l'extrait et l'apprécie pour le plaisir»2
Aucune représentation donc, les seules figures restent les mots, « le silence des lettres sur le papier ». Une autre manière d’introduire l’absurde (comme l’a fait, par exemple, Max Jacob) consiste à proposer des groupes de vers sans rapport entre eux :
Lorsqu’il regarda par la fenêtre
il vit les bienheureux pleurer.
J’ai oublié jusqu’à ton visage.
Là où les lézards couraient, où les couples s’asseyaient,
dans le jardin il n’y a plus que la neige
et les paons se sont endormis.
Sándor Weöres apprécie l’extrême brièveté et abondent les poèmes avec la concision du proverbe (« La poussière se hâte, la pierre a le temps »), réduits à une image (« Cristal de vent ») ou amorce donnée comme impossible à compléter (« Le sens de la vie est le suivant : / (… texte manquant)). Il retrouve aussi le ton de la comptine et celui de la chanson ; le titre "filles, nuages et papillons" est le second vers de la première strophe d’un poème qui en compte 4, les vers 2 et 3, identiques, forment un refrain dans chaque strophe, la première strophe reprise en position 4.
Il n’y a pas refus de la réalité, mais mise en évidence le plus souvent de l’absurdité du monde, du caractère décevant de ce que l’on observe au point que l’imaginaire est un recours devant l’insupportable. Quelques poèmes expriment d’ailleurs le désespoir d’être là, le souhait de ne plus se vivre dans la division :
Ce monde est trop petit pour moi,
seule la mort est vaste, mon pas retourne
dans le cercle du néant
et, paradoxalement ( ?) : « seule la mort peut me faire naître un ».
Cette traduction des poèmes Sándor Weöres est une vraie découverte, et l’on voudrait espérer une édition (plus) complète. Elle est accompagnée de huit encres d’Annie Lacour, feuilles et fleurs — du côté des nuages et des papillons, balance à la mélancolie.
1 Sàndor Weöres, Dix-neuf poèmes, traduits par Lorand Gaspar, Bernard Noël, Ibolya Virag, L'Alphée 1984, éditions Ibolya Virag, 2005 ; Maurice Regnaut (sous la direction de), Trois poètes hongrois, Kàlnoky, Pilinszky, Weöres, Action Poétique, 1985.
2 G. K. Chesterton, Le Paradoxe ambulant, Actes Sud, 2004, p. 151.
Sándor Weöres,filles nuages et papillons, traduction Cécile A. Holdban, encres Annie Lacour, Po&Psy, 2019, np, 12 €. Cette note a été publiée par Sitaudis le 26 mars 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sándor weöres, filles nuages et papillons, traduction cécile a. holdban, encres annie lacour | ![]() Facebook |
Facebook |
30/03/2019
Julien Bosc, Elle avait sur le sein des fleurs de mimosa : recension

La phrase titre débute chacune des 9 séquences du long poème posthume de Julien Bosc. Il s’agit d’un récit de rêve qui met en scène un homme et une femme, sans que l’on puisse, à certains moments, déterminer qui, des deux, rêve, cette indécision étant un des éléments de la construction du texte. L’absence de repères temporels (« Un long temps passa / Des siècles peut-être » ; « Un matin d’hier ; « Les années passèrent » ; etc.) et l’indétermination des espaces sont caractéristiques de cet état dans lequel le réel perd ses contours. Seul un élément du monde est présent d’un bout à l’autre du récit, la mer.
Un château est mentionné mais ce décor d’un certain romantisme est bâti devant la mer, par ailleurs la terre est travaillée par les eaux (« côtes hautes et déchirées ») et la plupart des notations qui la concernent la lient à la mer. Les mots employés n’appartiennent pas tous au vocabulaire courant et sont empruntés au lexique technique ; à côté, par exemple, de phare, digue, jetée, proue, hisser les voiles, larguer les amarres, on lira aussi bollard, musoir, amer, videlle, etc., et certaines expressions sont données avec une valeur figurée comme lester son rêve ou, à propos de la robe de la femme, prendre le large. Ajoutons l’existence de gigantesques navires ; sachant que Julien Bosc a voyagé quelques jours sur un porte-conteneurs (voir La coupée, 2016), on pourrait penser seulement à une fascination pour la mer si l’on oubliait qu’elle figure un lieu sans repère, toujours semblable à lui-même, et qu’elle symbolise toujours, conventionnellement, la vie (comme le liquide amniotique) autant que la mort (les dangers de la tempête), donc l’origine et la fin, une traversée et un retour.
L’image de la boucle (du vide au vide) apparaît très tôt dans le poème ; à la question « D’où venez-vous ? » est donnée une réponse complexe ; d’abord « D’un amour fou », ensuite « D’une racine vivace survivant à chacune des saisons et dont le dernier mot est l’écho silencé du premier » ; à l’idée de la vie qui ne cesse s’ajoute celle du retour, du miroir (qui évoque un livre précédent, Le verso des miroirs, 2018) ; la séquence suivante, donnée entre parenthèses, associe cette idée, avec l’image de la rencontre, à la mort : « (Or / Un matin d’hier / À l’angle de deux rues // La mort). Traversée d’une origine à la disparition. C’est aussi à partir du miroir qui réfléchit la lumière que sont détruits par le feu « Les lieux / Les noms / Les souvenirs (…) / Tout », c’est-à-dire l’espace, le temps, la mémoire (de l’espace et du temps) ; ne subsistent que « elle la fleur la mer » et ce qui est proposé également hors du temps et d’un lieu (« sans début trame ni fin ») et enfin, détachés de la séquence, « Les mots du corps ». On y voit une allusion à un écrit précédent, Le corps de la langue (2016), mais ici se pose la question de la présence, ou de l’absence, du corps.
Paradoxalement le corps apparaît peu dans l’ensemble des séquences. La phrase titre, reprise, implique certes la nudité, et cette nudité est soulignée (« nue et brune », ou blanche comme la dalle de la tombe), mais quand elle est évoquée ce n’est pas dans un contexte amoureux, les mots qui lui sont associés sont tous négatifs : « peine », « amour suffoqué » (donc, étouffé jusqu’à la mort), « trépas », « chancellement », « vertige » ; c’est un corps qui n’a plus d’assise, qui se défait, et l’amour est à peine énoncé qu’il disparaît. Ce mouvement vers la disparition répété plus avant, puisqu’elle fait entrer la nuit en elle, par « l’huis de la vie » ; singulier emploi d’un mot archaïque qui permet l’homophonie, lui, l’absent, apparaît en creux. Lorsque le corps (masculin ou féminin ?) vit l’acte amoureux, il n’est aucunement dans l’échange — soumis, yeux bandés, membres entravés —, sinon dans le « sang d’un baiser » et, une fois encore, tout disparaît dans « la tempête les flammes » ; le feu semble encore présent plus avant dans le poème avec le mot « âtre », dont le contexte (« La mer / Immense large d’huile âtre ») écarte l’idée de feu et oriente vers un autre sens : le mot, archaïque lui aussi, signifie « noir » (latin ater). L’absence d’échange se manifeste également dans une autre scène ; l’homme est mort et enterré, « Seule et nue elle l’exhuma / Le mit en elle une dernière fois ». Ces variations autour de l’inaccomplissement d’une relation amoureuse ont leur pendant dans d’autres rapports à l’autre et au monde.
La femme est, d’abord rêvée, introduite « dans le corps du poème » ; ensemble de mots, elle peut s’écarter de la figure conventionnelle de l’amoureuse et se définir sans relation avec ce que le lecteur attendrait ; ainsi, entrée dans le poème, elle délaisse :
(…) la veille pour les songes
La clarté pour l’ombre
Le feu pour le fanal
(…) Le dialogue pour le ressassement
L’étreinte pour le vide
Ce qui est stable, ce qui évoque fortement le réel, ce qui assure le lien à l’autre, tout cela est abandonné au bénéfice de ce qui est du côté de l’oubli, de la répétition, de l’absence. C’est une figure mélancolique qui s’impose dans ce récit, et les voix de l’homme et de la femme ne s’accordent pas — pour autant qu’elles cherchent à le faire. Poème étrange et attachant autour d’un amour fou, dans lequel les visages de l’amour, même rêvés, ne parviennent pas à sortir du chaos.
Julien Bosc, Elle avait sur le sein des fleurs de mimosa, Préface Édith de la Héronnière, peinture de Cécile A. Holdban, " la tête à l’envers ", 2019, 76 p., 16 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 7 février 2019.
17/03/2019
Marie-Claire Bancquart, Terre énergumène : recension
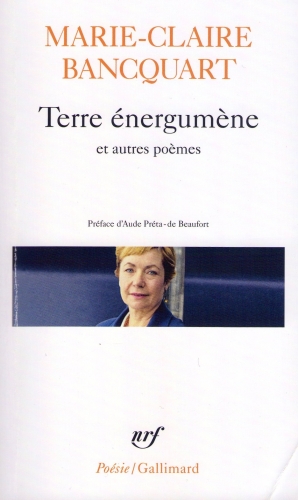
« J’habite le visible »
Le livre rassemble trois recueils publiés en 1994 (Feuilletage de la terre), 2007 (Verticale du secret) et 2009 pour celui qui donne son titre au volume. La préface les présente et parcourt l’ensemble de l’œuvre ; Aude Préta-de Beaufort montre l’unité d’une poésie où « le quotidien, ce qui existe au plus près de soi, les vagabondages de la pensée, de la mémoire, de la rêverie », la présence de l’être aimé mais aussi le doute, la mort dans un monde sans dieu constituent la matière.
Les choses proches, tous ces riens dont la vie de chacun est faite, ce sont un des motifs récurrents de l’écriture. Ce que l’on rencontre dans la ville comme ce que l’on regarde dans la marche sont sujets à s’étonner, on multiplierait sans peine les exemples : ici, « c’est une jacinthe (…) que nous recevons en plein dans les yeux // ou la trace brillante d’un escargot sur une feuille », et là, « des orbes / une tête de lion, une cannelure ». Ce qui retient n’est pas seulement le caractère de ce qui est vu, c’est aussi que chaque chose rappelle que nous-mêmes faisons partie d’un ensemble ; des moments de bonheur y sont liés et l’on rêve même parfois, dans la nature, de devenir animal, le corps alors plus libre « aime de toute sa peau / [et] voit l’exhalaison des sèves ». Mais un insecte sur une pierre, mais un regard bienveillant dans un bus, tous ces « Minimes dons / qui saturent la vie » rappellent également qu’ils sont, comme nous, éphémères.
Ce qui est vécu ne dure pas, qu’il s’agisse des paysages entrevus dans le train par la fenêtre, des reflets du corps dans les vitrines, des mots écrits sur les sarcophages, « tout s’efface / le monde / l’instant / le vide même ». De là, dans la poésie de Marie-Claire Bancquart, le rôle essentiel de la mémoire pour que ce qui a été ne disparaisse pas à jamais. Se souvenir « des jus de notre enfance » aide à vivre la dispersion qu’est la vie de l’adulte, retrouver les odeurs et les bruits des jours anciens, même dans les rêves, fait oublier un moment « la peur d’exister », et les mots sont le moyen de s’interroger sur l’énigme du temps qui a passé. Ce qui demeure plus longtemps, ce sont les œuvres humaines, le taureau de Lascaux qui « s’élance (…) depuis des millénaires », ou les figures mythologiques et littéraires, bribes infimes du passé tout comme les ruines, muséifiées, qui renvoient à l’existence d’une civilisation — et à sa mort. Ce qui peut susciter l’angoisse est cette accumulation de traces muettes, auxquelles on a imaginé brièvement pouvoir redonner vie. Il est possible de se souvenir qu’avant les immeubles, ici — à Paris, mais aussi à Bordeaux ou à Francfort — il y eut des usines, auparavant des potagers, plus en arrière dans le temps des forêts, des friches… Mais si rien du passé ne revit, on peut cependant voir que les ruines sont « bourdonnantes d’abeilles ». C’est souvent le sentiment de ne pouvoir aller au-delà de l’ « entrouvrure des choses », qui s’impose, pourtant ce qu’est l’obscur du monde n’empêche pas du tout de vivre fortement le présent.
Se souvenir du « jeu de l’enfant lointain » ou de l’enfance pendant la Seconde Guerre mondiale n’empêche pas Marie-Claire Bancquart de se préoccuper des conflits du présent, des « barbelés sur la terre entière, aujourd’hui », d’évoquer aussi le parcours tragique de Primo Levi et sa transmission d’une « expérience illisible ». Dans le présent encore, les guerres n’excluent pas que l’on rêve, lise — et aime. Dans les trois recueils réunis, mais tout autant dans les livres précédents, ce n’est pas la souffrance d’être devant l’énigme de la vie, la peur d’exister qui s’imposent, c’est de vivre les jours comme « une traversée de tendresse / près d’un autre corps ». Dans un long poème, "Àtoi, de toi, pour toi", s’exprime sans détour la plénitude de la relation amoureuse : « Est-ce ce que je pense à l’éternel / quand nous nous serrons nue à nu ? // Non, j’évoque l’herbe ou le bonheur d’une bête de grande taille. » On lira souvent dans les poèmes l’éloge du corps amoureux, du désir, de l’étreinte :
Caresse
genou, sexe et tendre cou à son attache
c’est la chair découverte
loin des phrases.
L’éloge n’est pas naïf, Marie-Claire Bancquart n’ignore jamais que le temps qui défait toutes choses atteint aussi le corps amoureux, que l’on « divorc[e] d’avec notre visage de la veille ». Continuer cependant à être là, sur la « terre énergumène », même quand on est devenu un « vieil animal qui flaire l’ horizon »
Il était indispensable de donner à lire largement dans un format accessible une œuvre importante, commencée depuis le début des années 1970. Une œuvre dans laquelle les « choses de rien » (pour reprendre une formulation de Marie-Claire Bancquart), les paysages (la ville, les ruines antiques), l’amour, et tout ce qui dérange (la mort, l’angoisse) ont toute leur place. Comment être plus près du lecteur quand on écrit : « la poésie me semble représenter un besoin vital, une énergie, un moyen d’être « un peu là » en approchant le monde » ?
Marie-Claire Bancquart, Terre énergumène, présentation Aude Préta-de Beaufort, Poésie/Gallimard, 2019, 400 p., 9, 30 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 17 mars 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie-claire bancquart, terre énergumène | ![]() Facebook |
Facebook |
07/03/2019
Hommage à Antoine Emaz (1955-3 mars 2019), recension du dernier livre publié
Prises de mer est le dernier livre publié par Antoine Emaz, en 2018, aux éditions, le phare du cousseix. Cette recension a été publiée par Sitaudis
Dans une caractérisation de la mer, le lecteur lit qu’elle « vient (…) s’affaisser », « Quelque chose comme une fatigue, ou une paresse — de mer lasse » ; plus loin, à propos des vagues, « nerveuse » apparaît après une série d’adjectifs. Rien qui puisse arrêter la lecture, habitués que nous sommes à ce que tout ce qui est vivant ou en mouvement soit décrit de manière anthropomorphique ; Antoine Emaz interrompt son propos et commente : « Parler d’un mer calme ou nerveuse, en colère, ne veut sans doute rien dire mais cela permet de s’entendre à défaut d’être exact ». On reconnaît dans la remarque sa rigueur dans l’usage de la langue, on la retrouve à chaque instant dans les pages de ce Journal, consacré à ce qui est vu, selon la saison, à différents moments du jour.
Anroine Emaz note ainsi précisément des bruits, celui des vagues que l’on écoute dans le sielnce autour, celui des coquillages que le pied écrase et qui se détache au milieu d’autres, celui du vent dont le « poids » et le « mouvement » appelle des comparaisons avec ce qui est vu dans les tableaux de Klee, la flèche organisatrice de l’espace. Sont relevés aussi avec précision les couleurs : bleu de source, (le ciel), gris étain, bleu frais, bleu soutenu (la mer), etc., la couleur de la mer changeant selon l’endroit d’où on l’observe : brune parce qu’elle prend la couleur du sable, puis après « quelques mètres de vert » bleu foncé. Pourtant, ces « prises de mer » ne sont pas seulement comparables à des marines.
Le premier paysage décrit, c’est celui du matin, où la relation entre le mouvement incessant des vagues s’accorde avec le « peu de bruit » et procure une impression de tranquillité. Mais ce qui est récurrent dans ces pages, c’est la saisie du vide de la mer, de l’espace, un vide associé au calme de la marche devant l’eau : elle n’a « ni but ni errance, comme les vagues du bord qui se plient et se déplient ». Ce vide n’a rien d’angoissant, on mesure ce que l’on est quand on prend conscience de la disproportion entre notre corps et l’étendue maritime, « on ne se perd pas, on s’efface pour se retrouver plus loin à l’intérieur, bout minime anonyme du vivant ».
L’action du vent transforme le paysage, le sol s’érode, le sable se met en mouvement et l’on a alors le sentiment de « marcher dans ce qui s’en va ». Il faut ajouter à ce caractère éphémère du paysage (« on passe ») que la perception constante du vide donne à penser que l’espace (de la mer, devant la mer) ne peut être une demeure, seulement un espace de passage ; les humains deviennent vite des silhouettes, des « bâtons verticaux sur l’étendue ». Si l’on tient cependant à les garder comme terme de référence, c’est sans doute « pour croire un peu saisir les choses ». C’est cette saisie des choses, si modeste soit-elle, qui importe : prendre sa mesure, pour Antoine Emaz, c’est toujours la condition pour « ouvrir et libérer ». Il y a, ici comme dans la plupart des écrits d’Antoine Emaz, des réflexions dans la lignée des moralistes classiques — ce qui les rend d’autant plus attachants.
Publié dans Emaz Antoine, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage à antoine emaz, recension de prises de mer | ![]() Facebook |
Facebook |
05/03/2019
Esther Tellermann, Première version du monde : recension

Ce serait sortir du cadre de la simple note de lecture que de montrer la continuité entre les textes d’Esther Tellermann ; notons cependant les liens de ce livre avec Une odeur humaine (2004), également donné comme "récit". Liens formels d’abord : prose qui privilégie souvent des blocs sans ponctuation, passage couramment dans la page d’une séquence à l’autre sans rupture syntaxique « (…) approcher la fin de l’univers, // la plaine est gorgée de sang (…) » (p. 88), introduction de formes considérées comme orales, entrelacement des voix et pas d’indication particulière pour passer de l’une à l’autre. Les rapprochements thématiques sont également nombreux, au point que Première version du monde, sur certains points, pourrait être lu comme une continuation de Une odeur humaine ; à côté de la présence de la Shoah, plus largement du racisme et des massacres de masse, le récit met aussi en scène la relation entre l’homme et la femme — plutôt qu’entre un homme et une femme — dans les échanges amoureux, qui parlent avec des interlocuteurs identiques (Madame, Docteur). En outre ces thèmes sont liés à celui de la disparition (du sujet, de la Terre).
Très tôt dans Première version du monde apparaît l’un des noms utilisés par les antisémites pour parler des Juifs (« youpins, youpinasses »), repris ensuite avec ajout de qualificatifs (« ordure, sale youpin ») ; est évoquée aussi très tôt l’envoi vers les camps de la mort : « on avait rempli les wagons de carnes, futurs cadavres », avec mention de tortures. Autre aspect des destructions, sont également rappelés les temps de la colonisation, avec un bref descriptif raciste de la vie des populations indigènes et un éloge des colons (« y avait pas encore de noms, fallait qu’on vienne ») et de leur action (« on va leur apprendre le vieux monde ! »). Ce type de discours a justifié, et justifie encore, les exactions et l’exploitation des ressources naturelles ; il est répété avec variante dans le récit, cette fois en insistant sur le caractère archaïque des pratiques indigènes, « Ils entouraient les cadavres de feuilles de palmiers, c’était à la naissance de l’Histoire (…) ». À ces « peuplades ignorantes (…) », à cet « abrutissement des races devant un lever de lune (…) », l’occidental oppose et propose ce qu’il est : « on a mieux, // tous en jeans et en baskets, on s’photographie, même que ça r’mue, on s’fait des films… ».
Cependant, si des voix vantent seulement la supériorité de leur modèle, d’autres rejettent la possibilité de toute différence et prônent la disparition de tout ce qui est estimé élément de désordre, « Faudra débroussailler ces youtres, ces nègres ces cafards (…), ce néant puant l’ordure ». Le livre abonde en allusions aux massacres et à la variété des moyens pour les mener à bien, de la machette aux armes biologiques. Éradiquer toute différence serait le moyen de préserver la vie future, « la ville doit être transformée en fosse commune, voilà tout, nous sommes nombreux depuis toujours à vouloir sauver l’espèce humaine ». On reconnaît là un des thèmes de l’eugénisme, pas seulement celui du nazisme mais (souvent) de tout projet d’un "monde nouveau". L’acharnement des humains à (se) détruire met en cause tout le vivant puisque « les océans se recouvr[…]ent de plastique » ; la disparition du monde d’aujourd’hui est vue comme une nécessité pour sortir de ce qui est mauvais (« ils (…) s’appliquaient à récuser la première version du monde ») ou comme un processus inévitable quoique incompréhensible (« nous n’avions pu ni expliquer ni enrayer la volonté humaine d’organiser sa propre fin »).
Voilà une vision peu amène, noircie sans doute par mon choix de retenir tels fragments du récit. Comment dans ce monde à l’avenir incertain peuvent se construire et se vivre les échanges amoureux ? Quel que soit l’état de la société, il est toujours nécessaire de comprendre ce qu’est la relation entre hommes et femmes ; ici, les voix sans visage ne renvoient pas à des personnages romanesques, plutôt au masculin et au féminin, et il n’est qu’une question : « que narrer d’autre que la rencontre de deux corps ? ». Les échanges amoureux évoqués relèvent du désir plus que de l’amour et ils apparaissent fort peu satisfaisants. Les mini scènes érotiques dans le récit ne font pas illusion, elles ne sont que répétition de gestes décevants ; pour lui, « c’est d’une sinistre trivialité ces cuisses ouvertes pour le même remède ancestral je t’aime tu répètes je t’aime, mêmes récidives, remèdes du vieux monde », pour elle, « ça colle cette odeur étrangère, pas lavé le sexe, j’ai rien senti Docteur, ça va trop vite ».
Ne peut-il y avoir quelque accomplissement de soi dans les échanges amoureux ? La recherche n’en est pas absente, mais le résultat toujours dans l’irréel (elle crut, ce serait), c’est dire qu’elle aboutit toujours plus ou moins à un échec. Au-delà des différences — l’homme toujours dominateur, la femme souhaitant être regardée autrement que comme objet de désir — les attentes convergent ; pour lui, la possession « serait une autre façon d’atteindre le ciel ou son envers », pour elle, l’aboutissement serait d’être « aux confins de la vie, plus proche de l’éternité qui ne réclame plus aucun effort pour disparaître ». On rapprocherait sans peine ce lyrisme amoureux, qui associe amour et disparition, de certains récits, par exemple de Bataille. Une autre aspect de la recherche exclut toute tension, rêve cette fois d’un idéal du retour à un temps d’avant tout échange amoureux, quand ce n’est pas à l’enfance.
Il est remarquable que, pour le masculin comme pour le féminin, l’évocation de l’idéal passe par la relation à l’enfance, c’est-à-dire à un moment de la vie où rien du désir amoureux n’a commencé ; pour elle il aurait fallu, non être pénétrée, mais « qu’il s’alanguisse dans un geste enfantin, les choses reviendraient à leur point de départ, l’émoi d’une première rencontre » ; pour lui, « un jour viendra (…) // l’étincelle d’un premier amour (…) // un contact si volatile (…) qu’il ferait croire à une continuité sans fin ». Pourquoi cela ne reste-t-il qu’à l’état de souhait ? Le vécu amoureux ne serait-il que sujet de roman, « illusions de pensionnaire » ? Voyons un autre plan : les conditions de vie, la « misère sociale » dans la "première version du monde" sont sans doute peu favorables à l’épanouissement par les échanges amoureux ; toute l’existence est enserrée dans un cadre rigide, limitée à « quelques actes notariés », et chacun apprend à ne vivre son corps que comme un « sac incongru » avec « une conscience empêchée d’avance ». Rien de possible aujourd’hui, mais peut-on penser un changement comme le laissent plus ou moins croire les derniers mots du livre,
« peut-être demain nous immerge dans une seconde version du monde » ?
Première version du monde offre une vision si complexe de notre monde que d’autres lectures en sont possibles. On pourrait s’attarder, par exemple, aux évocations de ce qui appartient à l’enfance, aux mentions des odeurs, à l’image du corps, à la construction même du livre (les trois parties ne sont pas équivalentes). Le récit d’Esther Tellermann ne se donne pas aisément à la lecture — et c’est tant mieux.
Esther Tellermann, Première version du monde, éditions Unes, 2018, 144 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 10 février 2019.
Publié dans Celan Paul, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, première version du monde, shoah, racisme, échange, désir, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
25/02/2019
La tête et les cornes, n° 6 : recension
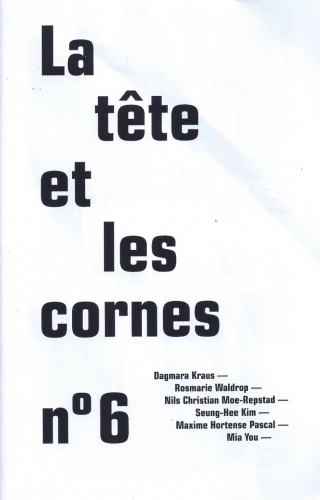
Quelles qu’aient été les conditions dans lesquelles une forme poétique est apparue, elle peut toujours être reprise plusieurs siècles après. Ainsi la fatrasie, née au XIIIème siècle, le plus souvent poème d’une seule strophe de 11 vers rimés selon un schéma précis (6 pentasyllabes suivis de 5 heptasyllabes), qui énumère des actions impossibles à accomplir ; redécouverte au XXème siècle, notamment par André Breton et Paul Éluard*, pour son caractère nonsensique, elle a été revivifiée par la poète allemande Dagmara Kraus (née en 1981), ainsi d’ailleurs que d’autres formes médiévales dont le virelai. Que la traduction de Jean-René Lassalle ouvre cette livraison de la revue montre l’intérêt du collectif qui l’édite pour ce que peut être l’expérimentation par le biais d’une forme délaissée. L’incohérence des deux poèmes retenus ne fait pas de doute :
supposons une seule fois
que oiseaumot infiltre
sa trogne morfondue
plutôt assez tailladée
nonobstant d’extrême circonspection
mi-pointant depuis l’extérieur
etc.
Il aurait été intéressant de donner les textes originaux des deux fatrasies pour qu’un lecteur germaniste (cela existe) saisisse la tension possible entre le caractère incohérent du propos et sa forme.
La présence de l’original, dans un corps plus petit, s’imposerait aussi pour le long extrait d’un livre de Rosmarie Waldrop, Driven to Abstraction (2010), "En voie d’abstraction", traduit par Françoise de Laroque. L’ensemble présenté tourne autour du nombre zéro, en même temps « signe pour une absence » et représenté par un cercle, donc par une infinité de points. Paradoxe que ce qui note « l’idée du rien » soit également « une trace de qui-compte » : l’introduction du nombre zéro est liée historiquement à l’invention de la monnaie (« un système de nombres noue des nœuds autour de rien »), de l’or comme unité de mesure, et en outre contemporain de l’invention de la perspective. À cet ensemble d’abstractions s’ajoute le phonème, « valeur abstraite comme celle du zéro, qui rend possible l’existence du langage » : formation essentielle qui permet sans limite de dire le monde, ce qu’entreprend Rosmarie Waldrop en proposant par exemple une énumération dont les contenus ne relèvent pas du hasard (« Hirondelles, missiles, hélicoptères, corps blessés, bourgeons, lever du soleil [etc.] », énumération qui s’achève par : « champs de fleurs sauvages et champ de mines en un sacré bouquet de confusion ».
Le désordre du monde, c’est-à-dire la vie, s’oppose à l’abstraction. Entre les différents moments des développements à propos du nombre zéro, de la perspective ou de la monnaie sont introduits des éléments très divers qui renvoient au vécu, d’où des phrases telle « Les voisins disent, quel beau bébé » (reprise en quatrième de couverture) ; d’où aussi, nombreux, des énoncés relatifs au corps et au plaisir amoureux, « Les doigts de la main droite errent sur les parties intimes et les doigts de la main gauche effleurent les seins ». Que les abstractions aient leur nécessité ne peut faire oublier qu’il n’y a pas d’autre monde que celui où nous sommes, et que « C’est encore sur notre cul que nous sommes assis ».
Le poème de Maxime Hortense Pascal interroge également le quotidien, ce qu’est le corps parmi d’autres corps, ce que deviennent les tentatives de dire ce qui est devant soi, ce qu’est un monde où « l’air tient le choc pour le moment ». Poème tout de questions sans réponses possibles, si ce n’est contre l’oppression, contre la destruction le conseil répété d’aller vers la nature, de la parler :
Épelle le nom de la renoncule à feuilles d’ophioglosse ranunculus ophioglossifolius ne la renonce pas rappelle son milieu ouvert son milieu humide son milieu menacé
L’image de la sole blanche sur une assiette blanche dans le poème de Seung-hee Kim (traduit du coréen par Camille Bessette et Hyun-jee Cho) aboutit d’une autre manière à interroger le monde contemporain, la poète concluant « l’extérieur s’immisce toujours en nous par violence ». Dans une prose autour de la musique, traduite par Martin Richet, Mia You évoque le temps de l’enfance et le fait d’être un sujet par la musique, « chaque note jouée pour dire que nous existons ». Une livraison de La tête et les cornes comprend presque toujours un poète d’un pays nordique ; Emmanuel Reymond traduit cette fois le norvégien Nils Christian Moe-Repstad. Poésie très elliptique qui creuse dans la mémoire des temps géologiques, mémoire inscrite dans les pierres, temps gravé dans un espace.
La variété des textes dans la forme comme dans l’origine linguistique caractérise depuis le premier numéro la revue. Il faut ajouter que la couverture est faite pour se déplier : on obtient une feuille de 42cm sur 27,50cm illustrée cette fois de quatre images, chacune légendée en espagnol (tournage, décollage, vol, atterrissage), sous le titre général " Tentativa de sobrevolar un cuerpo invertido " — la tentative échoue…
On peut s’abonner à la revue en écrivant à :
lateteetlescornes@gmail.com
* Voir Paul Éluard, Première anthologie vivante de la poésie du passé (Seghers, 1951).
La tête et les. Cornes, 36 p., 6 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 2 février 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la tête et les cornes, n° 6, poésie étrangère | ![]() Facebook |
Facebook |
11/02/2019
Ana Tot, mottes mottes mottes
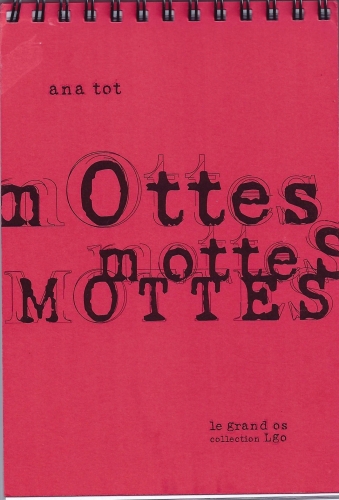
On ne peut pas choisir pour pseudonyme un double palindrome (Ana + Tot—Thot, dieu des scribes et de la parole) sans avoir un goût prononcé pour toutes les manipulations possibles de la langue, et c’est le cas : l’auteur, à sa manière, s’apparente aux Grands Rhétoriqueurs pour l’invention, la virtuosité et l’humour. Il joue avec la syntaxe, la morphologie, la prononciation, avec les figures de rhétorique, le sens des mots, la versification sans qu’il soit aisé de proposer des classements. Le livre lui-même rompt joyeusement avec la pratique éditoriale ; il se présente sous forme d’un carnet à spirale (16 cm x11 cm), avec une première et une quatrième de couverture semblables, on peut donc commencer à lire d’un côté (numérotation paire des pages) ou de l’autre (numérotation impaire), en résistant à la tentation de lire successivement, par exemple les pages 1 et 114 ou 3 et 113. Le titre est un exemple de ce qu’est le contenu, puisqu’il s’agit d’un jeu sur le genre grammatical, précisément sur des paires de mots que l’on retrouve dans un des poèmes avec « la manche est creuse / le manche est plein » ; donc, « mottes » comme un féminin de « mot ».
Le déplacement du masculin au féminin prend une autre forme avec, parallèlement à « cousins / cousines », « en limousin / en limousine ». On ne s’étonnera pas de lire des inversions du genre grammatical (« le fibre le tige le sève / la fruit la nœud la gland [etc.] » (un mauvais esprit trouvera ici des allusions sexuelles), y compris avec la neutralisation de l’article (l’) : « l’écorce l’humus l’humeur ». À partir du moment où l’on examine les paires de mots possibles, la langue permet d’innombrables possibilités ; à côté d’une anagramme comme « suave / sauve », l’homophonie donne de nombreuses séries : de « scènes d’amours saines » à « le bout bout / le vagin geint » et aux approximations telle « et cetera / se-taira / c’est-tes-rats ». La répétition d’un son, y compris la rime) est à la source d’un poème sur les parties du corps : à chacune est attribuée une chose qui se consomme, introduite par l’anaphore ’’pour le (variante les, la) : « pour le teint le thym / pour les narines des mandarines / pour la brioche une brioche ; etc. ». On passera de l’homophonie à l’à-peu-près avec « un nom brille dans nombril » qui se poursuit en « l’anneau vrille le nom brûle ». On changera le sens en changeant une consonne (« soit tu l’arraches / soit tu t’arraches »), une voyelle (« mère / mort », « père / peur ») ou en introduisant dans un groupe en chiasme une consonne au bon endroit (« de peines la coupe / du couple est pleine »).
Jeux de sens avec par exemple « il nia rien/ il nia rien-à-dire », et jeu du sens et des sons avec l’allitération, dans un poème comme : « lente lapée // longue / langue / lasse /laisse / l’os /lisse ». Un autre poème repose sur l’assonance, « résumé // corps ciseau / corps fuseau / corps tuyau //corps // chaud », et allitérations et assonances peuvent se mêler :
guerre / un
à bas l’abus
à bas l’abat
à bas l’abus d’abats
l’obus s’abat sur les absts
à bas l’abat d’obus
à bas l’envoi là-bas
à l’abattoir
à bas
Il faudrait aussi examiner la versification, où rien n’est laissé au hasard ; ainsi, chaque vers d’un poème commence par un pronom élidé, « j’la cultive / ell’ colporte / j’la calfeutre ; etc. », atteinte à la morphologie et moyen de compter chaque fois 3 syllabes ; dans tel autre poème, est répétée trois fois la structure « vers de 4 syllabes / une syllabe / une syllabe / une syllabe ». Etc. Il faudrait s’attarder à des variations complexes à partir de deux mots, "rien" et "mieux" (« il n’y a rien de mieux que rien mieux que rien / ; etc.), à la manière d’illustrer le mot "anamnèse", à tel micro récit qui renoue avec le non-sens carrollien, etc.
On pourrait à la suite de mes quelques remarques ne voir dans un tel livre qu’un ensemble de jeux ; ce serait déjà beaucoup mais mottes mottes mottes n’est pas une production de l’Oulipo et l’on y trouvera autre chose qu’un plaisir de l’invention. Avec "persona" est esquissée une vision de notre société, « on n’est plus vu / dès qu’on est nu // le vêtement ment / si le silence / et le mensonge / habillent ; etc. » ; l’usage de l’homophonie et de la rime peuvent être au service d’un engagement sans équivoque :
les embruns humectent le sang brun
des hommes tombés sur le rivage
à l’abattoir où vont les uns
répond soudain le sang des braves
c’est toujours soi qu’on assassine [etc.]
Ana Tot, avec tous les aspects ludiques de son livre, a le sérieux de qui entend bien « faire / mordre aux mors ordinaires / la poussière du désordre ».
Ana Tot, mottes mottes mottes, le grand os, 2018, 118 p., 12 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudisle 23 janvier 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana tot, mottes mottes mottes : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
05/02/2019
La revue de Belles-Lettres, 2018-2 : recension
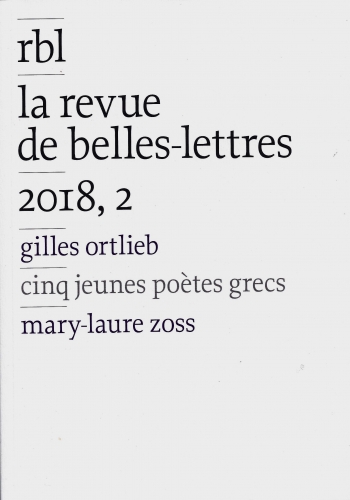
La dernière livraison de la revue éditée à Lausanne propose un dossier consacré à Gilles Ortlieb, occasion de reprendre quelques-uns de ses livres parmi la trentaine publiée. L’ensemble s’ouvre avec une prose, comme issue d’un journal si l’on se fie aux dates qui la jalonnent, autour d’un passage dans une ville, Arles, que la vie semble en partie abandonner ; l’imagination lit des traces de délaissement qui, progressivement, iront « Jusqu’à ce que les anciens marais reprennent possession des jardins et de la campagne environnante ». Journal ou carnet duquel des notes seraient extraites ? le lecteur reconnaît une manière analogue de regarder les choses du monde dans les essais et les poèmes.
La vision de la ville de province, celle de l’essayiste qui « replace[…] sous la lampe » des écrivains peu ou mal lus, s’accordent en effet avec ce que Jacques Réda met en valeur dans l’œuvre. Chaque fois, Gilles Ortlieb « discerne, dans le fouillis du réel, cet inaperçu qui paraît en être l’accessoire sinon le rebut »., il « enregistre, et s’en tient là » ; il saisit le réel comme l’a fait le peintre Thomas Jones,, notamment avec en 1782 Un mur à Naples : on y voit, au milieu d’une muraille dont le crépi s’écaille et laisse apparaître les pierres, deux fenêtres closes et, séchant à la rambarde d’un petit balcon de l’une, un drap et (peut-être) une couverture, et à une ficelle fixée au mur, un vêtement blanc, un autre bleu ; au-dessus à gauche un pan de mur, le ciel bleu à droite : rien d'autre. La comparaison avec le peintre anglais est forte : il y a chez Gilles Ortlieb un semblable « souci d’exactitude » qui, selon Jacques Réda, est peut-être « la seule parade que nous puissions opposer au rien qui, dans l’inaperçu, puise le moyen paradoxal de revêtir toute une variété de formes. » Patrick McGuinness, lui, insiste sur le mélange des genres, le chevauchement des formes dans l’écriture de Gilles Ortlieb qui, prenant toujours pour motif les choses ordinaires de la vie, parvient à y distinguer ce qu’elles contiennent de mystérieux, d’inattendu. C’est que notre quotidien est « comme perçu à travers un télescope tenu du mauvais côté » ; de là non seulement la mise au jour de ce qui demeure caché pour la plupart d’entre nous mais aussi, régulièrement, la « révélation d’une sorte d’algèbre kafkaïenne ».
Le quotidien a sa part dans les extraits de la correspondance (année 1984-1985) avec Henri Thomas, qui fut un modèle pour Gilles Ortlieb avant d’être un ami. Chacun fait part à l’autre de ses activités, de ses lectures, de ses voyages — l’ensemble s’achève avec une longue lettre d’Ortlieb à propos de l’île grecque où il se trouvait. Les difficultés de la vie sont présentes : Henri Thomas propose par exemple son aide pour l’édition d’un texte, Ortlieb, qui traduisait pour une collection aux éditions Laffont, pose une question sans réponse, « Comment concilier gagne-pain et le reste ? La question m’a l’air souvent insoluble ». Comme il le raconte dans une lettre, elle l’est aussi pour Paul de Roux, qui dirigeait la collection : de retour d’une semaine en Bretagne, « il avait suffi d’un jour pour que Laffont lui pèse à nouveau bien lourd ». Mais tous deux s’accordent dans leur correspondance sur la nécessité de l’écriture, sur « la chimère d’y voir plus clair dans la vie et le réel » grâce à elle.
Gilles Ortlieb écrit également à propos d’autres écrivains, ici du dramaturge Arthur Adamov dont il relate quelques moments de la vie*, et, passeur, il est traducteur de l’allemand, de l’anglais et du grec : il donne dans ce numéro cinq bref récits de Tanassis Valtinos. Son "autoportrait" est construit à partir de ses propres proses par Marcel Cohen, non pas pour caractériser l’œuvre mais retenir quelques attitudes de l’écrivain devant le monde ; ainsi dans cet extrait, « Quelle est la nature du plaisir que l’on éprouve (…) à se trouver là où l’on ne devrait pas être et à fuir autant que possible chaque fois que cela est possible, les lieux où la plupart jugent bon de se trouver ? »
À côté de ce dossier, le lecteur retrouvera ou découvrira dans la revue une figure un peu oubliée, celle d’Armel Guerne, poète et grand traducteur, grâce à un hommage de Jean-Yves Masson qui insiste sur l’importance du rôle du rêve chez ce traducteur de Novalis et des romantiques allemands. Un autre écrivain un peu à part, Jean-Loup Trassard, est lu par Mary-Laure Zoss ; attentive au rythme et à l’allure des textes, à « une langue qui engage le corps et le souffle » ; elle montre qu’il se tient dans son œuvre au plus près du vivant et qu’il a su restituer une présence à une civilisation agraire en voie de disparition. On lira encore, réunis par Jean-Daniel Murith, cinq jeunes poètes grecs (dont quatre femmes), non encore traduits, et une longue note de lecture qui clôt le riche sommaire, à propos de Un nouveau monde, poésies en France 1960-2010, d’Yves di Manno et Isabelle Garron ; Jacques Lèbre en regrette les limites, avec des choix qui excluent, d’Edmond Jabès à André Frénaud, de Robert Marteau à Philippe Jaccottet.
* La revue Europe a consacré son numéro de janvier-février 2018 à Arthur Adamov, numéro évoqué par Gilles Ortlieb.
La revue de Belles-Lettres, 2018- 2, Société de Belles-Lettres de Lausanne, 208 p., 25 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 18 janvier 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la revue de belles-lettres, 2018- 2, gilles ortlieb, adamov, réda, zoss, masson | ![]() Facebook |
Facebook |
31/01/2019
Michel Collot, Le parti-pris des lieux : recension
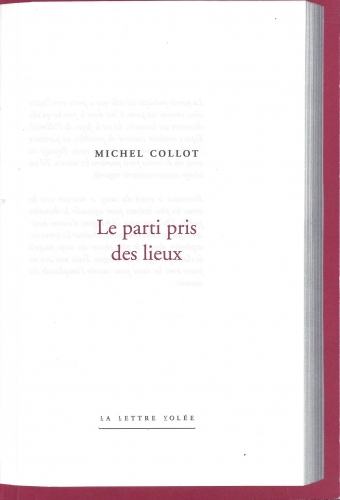
Connaisseur de la poésie moderne et contemporaine, Michel Collot a beaucoup écrit à propos du paysage*. Le parti pris des lieux rassemble pour l’essentiel des poèmes en prose à propos de paysages ’’naturels »’’, puis de paysages urbains ; suivent une série de rêves et des poèmes écrits après une résidence à Charleville. Les dernières séquences constituent une ouverture, réflexions sur l’architecture grecque et sur des peintures de paysages. Ajoutons que, d’un bout à l’autre, l’écriture des paysages est souvent moyen de définir ce qu’est pour lui la poésie.
Les paysages, vus directement ou réinventés grâce aux tableaux, sont des espaces explorés de diverses manières et liés au temps, ‘’lieu mémoire’’. Deux courts avant textes annoncent ces caractéristiques, j’en extrais la première phrase : « La parole poétique est celle qui se porte vers l’autre rive, comme un pont » et « Remonter le cours du sang, se tourner vers les zones les plus intimes pour agrandir le domaine public ». Ce qu’apprennent les proses données autobiographiques, c’est l’absence pour Michel Collot d’ancrage dans un paysage pendant l’enfance, contrairement à celui qui, né dans un village de Bourgogne ou des Landes, apprécie d’en dire les charmes ; il a vécu dans cette absence de lieu qu’est toute banlieue, loin de la Champagne paternelle et du Vaucluse maternel : « n’étant nulle part », il devint capable d’une « adhésion fugitive » à un lieu jusqu’alors inconnu, chaque fois que « le temps d’un instant, se nouait un certain accord entre moi et le monde, entre le ciel et la terre, entre la nature et les hommes. » C’est ensuite par l’écriture qu’il invente ses propres paysages.
L’inconnu ne devrait jamais être inquiétant, il apparaît plutôt comme une chance puisqu’il oblige chaque fois à « faire l’épreuve de [notre] relation intime avec le monde » et, ce faisant, à reconnaître notre « appartenance au monde ». L’écriture du paysage, à partir de ces prémices, abandonne l’idée commune du lyrisme comme expression du moi : il est ici « expression du sujet hors de soi qui explore son propre inconnu à travers l’étrangeté du monde et des mots ». Ce sont des fragments de cette exploration qui sont proposés, les paysages les moins aimables pouvant être appréciés. Ainsi, on sait que « la mondialisation habille le globe de teintes uniformes », cependant rien n’empêche de voir la ville autrement que grise et de la réinventer à partir des matériaux disponibles devant soi. Un exemple : Michel Collot, assis un soir d’hiver dans un abribus, voit sur l’immeuble en face de lui la mention d’une pension de famille et il commence à « imaginer la vie des pensionnaires », puis il découvre dans les vitres d’une fenêtre ouverte « un paysage inaperçu », enfin une jeune fille à sa fenêtre le fait rêver — jusqu’au moment où l’autobus arrive. Ce poème récit illustre la manière dont peuvent se révéler autres les choses du monde.
Il faut évidemment prêter une attention particulière à ce qui nous entoure pour comprendre, non qu’il y a des choses cachées dans le quotidien mais plutôt qu’à tout moment peut naître une émotion, que l’imagination s’empare aisément d’un détail. Alors, le lieu et le temps se transforment, parfois de manière inattendue : ainsi, « au bord du précipice (…) on plonge dans les entrailles de la terre » et, entre les murettes, on s’égare dans un « dédale de couloirs » vers quelle issue ? « le vide », et l’on se dit, en l’espérant et en le craignant : « Le Minotaure nous y attend » — avant à nouveau de marcher sur un sentier plus avenant. Un autre ’’lieu’’ privilégié — espace et temps s’y confondent — est le sommeil, grâce auquel le narrateur « plonge dans la nuit des temps, descend au fond de la grotte obscure des sensations. » La paroi où la cordée progresse est aussi mouvement vers l’inconnu et la plus petite erreur peut conduire à la chute, alors « une main se tend, une voix répond », « L’échange est renoué », la chute écartée. Il est donc des lieux dangereux qui, par leur nature même, peuvent conduire à la disparition. Dans les poèmes de Michel Collot, le vide est toujours proche : celui des cauchemars n’est dissipé que par le jour, qui aide à « échapper à l’abîme du sommeil et à la masse obscure des rêves. » Le vide est également présent dans la vie de chaque jour, ainsi la jeune femme qui a fait rêver le narrateur « s’appuy[ait] sur le garde-corps », et lui-même prend garde à vérifier, lorsqu’il se trouve à un étage élevé, qu’un appui à une fenêtre le préservera de la chute ; dans un rêve, il voit une « rambarde très basse » et, rapporte-t-il, « je crains de tomber ».
Il faut sans cesse ouvrir les yeux pour voir ce qui échappe au premier regard pour lequel tout est indistinct, et comprendre progressivement que toujours un « rayon (…) perce à jour toutes choses (…) : les voici de nouveau visibles, et rendues à leur part d’invisible. » Ainsi la poésie : beaucoup « de mots éculés, sans cesse remâchés pour retrouver enfin par la grâce d’une image la saveur de la langue. » Cette exploration des lieux est sans cesse révélation, des « ramifications secrètes » de la paroi rocheuse au surgissement de la rivière un temps partie dans « l’épaisseur obscure » de la terre. Ainsi de la poésie : « la ligne devient sens, le sens prend la tangente — tangent à l’infini ».
Michel Collot, Le parti-pris des lieux, La Lettre volée, 2018, 128 p., 19 €.Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 28 décembre 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel collot, le parti-pris des lieux, exploration, inconnu | ![]() Facebook |
Facebook |





