06/10/2024
Étienne Faure, Séries parisiennes : recension
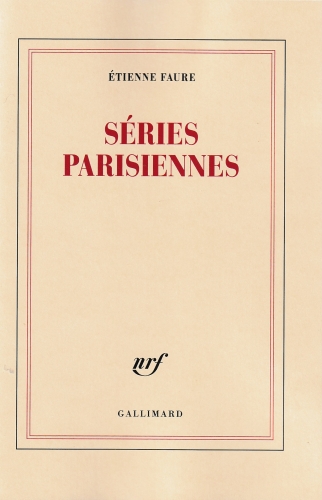
On pourrait rêver de réunir les poèmes, vers et proses, écrits à propos de Paris entre 1900 et aujourd’hui, on aurait sans doute le sentiment qu’il existe plusieurs villes du même nom dans le même lieu, d’Apollinaire à Réda, de Léon-Paul Fargue à Roubaud. Séries parisiennesentrerait aisément dans cet ensemble, on y entend la voix particulière d’Étienne Faure, sa manière de vivre la langue qui invente "son" Paris, on y reconnaît des motifs présents depuis ses premiers livres, on y retrouve une forte attention à la composition et à l’unité d’un ensemble.
Séries parisiennes est composé de 16 ensembles, tous titrés "Côté + nom" : "Côté Seine", "Côté rue" pour les premiers, "Côté voix", "Côté H" pour les derniers. "Côté cage" (la cage de l’ascenseur d’un immeuble) rassemble « Dix-sept haïkus dans l’ascenseur » de construction syllabique régulière (5-7-5) ; tous les autres groupes comptent 6 vers ou proses, sauf "Côté mains" avec 12 quintils — donc 15 groupes de 6 vers à quoi s’ajoutent 6x2, soit à nouveau 17. Jeu des nombres et la thématique hors la cage est présente dans les haïkus : le baiser, les oiseaux, les voix, les écrivains (avec Balzac), etc. Les figures sont limitées à quelques paronomases, « les remous/les rumeurs », « intemporelles/intempéries », « se carapatent/Carpates » ; l’emploi du vocabulaire noté familier ou argotique par les dictionnaires, très rare chez Étienne Faure, est présent ici peut-être pour mieux marquer le caractère urbain de l’ensemble (zef, se tirer, (d’une femme) la mieux roulée, piaule).
La phrase des poèmes se développe le plus souvent à partir d’un mot ou d’un thème ; elle peut s’ouvrir avec deux mots repris à la sortie en ordre inverse avec changement de genre, (nom/ adjectif, « le vert et le noir »/« paysage noir et vert tendre »). Dans la prose d’ouverture, le lecteur passe de fenêtre à spectacle, manteau d’arlequin, théâtre, scène de genre, acte un, acteurs, jeu, chandelle (pour évoquer le théâtre ancien). Ces reprises sont un des moyens pour construire des poèmes, en prose ou en vers, d’un seul tenant, l’unité pouvant aussi être obtenue par l’emploi d’un ensemble homogène de couleurs : dans le second poème du recueil pour caractériser la saleté de la Seine, « vert trouble », « or gris sale », « eau rouille », couleurs opposées au bleu outremer, à l’azur. L’aspect trouble de l’eau n’empêche pas son mouvement, symbole habituel du « temps qui coule », comme l’eau « passe et file » vers la mer.
Le ton est donné, on ne découvrira pas un Paris insolite, pas plus que ses monuments ; rien d’autre à voir que le quotidien, ce qu’offrent la rue, les bancs, les allées du cimetière, les parcs, quelques personnages résolument à l’écart de la société, « (ces) vieux Rimbaud qui marchent ». Rien que le quotidien et s’attacher à ce qui échappe souvent au regard alors qu’il suffit de lever la tête, suivant en cela le Baudelaire des fenêtres : « Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. » Le piéton des Scènes parisiennes observe ce qui semble être une « scène de théâtre », reconstitue ou invente « Tout un fracas de vies intérieures », engrange un matériau offert à qui veut le voir tout comme il saisit au cours de ses marches des phrases, des fragments de récits. L’observation des habitués des bancs, dans les parcs, est différente. Immobiles et souvent silencieux, ils semblent « à l’écart du temps qui passe », dans un autre univers, celui des souvenirs.
Le narrateur sans cesse imagine des vies, également des scènes amoureuses où le couple, bien que dans la chambre, semble hors du monde de la ville, comme s’il s’étreignait sur un « grabat de feuilles / de paille » et s’entend aussi un « froissement de litière » ; l’étreinte entraîne un vocabulaire connotant la nature et elle impliquait également une position des corps pour rappeler la dyade Éros-Thanatos : devenus des « gisants » et « leur mort est à son comble ». Il reconstitue aussi des ruptures (« pour avoir trop bu »), l’un partant « refaire sa vie », ou « attendant l’autre (elle ne vient pas) ». Tout peut être point de départ d’une fiction, voix et gestes glanés dans les rues suscitant de courtes pièces. Cette attitude de voyeur en quête de ressources est d’ailleurs dite dans un poème qui renvoie le lecteur « aux livres anciens » où un personnage observe une scène érotique par le trou d’une serrure avant de devenir lui-même acteur.
Les livres — les livres de poèmes — sont partout dans les Séries parisiennes. Un ensemble de poèmes est consacré à des écrivains qui, tous, ont été attentifs aux choses ordinaires de la vie ; ils sont nommés (Follain, Guillevic, Réda, Goffette, Vaché), ou reconnaissable par un détail, Stéfan par « litanies », « Judas », plus clairement par « stéfaniennes ». À côté de ces hommages, le lecteur collecte des citations, de ces auteurs et, dans les poèmes, de Rimbaud (« On ne part pas »), de Ronsard ("Mais ce mien corps enterré/s'il est d'un somme fermé/Ne sera plus rien que poudre »), fragment recopié par le narrateur qui le lit au Père Lachaise. Il repère une allusion probable à un titre d’Étienne Faure (Vues prenables, 2009) dans « Rêvent-ils (…) d’autres vues imprenables », ou il se souvient du Verlaine de Sagesse(« Le ciel est, par-dessus le toit ») avec « La mort est par-dessus les toits ».
La mort est présente pour le narrateur par le souvenir des disparus, proches ou non, par le souvenir de ce qu’ils furent ; ainsi la mère définitivement absente, « un beau vide », ou tous ceux devenus sans visage ; parfois, il se vit « rattrapé par le néant des aïeux sans racines, qui n’auront bientôt jamais existé ». À côté des drames personnels, l’Histoire est le temps pour tous de la mort ; le dernier ensemble, est titré « H » — initiales dans « Les Humbles champs d’Honneur de l’Histoire Humaine » — et plusieurs recueils d’Étienne Faure s’achèvent avec l’évocation de ce qui ne fait en rien honneur aux humains. La guerre était annoncée par les cloches et leur bruit peut encore l’évoquer, trace d’un autre temps, comme les couteaux des bouchers dans un abattoir ; pour le narrateur, c’est le grincement des roues, des freins d’un vélo qui appelle le souvenir des années 1940 et des rafles de juifs, l’envoi dans les camps d’extermination, ce sont aussi les déformations du corps à cause des privations qui restent les empreintes des années de guerre.
Les potences finissent par être « arrachées » et tous sont enfin « à l’air libre »… On sait bien que la poésie ne changera pas le cours des choses, qu’elle n’empêchera pas le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie (parmi d’autres plaies trop présentes) de prospérer ; cependant, qu’un ensemble à propos d’une perception très personnelle de Paris se termine en évoquant la peste brune, toujours vivante sous des formes plus ou moins avenantes, n’est pas indifférent.
Étienne Faure, Séries parisiennes, Gallimard, 2024, 156 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 19 juillet 2024.
Publié dans Faure Étienne, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne faure, séries parisiennes, recension | ![]() Facebook |
Facebook |






Les commentaires sont fermés.