16/03/2012
Jean-Claude Pinson, Laïus au bord de l'eau

J'écris parfois dans l'allégresse
parfois dans les douleurs du doute
bénignes certes mais réelles, physiques
maux d'estomac mauvais sommeil
je me lève en aveugle me cogne
vais dans mon bureau, dérange un papillon de nuit
nerveux palpite contre des feuilles blanches
tourne des pages, les rature
trouve un goût de vin frelaté à mes vers
ai bien envie de tout laisser en plan
alors j'ouvre des livres
cherche des modèles, des mots qui fusent
cailloux lancés par une fronde,
goûte des vers puis les recrache
m'essaie à jouer les sommeliers :
« ça, insipide, trop fade venaison
vers ennuyeux à faire fuir
les déjà peu nombreux lecteurs de poésie
ça par contre superbe, à la fois subtil et corsé :
Réda dont il faudrait pouvoir prendre la roue
mais comment faire ? compter sur l'alchimie
de quelques verres de vin ? autant que l'univers
c'est un entier mystère impossible à percer
même avec le secours de l'or d'un Mercurey
versé dans de nombreux ballons
qu'un jour à quelques-uns nous partageâmes à Lyon »
la tête en feu je tente à nouveau de dormir
comptant sur l'alambic de la nuit
pour qu'au matin mes vers soient à peu près buvables
filent moins lourdement qu'ici la métaphore
Jean-Claude Pinson, Laïus au bord de l'eau, Champ Vallon,
1993, p. 46-47.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude pinson, laïus au bord de l'eau, écrire | ![]() Facebook |
Facebook |
15/03/2012
Aragon, Je 'ai jamais appris à écrire, ou les incipit
 Ce commencement de moi... j'ai très vite appris à lire, au sens enfantin qu'on donne à ce verbe. C'est-à-dire reconnaître les lettres, les associer, démêler les mots, en sortir un sens, prendre conscience de la chose écrite, pouvoir l'énoncer à mon propre étonnement. Mais quand on me mit un crayon dans les doigts, et qu'on entreprit m'enseigner comment le tenir, en tracer des signes séparés et tout ce qui s'en suit, j'eus une espèce de révolte. Je refusais d'entendre la signification de ces exercices, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que, puisque je lisais, difficilement encore il est vrai, des caractères formés par quelqu'un, avec une certaine fierté par exemple de reconnaître le lion dans quatre lettres liées, il allait de soi que je devais m'appliquer à répondre à l'écrit par l'écrit, à écrire moi-même. On avait beau s'attacher à me l'expliquer, je ne voyais là rien de raisonnable, puisque je pouvais parler, crier le mot LION, et même imiter le lion par le geste, le grognement, et la fureur, comme je l'avais vu une fois au Jardin d'Acclimatation. Mais l'écrire, pourquoi faire ? puisque je le savais déjà.
Ce commencement de moi... j'ai très vite appris à lire, au sens enfantin qu'on donne à ce verbe. C'est-à-dire reconnaître les lettres, les associer, démêler les mots, en sortir un sens, prendre conscience de la chose écrite, pouvoir l'énoncer à mon propre étonnement. Mais quand on me mit un crayon dans les doigts, et qu'on entreprit m'enseigner comment le tenir, en tracer des signes séparés et tout ce qui s'en suit, j'eus une espèce de révolte. Je refusais d'entendre la signification de ces exercices, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que, puisque je lisais, difficilement encore il est vrai, des caractères formés par quelqu'un, avec une certaine fierté par exemple de reconnaître le lion dans quatre lettres liées, il allait de soi que je devais m'appliquer à répondre à l'écrit par l'écrit, à écrire moi-même. On avait beau s'attacher à me l'expliquer, je ne voyais là rien de raisonnable, puisque je pouvais parler, crier le mot LION, et même imiter le lion par le geste, le grognement, et la fureur, comme je l'avais vu une fois au Jardin d'Acclimatation. Mais l'écrire, pourquoi faire ? puisque je le savais déjà.
C'était le plus grand obstacle que ceux qui voulurent m'enseigner l'écriture trouvaient sur leur chemin. Un obstacle quasi insurmontable, tel était mon acharnement. Et je trouvais ces gens stupides, lesquels n'entendaient pas ce que je leur disais, qui me paraissait l'évidence, je cassais mon crayon ou je le jetais par la fenêtre. Enfin on y renonça, ma mère disait que c'était affreux, un enfant qui ne saurait jamais écrire. Moi, je m'en passais. Je dictais ce qui me traversait la tête à ces deux tantes que j'avais, et je constatais qu'après, leur gribouillis restituait pour d'autres yeux ce que j'avais dit, très exactement. Si bien que la parole dit me paraissait fort suffisante.
Aragon, Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipit, "Les sentiers de la création", éditions Skira, 1969, p. 9-10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, je n'ai jamais appris à écrire, ou les incipit, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
14/03/2012
Zbigniew Herbert, Corde de lumière, Œuvres poétiques complètes I : recension

Les œuvres de Zbigniew Herbert (1924-1998) — une dizaine de livres de poèmes, des essais — restent peu connues en France(1). Le premier volume des œuvres poétiques (qui en comprendra trois) rassemble Corde de lumière (1956), Hermès, le chien et l'étoile (1957) et Étude de l'objet (1961) ; il est précédé d'une "conversation de l'auteur avec lui-même" autour du thème de l'écriture de poèmes. Parallèlement à cet ensemble, paraît un volume d'essais, Le Labyrinthe au bord de la mer (2000 en polonais, donc posthume), consacré aux voyages du poète en Grèce et en Italie et à ses réflexions sur l'Antiquité ; il sera suivi de deux autres.
On peut commencer l'exploration des poèmes, en vers et en prose, en examinant ce que Zbigniew Herbert rejette. Dans les réponses qu'il propose à ses propres questions, il marque nettement son refus du réalisme socialiste qui ne tient aucun compte de la réalité observable. Il revient sur ce point à plusieurs reprises dans ses poèmes, par prudence sans allusion directe à ce qu'imposait le pouvoir en Pologne mais sans aucune ambiguïté. Un écrivain peut sans doute présenter un monde idéal, décrire les choses quotidiennes en gommant toutes aspérités, et donc ignorer que le réel s'imposera à un moment ou à un autre ; ainsi l'image de la "La chambre meublée" [titre d'un poème] sera, pour ne pas choquer, celle d'un « monde faux » — mais « du papier peint arraché / des meubles non apprivoisés / les taies des glaces sur le mur / voilà l'intérieur réel » (p. 225). De manière analogue, il est inutile de peindre « toute la nuit en rose » les murs gris de la prison : cela n'empêchera pas l'enfermement. Donc, il faut sortir des leçons imposées, quoi qu'il en coûte — et Z. Herberrt a payé le pris — et tenter de dire ce qui est en sachant que tous « nous avons des cailloux / noirs à la place des yeux » (p. 75).
Quoi écrire ? « [...] le domaine des choses, le domaine de la nature me semblait être un point de repère, et également un point de départ, permettant de créer une image du monde en accord avec notre expérience » (p. 17). Donner une "image du monde" en choisissant pour point de départ un tabouret, des chaises ou une table, c'est aller contre toute idéalisation de la réalité et, en même temps, affirmer que « nous sommes réels » (p. 113). Cette attention à ce qui passe inaperçu peut aussi être la base d'une critique d'une certaine poésie ; dans un portrait de la poule (bien différent de celui de Jules Renard dans ses Histoires naturelles), il retient la rupture entre elle et les autres oiseaux, comportement né de la vie avec les hommes, et notamment « cette parodie de chant, ces supplications brisées pour une chose incroyablement ridicule : un œuf souillé, blanc, rond. // La poule rappelle certains poètes. » (p. 343) Décrire ces choses sans relief, qui conduisent à séparer « la chose de l'apparence » (p. 167), ne signifie pas pour Zbigniew Herbert qu'il faudrait seulement s'attacher à un réel "nu" ; bien des poèmes, surtout ceux en prose, débordent ce cadre et construisent un univers de fantaisie, parfois de non-sens : ainsi, le chat « arrache les oiseaux des arbres avant qu'ils soient mûrs » (p. 321), l'ours refuse d'aller à l'école, etc. La poésie est comme le coquillage vide qui « raconte / les mers évaporées dans le sable » (p. 421)
Pour ce qui est du "domaine de la nature", il apparaît de manière récurrente sous une forme élémentaire : l'eau, la terre, le feu, l'air, puis les fleurs (seule la rose est citée, abondamment), les arbres (« un tronc de bouleau comme une corde de lumière », p. 85), les oiseaux, auxquels le Poète est associé :
que serait le monde
s'il n'était plein
de l'incessant va-et-vient du poète
parmi les pierres et les oiseaux
(p. 197)
Ce monde naturel se caractérise par le fait qu'il donne sans détour ce qu'il est. On pourrait reconnaître une forme de panthéisme dans la poésie de Zbigniew Herbert qui, l'une des rares fois où il s'adresse à un lecteur, écrit : « sans attendre de meilleure récompense / assieds-toi sous l'arbre » (p. 85). Et c'est à partir des éléments naturels que le poète peut décrire le monde des choses : « il me faut regarder les toits comme la pleine mer » (p. 219), écrit-il.
L'univers de Zbigniew Herbet est plus complexe ; y est intégré une relation active à la tradition, qu'il s'agisse de l'Antiquité — des poèmes ont pour thème Athéna, Marc-Aurèle, Néfertiti, Jonas, etc. — ou plus largement du passé. Les références ne doivent rien à une quelconque nostalgie, l'Antiquité est toujours une source vivante et, à l'occasion, se révèle un instrument critique ; si Arion, ce cheval doué de la parole, chante l'harmonie, le paradis perdu (« tout est aussi bon / qu'au commencement », p. 147), ce n'est cependant qu'un chant..., et il s'éloigne sur la mer, « seul » (p. 149). Et de la statue d'Apollon appréciée dans la jeunesse, « il ne reste qu'un socle vide » (p. 49). Quant au passé, il est doublement important : opposé aux "lendemains qui chantent" du pouvoir, c'est aussi un appui pour comprendre ce qui est vécu aujourd'hui — « la poésie est fille de mémoire / elle veille les corps dans le désert » (p. 273).
On lira, insistante dès le premier livre, une volonté d'être lisible, d'écrire sans détour — « je donnerai toutes les métaphores / pour une expression / comme une côte écalée de ma poitrine / pour un mot / qui rentre / dans les limites de ma peau » (p. 169). Une poésie donc qui s'en tient à un vocabulaire commun, à une syntaxe sans recherche, qui privilégie l'énumération plutôt que l'image : l'essentiel, toujours, est de parvenir à « décrire la simple émotion » (p. 169), de la susciter chez le lecteur non pour rejeter la réflexion mais pour qu'elle ne soit pas première. Dans un poème de circonstance, "Aux Hongrois", écrit au moment de l'insurrection en 1956 contre le pouvoir communiste, les quatre brefs quatrains ne visent pas à décrire ce qui se passait, plutôt à exprimer « d'une manière aussi pure et transparente que possible » (p. 16) la solidarité avec ceux qui luttaient pour des valeurs. Cela est peu ? C'est que les mots du poète n'ont pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, ni d'expliquer le monde. Dans une parabole, le "Poète" relate que « deux ou trois / fois / [il a] été sûr / de toucher au fond des choses / de savoir » (p. 475) ; sa recherche a été interrompue par une intervention extérieure mais, quand il l'a reprise, il a atteint son but et a pu enfin contempler « le cœur des choses // une étoile morte // une goutte noire d'infini » (p. 477).
Alors ? Il y a sans doute dans l'affirmation de l'absence de pouvoir de la poésie un refus de l'aveuglement de ceux qui écrivaient pour vanter « le royaume de l'avenir », pour faire croire que le « paradis sera prêt / à la fin de la lutte des classes » (p. 277). C'est en même temps dire que les poèmes, comme le reste des créations humaines, disparaîtront dans l'oubli. Dans la série des éléments de la nature, le dernier cité par Zbigniew Herbert est l'herbe : « l'herbe qui survient lorsque l'histoire s'accomplit / et qui est un chapitre du silence » (p. 117). On relèvera ici la rencontre avec un poète fort différent, Jude Stéfan, qui évoque dans les Suites slaves « l'oubli des herbes » (André Dimanche, 1983, p. 81).
Zbigniew Herbert, Corde de lumière, Œuvres poétiques complètes I, traduites du polonais par Brigitte Gautier, édition bilingue, Le Bruit du temps, 2011, 528 pages, 26 €.
Recension parue en 2012 dans Les carnets d'eucharis de Nathalie Riera
1 Trois recueils, tous épuisés, ont été traduits : Monsieur Cogito et autres poèmes (Fayard, 1990), Redresse-toi et va (Orphée/La Différence, 1995) et Élégie pour le départ suivi de Rovigo (Le Passeur, 2000). Deux essais sont disponibles, Un barbare dans le jardin (Le Rocher, 2000) et Nature morte avec bride et mors (Calmann-Lévy, 2003).
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zbigniew herbert, corde de lumière, poésies complètes | ![]() Facebook |
Facebook |
13/03/2012
Ernst Meister, Espace sans paroi

Là-bas sur les récifs
un murmure, te semble-t-il,
de non et de rien.
À proximité de toi
la vague déferle.
Là ! hors
de la mer élargie
bondit dans l'air un dauphin.
Dort auf den Klippen
ein Gemurmel, scheint dir,
vom Nicht und Nichts.
In deiner Nähe
die Welle schlägt an.
Da ! aus
gebreitetem Meer
spring hoch auf
ein Delphin.
*
Les éloignements
nous font vivre.
La mort
nous apparaît
aussi lointaine que la plus haute
étoile.
L'empressement de la nature
met en nous la mesure.
Wir leben
von den Entfernungen.
Der Tod
kommt uns vor
so weit wie der höchste
Stern.
Ein Geschäftiges der Natur
setzt Maße in uns.
Ernst Meister, Espace sans paroi, traduit de l'allemand
par Jean-Claude Schneider, Atelier La Feugraie, 1992, n. p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst meister, espace sans paroi, la mort, la mer | ![]() Facebook |
Facebook |
12/03/2012
Antoine Emaz, Cuisine (publie.net)

La « poésie » va prendre en charge ce que le récit classique ne peut porter, peut-être parce qu'il ne s'agit pas de fiction. Quelques chose l, comme si travailler dans le vrai interdisait le récir, parce qu'un poète n'est pas un autobiographe narcissique ou exhibitionniste et qu'il sait que la poésie est et n'est pas un confessionnal. Donc on va avec le récit, on le détourne, on le déboîte, le défait, on le déstructure, le pousse aux limites... plus rien n'est reconnaissable mais tout est dit. Ce cœur noir moteur, c'est lui qui pulse. En poésie, quand on sait lire, l'urgence est palpable, la nécessité de dire évidente. Cela peut être plus ou moins masqué par le dispositif d'écriture qui est à la fois un mode d'exposition et un mode de défense, mais c'est bien un cœur ouvert, au bout. L'enfant qui pleure de Reverdy.
En poésie, ce qui est dit est l'affleurement lisible de ce qui est tu : la vague / les profondeurs de la mer.
Dans tout ce que je note au jour le jour, cette piétaille de lignes, je ne vois pas bien en quoi je suis poète. Je note seulement ce que d'ordinaire on ne retient pas, espérant que tel ou tel détail sera révélateur, qu'il portera un peu plus que seulement lui-même.
Antoine Emaz, Cuisine, publie.net, p. 31, 35, 50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
11/03/2012
Jacques Réda, Lettre au physicien, La physique amusante II

Au fond des distances béantes
Que peuplent des mondes éteints,
Les étoiles ont des destins
Différents : naines ou géantes
Selon leur grosseur et leur poids.
Et plus une étoile est massive,
Plus tôt son ardeur la lessive
Car elle carbure cent fois
Plus vite qu'une plus petite :
Économes de leurs moyens
Ces astres finiront foyens
De l'Univers.
Pour notre site
Dont l'agrément dépend de lui,
Le Soleil est d'une envergure
Simplement honnête. On mesure
Qu'à présent il a déjà lui
Environ cinq milliards d'années
Et qu'il devrait en vivre autant.
Le présent est réconfortant :
Ses ambitions effrénées
Auront peut-être alors conduit
Notre inquiète fourmilière
Sur quelque boule hospitalière,
Dans un éternel aujourd'hui
D'où nous verrons, comme au spectacle,
Le tableau final du Soleil
Gonflant d'un volume pareil
À cent fois son vieil habitacle,
Devenir rouge, cramoisi,
Dévorer tout de son système :
Planète, lune, ce poème
Qu'il faut achever. Allons-y :
Donc, notre astre, géante rouge,
Consommé tout son carburant,
Bientôt se ratatine au rang
De Naine Blanche où rien ne bouge
Qu'un durable rayonnement
Qui pourtant aussi s'exténue :
En naine noire il diminue
Et s'efface du firmament.
Qu'en est-il de la Naine Brune ?
Elle n'est pas l'enfant métis
De cette Blanche au teint de lis
Et de la Noire. Ce n'est qu'une
Étoile ratée en raison
De sa faible masse. Elle éclaire
Faute de thermonucléaire
Activité, moins qu'un tison.
N'est-elle pas des plus heureuses ?
Souvent des brunes m'ont séduit.
Dans la pénombre du déduit,
Ce sont d'ardentes amoureuses.
Je voudrais, loin dans l'Univers,
Auprès d'une Brune secrète
(Naine, soit, nulle n'est parfaite),
Partir mon temps d'anachorète
Entre son amour et mes vers.
Jacques Réda, Lettre au physicien, La
Physique amusante II, Gallimard, 2012,
p. 33-35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, lettre au physicien, la physique amusante, étoile | ![]() Facebook |
Facebook |
10/03/2012
Georges Perros, Poèmes bleus

Ces envies de vivre qui me prennent
Et cette panique, cette supplication
Cette peur de mourir
Alors que je n'ai pas encore vécu
Et que dans ces moments
J'ai ma vie sur la langue
Il me semble que ça va être possible, enfin
Que je vais y aller d'une grande respiration
Que je vais avaler le soleil et la lune
Et la terre et le ciel et la mer
Et tous les hommes mes amis
Et toutes les femmes mes rêves
D'un seul grand coup
De poitrine éclatée
Quitte à en mourir, oui,
Mais pour de bon
Pas de cette mort ridicule
Déshonorante, inutile,
Qui accuse la parodie
Qui accuse le défaut
De ce qu'on appelle la vie
Sans trop savoir de quoi nous parlons.
On se renseigne auprès des autres
On leur pose des tas de questions
Avec cette hypocrisie de bonne société
On marque des points en silence
Ils souffrent autant que nous, tant mieux
On se dit même
Qu'on est un peu plus vivants qu'eux
Ô l'horreur
et la fragilité
De nos amours.
Georges Perros, Poèmes bleus, "Le Chemin",
Gallimard, 1962, p. 131-132.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perros, poèmes bleus, mourir, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
09/03/2012
Claude Dourguin, Laponia

[...] Un vieil instinct à foulées lentes fait se remettre en route, étranger à toute intimité — ailleurs la courbe d'une prairie, un boqueteau de peupliers au creux d'un vallon —, le paysage boréal est inhabitable. Il ne permet, évidence familière chérie, jamais redoutée, que la traversée ; le parcours est la seule approche, cette sympathie dynamique, aérienne qui lie au paysage, fait éprouver sa vérité, livre son être même. Certaines hautes terres, roches, landes et pelouses livrées au seul vent accordent cette ivresse. Mais la variété des formes rencontrées, les toits humains en une ou deux journées de marche vite rejoints, provoquent l'attention, sollicitent les rêveries et atténuent l'intensité de la perception de l'étendue, lui donnent les limites des moments. Ici à traverser les centaines de kilomètres sans âme qui vive que le blanc unifie j'éprouve l'espace nu, bien des fois il ma semblé le pousser devant moi, à l'infini toujours reconstitué, inépuisable, et peut-être est-ce folie dont me tient l'exaltation, avancer projetée vers là-bas, allégée, délivrée des attaches et du regard par-dessus l'épaule, toute entière dessein, tendue vers l'avenir inconnu, illusoire peut-être, qui se confond avec le franchissement des distances. Alors cet élan sans rupture que rien n'arrête — un jour, la mer, seule — tient lieu de destin.
Claude Dourguin, Laponia, éditons Isolato, 2008, p. 41-42.
© Photo Claude Dourguin.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin laponia, paysage, marche, destin | ![]() Facebook |
Facebook |
08/03/2012
Guillevic, Ensemble
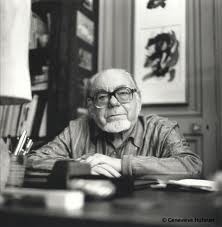
Ensemble
I
Il fallait que le jour,
En se levant de table,
Laisse achever la nuit
Son repas de bitume.
Il fallait que le jour,
En se levant de table,
Vienne toucher la cour
Tout engluée de fable.
Et qu'il laisse la nuit,
Engluée dans ses plumes,
Achever dans le froid
Son repas de bitume.
II
Si la voile bat au vent,
C'est que tout n'est pas perdu.
— Au levant l'eau de mer batifole dans le sel.
Au levant le soleil,
Cœur nettoyé de sang.
III
Tu te réveilles...
Tu vois encore de grands trous d'ombre,
Des gueules ouvertes, des dents de roches,
Un grand feu
Léchant le métal.
Tu as vu, retiré de la mer incendiée,
Le sol bouchant le noir des longs couloirs brûlés,
Le mouvement des grandes masses d'eau, tu te souviens
De la clameur de leur défaite.
Tu glissais parmi le chaos,
Poussant les roches au rire,
Cherchant l'amitié du feu.
Tes flancs, ta bouche accouchaient les végétaux,
Les animaux criant d'espoir et s'en allant
Attendre la poussée de leur chair exigeante.
Tu faisais claquer la lagune sur ta langue,
Tes doigts montaient dans les écorces,
Tu collais à ta peau
Toute l'argile.
[...]
Guillevic, Ensemble, "Cahiers de l'École de Rochefort", René Debresse éditeur, 1942, p. 3.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillevic, ensemble, la mer | ![]() Facebook |
Facebook |
07/03/2012
Pierre Jean Jouve, Proses (Nuages, Formes), dans Œuvre II

Nuages
Nous nous étions bien trompés sur les nuages, alors que nous les croyions les signes de l'infini. « J'aime les nuages... les nuages qui passent... les merveilleux nuages... » À présent que nous montons sur les nuages, nous voyons ces bêtes, volumineuses et mornes, du faux pays de la haute tristesse : nous voyons ces cheminements d'années noires blêmes, ou blanches comme la mort, se poursuivre pour entasser l'impitoyable couvercle sous lequel rampe la destinée. Le ciel est-il d'un vert électrique trop pur, nous gémissons d'y être des intrus, à cause de ces nuages blessants, pareils à une terre boursouflée. Montagnes de caricature, vous nous exilez de nous-mêmes, vous nous montrez le long néant certain, et la traînée de couchant rougeâtre qui borde n'a même plus la force de nous plaindre.
Malheur à la vie humaine prisonnière des nuages.
*
Formes
L'art est forme, mais encore faut-il que le terme aille aux profondeurs : « L'idée et la forme sont deux êtres en un. » Est-il un amour sans corps ? une beauté sans matière, une ivresse sans flacon, est-il un désir sans objet pour lui marquer de loin sa mort ? Mais les formes d'hier nous abusent aujourd'hui par des conventions de vêtements sur des ombres défuntes. Nous du moins avons reçu l'obligation de pénétrer des formes vives adéquates au vide dévorant, des formes de l'informe, des formes consumant la durée même. Formes contraires à celles qui les ont enfantées, ennemies de leur mère, en désaccord sur toutes les manières de contact : notre ouvrage est de faire passer par elles l'amour avec l'intouchable, ce qui comporte mouvement, exaspération, limite et spasme, pour la production du vrai.
Pierre Jean Jouve, Proses, dans Œuvre II, texte établi et présenté par Jean Starobinski, Mercure de France, 1987, p. 1206 et 1240.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre jean jouve, nuages, formes, starobinski | ![]() Facebook |
Facebook |
06/03/2012
Ossip E. Mandelstam, Le Bruit du temps

La bibliothèque de la prime enfance est un compagnon de route pour la vie entière. La disposition des étagères, les collections d'ouvrages, la couleur des dos, on les perçoit comme la teinte, la hauteur et la structure mêmes de la littérature universelle. Si bien que les volumes absents d'une première bibliothèque n'alimenteront jamais ce vaste édifice livresque où se reflète l'image du monde. Là, qu'on le veuille ou non, chaque œuvre est classique, et aucun dos de livre n'en peut être soustrait.
[...] L'étagère du bas, dans mon souvenir, offrait toujours une image de chaos ; les livres n'y avaient pas leurs dos alignés, ils étaient couchés comme des ruines : des Pentateuques roussis aux reliures en loques, une Histoire juive écrite dans la langue hésitante et maladroite d'un talmudiste parlant russe. C'était le chaos judaïque précipité dans la poussière. Où il fut très vite rejoint par mon alphabet hébreu ancien, que je n'ai donc jamais appris. [...]
Au-dessus des ruines juives commençaient les livres bien rangés : on y trouvait les Allemands : Schiller, Goethe, Körner — puis Shakespeare en allemand — vieilles éditions de Leipzig et Tübingen, ventrues, râblées, aux reliures bordeaux en cuir estampé, et dont les petits caractères convenaient aux yeux d'un public jeune ; les gravures étaient gracieuses, un peu à la manière antique : femmes aux cheveux indisciplinés se tordant les mains, lampes aux allures de lustre, cavaliers au front haut, grappes de raisin en vignette. Mon père, en autodidacte, s'était frayé là, hors des fourrés talmudiques, un passage jusqu'au monde germanique.
Plus haut encore, il y avait les livres russes de ma mère — Pouchkine, édition Issakov de 1876. Je pense aujourd'hui encore que c'était une belle édition, elle me plaît davantage que celle de l'Académie. Là, rien d'inutile : les caractères sont harmonieux, les colonnes de vers s'écoulent, fluides comme des bataillons que guident en stratèges les chiffres sensés et précis des années jusqu'en trente-sept. La couleur du Pouchkine ? Chacune étant due au hasard, laquelle élire pour des paroles murmurées ? Hou, cet idiot d'alphabet coloré de Rimbaud !
Mon Pouchkine d'Issakov avait une défroque décolorée dans sa reliure de calicot pour lycéens, une soutane brun-noir déteinte, aux intonations terreuses, sableuses ; elle ne craignait ni tavelure ni encre ni feu ni pétrole. Le sable noir de ce froc d'un quart de siècle avait amoureusement tout absorbé en lui — et je ressens, d'autant plus vifs sous cet habit de tous les jours, la beauté spirituelle et le charme presque physique de mon Pouchkine maternel. On y avait écrit d'une encre rouge pâle : « À l'élève de troisième pour son zèle ». Il y avait là, comme ourdis dans le tissu de cette édition, les récits autour des maîtres et maîtresses exemplaires, aux joues rosies de phtisie, aux souliers troués : les années quatre-vingt à Vilno.
Ossip Mandelstam, Le Bruit du temps [1923], traduit du russe et présenté par Jean-Claude Schneider, éditions Le bruit du temps, 2012, p. 36-37.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, le bruit du temps, bibliothèque, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
05/03/2012
Nathalie Riera, Clairvision

Ralentir. La mer étale du matin. Pas un souffle dans l’air. Jusqu’au moindre bruit qui aussitôt fait trêve : me complaire à cette suspension brutale. C’est là que je me dis qu’il n’y a rien à élucider, à combler, juste vaciller sur des hauts talons. S’asseoir un moment, savoir qu’il suffit d’une route pour que ça étincelle et t’emporte, au temps des ronces où tous les crimes sont permis.
Le fond de l’eau. Ce qui fut éclair et azur, sans revirement possible, d’un vénérable bleu marine.
Accélérer. Les premières vagues, l’iode et le ressac. Une route qui t’emporte, la houle sauvage où je revois de mes yeux enfant sur le papier une larme d’encre qui n’est pas une rature. Les algues ne rompent pas leurs liens. Les mots me choisissent, herbe et terre sous les talons.
La transparence de l’eau : sous un arbre, je dessine les bruits des sabots.
Parmi des esquisses de poussière soulevée par le passage des chevaux, un tapage de mots. Quelques feuilles d’arbres agitées, quelques pages d’un livre sans histoire, sans personnage, rectos versos muets.
Nathalie Riera, Clairvision, Publie.net, 142 pages en pdf, illustrations de Lambert Savigneux, p. 17.
Nathalie Riera publie en ligne la revue de littérature Les carnets d'eucharis.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie riéra, clairvision, la mer, les mots | ![]() Facebook |
Facebook |
04/03/2012
Valérie Rouzeau, Vrouz
Bonne qu'à ça ou rien
Je ne sais pas nager pas danser pas conduire
De voiture même petite
Pas coudre pas compter pas me battre pas baiser
Je ne sais pas non plus manger ni cuisiner
(Vais me faire cuire un œuf)
Quant à boire c'est déboires
Mourir impossible présentement
Incapable de jouer ni flûte ni violon dingue
De me coiffer pétard de revendre la mèche
De converser longtemps
De poireauter beaucoup d'attendre un seul enfant
Pas fichue d'interrompre la rumeur qui se prend
Dans mes feuilles de saison.
*
Aussi je est un hôte d'on ne sait qui ni quoi
Mystère en bout de course comme à la balançoire
La vie assujettit drôlement ses invités
Alors je vante le vent par ma lucarne ouverte
Et je ne confonds pas auspices avec hospices
Rouzeau avec réseau dentiste avec temps triste
Pater avec par terre pleure avec meurs meurs meurs
Tu pisseras moins moins moins
Mon poème ne compte pas davantage
Que la conversation bruyante de mon prochain
M'empêchant de poursuivre par ici sauf
À fermer ma lucarne ou la repeindre en bleu
Appeler ma prochaine
Ou m'écrier au feu
Valérie Rouzeau, Vrouz, La Table Ronde, mars 2012, p. 11, 140.
© Photo Tristan Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie rouzeau, vrouz, autobiographie | ![]() Facebook |
Facebook |
03/03/2012
Maïakovski, "Adulte", dans Lettres à Lily Brik

Adulte
Adulte, on fait de affaires.
Des roubles en poche.
De l'amour ? En voila !
Pour cent petits roubles.
Et moi,
sans domicile,
les mains
dans les poches
déchirées,
je m'en allais, les yeux ouverts.
La nuit
vous mettez vos meilleurs habits,
vous cherchez le repos sur l'épouse ou la veuve.
Et moi,
Moscou m'étouffait dans ses bras,
de l'anneau des boulevards sans fin.
Dans vos cœurs,
dans vos monstres,
vont et viennent les amantes.
Quels transports, partenaires de la couche d'amour !
Moi, qui suis la place de la Passion,
je surprends
le sauvage battement de cœur des capitales.
Déboutonné,
le cœur presque dehors,
je m'ouvrais au soleil et à la fleur d'automobile...
Déboutonné,
le cœur presque dehors,
je m'ouvrais au soleil et à la flaque d'eau.
Entrez avec vos passions !
Grimpez avec vos amours !
Dès maintenant, j'ai perdu le contrôle de mon cœur.
Je connais chez autrui le domicile du cœur.
Il est dans la poitrine — c'est connu de chacun.
Avec moi,
l'anatomie a perdu la tête.
Je suis tout cœur —
Cela bat de partout.
Ô, combien fussent-ils,
seulement les printemps,
en vingt ans engloutis dans sa fournaise !
Accumulé, leur poids n'est pas supportable.
Pas supportable,
non pour le rire,
mais à la lettre.
Vladimir Maïakovski, Lettres à Lily Brik (1917-1930),
traduites du russe par Andrée Robel et présentées par
Claude Frioux, Gallimard, 1969, p. 95-96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maïakovski, lettres à lily brik, adulte | ![]() Facebook |
Facebook |
02/03/2012
Marcel Schwob, Le Livre de Monelle

Monelle me trouva dans la plaine où j'errais et me prit par la main.
— N'aie point de surprise, dit-elle, c'est moi et ce n'est pas moi ;
Tu me retrouveras encore et tu me perdras ;
Encore une fois je viendrai parmi vous ; car peu d'hommes m'ont vue et aucun ne m'a comprise ;
Et tu m'oublieras et tu me reconnaîtras et tu m'oublieras.
Et Monelle dit encore : Je te parlerai des petites prostituées et tu sauras le commencement.
Bonaparte le tueur, à dix-huit ans, rencontra sous les portes de fer du Palais-Royal une petite prostituée. Elle avait le teint pâle et grelottait de froid. Mais « il fallait vivre » lui dit-elle. Ni toi, ni moi, nous ne savons le nom de cette petite que Bonaparte emmena, par une nuit de novembre, dans sa chambre, à l'hôtel de Cherbourg. Elle était de Nantes, en Bretagne. Elle était faible et lasse, et son amant venait de l'abandonner. Elle était simple et bonne ; sa voix avait un son très doux. Bonaparte se souvint de tout cela. Et je pense qu'après le souvenir du son de sa voix l'émut jusqu'aux larmes et qu'il la chercha longtemps, sans jamais plus la revoir, dans les soirées d'hiver.
Car, vois-tu, les petites prostituées ne sortent qu'une fois de la foule nocturne pour une tâche de bonté. La pauvre Anne accourue vers Thomas de Quincey, le mangeur d'opium, défaillant dans la large rue d'Oxford sous les grosses lampes allumées. Les yeux humides elle lui porta aux lèvres un verre de vin doux, l'embrassa et le câlina. Puis elle rentra dans la nuit. Peut-être qu'elle mourut bientôt. Elle toussait, dit de Quincey, le dernier soir que je l'ai vue. Peut-être qu'elle errait encore dans les rues ; mais, malgré la passion de sa recherche, quoiqu'il bravât les rires des gens auxquels il s'adressait, Anne fut perdue pour toujours. Quand il eut plus tard une maison chaude, il songea souvent avec des larmes que la pauvre Anne aurait pu vivre là près de lui ; au lieu qu'il se la représentait malade, ou mourante, ou désolée, dans la noirceur centrale d'un b... de Londres, et elle avait emporté tout l'amour pitoyable de son cœur.
Marcel Schwob, Le Livre de Monelle, 1959 [1894], p. 9-11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel schwo, le livre de monelle, de quincey, prostituée | ![]() Facebook |
Facebook |






