06/02/2026
Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismes

Échange de lettres entre deux personnes qui ne s’aiment pas, mais dont chacune voudrait rendre l‘autre amoureuse d’elle, au point qu’elles mourraient d’amour ou se suicideraient. Une telle chose pourrait être drôle.
Une secte qui ne cracherait pas serait certes préférable à une autre qui ne mangerait pas de haricots.
Il est assez triste que, de nos jours, la vérité doive soutenir sa cause par des fictions, des romans ou des fables.
Cet homme avait tant d’intelligence qu’il n’était presque plus bon à rien dans la vie.
Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismes, Denoël, 1985, p. 221, 224, 225, 228.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg christoph lichtenberg, aphorismes | ![]() Facebook |
Facebook |
05/02/2026
Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismes

La super-intelligence est une des forces les plus méprisables de la sottise.
Celui qui a moins que ce qu’il désire doit savoir qu’il a plus que ce qu’il est digne d’avoir.
Il aimait bien être couché à l’antipode de sa femme dans le lit.
On peut parfaitement vivre dans le monde en faisant des prophéties, mais non pas en disant des vérités.
Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismes, Denoël, 1985, p. 208, 209, 210, 220.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg christoph lichtenberg, aphorismes | ![]() Facebook |
Facebook |
04/02/2026
Pierre Silvain,

Photo T. H.
Wannsee
L'été avant de prendre congé mijote de l'orage
Pour la fin de l'après-midi comme il y a longtemps dans la ville thermale
Où tu traînais parmi les curistes une vacance d'âme
Sous l'étagement poum ! poum ! des feuillages énormes
Décrits par Pierre Jean Jouve alors qu'ici au bord du lac
Tu attends l'appareillage du bateau
La grosse femme avec ses trois mouflets derrière
Te poussant jusqu'au pied de la passerelle
Bercée par une corde et toute l'escouade vacancière
Shorts tee-shirts jambes brunes poils blonds
Comme elle poussant pressée d'atteindre la destination
Finale (sans rien de commun avec la solution du même nom
C'est si loin maintenant aussi ténu que la brume de chaleur
Sur le miroitement de strass des vagues)
Qui pour la plupart est la plage et pour les autres
L'île des Paons. Les vers que tu te récitais
Sous les frondaisons Death is so permanent
Drive carefully te reviennent tandis que le bateau
Quitte l'appontement avec le léger tangage
Presque berceur
D'un convoi plombé.
Sarrebruck (1958)
Portrait du Hauptsturmfürher de la Waffen SS
Dans son cadre. Installé près du poste monumental
Diffusant du Bach en sourdine sur la commode. La rose
Ne tient pas à cause de la chaleur du poêle
Qui tire à fond. Elle se défeuille sans bruit
Longuement pétale à pétale devant l'absent.
La tasse de vieux saxe que la femme porte à ses lèvres
Est décorée de motifs champêtres
Aux tons passés. Dehors c'est presque la nuit. Neige. Odeur de houille
Dans les rues. Des particules noires sur les congères.
Sait-on à quoi pense la femme. Guten Abend
(Lance le locataire étranger en traversant le couloir)
Auf Vierdersehen
Frau Krabbe.
Pierre Silvain, Allemande (suite), dans la revue Conférence, n° 15, automne 2002, p. 389 et 395.
1 "Death is so permanent. Drive carefully" : signal routier des Forces américaines en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale (note de T. H.)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
03/02/2026
Henri Thomas, La joie de cette vie

Non, je n’ai pas peur de la mort, ce qui m’effraie, me gêne, m’ennuie, me fait honte, c’est que les hommes ont fait de la mort : une horreur privée, un embarras public.
Je n’avais pas de conversation comme on en a partout, comme j’en écoutais ici et là, sans pouvoir vraiment y participer ; c’était comme de regarder les gens jouer aux cartes quand on est incapable de prendre part au jeu.
Une bonne pat des ennuis de la vieillesse vient des autres, jeunes ou vieux ; ils vous retirent, par prudence ou par indulgence ou par mépris, les outils de la vie, les armes, les fonctions, « dont vous n’avez plus besoin. Reposez-vous, ce serait risqué, ne vous exposez pas… ».
Goût d’écrire suffisant pour noter ce dégoût de vivre alors que je n’aurais pas vécu, ou que j’aurais oublié ce que c’est, ce que ce fut ; tout, sauf la vie ainsi créée — et le poids du vécu-disparu.
Henri Thomas, La joie de cette vie, Gallimard, 1992, p. 49, 50, 53, 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, la joie cette vie, vivre | ![]() Facebook |
Facebook |
02/02/2026
Pierre Reverdy, Le livre de mon bord

Le style, ce ne doit pas être tellement l’homme qu’on l’a dit – car l’on se complaît bien plus à sa personnalité qu’en ce qu’on écrit. On se désespère d’écrire mal, et rien ne concorde entre ce que l’on sent et ce que l’on écrit. On se relit, on retouche ce style répugnant, rien ne vient mieux. Je crois que ce qui est vraiment l’homme c’est le plaisir ou le dégoût qu’il prend à l’effort pour écrire mieux. C’est-à-dire qu’il n’y ait pas plus de vulgarité dans le style que dans la pensée.
L’homme ne se réalise que dans la connaissance. Les frontières de sa connaissance sont les frontières de son être. Plus il connaît, plus il est vaste et étendu, moins il connaît, plus il est étroit et restreint. Mais il y a aussi le parti qu’il tire et l’usage qu’il fait de ces connaissances et qui le font grand ou petit.
Le style, bon ou mauvais, je parle de ce qui caractérise un écrivain, ce n’est pas le premier jet, mais l’état où il laisse la chose écrite, celui auquel il n’éprouve plus le besoin de rien changer. Et ce n’est pas la moindre révélation du caractère que de ne jamais tenir pour définitive l’expression formelle de sa pensée.
Pierre Reverdy, Le livre de mon bord, Mercure de France, 1948, p. 47-48, 162, 210.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdi, le livre de mon bord, style | ![]() Facebook |
Facebook |
01/02/2026
Daniil Harmes, Le Samovar

Les chats
Un jour, d’un joyeux pas
Je revenais chez moi
Soudain je vois des chats
Qui m’tournent le dos, ma foi.
Je crie, hé-ho, les chats !
Ne restez pas comme ça,
Suivez-moi de ce pas
Je vous emmène chez moi.
Suivez-moi donc les chats,
Je vais vous mitonner
De suite un fameux plat,
Il y aura du soufflé.
Non, non ! répondent les chats,
On préfère rester là !
Les voilà donc assis,
Aucun ne m’a suivi.
Daniil Harms, Le Samovar, traduction
du russe Eva Antonniko, Héros-Limite,
2015, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniil hatms, le samovar, les chats | ![]() Facebook |
Facebook |
31/01/2026
Daniil, Harms, Le Samovar

Comment c’est, déjà ?
Un anglais ne parvenait pas à se rappeler le nom de cet oiseau.
Ceci, dit-il, est une rondelle. Non, que dis-je, pas une rondelle, mais une haridelle. Ou bien non, pas une haridelle, mais une ribambelle Zut ! pas une ribambelle, mais rimbiballe. Non, c’est pas ça, pas rimbiballe, rimbibouballe.
Voulez-vous que je vous raconte l’histoire de cette rondelle ? Je veux dire, pas de cette rondelle mais de cette haridelle. Ou bien non, pas cette haridelle, mais ribambelle. Zut alors ! pas ribambelle mais rimbiballe.
Non pas rimbiballe, mais rimbibouballe ! Sapristi, c’est toujours pas ça ! Roumbibaballe ? Non, pas roumnibaballe ! Rimbibouballe ? Mais non ! Bref, j’ai oublié le nom de cet oiseau. Mais si je ne l’avais pas oublié, alors je vous raconterais séance tenante l’histoire de cette rimbibouboubabarondelle.
Daniil Harms, Le Samovar, traduction
du russe Eva Antonniko, Héros-Limite,
2015, p. 20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : daniil harms, le samovar, jeu de langue | ![]() Facebook |
Facebook |
30/01/2026
Anne Malaprade, Épuiser le viol : recension

Une première lecture de épuiser le viol m’a déconcerté par tout ce qu’il me fallait, littéralement, redécouvrir, à commencer par les lettres de Mme de Sévigné (mais on ne se lasse jamais de les lire), dont en avant texte deux citées avec deux personnages, le loup et le loup-garou, ce qui introduit le jeu entre Loup, figure du violeur (on reconnaîtra ici et là des allusions au Petit Chaperon Rouge, version Perrault) et Louve, son épouse. « Animal » se transforme, loup et louve prennent forme, visage et pratiques des humains, « Louve (…) entre dans la tanière (…) Sur le bureau une boîte de thon ». Un second texte, de l’autrice cette fois, explicite le titre et ce faisant définit les enjeux du livre, en suggère des éléments ; extrait :
Violer jusqu’à épuisement des ressources exacerbe des incompétences métriques (oublier des distances entre soi et l’autre, les avaler, les dissoudre en déchets), des incompétences scalaires (confondre la grande dans le petit, l’enfant tellement adulte, le féminin sur le masculin, le neutre par l’indéfini), des incompétences d’emplacement (se perdre dans le tissu-peau des petites filles et ce en pleine lumière familiale) (…)
Huit chapitres suivent, tous doublement titrés, chaque titre comme un sommaire du texte. Le premier annonce des éléments tragiques, « Le saut de la mort / Lune nous regarde » ; le troisième est une allusion à une série colombienne, « L’esclave blanche / Lune en son royaume », le sixième « Le procès de Louve / Lune décharnée » renvoie à un livre pour enfants, variation sur l’histoire du Chaperon rouge, Le procès du Loup, de Zarko Patan ; tous les autres sont des titres de films de Carl Th. Dreyer, du premier « Pages arrachées au livre de Satan / Lune perd son propre cadavre » au dernier du livre, « Ordet / Allumer les soleils ».
Au chaos du monde correspond le chaos dans la vie d’une femme, son refus du viol dans tous les sens du mot, sa perte de repères quand son couple est brisé — « Un matin, les époux font l’amour pour la dernière fois (…) elle sait que c’est fini ». À la perte répond la construction du livre ; pas de récit, la discontinuité : chaque ensemble formé de groupements de dimension très variable séparés par une barre (/), le lecteur pouvant s’égarer d’ailleurs dans la distribution des noms qui ne sont pas toujours attribués au même personnage ; ainsi "Violette" — est-il besoin de souligner le rapport à "viol" ? —, dont même un homme dans un roman1 d’Emily Brontë, Heathcliff, surgi au détour d’une phrase, aurait un instant l’apparence. Ainsi encore Louve, dont il faut lire le nom sans le "u", « Louve dérive de Love en Love : elle est parfois son père, parfois la petite fille. Elle est très rarement Louve », alors que Loup est toujours l’Envioleur, homme et père, comme "Petits" ou "Violettes" sont les enfants. Il « fréquente Barbe-Bleue et (…) fait peur aux Ogres », cependant il « aurait aimé se déguiser en Violette ».
Comment écrire le désastre en écartant le pseudo-réalisme de la plupart des romans ? La discontinuité ne suffit pas et le livre est nourri, toujours en lien étroit avec le propos, par la littérature dans toute sa variété, dès son ouverture, et par le cinéma, la musique même (Steve Reich) et la peinture avec un hommage à Marcel Duchamp et mention d’une toile qui pourrait être placée « sur un petit pan de mur jaune »2. Relever tous les extraits et toutes les allusions, leur rôle dans l’histoire de Louve est exclu ici, on retiendra quelques exemples. Quand Louve « ne respire que de disparaître demain auprès des renards bleus(Mandelstam) », il est bon de relire le poème évoqué, il résonne par image avec la situation de Louve qui vit une violence réelle et souhaiterait retrouver quelque chose de la « beauté primitive » des « renards bleus »3, très loin, dans un autre monde, l’Arctique.
Cette violence est suggérée par une allusion, « Il la tue, il ne lui fait pas de bien. Il n’a pas vu le film de Resnais » ; on lit peut-être une ironie de la part de la narratrice ; dans Hiroshima mon amour (1959), les mots de "Elle" à "Lui", repris plusieurs fois dans une scène amoureuse, étant « Tu me tues, tu me fais du bien ». D’une manière positive sont évoquées plus loin les « répliques lancinantes de Hiroshima mon amour », cette fois, semble-t-il, pour une union entre une Violette et Louve. La rupture a été d’autant plus difficile à vivre que Louve aurait voulu « que l’amour ne s’éloigne pas dans la séparation », mais rien ne peut se substituer à l’éloignement des corps qui implique la fin d’une histoire, sauf à nier la réalité, ce qui est souligné : « Elle a tort, tout le vivant est soumis à la fin et au détachement. »
« Le retour au réel précède sa solitude intégrale. Cela s’appelle l’aurore. » Plus qu’au film de Bunuel, le titre renvoie à la fin de la pièce de Giraudoux, Électre, conclusion amère de la fin d’une histoire, « Comment cela s'appelle-t-il, quand le jour se lève, comme aujourd'hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l'air pourtant se respire, et qu'on a tout perdu (…) — Cela a un très beau nom (…). Cela s'appelle l'aurore. » Que reste-t-il ? Ce qui s’est achevé laisse, au moins un temps, Louve sans défense avec le sentiment de n’avoir plus d’identité, ce qui s’exprime par « Mon nom est Personne », proposition non référencée, l’épisode du Cyclope dans l’Odyssée étant devenue commune. Ce que pense Louve de son sort est traduit dans les dernières pages avec un emprunt à une réplique d’une femme, Bébé Donge, « On ne recommence pas deux fois l’amour. »4
La tentation de disparaître est là, surtout quand dans la vie quotidienne, dans la rue même rien n’entraîne vers la vie, « beaucoup portent une barbe bleue ». C’est, progressivement, par la disparition des « incompétences » que Louve pourrait retrouver ce qu’elle est, en écrivant son histoire, la douleur et la violence, mais une fois écrit « Ce livre fait mal aux Louves. Elles sentent bien que le style est dans le ventre, et qu’il a toute l’importance d’une aventure. » Le livre peut aider à revenir à la vie, tout comme dans le film Ordet = (la) parole, les mots de Johannes redonnent vie à Inger, morte au moment de son accouchement. Mais la conclusion du livre est amère, empruntée à une lettre de Flaubert :
« (…) quand les intérêts de la chair et de l’esprit, comme les loups, se retirent les uns des autres et hurlent à l’écart, il faut donc comme tout le monde se faire un égoïsme (plus beau seulement) et vivre dans sa tanière ».
On reconnaît d’un livre à l’autre l’écriture d’Anne Malaprade, une langue qui n’hésite pas à recourir aux mots justes, dire telle réalité (merde, couille, putain) et à un emploi ancien : un moustique a dévisagé le visage de Louve, soit "défiguré" — d’où la suite pleine d’humour : elle ressemble alors à La Joconde L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp. Il y a parfois le plaisir de la paronomase (« Les mots, quels mots. Les mets, quels mets. »), et du jeu des significations (« elle aussi balance, se balance, s’en balance ».) On multiplierait les exemples. Ce qui est un fait d’écriture propre à l’autrice est la virtuosité des énumérations qui associent des éléments hétérogènes et l'on ne peut oublier l'art difficile de la répétition.
Anne Malaprade, Épuiser le viol, éditions isabelle sauvage, 2025, 144 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 10 décembre 2025.
1 Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent.
2 allusion à Proust, La Prisonnière.
3 Pour la gloire grondante des temps futurs, dans Ossip Mandelstam, Œuvres poétiques, traduction Jean-Claude Schneider, Le Bruit du temps/La Dogana, 2018, p. 364.
4 dans le film d’Henri Decoin, La Vérité sur Bébé Donge. (1952)
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne malaprade, épuiser le viol | ![]() Facebook |
Facebook |
29/01/2026
Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel

Les planches se sont adoucies sous le soleil printanier,
le mouvement s’est accéléré avec l’exclamation rouge.
Au nord Birko a viré brique — le rivage n’est pas le nôtre !
Tu espère encore t’améliorer, tu tresses tes cheveux
et je sens comme une tempête de soleil !
Tramway, samovar, sémaphore,
le passage du Nord-Ouest est en moi !
Joyeuse tempête, tu ne vaincras pas,
tu ne me vaincras pas !
Sous l’échelle le ponton tremble.
Dans la brasserie de Courlande
il y a une fille avec des tresses noires.
Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel, traduction
du russe Jean-Baptiste Para, Æncrages & Co, 2025, p. 86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elena gouro, leș petits chameaux du ciel, variété | ![]() Facebook |
Facebook |
28/01/2026
Audre Lorde, Une merveilleuse arithmétique de la distance : recension
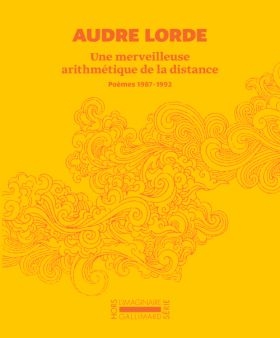
Au début du XXe siècle, des femmes que leur statut social protégeait n’ont pas hésité à écrire à propos de leur homosexualité ; on pense toujours à Renée Vivien et à Nathalie Clifford Barney et il faut relire aussi Lucie Delarue-Mardrus, se souvenir de l’exaltation du corps chez Joyce Mansour, etc. Le militantisme LGBT aux États-Unis, le "mariage pour tous" (2013 en France), le mouvement #MeToo, entre autres, ont favorisé depuis une vingtaine d’années la publication d’une poésie longtemps ignorée. L’œuvre poétique d’Audre Lorde (1934-1992 ; elle avait ôté l’y de son prénom) a commencé à être traduite tardivement en français (La Licorne noire, 2021), d’autres publications ont suivi grâce aux traductions du collectif Cételle (Charbon et Contrechant, 2023). Aujourd’hui, la collection de poche L’Imaginaire, dans un format et une présentation inhabituels, propose un ensemble posthume (1993) de poèmes ; quatre brèves préfaces d’Alice Diop, Fatou S., Kiyémis et Mélissa Lavaux rappellent l’importance d’Audre Lorde aux États-Unis : auteure noire, féministe lesbienne, elle fut jusqu’à sa disparition militante des droits civiques et de la liberté des femmes.
Les traductrices précisent dans une note, qu’elles ont choisi pour se « rapprocher le plus possible du propos d’Audre Lorde », de s’appuyer « ponctuellement sur des stratégies de démasculinisation de la langue française ».
Le titre porte une leçon ; il faut toujours aller de l’avant, partir au moins métaphoriquement, « Pas de place pour régler les comptes / sauf dans une merveilleuse arithmétique de la distance ». Aller de l’avant implique de s’opposer à ce qui est, opprime, empêche d’être soi, nie jusqu’à l’existence : Audre Lorde dénonce le racisme ordinaire qui tue, par exemple en 1984 une femme noire pauvre, Eleanor Bumpurs, refusant son expulsion : la porte de son logement enfoncée, elle est abattue par un policier. Le refus de l’autre parce que noir est chose commune partout, jusqu’à instaurer l’apartheid, comme en Afrique du Sud, où l’on tuait quotidiennement à Soweto. Le racisme ne disparaît pas aisément, toujours présent des deux côtés de l’Atlantique.
Audre Lorde prend l’exemple de son père, né de père inconnu, qui a travaillé toute sa vie pour que ses filles ne connaissent pas le même sort que lui ; il achetait de « vieux livres », rapporte-t-elle, « pour mon univers sans langage », et elle est devenue bibliothécaire. Que pouvait faire son père ? « Noir et sans le sou / sur cette terre où seuls les hommes blancs / règnent par l’argent. » Comment ne pas désespérer de la persistance de la ségrégation ? Audre Lorde, d’abord surprise du visage haineux de sa nouvelle voisine blanche, entend l’enfant qui l’accompagne, « Je ne t’aime pas, braille-t-il, / Tu viens pour me garder ? ».
La vie quotidienne dans une ville américaine des années 1980 était difficile pour l’ensemble des ouvriers, la crise économique de 1975 avait laissé des traces, mais elle l’était encore plus pour la population noire plus vite atteinte par le chômage, « la misère me hurle / dans les rues voisines », écrit-elle, aggravée par les ravages de la drogue et ceux de la prostitution qui conduit des femmes « du trottoir au néant ». La situation est d’autant plus mal vécue par la communauté noire que les "Blancs" ne représentent sur terre qu’une minorité, ce que souligne avec humour Audre Lorde :
La plupart des habitants de cette planète
sont (…) Asiates, Noires, Brunes, Pauvres, Femmes, non Chrétiennes
et ne parlent pas anglais.
Vers qui se tourner pour continuer à se tenir debout ? D’abord vers les femmes qui n’ont pas renoncé à changer leur vie, celle de leur famille. Audre Lorde s’est nourrie des paroles de sa mère, modèle comparable à « une eau libérée », qui l’ont incitée à toujours se battre. Elle évoque aussi un militant noir des droits civiques, Marcus Garvey 1887-1940) qui, à l’origine de la culture rasta, avait une position radicale : il prônait le retour des anciens esclaves en Afrique.
Mais elle exalte surtout dans ses poèmes de la ville le rôle des sens, attentive au timbre de la voix, aux regards, aux odeurs ; elle n’oublie jamais l’importance des rêves et des désirs : elle écrit ce qu’était l’amie disparue avec qui elle passait parfois la nuit à lire des poèmes — « Je n’arrive pas à croire que tu sois sortie / de ma vie. / Alors tu ne l’es pas. » Elle-même succombera à une récidive d’un cancer du sein, active jusqu’aux derniers jours (« comme il est dur de dormir / au milieu de la vie ») et toujours exemple de militante pour la liberté complète des femmes : libres socialement et libres de leur corps.
Audre Lorde, Une magnifique arithmétique de la distance, Poèmes 1987-1992, édition bilingue, traduction Providence Garçon et Noémie Grunewald, collection L’imaginaire/Hors-série, Gallimard, 2025, 148 p., 25 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 26 novembre 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : audre lorde, une magnifique arithmétique de la distance : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
27/01/2026
Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel

Je touche la vie avec des mots affectueux, plein de chaleur, car comment toucher autrement ce qui est blessé ? Il me semble que toutes les créatures ont froid, tellement froid.
Voyez-vous, je n’ai pas d’enfants — c’est peut-être pour cela que j’aime de façon si insupportable tout ce qui est vivant.
J’ai parfois l’impression d’être la mère de tout.
Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel, traduction du russe Jean-Baptiste Para, Æncrages, 2025, p. 77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elena gouro, leș petits chameaux du ciel, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
26/01/2026
Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel

Soir rose
Ici, dans le paradis épuré d’une mer rosissante, d’inexplicables bandes vertes ont commencé à scintiller et à flotter. Je me suis désolée de toute cette clarté et de l’impossibilité d’exprimer ce qui n’avait pas d’explication. L’ondoiement du vert éclatant de jeunesse restait sans réponse. Ce qui s’offrait à mes yeux restait irrévocable. Un insoutenable paradis de lumière et d’eau.
Pourquoi est-il d’une absolue nécessité que quelque chose en nous se tende, se déchire et geigne d’un bonheur ineffable — sans jamais trouver de résolution.
Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel, traduction du russe Jean-Baptiste Para, Æncrages, 2025, p. 68.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elena gouro, leș petits chameaux du ciel, soir rose | ![]() Facebook |
Facebook |
25/01/2026
Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel

Oiseau tempête, diablotin déluré —
La forêt en furie t’attend !
Leurs frères couronnes hissées dans les nuages,
Ce sont les frères qui feront rage !
Tu n’entends plus la voix de ton chagrin
Quand ils entonnent un chant farouche
Et agitent leurs branches dans le ciel turbulent.
Oh ces frères ! Pattes dressées,
Ils ébouriffent follement leurs aiguilles.
Oiseau-tempête, tendre rêveur,
Tu attrapes les étoiles,
Dans les travées des sapinières…
Tu ramasses des airelles rubis
Dans les filets de ta merveilleuse idiotie
Et répands les perles de canneberge
En larges tapis, puis relâches vers le ciel
Ce que ton œil saisit.
Si tu écartes un peu les doigts
Un flocon de chaude lumière
S’en échappera.
Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel, traduction
du russe Jean-Baptiste Para, Æncrages & Co, 2025, p. 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eena gouro, les petits chameaux du ciel, oiseau | ![]() Facebook |
Facebook |
24/01/2026
Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel

Le monde était aussi simple et doux qu’une colombe. Si on l’avait caressé, il aurait pris son vol.
Mais il a été attelé à la charrue, jeté aux fers, il est devenu une place de négoce et de supplice commercial pour les pacifiques, les simples d’esprit et les cœurs aimants.
Elena Gouro, Les petits chameaux du ciel, traduction du russe Jean-Baptiste Para, Æncrages & Co, 2025, p. 39.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elena gouro, leș petits chameaux du ciel, destruction | ![]() Facebook |
Facebook |
23/01/2026
Images de Venise et alentours
| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |











