13/12/2025
Norge, Le Stupéfait
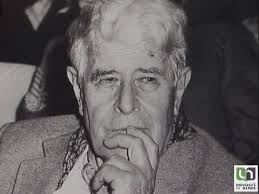
Une fête
La folle mouche d’octobre
Qu’exaltait l’amour de vivre
Sent déjà pincer le givre
Qui va lui blanchir la robe.
Mais elle ne gémit pas
Et nous zézaie à tue-tête,
Mordant au raisin muscat
Que la mort est une fête.
Norge, Le Stupéfait, Gallimard,
1988, p. 99
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norge, le stupéfait, rien | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2025
Norge, Le Stupéfait

Rien
As-tu jamais écouté
Le bruit d’une goutte d’eau
Qui tombe au fond du puits ?
As-tu jamais regardé
Une feuille de platane
Qui vient toucher la terre ?
As-tu jamais caressé
Le dernier mot d’une vague
Qui meurt sur le rivage ?
Mais as-tu jamais compris
La fabuleuse parole
Qui couve le silence ?
- Je n’existe pas assez
Pour être et pour caresser.
Norge, Le Stupéfait, Gallimard,
1988, p. 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : norge, le stupéfait, exister | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2025
Giorgio de Chirico, Poèmes
Mélancolie
Lourde d’amour et de chagrin
mon âme se traîne
comme une chatte blessée
— Beauté des longues cheminées rouges
Fumée solide
Un train siffle. Le mur
Deux artichauts de fer me regardent.

J’avais un but. Le pavillon ne claque plus
— Bonheur, bonheur, je te cherche —
Un petit vieillard si doux chantait doucement
une chanson d’amour.
Le chant se perdit dans le bruit
de la foule et des machines
Et me chants et mes larmes se perdront aussi
dans les cercles horribles
ô éternité.
Giorgio de Chirico, Poèmes Poesie, présentés par
Jean-Charles Vegliante, Solin, 1981, p. 25/
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giorgio de chirico, poèmes, mélancolie | ![]() Facebook |
Facebook |
10/12/2025
André Frénaud, HÆRES
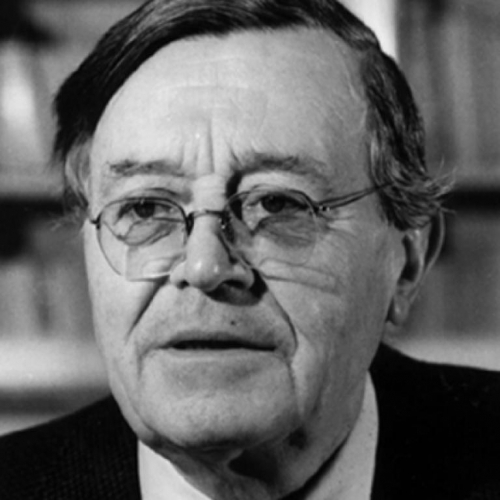
Les expressions de la physionomie
Celui qui sans raison prétend au sacrifice,
celui dont les dons ne valent plus,
celui qui s’entête, celui qui écourte,
celui qui fait la roue — qui fait semblant —
celui qui s’est détourné, qui est là encore
quand il sourit sans plus récriminer,
celui qui s’encourage par des billevesées
à défaut de mieux,
celui qui hurle parce qu’il ne sait plus dire,
celui dont le cri s’est étranglé,
celui qui s’entrouvrait à la rumeur
qu’il n’entend plus,
celui-ci, le même,
sous différents jeux de physionomie,
dans la bonne direction décidément,
et qui atermoie, qui atermoie,
conserve-t-il de la bonté, je le voudrais.
André Frénaud, HÆRES, poèmes 1968-1981,
Gallimard, 1982, p. 253.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, haeres, physionomie | ![]() Facebook |
Facebook |
09/12/2025
Ossip Mandelstam, Tristia
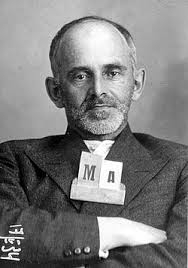
Ce chant de grillon de l’horloge
c’est le murmure de la fièvre,
le râle desséché du poêle
c’est rouge soie qui se consume.
Si ronge la dent des souris
la trame amincie de la vie,
c’est que l’aronde ou dans sa ronde
son enfant détache ma barque.
Ce qu’au toit la pluie balbutie
c’est noire soie qui se consume,
mais le merisier n’entendra
jusqu’au fond des mers que « pardonne. »
Parce qu’innocente est la mort
et de rien ne vient le secours
si dans ta fièvre rossignol
le cœur a gardé sa chaleur.
Ossip Mandelstam, Tristia, dans Œuvres
poétiques, Le Bruit du temps/La Dogana,
2019, p. 177.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : osait mandelstam, tristia, grillon, rossignol | ![]() Facebook |
Facebook |
08/12/2025
Ossip Mandelstam, Poésies complètes
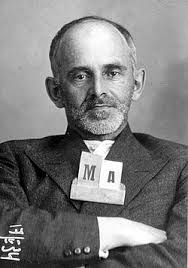
Pour la gloire grondante des siècles futurs,
pour l’éminente tribu des hommes
je perds le droit de boire au festin des pères,
ainsi que l’allégresse et l’honneur.
Le siècle chien-loup m’a bondi sur l’épaule,
mais je n’ai de sang de loup ; fourrez-moi
ainsi qu’une chapka, dans la manche
d’une pelisse pour steppe sibérienne.
Que je ne voie ni froussard ni boue morbide,
ni ossements sanglants dans la roue,
et que pour moi dans la nuit les renards bleus
luisent de leur beauté primitive.
Mène-moi de nuit où l’Ienisséï coule,
là où le pin touche jusqu’aux étoiles,
parce que loup par le sang je ne suis pas
et que seul me tuera mon semblable.
17-18 mars 1931
Ossip Mandelstam, Œuvres poétiques, traduction Jean-Claude Schneider, Le Bruit du temps/La Dogana, 2018, p. 364.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : osait mandelstam, poésies complètes, loup, renard | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2025
Chapiteaux romans (Autun)
Photos T.H.
| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2025
Anne Malaprade, épuiser le viol

Et tu récites une prière, et tu te redis, et tu écris, et tu domptes ton corps : l’obéissance à la Loi qu’on s’est prescrite en liberté. Purain de Loi : tu n’as pas assez travaillé, tu as menti, tu as demandé aux autres de te couvrir, de fumer, de boire. Tu as triché, tu n’as pas appris jusqu’à l’écœurement, tu as joué, tu as volé, tu as déchiré, tu as fait des faux, tu as recopié. Putain de Loi, putain de travail, putain de pensée, putain de partition, putain de main agrippée, putain d’orthographe dont j’accroche les mots jusqu’à les casser. Tu fais travailler la pute en toi, et cette pute c’est l’humanité qui te reste et que tu protèges et qui au réveil est toujours encore plus fatiguée.
Anne Malaprade, épuiser le viol, éditions isabelle sauvage, 2025, p. 118.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anna malaprade, épuiser le viol, loi | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2025
Jean-Pierre Schlunegger, Feu de grève

Écriture
Pipe éteinte gueule de nuit sur la table
Objets dissous à peine formulés
Comme une rivière
Tout l’infini des rêves
Vides de sens
Des trous dans l’air
Monde crapaud
En mal de disparaître
Où les objets
Se meurent séparés
Halo tueur
La lampe rit
Blancheur de linge
Et sur la plage
Les mots suffoquent
Leurs pattes noires
Tremblent encore
Semblant de vie
À peine éclose
Ici mes mains
Là le reflet de mon visage
Surnagent mollement
Dans le pâle décor
En moi le même avortement d’images
Jean-Pierre Sclunegger, Feu de grève dans
La revue de belles-lettres, II, 2025, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre schlunegger, feu de grève, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
03/12/2025
Anne Malaprade, épuiser le viol

Solution : renoncer, se cacher, trouver un placard, un coin, un espace retranché, se terrer, fermer les yeux pour ne plus entendre, se boucher les oreilles, ne plus percevoir. devenir animal, existence nyctalope. Tout ce qui dépasse du corps se replie. Nul bras, aucune jambe ne doit paraître. Violette devient boule, tête dans les muscles, dos dans le ventre sphérique. L’espace-cagibi recueille l’émotion-porc-épic. On y trouve des réserves de chaleur, d’obscurité, de lait, d’eau, un sol collant, des planches assez larges pour figurer une couche. Les foulards sentent le cuir, les tissus sont usagés, les talons abîmés. C’est un concentré d’odeur familiale.
Anne Malaprade, épuiser le viol, éditions isabelle sauvage, 2025, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne malaprade, épuiser le viol, famille, ce cacher | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2025
Anne Malaprade, épuiser le viol

Échapper à soi, fuir de soi, quitter son corps, déplacer le regard, le monde, le monde, résoudre un problème, lire Wittgenstein, Musil, Proust, les plus difficiles, suivre des cours de logique, donner de l’argent et pas simplement du temps, pas uniquement de l’écoute, sourire dans le vide, translater la vitre.
Entrer dans un tableau, caresser une sculpture, posséder un son, monter l’échelle qui mène aux livres, dormir dans l’atelier, jouer avec les coussins multiples, essayer tous les parfums de Louve, se laver les yeux, construire sans copier, expliquer sans recopier, concevoir un raisonnement, aller chercher les preuves dans une bibliothèque, repérer les pages, retenir les généalogies grecques, placer les îles sur une carte vierge de toute mémoire.
Anne Malaprade, épuiser le viol, éditons isabelle sauvage, 2025, p. 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne malaprade, épuiser le vio | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2025
Robert Desnos, Domaine public

Au bout du monde
Ça gueule dans la rue noire au bout de laquelle l’eau du
fleuve frémit contre les berges.
Ce mégot jeté d’une fenêtre fait une étoile.
Ça gueule encore dans la rue noire.
Ah ! vos gueules !
Nuit pesante, nuit irrespirable.
Un cri s’approche de nous, presque à nous toucher,
Mais il expire juste au moment de nous atteindre.
Quelque part dans le monde, au pied d’un talus,
Un déserteur parlemente avec les sentinelles qui ne
comprennent pas son langage.
Robert Desnos, Les Portes battantes, dans Domaine
public, Gallimard/Le Point du jour, 1953, p. 289.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, au bout du monde | ![]() Facebook |
Facebook |
30/11/2025
Robert Desnos, Domaine public

Hommes
Hommes de sale caractère
Hommes de mes deux mains
Hommes du petit matin
La machine tourne aux ordres de Deibler
Et rouages après rouages dans le parfum des percolateurs qui suinte des portes des bars et le parfum des croissants chauds
L’homme qui tâte ses chaussettes durcies par la sueur de la veille et qui les remet
Et sa chemise durcie par la sueur de la veille
Et qui la remet
Et qui se dit le matin qu’il se débarbouillera le soir
Et le soir qu’il se débarbouillera le matin
Parce qu’il est trop fatigué
Et celui dont les paupières sont collées au réveil
Et celui qui souhaite une fièvre typhoïde
Pour enfin se reposer dans un beau lit blanc…
Et le passager émigrant qui mange des clous
Tandis qu’on jette à la mer sous son nez
Les appétissants reliefs de la table des premières classes
Et celui qui sort dans les gares du métro et que le chef de gare chasse jusqu’à la station suivante…
Hommes de sale caractère
Hommes de mes deux mains
Hommes du petit matin
Robert Desnos, Les sans cou, dans Domaine public,
Gallimard/Le Point du jour, 1953, p. 243.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, caractère | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2025
Robert Desnos, Domaine public

(…) Je n’ai pas fini de te dire tout.
Mais à quoi bon…
L’indifférence en toi monte comme un rosier vorace qui, détruisant les murailles, se tord et grandit,
Étouffe l’ivrogne de son parfum…
Et puis, est-ce que cela meurt ?
Un clair refrain retentit dans la ruelle lavée par le matin, la nuit et le printemps.
Le géranium à la fenêtre fermée semble deviner l’avenir,
C’est alors que surgit le héros du drame.
Je te conte cette histoire qui ne tient pas debout que parce que je n’ose
pas continuer comme j’ai commencé
Car je crois à la vertu des mots et des choses formulées.
(…)
Robert Desnos, Siramour, dans Domaine
public, Gallimard/Le Point du jour, 1953, p. 206-207.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, histoire | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2025
Robert Desnos, Domaine public

En sursaut
Sur la route en revenant des sommets rencontré par les corbeaux et les châtaignes
Salué la jalousie et la pâle flatteuse
Le désastre enfin le désastre annoncé
Pourquoi pâlir pourquoi frémir ?
Salué la jalousie et le règne animal avec la fatigue avec le désordre avec la jalousie
Un voile qui se déploie au-dessus des têtes nues
Je n’ai jamais parlé de mon rêve de paille
Mais où sont partis les arbres solitaires du théâtre
Je ne sais où je vais j’ai des feuilles dans les mains j’ai des feuilles dans la bouche
Je ne sais si mes yeux se sont clos cette nuit sur les ténèbres précieuses ou sur un livre d’or et de flamme
Est-il le jour des rencontres et des poursuites
J’ai des feuilles dans les mains j’ai des feuilles dans la bouche
Robert Desnos, Ténèbres, dans Domaine public, Gallimard/Le Point du jour, 1953, p. 150.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, domaine public, ténèbres | ![]() Facebook |
Facebook |









