19/06/2022
Michel Collot, Épitaphes Épiphanies : recension
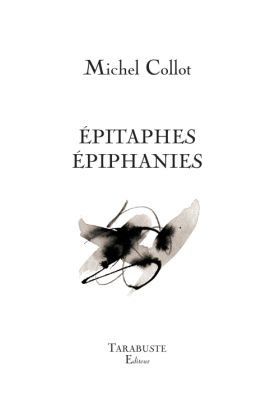
Le livre s’ouvre par les « Épiphanies » et le poème inaugural oriente la lecture avec son double lien à la vie, l’enfance présente intégrée à la nature, « L’enfant parlait aux arbres ». Il participe ainsi à l’harmonie du monde : au mouvement des branches répondent des sons variés qui s’organisent en une sorte de chant, lui-même parallèle à celui des oiseaux — et cette harmonie est restituée par le poème. Cette fusion heureuse se répète dans d’autres circonstances. Les voix venant d’une maison se confondent avec les sons extérieurs, tous manifestations du vivant : chant des oiseaux, chocs issus des travaux, bruit d’un tracteur, d’un train, etc., « toutes ces notes » composent un « concert », « Les sons de la nature s’accordent à distance avec ceux du travail ». Après la plongée dans le monde, le silence du retrait est nécessaire pour « l’écoute des mots » et l’écriture de la polyphonie.
La rupture d’avec le vécu qu’exige l’écriture, le lecteur la reconnaît dans de brefs poèmes-récits. Une partie de pêche, par exemple, est interrompue par l’envol — vrai « coup de foudre » — d’un oiseau inconnu, ce qui conduit à la rêverie, puis d’un événement somme toute banal, au désir d’en conserver une trace par les mots. Dans un contexte autre, celui du conte, un scribe comprend que son immobilité use et vieillit son corps ; il abandonne son activité répétitive au service des puissants, court la campagne et devient écrivain public pour les pauvres ; lorsqu’il est seul, le soir, il trace avec son pinceau « des phrases inattendues, enchevêtrées et pourtant limpides ». Après sa mort, leur « beauté (...) s’imposa d’emblée comme une évidence » à ses fidèles, « mais on dispute encore à l’infini sur leur sens ».
Le pinceau a laissé des traces de ce que provoquent les émotions, les choses de la vie, soit rien d’immédiatement lisible ; ce qui est vécu offre seulement, comme les jardins d’Étretat évoqués ailleurs, des « jeux d’ombre et de lumière ». Rien n’est aisément déchiffrable parce que la tromperie, les jeux de masque sont toujours possibles. On le voit dans la relation d’un vernissage ; Michel Collot décrit les comportements des invités, obséquieux auprès du peintre, seulement préoccupés de leur apparence, de se mettre en avant ; il leur oppose, à l’extérieur de la galerie, la manière d’être d’une fillette qui, « Tournant le dos à l’assistance » lit et, ainsi, « découvre (...) le vrai visage de la vie », alors que ceux qui se donnent en spectacle derrière la vitre n’en présentent qu’un aspect étriqué. Seule vaut l’attention aux choses du monde, aux mots qui en proposent quelques aspects.
Michel Collot insiste sur ce que chacun, s’il ouvre yeux et oreilles, devrait voir et entendre : tout se transforme sans cesse dans ce monde, y compris les phénomènes les plus communs. Les jours de pluie les trottoirs deviennent des miroirs, les flaques reflètent le ciel et, levant la tête, on voit dans les nuages, des signes, des formes variées, des visages même. Voyons l’hiver : la neige a recouvert toutes choses et tout est nouveau, on constate que « la lumière semble émaner du sol ». Ces métamorphoses modifient le plus souvent de manière heureuse les éléments de la nature ; la vague donne un instant à la pierre « terne » l’éclat d’un joyau, les fleurs tombées de jacarandas deviennent nuages ou eau, ailleurs les couleurs azur ou mauve des fleurs « à ras de terre » donnent l’illusion que le ciel ou la mer sont venus sur le sol — « ici-bas l’au-delà ». Le torrent est un lieu privilégié de changements continuels avec ses reflets, ses remous, ses bouillonnements mais sa métamorphose, parfois, « rompant le pacte séculaire », est destructrice : le torrent se transforme en fleuve qui emporte tout, arbres et constructions humaines — comme la mort.
Quand la mort vient, c’est la totalité du monde qui se transforme et perd sa lumière. À la mort de l’aimée, la brume a dissimulé la mer et bientôt « un linceul enveloppe le ciel et la terre inertes ». Comment dire le souffle qui s’en va ? Michel Collot rappelle justement le « I can’t breathe » du Noir américain George Floyd, le genou d’un policier lui écrasant la gorge. Moment tragique de la violence ou de la maladie, quand ce qui fait vivre, le souffle, est rompu. Avec la mort disparaît le partage, le lien à l’Autre, l’aimée devient la présence absente — « je tâte le drap dans le noir pour m’assurer que tu es bien à mes côtés », écrit Michel Collot. Il ne peut y avoir de « survie » de ce « double invisible » que par les mots qui empêcheront la disparition complète. On pense aux souvenirs qui se lèvent à telle ou telle occasion : en préparant un thé à la menthe surgissent les cimes de l’Atlas, formes et couleurs. Flot d’images ; « Éblouissant, le souvenir sort de l’oubli. »
- Des textes lus dans un rêve étaient une énumération de motifs lyriques traditionnels, ils « parlaient de l’amour qui fuit, du temps qui passe, de la vie brève ». Ces thèmes correspondent à ce qui a été vécu : comment ne pas essayer de ne rien en laisser échapper jusqu’aux derniers moments et le proposer en partage ? On lit dans le livre, et pas seulement dans l’ensemble "Épitaphe" (le pluriel du titre a disparu) la tentative, sans recherche formelle complexe, de « faire bouger le sens et vibrer l’émotion dans les mots ».
Michel Collot, Épitaphes Épiphanies, Tarabuste,2022, 100 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 16 mai 2022.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel collot, épitaphes épiphanies, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
14/03/2019
Jules Supervielle, Le Corps magique

Qui parle ?
L’univers fait un faible bruit
Est-ce bien lui à mon oreille ?
Pourquoi si faible si c’est lui
Alors qu’il n’a pas son pareil
Pour être lui, même la nuit.
Que deviendra ce faible bruit
A ses seules forces réduit
Sans une oreille qui le pense,
Sans une main qui le conduise,
Où le bruit est encore le bruit.
Où le silence à son silence
Très secrètement se fiance.
Jules Supervielle, Le Corps magique, dans
Œuvres poétiques complètes, éditions
Michel Collot, Pléiade/Gallimard, 1996, p. 601.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jules supervielle, le corps magique, michel collot, bruit, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
31/01/2019
Michel Collot, Le parti-pris des lieux : recension
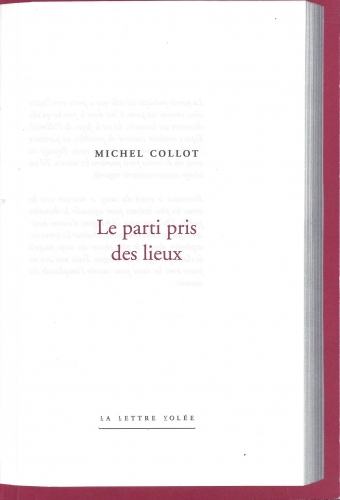
Connaisseur de la poésie moderne et contemporaine, Michel Collot a beaucoup écrit à propos du paysage*. Le parti pris des lieux rassemble pour l’essentiel des poèmes en prose à propos de paysages ’’naturels »’’, puis de paysages urbains ; suivent une série de rêves et des poèmes écrits après une résidence à Charleville. Les dernières séquences constituent une ouverture, réflexions sur l’architecture grecque et sur des peintures de paysages. Ajoutons que, d’un bout à l’autre, l’écriture des paysages est souvent moyen de définir ce qu’est pour lui la poésie.
Les paysages, vus directement ou réinventés grâce aux tableaux, sont des espaces explorés de diverses manières et liés au temps, ‘’lieu mémoire’’. Deux courts avant textes annoncent ces caractéristiques, j’en extrais la première phrase : « La parole poétique est celle qui se porte vers l’autre rive, comme un pont » et « Remonter le cours du sang, se tourner vers les zones les plus intimes pour agrandir le domaine public ». Ce qu’apprennent les proses données autobiographiques, c’est l’absence pour Michel Collot d’ancrage dans un paysage pendant l’enfance, contrairement à celui qui, né dans un village de Bourgogne ou des Landes, apprécie d’en dire les charmes ; il a vécu dans cette absence de lieu qu’est toute banlieue, loin de la Champagne paternelle et du Vaucluse maternel : « n’étant nulle part », il devint capable d’une « adhésion fugitive » à un lieu jusqu’alors inconnu, chaque fois que « le temps d’un instant, se nouait un certain accord entre moi et le monde, entre le ciel et la terre, entre la nature et les hommes. » C’est ensuite par l’écriture qu’il invente ses propres paysages.
L’inconnu ne devrait jamais être inquiétant, il apparaît plutôt comme une chance puisqu’il oblige chaque fois à « faire l’épreuve de [notre] relation intime avec le monde » et, ce faisant, à reconnaître notre « appartenance au monde ». L’écriture du paysage, à partir de ces prémices, abandonne l’idée commune du lyrisme comme expression du moi : il est ici « expression du sujet hors de soi qui explore son propre inconnu à travers l’étrangeté du monde et des mots ». Ce sont des fragments de cette exploration qui sont proposés, les paysages les moins aimables pouvant être appréciés. Ainsi, on sait que « la mondialisation habille le globe de teintes uniformes », cependant rien n’empêche de voir la ville autrement que grise et de la réinventer à partir des matériaux disponibles devant soi. Un exemple : Michel Collot, assis un soir d’hiver dans un abribus, voit sur l’immeuble en face de lui la mention d’une pension de famille et il commence à « imaginer la vie des pensionnaires », puis il découvre dans les vitres d’une fenêtre ouverte « un paysage inaperçu », enfin une jeune fille à sa fenêtre le fait rêver — jusqu’au moment où l’autobus arrive. Ce poème récit illustre la manière dont peuvent se révéler autres les choses du monde.
Il faut évidemment prêter une attention particulière à ce qui nous entoure pour comprendre, non qu’il y a des choses cachées dans le quotidien mais plutôt qu’à tout moment peut naître une émotion, que l’imagination s’empare aisément d’un détail. Alors, le lieu et le temps se transforment, parfois de manière inattendue : ainsi, « au bord du précipice (…) on plonge dans les entrailles de la terre » et, entre les murettes, on s’égare dans un « dédale de couloirs » vers quelle issue ? « le vide », et l’on se dit, en l’espérant et en le craignant : « Le Minotaure nous y attend » — avant à nouveau de marcher sur un sentier plus avenant. Un autre ’’lieu’’ privilégié — espace et temps s’y confondent — est le sommeil, grâce auquel le narrateur « plonge dans la nuit des temps, descend au fond de la grotte obscure des sensations. » La paroi où la cordée progresse est aussi mouvement vers l’inconnu et la plus petite erreur peut conduire à la chute, alors « une main se tend, une voix répond », « L’échange est renoué », la chute écartée. Il est donc des lieux dangereux qui, par leur nature même, peuvent conduire à la disparition. Dans les poèmes de Michel Collot, le vide est toujours proche : celui des cauchemars n’est dissipé que par le jour, qui aide à « échapper à l’abîme du sommeil et à la masse obscure des rêves. » Le vide est également présent dans la vie de chaque jour, ainsi la jeune femme qui a fait rêver le narrateur « s’appuy[ait] sur le garde-corps », et lui-même prend garde à vérifier, lorsqu’il se trouve à un étage élevé, qu’un appui à une fenêtre le préservera de la chute ; dans un rêve, il voit une « rambarde très basse » et, rapporte-t-il, « je crains de tomber ».
Il faut sans cesse ouvrir les yeux pour voir ce qui échappe au premier regard pour lequel tout est indistinct, et comprendre progressivement que toujours un « rayon (…) perce à jour toutes choses (…) : les voici de nouveau visibles, et rendues à leur part d’invisible. » Ainsi la poésie : beaucoup « de mots éculés, sans cesse remâchés pour retrouver enfin par la grâce d’une image la saveur de la langue. » Cette exploration des lieux est sans cesse révélation, des « ramifications secrètes » de la paroi rocheuse au surgissement de la rivière un temps partie dans « l’épaisseur obscure » de la terre. Ainsi de la poésie : « la ligne devient sens, le sens prend la tangente — tangent à l’infini ».
Michel Collot, Le parti-pris des lieux, La Lettre volée, 2018, 128 p., 19 €.Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 28 décembre 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel collot, le parti-pris des lieux, exploration, inconnu | ![]() Facebook |
Facebook |
04/01/2019
Michel Collot, Le parti-pris des lieux

Face revêche, le mur lépreux. La suie, la crasse s’y sont accumulés pendant un siècle, incrustées dans le moindre interstice. Sur la paroi le regard glisse, le corps dévisse.
Sous la couche uniforme, enduite d’ennui, transparaissent pourtant quelques zones plus pâles, ou plus sombres, et même des traces de couleur. On croit parfois surprendre deux silhouettes qui s’esquissent. Elles animent un instant la tristesse ambiante, puis disparaissent dans le halo d’un autre noir. Ballet de spectres qui s’esquivent, intermittent.
Mais à l’aurore tout devient clair pour qui sait lire le palimpseste. Les taches roses se recomposent, lettres géantes, majuscules où l’on déchiffre : SAINT-RAPHAÊL, puis en dessous, en lettres minuscules : quinquina.
L’opacité s’est déchirée, l’espace soudain s’est rouvert : je plonge dans la foule, tout requinqué d’avoir trouvé, sous les pavés, la plage.
Michel Collot, Le parti-pris des lieux, La Lettre volée, 2018, p. 58.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel collot, le parti-pris des lieux, palimpseste, aurore, réclame | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2012
Place de la Sorbonne, revue annuelle, n° 2, mars 2012

On ne dit rien de remarquable quand on insiste sur le rôle essentiel des revues, quel que soit leur tirage (souvent modeste) et leur fréquence, pour la diffusion de la poésie : à côté d'auteurs bien connus, qui attirent l'acheteur, bien des auteurs nouveaux trouvent là un support indispensable. Leur diversité reflète la variété du paysage poétique en France, qu'elles soient pour l'essentiel consacrées à la poésie — Action poétique, Dans la lune, N4728, Nu(e), Rehauts, Triages, etc. — ou accordent une part plus ou moins importantes à d'autres formes de littérature, aux arts et à la lecture des œuvres — Conférence, L'Étrangère, Europe, Friches, Fusées, Il Particolare, Thauma, etc.1 Il faudrait ajouter la riche floraison de sites et blogs qui, sans les remplacer, complètent le rôle des revues papier.
En tout cas, l'arrivée d'une nouvelle revue ne peut que réjouir. Le second numéro de Place de la Sorbone, qui a pour sous-titre "Revue internationale de poésie de Paris Sorbonne", a vu le jour en mars. Son rédacteur en chef, Laurent Fourcaut, poète, est aussi un universitaire fin connaisseur de la poésie contemporaine, à laquelle une large pace est donnée (le 1/3 de la livraison), avec des poètes reconnus — de Marie-Claire Bancquart, Charles Dobzynsky à Jean-Pierre Verheggen —, d'autres beaucoup moins. Une large place est réservée à la poésie d'autres langues : Erich Fried pour l'allemand, Diane Glacy pour l'anglais des États-Unis, Rachel pour l'hébreu, David Rosenman-Taub pour l'espagnol du Chili ; les traductions, de qualité, sont toujours précédées du texte original, ce que ne font guère la plupart des revues.
Plusieurs rubriques prolongent ces deux ensembles. Dans cette livraison, Michel Collot, dont on connaît les travaux sur la poésie, donne des pistes pour s'y retrouver dans "le paysage brouillé de la poésie française contemporaine" ; d'une manière fort différente, Lionel Ray éclaire lui aussi dans un entretien la situation de la poésie vivante, tout comme le font les réflexions sur la question du sens de Jean-Claude Pinson.
Il faut ajouter "Contrepoins" avec les picto-clichés de Roxane Maurer et leur lecture, "Vis-à-vis" où un poème (de Claude Ber) est commenté, et des notes de lecture qui ne privilégient pas des ouvrages récents mais s'apparentent, un peu trop, plus à de mini monographies qu'à des notes. La revue (372 pages) est éditée sur un beau papier, avec une mise en pages aérée, une typographie bien lisible, et son prix (15 €) est modique. Longue vie à cette Place de la Sorbonne !
Place de la Sorbonne, n° 2, revue annuelle, éditions du Relief, 15 €.
Cet article a paru dans Les carnets d'eucharis début avril 2012.
Conclusion de Michel Collot, "Le paysage brouillé de la poésie française contemporaine" (p. 20-21)
(...) le paysage, qui appartient à une longue tradition, n'est pas pour autant un thème passéiste ou nostalgique : il participe pleinement de l'actualité littéraire, artistique et intellectuelle en France et dans beaucoup d'autres pays, où les questions d'environnement sont devenues un enjeu majeur, à la fois social et culturel. Dans le champ poétique, sa résurgence répond au besoin de dépasser la clôture du texte et de la subjectivité pour ouvrir le poème au monde, car le paysage le plus familier comporte un horizon par lequel il s'ouvre sur l'ailleurs, et il est déjà en lui-même une image du monde.
Renouer ainsi avec le monde, c'est peut-être aussi un moyen pour les poètes de retrouver le contact avec un public plus large. Après les stratégies de rupture ou de repli qui ont caractérisé les dernières décennies du XXe siècle, beaucoup ont ressenti le besoin de restaurer la communication poétique avec le monde et avec le lecteur en mettant en œuvre ce que j'appellerai avec Édouard Glissant une « poétique de la relation ».
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : place de la sorbonne, revue, laurent fourcaut, michel collot, erich fried, rachel | ![]() Facebook |
Facebook |





