31/03/2020
Joseph Joubert, Carnets, I

L’imagination est le goût. La raison est sans appétits : la vérité et la justesse lui suffisent.
Le papier est patient, mais le lecteur ne l’est pas.
Tout ce qui est très plaisant a quelque exagération et contient nécessairement une vérité défigurée.
Les animaux aiment ceux qui leur parlent.
Le châtiment de ceux qui ont trop aimé les femmes est de les aimer toujours.
Joseph Joubert, Carnets, I, Gallimard, 1938, 1994, p. 271, 272, 273, 274, 278.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joubert, Joseph | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph joubert, carnets, i, imagination, raison, vérité, animal, femme | ![]() Facebook |
Facebook |
30/03/2020
Vanda Mikšić, Jean de Breyne, des transports : recension
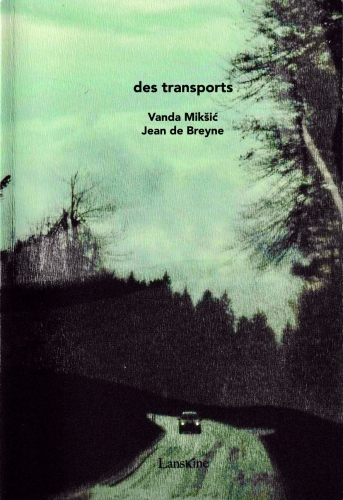
Vanda Mikšić, poète croate, traductrice de l’italien et du français, voyage souvent en bus, en voiture, alors que Jean de Breyne se déplace plutôt en train et en avion. Les deux écrivains ont décidé qu’au cours de leurs voyages, ils s’écriraient des poèmes et c’est cette correspondance, de septembre 2014 à décembre 2016, qui est publiée. Tous deux sont des observateurs du monde et ils notent ce qu’ils voient et entendent pendant quelques heures dans ce lieu clos qu’est le moyen de transport emprunté.
Qui a voyagé reconnaîtra cette femme qui s’est trompée de numéro de siège et, sûre de son bon droit, refuse de le reconnaître. Il entendra cet homme qui ronfle et, en car, les bavardages du chauffeur ; à l’heure du repas, des sacs s’ouvrent et les odeurs de nourriture s’imposent. Vanda Mikšić voit « les gouttes / qui filent /sur le pare-brise », elle s’amuse de la figure dessinée par les chiffres 6 et 9 et les trépidations du car sont telles que « S’éveillent des désirs » ; elle essaie de ne pas vexer ce poète qui veut lui faire lire ses vers. Jean de Breyne observe une femme qui « A défait son chignon ses cheveux / Sont tombés sur ses épaules / Puis de ses deux mains / Elle les a relevés et rattachés » et, dans un voyage en avion, il s’attarde sur le visage d’une femme endormie, une autre fois c’est dans le hublot qu’il regarde « un profil avec cheveux blonds / échappés / sur la joue ». L’extérieur, en train ou en car, existe grâce aux fenêtres et chacun pourrait écrire
Toujours je regarde
Toujours je peux être ému
par les feuillages.
Et défilent, pour le passager du TGV, haie, ruisseau, étang, arbres, les gares. On écoute les annonces, on oublie les visages. Parfois, des animaux ou un arbre sur la voie arrêtent momentanément le voyage, puis le train repart « tout droit sans écart (...) / Vers là-bas ». Train ou car traversent le paysage, et l’on sait bien qu’il n’est pas indispensable de regarder, ce que note Jean de Breyne : « Même ce que je ne vois pas / Les animaux les humains / Je vois tout cela / Parce que je le sais ». Divers incidents peuvent rompre l’inévitable monotonie des déplacements, il n’empêche que rien d’autre n’est à partager avec les voyageurs que le parcours. « On espère toujours l’indicible / mais on se heurte au temps ». Ce temps, comme l’espace, peut s’abolir quand le car, par exemple, avançant dans un brouillard épais, semble être « nulle part ». Dans l’avion, la relation au temps change : l’extérieur disparaît et le voyageur n’a plus aucun repère, au-dessus des nuages tout apparaît immobile, le seul contexte est l’intérieur de la cabine.
Mais voyager, quelle que soit la durée du voyage, c’est toujours, répètent Vanda Mikšić et Jean de Breyne, connaître la séparation d’avec le quotidien et, de là, questionner ce qu’est sa vie. L’un se demande ce qu’est la réalité : est-ce vraiment ce que l’on regarde par la fenêtre ? Et qu’est-ce que l’on met entre parenthèses le temps d’un voyage ? Comment penser le temps qu’il reste à vivre ? Le voyage est aussi le temps du retour sur sa propre histoire et, encore, l’occasion de penser le présent. Vanda Mikšić s’interroge sur tout ce qui conduit ses contemporains à consommer aveuglément « tous les biens de masse / fabriqués par le capital ». En feuilletant son carnet, elle retrouve les dessins de son fils qui, à sa manière, explore le monde. Elle lit, beaucoup, et revient sur son activité de traductrice qu’elle vit comme « un risque, une aventure » — ce dernier mot aussi sous la plume à propos du voyage. Elle quitte le présent du voyage et dans un rêve éveillé imagine des ébats amoureux dans une chambre à Tokyo...
Toute correspondance, celle-ci par internet, doit être échange et chacun ici écrit en pensant au destinataire, par exemple en lui faisant part de préoccupations à propos de la vie, du travail — les poèmes de Vanda Mikšić sont publiés par Jean de Breyne et elle le traduit. Dans une lettre, Jean de Breyne accumule les jeux de mots autour des noms de ville (Rennes/reine, Lorient / l’Orient, etc.), ce qui ne l’empêche pas, après avoir évoqué l’écriture de Vanda Mikšić, de penser que « La tragédie est le lot de chacun ». Elle s’enquiert à plusieurs reprises de ce qu’il fait et rappelle le lien qui les unit au moment où elle lit L’Amitié de Blanchot, « l’amitié, Jean, c’est ce que je lis ». Chacun écrit pour partager quelques moments de vie, en évitant de dire ce qu’il y a d’intime en soi mais en faisant part, sans détours, de ce qui l’absorbe au moment de l’écriture : c’est ce qui fait le charme de cette correspondance.
Vanda Mikšić, Jean de Breyne, des transports, Lanskine, 2019, 88 p., 14 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 28 février 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vanda mikšić, jean de breyne, des transports : recension ; correspondance, poète croate | ![]() Facebook |
Facebook |
29/03/2020
Estienne de la Boétie, Sonnets

J’ai fait preuve des deux, meshui je le puis dire :
Soit je pres, soit je loing, tant mal traicté je suis,
Que choisir le meilleur à grand peine je puis
Fors que le mal present me semble tousjours pire.
Las ! En ce rude choix que me fault il dire ?
Quand je ne la voy point, le jours me semblent nuits ;
Et je sçay qu’à la voir j’ai gaigné mes ennuis :
Mais deusse je avoir pis, de la voir je desire.
Quelque brave guerrier, hors du combat surpris
D’un mosquet, a despit que de pres il n’aist pris
Un plus honneste coup d’une lance cogneue :
Et moy, sachant combien j’ay par tout enduré,
D’avoir mal pres & loing je suis bien asseuré ;
Mais quoy ! s’il faut mourir, je veux voir qui me tue.
Estienne de la Boétie, Sonnets, dans Œuvres complètes, II, édition Louis Desgraves, Conseil général de la Dordogne/William Blake ans Co, 1991, p. 127.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : estienne de la boétie, sonnets, amour, dédain | ![]() Facebook |
Facebook |
28/03/2020
Henri Thomas, Le crapaud dans la tour

La pleine lune éclairait ma chambre par la fente des volets, et mon chien qui se promenait dans la propriété était fou comme à chaque pleine lune ici. Colpach ne connaissait, jusqu’à l’été, que les nuits des Ardennes. Celles d’ici, par pleine lune, l’ont mis dans de telles frayeurs que j’ai presque regretté de l’avoir amené, mais je n’avais vraiment personne à qui le confier. Il a peur, et il se met à aboyer, c’est le cas de le dire, à la lune. Cela m’a valu des plaintes de nos hôtes intellectuels. Cette nuit-là j’ai entendu une fenêtre s’ouvrit, et la voix de la jeune artiste-peintre : « Ô ce chien ! »
Colpach ne se calme que si je viens à lui et lui prends le museau dans ma main. Je l’ai trouvé sur une terrasse écartée, et je l’ai amené dans mon garage où il fait noir.
Henri Thomas, Le crapaud dans la tour, Fata Morgana, 1992, p. 14-15.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, le crapaud dans la tour, chien, pleine lune, peur | ![]() Facebook |
Facebook |
27/03/2020
Italo Svevo, Écrits intimes

Aujourd’hui, je suis passé devant la fenêtre d’un rez-de-chaussée. IL y avait un chat qi regardait la ville avec l’attention objective et indifférente qui est la qualité de ce petit félin au repos. Ce chat me donna envie de rire. Blanc et jaune, il avait autour du nez une tache plus sombre, qui était peut-être causée par de la saleté, ce qui lui conférait une apparence de dédain. Ce petit nez semblait se tordre de dégoût. Mais un animal à ce point inerte ne doit pas exprimer un tel dégoût. Je lui dis : « Stupide animal ! »
Il me regarda et ne donna pas d’autre réponse. Mais il n’aurait pas eu besoin d’autre chose, parce qu’avec ce geste, il avait concentré sur moi tout cet ennui qu’il avait manifesté au quartier tout entier.
Mais, derrière lui, se dressa la petite tête d’un enfant de douze ans et, de sa fenêtre sombre, il me retourna mon insulte : « C’est toi qui es stupide, et pas ma bête. »
Et j’aimai cet enfant, qui protégeait son chat.
Italo Svevo, Écrits intimes, traduction Mario Fusco, Gallimard, 1973, p. 115.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italo svevo, Écrits intimes, mario fusco, chat, dédain, protection | ![]() Facebook |
Facebook |
26/03/2020
Eduard Mörike (1804-1875), Poèmes

À l’aimée
Lorsqu’à te contempler je me sens apaisé
Comblé, sans faim, sans voix, près de ton ssanctuaire
Je crois alors tout bas entendre respirer
L’ange qui te ressemble et habite en toi.
Un sourire étonné et qui doute, incrédule
Vient naître sur ma lèvre : est-ce leurre, illusion,
Puis-je croire enfin que on unique désir,
Mon vœu le plus hardi, en toi sera comblé ?
Quand plonge mon esprit d’abîmes en abîmes
J’entends dans l’antre noir de la divinité,
Les sources du Destin au bruit mélodieux.
Je porte mon regard chancelant vers les cieux :
Au firmament, là-haut, me sourient les étoiles ;
Et j’écoute à genoux leur beau chant lumineux.
Eduard Mörike, Poèmes, traduction Nicole Taubes,
Les Belles Lettres, 2010, p. 151.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eduard mörike, poèmes, à l'aimée, destin, ange | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2020
Christopher Okigbo, Labyrinthes

Et comment dit-on NON en plein tonnerre ?
On trempe sa langue dans l’océan ;
Campa avec le chœur des dauphins
Inconstants, près de minces bancs de sable
Arrosés de souvenirs ;
On étend ses branches de corail
Les branches s’étendant dans le silence
Des sens ; ce silence se distille
En jaunes mélodies.
Christopher Okigbo, Labyrinthes, traduit de l’anglais
(Nigeria) Christiane Fioupou, Gallimard, 2020, p. 141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christopher okigbo, labyrinthes, dire non, mer, silence, mélodie | ![]() Facebook |
Facebook |
24/03/2020
Henri Michaux, Face aux verrous

Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage.
Les oreilles dans l’homme sont mal défendues. On dirait que les voisins n’ont pas été prévus.
Il devait retenir son œil avec du mastic. Quand on en est là...
À chaque siècle sa messe. Celui-ci, qu’attend-il pour instituer une grandiose cérémonie du dégoût ?
Henri Michaux, Face aux verrous, dans Œuvres complètes, II,
Pléiade/Gallimard, 2001, p. 452, 454, 457, 457.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, face aux verrous, henri michaux, face aux verrous | ![]() Facebook |
Facebook |
23/03/2020
Pierre Reverdy, En vrac

Le réel est en dehors de moi. Pour m’adapter au réel, une adaptation si précaire, pour pouvoir vivre dans ce bocal, on a été obligé, et j’ai été surtout ensuite obligé moi-même, de me forger sans arrêt, de me former et de me reformer selon les circonstances et toujours selon les exigences d’un état de choses extérieur et jamais d’après le simple élan de ma nature, de ce que je sens de plus irréductiblement simple dans ma nature. Ce désir immédiat, la succession des désirs immédiats.
Pierre Reverdy, En vrac, dans Œuvres complètes, II, Flammarion, 2010, p. 818.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, en vrac, désir, réel | ![]() Facebook |
Facebook |
22/03/2020
René Char, Le Poème pulvérisé

À la santé du serpent
VII
Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience.
XX
Ne te courbe que pour aimer. Si tu meurs, tu aimes encore.
XIV
Si nous habitons un éclair, il est le cœur de l’éternel.
XXV
Yeux qui, croyant avoir inventé le jour, avez éveillé le vent, que puis-je pour vous ? Je suis l’oubli.
René Char, Le poème pulvérisé, dans Œuvres complètes, édition Jean Roudaut, Pléiade/Gallimard, 1983, p. 263, 264, 266, 267.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené char, le poème pulvérisé, à a santé du serpent, oubli | ![]() Facebook |
Facebook |
21/03/2020
Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle

Deux poèmes pour Ossip Mandelstam
I
Personne ne nous a rien ôté —
Elle m’est douce, notre séparation !
Je vous embrasse, sans compter
Les kilomètres qui nous espacent.
Je sais : notre art est différant.
Comme jamais ma voix rend un son doux.
Jeune Derjavine (1), que peut vous faire
Mon vers brutal et ses à-coups !
Pour un terrible vol je vous
Baptise : envole-toi donc, jeune aigle ;
Tu fixes le soleil, l’œil ouvert, —
Est-ce mon regard trop jeune qui t’aveugle ?
Plus tendrement et sans retour
Nul regard n’a suivi votre trace.
Je vous embrasse, — sans compter
Les kilomètres qui nous espacent.
12 février 1916
Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle, suivi de Tentative de
Jalousie, traduction Pierre Léon et Ève Malleret,
Poésie/Gallimard, 1999, p. 96.
- Gabriel Derjavine (1743-1816), poète officiel du règne de Catherine II.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, le ciel brûle, ossip mandelstam, aigle, espace | ![]() Facebook |
Facebook |
20/03/2020
Andrée Chedid, Textes pour un poème et Poèmes pour un texte, 1949-1991

L’oubli
Il y a un grand trou noir au fond de mon jardin
Où je jette les pierres qui encombrent ma route
Il y a un grand trou noir au creux de ma mémoire
Où se jettent les visages à qui j’avais juré
Rempart contre l’oubli
Il y a un grand trou noir dans la tête du monde
Où je m’engloutirai
Moi tout baigné de vie
Avec mon sang et mes cheveux
Avec mes pas qui résonnent
Avec ma grande tourmente d’homme
Il y a un grand trou noir dans la tête du monde
Où je m’engloutirai.
Andrée Chedid, Textes pour un poème, suivi de
Poèmes pour un texte, 1949-1991, Poésie / Gallimard,
2020, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrée chedid, textes pour un poème et poèmes pour un texte, l'oubli | ![]() Facebook |
Facebook |
19/03/2020
Ludovic Degroote, Si décousu : recension
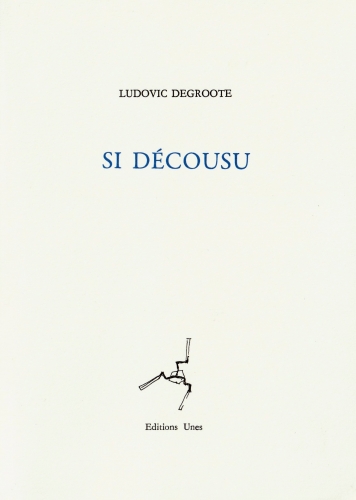
Une partie des poèmes, comme le précise une note avant la table des matières, a été publiée en revues, sous forme de plaquettes ou de livres d’artistes, entre 1989 et 2015, et une quinzaine de poèmes inédits ont été écrits entre 1994 et 2006 : tout laisse penser que ces décalages dans le temps donnent leur sens au titre, que le livre est une réunion d’éléments hétérogènes. La lecture s’oppose à cette première impression, d’un bout à l’autre les mêmes motifs sont présents — notamment, insistant, le thème de la difficulté de lire un ordre dans les éléments du monde et d’y avoir une place :
dès que je m’en vais je suis dans la pente / je regarde la mer et je suis dans la pente ; je n’ai plus besoin de montagne / ni de marécage / tout cela paraît si décousu alors que la vie ne sort pas de sa ligne : on ne se défait pas de ce qu’on est / par delà les piles des ponts / nous somme finis (p. 118-119)
Quant à l’unité formelle des poèmes, elle est aisément visible. On note des textes anciens jusqu’aux plus récents une permanence dans l’emploi de la paronomase, souvent en accord avec le propos de l’ensemble du livre, « vie tenue ténue », « sans vides sans rides », « impuissances impatiens », "tenue - venue", "gravir - gravats", "poupée - coupée". L’unité est en relation avec le désordre du monde et du Sujet ; le plus souvent, les vers sont séparés par des blancs, sans aucune ponctuation ni majuscule (y compris pour les noms propres), ce qui ralentit la lecture, et cette absence de lien mime la distance entre les choses, entre les choses et le Sujet. Un texte en prose restitue cette distance en introduisant régulièrement des barres dans le texte — voir la citation ci-dessus —, parti-pris de morcellement exposé jusque dans le titre du texte :
TEMPS // MORT // BLOC
DÉFAIT
DE // SON // TEMPS
Une autre prose, heureusement titrée "Compost", accumule des noms de fleurs, d’arbustes, d’arbres, longue énumération en une seule phrase et aucun des éléments nommés ne se détache des autres : tous ne sont que des « mots défaits dans leur lente transformation vide ». L’accumulation n’aboutit donc pas à un enrichissement (comme le compost agricole à un engrais), mais plutôt à montrer une opération inutile, un manque, et ce manque est partout présent. Ainsi, la mer en tant que telle apaise, mais ce qui la désigne et le nom des choses qui lui sont attachées, n’ont pas de réalité, « mer digue barque / dans ces mots le vent / des images vaines ».
Plus largement le monde, ce dans quoi chacun vit, est toujours qualifié négativement, milieu par nature du manque ; il semble impossible d’y trouver le moindre appui, quelle que soit la tentative pour aller vers l’Autre, ce que suggère le remplacement de "tendue" par "pendue" : « on s’accroche / à tout ce qui dépasse // un signe de vie // un regard // une main pendue ». Tout se passe comme si tout échange, toute présence étaient refusés. Le monde se caractériserait d’abord par l’existence devant soi d’un mur — « un mur partout » ; on pense à Antoine Emaz qui écrivait, dans "Poème du mur", « un mur indéfiniment » et, aussitôt, « un jour / on ira / plus loin » ; Ludovic Degroote prend-il le même parti ? « on est là / parce qu’on reste là ». Peut-on (se) changer ? comment vivre « la brutalité », « l’horreur du monde » ? Pour le dire autrement « qu’est-ce qu’on peut bien faire de soi » est peut-être la question en arrière-plan du livre.
Rien ne peut modifier ce fait que « nous allons seuls / dans notre solitude », mais c’est cependant quand on se met à l’écart, dans la « nuit claire » — image du temps à côté du temps du monde —, que l’on réussit à « ne pas avoir à jouer ce qu’on est ». Encore faut-il pouvoir penser ce que l’on est, quand le Sujet lui-même apparaît "si décousu". La construction de soi exige du temps pour « réduire la distance / qui vous mène à vous-même » et ce temps est aussi celui qui « nous défait ». Le passé demeure accessible mais les souvenirs sont tellement coupés du présent qu’ils semblent renvoyer à quelqu’un d’autre que celui qui les évoque ; quelle relation entre celui qui se souvient des « gaies tombes fleuries », des « riants caveaux » de son « enfance moisie », et celui qui écrit « je suis coupé de moi », « on vit séparé » ? Tout l’enjeu est bien de coudre, reformer un tissu, une continuité dans ce qui, la vie, n’est que discontinuité, fragments successifs. Restent ce qui ne peut se dénouer, des ombres qui demeureront quoi qu’on fasse, ce qui s’exprime de manière sibylline : [nés, nous sommes] « précédés de notre disparition » ? — disparition, un des mots récurrents.
La fragilité liée au fait de vivre ne signifie pas abandon au chaos, si l’on sait qu’il y a « manque » on sait aussi qu’il s’inscrit dans une double histoire, celle de la personne et celle de la poésie, tout comme l’ossuaire visité à Rome dont un passage de la description, « tête cou- / pée qui coupe / la tête zone du cou », renvoie aux disparus et est une allusion transparente à "Zone" d’Apollinaire.
Ludovic Degroote, Si décousu, éditions Unes, 2019, 136 p., 21 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 21 février 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degroote, si décousu : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
18/03/2020
Simone Debout & André Breton, Correspondance 1958-1966

L’Atelier d’André Breton
Derrière la lourde table bureau, le mur que l’on a célébré et finalement transporté dans un espace public, comme si l’on pouvait séparer ce mur de l’atelier qu’à la fois il clôturait et portait jusqu’aux confins de la terre. Là, étaient juxtaposées des pièces d’art primitif, une écorce aborigène, des planches sculptées de Nouvelle-Calédonie, un tableau de Picabia et la grande peinture d’une tête de Miró. Plus bas, une foule de statuettes des Marquises, de l’Île de Pâques, des masques, de sombres fétiches parés de coquillages ou d’écorces et de plumes, et des petits tableaux de Jarry, de Miró, d’Arp, une photo-portrait d’Élisa et une grande volière d’oiseaux aux brillantes couleurs et des crânes surmodelés. Le passé et le présent le plus proche et le plus lointain, un tout dont la véhémence et la cohérence étaient celles du désir, de regard qui les avait choisis un à un, et que cette commune élection accordait.
Simone Debout, Mémoire, d’André Breton à Charles Fourier, dans S. D. & André Breton, Correspondance, 1958-1966, éditions Claire Paulhan, 2020, p. 170-171.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Breton, André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : simone debout & andré breton, correspondance, 1958-1966, atelier | ![]() Facebook |
Facebook |
17/03/2020
Christiane Veschambre, dit la femme dit l'enfant

À la radio, dit la femme, j’ai entendu Simone de Beauvoir déclarer qu’elle avait totalement réussi sa vie, que tous les rêves qu’elle faisait à seize ans, elle les avait réalisés. J’ai pensé en l’entendant que l’on ne quitte jamais le monde où on est né, même quand on s’en est exilé par un bond qui semblait définitif et qu’on a mis des univers entre soi et lui : parler ainsi de sa vie réussie c’est la tenir entre ses mains comme une propriété, il faut avoir le sens de la propriété, du bien à acquérir et à faire fructifier, de la satisfaction des biens ainsi un à un thésaurisés par la réalisation de chaque rêve. J’ai senti comme ma vie ne formait pas objet, comme mes rêves pour elle jouer du violoncelle, avoir un cheval, parler le russe et le portugais, peindre, construire des ponts — ne pouvaient parfois trouver leur dire qu’à présent, à la même heure où Simone de Beauvoir pouvait en faire un prospère bilan.
Christiane Veschambre, dit la femme dit l’enfant, éditions isabelle sauvage, 2020, p. 18-19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, dit la femme dit l’enfant, exile, réussite, propriété | ![]() Facebook |
Facebook |





