17/07/2012
Jean Follain, Paris

Cimetières
Le Père-Lachaise, lieu de l'ultime résistance des communards, reste pénétré des odeurs du dernier siècle quand s'agglutinèrent à Paris plusieurs villages de la banlieue. M. Thiers, le nabot à vigoureuse cervelle dont la gravure d'apothéose décore encore de vieilles maisons rurales, y est enterré sous un immense mausolée carré. Quelques-uns, parmi les tombeaux de généraux de Napoléon, sont encore entretenus, beaucoup ne le sont plus : l'amateur d'émotions, le revers du veston recouvert de pellicules, y découvre d'anciennes couronnes fangeuses et circonscrit d'un doigt spatulaire les aigles en relief sur la pierre moussue.
La multitude des cippes, des amphores, des croix, force le cœur dans les beaux jours de végétation abondante, alors que dans des coins pas encore défrichés, se balancent coquelicots et folles avoines, ainsi en est-il non loin du mur sanglant.
Autour du four crématoire, le colombarium forme une grande bibliothèque d'urnes. De petits bourgeois à esprit fort, porteur de leur vivant d'un regard têtu et doux, des ouvriers convaincus et sobres se font incinérer. leurs parents pour rendre les devoirs à leurs cendres doivent si elles sont haut placées le long du mur prendre l'échelle et monter jusqu'à la case numérotée parmi tant d'autres.
On peut visiter le four crématoire. La salle de crémation porte la marque de l'architecture salomonique. Elle comporte un orgue. La bière est introduite dans un simulacre de four en stuc décorée de roses, puis enlevée dans la coulisse et glissée devant deux parents seulement dans le véritable four qui consume à peu près tout car on ne retrouve que quelques débris d'os.
Pour la visite publique, le four fonctionne en veilleuse ; j'ai vu parmi les visiteuses une petite bourgeoise vêtue de noir, la lueur rose éclairant son visage s'écrier en riant : « Eh bien, moi qui aime la chaleur, je serai servie. »
Jean Follain, Paris, éditions R.-A. Corréa, 1935, p. 59-61.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean follain, paris, cimetière, le père-lachaise | ![]() Facebook |
Facebook |
16/07/2012
Louise Herlin, L'amour exact

Ratiocinations
Si j'avais su, dit-il, que si brève est la vie — à peine en train déjà le terme approche
J'aurais mieux usé de mon temps J'aurais pris le temps d'aimer le proche et le lointain
J'aurais saisi l'aventure au col, la chance au vol
J'aurais sondé le savoir humain
exploré le cosmos et l'atome
si j'avais su que passe comme un sommeil fiévreux comme un été talonné par l'automne
l'existence si lente au départ que l'enfant griffe à coups d'ongle impatient d'en mouvoir la coque multi-millénaire
J'aurais levé plus de voiles ici-bas,
nommé plus d'objets
trouvé la clé d'énigmes plus nombreuses
négligé moins d'affection, de gens
J'aurais nourri plus d'espoirs si j'avais su, dit-il,
si j'avais pu prévoir
qu'à si peu se résume (en arrondissant)
avoir été au monde une vie durant
Louise Herlin, L'amour exact, éditions de La Différence,
1990, p. 96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise herlin, l'amour exact, ratiocinations, si j'avais su... | ![]() Facebook |
Facebook |
15/07/2012
Paul Éluard, Dignes de vivre

Du dehors
La nuit le froid la solitude
On m'enferma soigneusement
Mais les branches cherchaient leur voie dans la prison
Autour de moi l'herbe trouva me ciel
On verrouilla le ciel
Ma prison s'écroula
Le froid vivant le froid brûlant m'eut bien en main.
Du dedans
Premier commandement du vent
La pluie enveloppe le jour
Premier signal d'avoir à tendre
La voile claire de nos yeux
Au front d'une seule maison
Au flanc de la muraille tendre
Au sein d'une serre endormie
Nous fixons un feu velouté
Dehors la terre se dégrade
Dehors la tanière des morts
S'écroule et glisse dans la boue
Une rose écorchée bleuit.
Paul Éluard, Dignes de vivre, avec vingt bois originaux
de Théo Kerg, chez les éditeurs des Portes de France,
1947, p. 52-55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul Éluard, dignes de vivre, du dehors, du dedans | ![]() Facebook |
Facebook |
14/07/2012
Étienne Faure, Correspondances, dans Théodore Balmoral

Transie je suis sur le quai d'hiver
et tente en vain l'espoir au cœur
d'arriver à temps malgré la neige,
le gel qui tout met à distance
derrière la vitre de ce temps où l'on s'aimait
sans hésiter, prenant la vie
comme si elle venait, à perdre connaissance
puis vie, de nouveau se perdre
depuis le quai où l'on s'est tant quittés
dans les films, yeux mouillés par l'histoire,
à dire adieu d'un geste sec,
de la main, du mouchoir — nous sommes quittes —
tandis qu'on maudit dans la buée de son souffle
le mouvement trop lent qui déplace
les corps, les rapproche, trop tard
pour prendre avec le monde, en sa fusion même
langue — c'était cela sans doute
être éprise
rapprochements
Étienne Faure, Correspondances, dans "Théodore Balmoral",
Printemps-Été 2012, p. 147.
© Photo Tristan Hordé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, correspondances, théodore balmoral, être éprise | ![]() Facebook |
Facebook |
13/07/2012
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride

La poésie
c'est refuser la vie — partie par partie —
pour l'accepter tout entière —
que l'image se pulvérise et devienne dérisoire.
La banalité poétique se résorbe aussi bien que l'autre, seulement il faut l'avoir éprouvée, jusque dans la trame — ce qui n'est pas facile
*
Le poète est celui qui, dormant et sachant qu'il dort,
ne se réveille pas —
*
le poème sort avec sa lie
hors de sa gangue d'angoisse
et de toute la boue qui le charrie
*
la poésie, c'est cette exaspération des facultés critiques,
de cette faculté critique qui ne mord pas sur la matière
il y a cette révélation de l'insipide
— de cette clarté
qui court en avant d'elle-même
ce qu'il y a de plus éclatant, de plus exotique, est comme la préfiguration de sa banalité
qui n'est suscité que pour être incinéré
l'image n'est que l'indication de sa course, de sa rapidité.
Nous sommes — heureusement — en retard sur cette banalité.
Notre vie, notre poids, notre étonnement, notre lenteur — notre admiration.
on a touché l'essence de la poésie, quand on sent passer ce souffle incolore, ce souffle
le vent dont nous sommes affublés
le feu, c'est cet immense retard sur la banalité —
l'image n'est suscitée que pour être incinérée.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Le Bruit du temps, 2011, p. 249, 252, 253, 254-55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
12/07/2012
Frédéric Forte, Re-

L'histoire en contient pas
ce livre la moindre lune
l'histoire en contient pas de verre
trouble la vue ne va ne
mécanise pas
le poème ainsi est une condition
de re- (ou pas) légèrement
dans la dune
passagèrement
la dune en poésie ce n'est pas
rare et en état de prune non ça
n'aidera pas ce livre
la moindre lune
Entre deux pages la même
pluie à la place de rien
entre deux pages la même porte
absente pas de chien, un
écran dessus le thème inexistant
de re- son tiens italique posé
schème de qui s'avance
et combien
ce qui avance
à combien dans la marge, petits nems
empilés des amibiens tombant serrés
clinamen, pluie
à la place de rien
Frédéric Forte, Re-, "Le comptoir des mots"
éditions NOUS, 2012, p. 41 et 43.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frédéric forte, re-, histoire | ![]() Facebook |
Facebook |
11/07/2012
Sofia Queiros, et puis plus rien de rêves

INT. NUIT
Tellement fatiguée, je m'endors sans éteindre les lumières, ni fermer les volets. Moi qui souvent retarde l'heure du coucher.
La peur de la mort.
Je ne visite pas ma tante moribonde.
Des enfants dans mon rêve « prennent le pli » — c'est ce qu'ils disent — et penchés en avant, se tirent le visage dans tous les sens, juste au-dessus de mon nez.
C'est pour de rire, je devrais rire. Mais je m'agite.
Dehors le vent s'éparpille et se cogne aux vitres de mes fenêtres.
INT. JOUR
Je passe en revue les images empilées.
Ici la maison brûle. Je suis seule et désemparée. Celui que j'aime a foutu le feu, puis le camp.
Ici c'est un jour de petite gloire, un sourire bien mérité. La jupe à volants rose fuchsia que je porte vole et j'ai sur le visage une orchidée.
Puis ici, encore dans la maigreur du chagrin d'amour.
Là les figures en contre-jour se font brouhaha.
Je suis sensible au bruit et à la lumière, aux mots éparpillés dans les rayons du soleil, au petit martèlement qui sort de la fenêtre du voisin.
Sofia Queiros, et puis plus rien de rêves, éditions isabelle sauvage, 2012, p. 22-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
10/07/2012
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
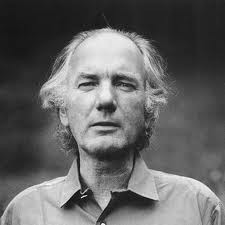
Ma mort viendra bientôt
par le champ, fatiguée,
quand les ombres
des corbeaux noirs
se précipitent sur l'herbe
et, derrière la maison, l'arbre
ferme les paupières
dans la neige
et quand soufflent
les mots
de l'hiver qui approche
L'âme malade, regardant
autour d'elle,
ne glisse plus vers le village.
Mein Tod kommt bald
über den Acker, müd,
wenn in das Gras
die Schatten stürzen
schwarzer Raben
und hintern Haus der Baum
die Lider schließt
im Schnee
und mahen Winters
Worte wehn...
Die kranke Seele huscht
umblickend nicht mehr
auf das Dorf
hinüber.
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer, traduit de l'allemand
et présenté par Suzanne Hommel, "Orphée", La Différence, 2012, p. 97 et 96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
09/07/2012
Louise Labé, Sonnet XIIII
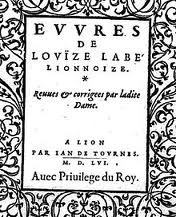
Sonnet XIIII
Tant que mes yeux pourront larmes espandre,
A l'heur passé avec toy regretter,
Et qu'aux sanglots & soupirs resister
Pourra ma voix, & un peu faire entendre :
Tant que ma main pourra les cordes tendre
Du mignart Lut, pour tes graces chanter :
Tant que l'esprit se voudra contenter
De ne vouloir rien fors que toy comprendre :
Ie ne souhaitte encore point mourir.
Mais quand mes yeux ie sentiray tarir,
Ma voix cassee, & ma main impuissante,
Et mon esprit en ce mortel seiour
Ne pouvant plus montrer signe d'amante :
Prirey la Mort noircir mon plus cler jour.
Louise Labé, Œuvres, Lyon, chez Jean de Tournes,
1555, p. 118, dans Gallica, Bibliothèque numérique de la BNF.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, sonnet, amour, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
08/07/2012
Louis Aragon, Les Poètes

La Tragédie des poètes
La chambre de Don Quichotte
Comme un cheval d'os de poil et de feu sera toujours au cavalier préférable à toute monture fictive
De même à celui qui ne se soucie aucunement de cavalcade et que n'émeut ni la sueur de la robe ni le hennissement
Un cheval de pierre est plus grand là debout sur son socle à tout jamais qui se cabre
Plus enivrant dans cette inutilité de la crinière qui bouge avec la lenteur du soleil
Et cette couleur blafarde aux ombres variables
Que la bête chaude et glacée entre les cuisses de l'homme qui s'envole
La bête à qui le poignet fait mal où la main le retient
Ainsi les mots dans ma bouche sont le cheval de pierre
Et ils sonnent de tous ces grelots mis aux harnais imaginaires
Ils sont le cuir férocement qui arrête l'élan de la pensée
Ils entrent dans la chair de ce que je dis
Et c'est moi qui souffre où la raison me blesse déjà dépassant ce qu'elle permet d'entendre
Déjà mis en sang par la bride et chaque parole n'est plus
Ce qu'elle était mise en branle Elle dit autre chose que ce qu'elle dit
Que ce qu'elle disait Je m'enivre
De l'emploi que je fais des vocables humains et tremble
Je ne sais trop moi-même de quelle profanation commise de quel forfait
Que je signe de quelle dénonciation du langage
Et pourtant quand le caillou roule et m'échappe et tombe et rebondit
Ce n'est point le sens qui meurt mais autre chose qu'il devient
Qu'un autre que moi ne lui aurait point donné licence d'être
Autre chose que ce galop suivant les règles du pavé que cette course
D'ici à là et pas plus loin
Autre chose qu'une liaison de poste avec son horaire et la ville à chaque bout nommée
Autre chose que le cheminement de la pensée autre chose
Que midi forcément à la fin de la matinée
Autre chose autre chose n'en fût-il point d'autre et je m'entends
Moi-même avec étonnement moi-même dans l'écho redoublé des syllabes
Comme celui dans la montagne qui avance le pied sur l'éboulis
Et sent fuir à peine posé toute la terre sous sa semelle en vain prudente
Les mots l'un l'autre qui s'entraînent dans la chute et on ne peut plus rien arrêter
Ni le bond des blocs et leur presse et le déclenchement du vertige
Ni l'énorme suintement de poussière fuyante fine affolée
Ni l'écho sauvage qui répond de falaise en falaise comme une image de miroir en miroir
Et plus rien ne se borne à soi désormais mais tout vocable porte
Au-delà de soi-même une signification de chute une force révélatrice
Où ce que je ne dis pas perce en ce que je dis
Où plus fort est l'entraînement des paroles que le rêve qui les précède
Où je suis emporté comme un fétu de paille sur une mer démontée
Où je suis le jouet qui ne se peut retenir d'une nécessité nouvelle
Nouvellement dans sa marche inventée
Et je n'ai plus maîtrise de ma langue à la fois torrent et ce qu'il roule
Je n'ai plus le choix de ne point proférer ces sons chargés d'ivresse comme le grain d'un raisin noir
Je ne puis faire que je ne les ai point prononcés
Avec toute la violence de l'élocution surhumaine qui me roule me tourne me renverse
Et que vous expliquez bien mal avec ce pauvre mot de poésie
Auquel on en fait voir de toutes les couleurs
[...]
Aragon, Les Poètes, dans Œuvres poétiques complètes, II, édition sous la direction d'Olivier Barbarant, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, p. 357-359.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, les poètes, don quichotte, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
07/07/2012
Jacques Dupin, La mèche

La mèche
Éteinte dans sa tombée
une phrase épanouie
frissonne dans l'aléa
des copeaux qui se dispersent
L'armature du tonneau
se tend à crever la panse
du gueux assoiffé de mots
l'intérieur du vin ouvert
comme un théâtre de consonnes
tangue dans les vertèbres
le hoquet est sublimé
par la secousse de l'air
sous la voûte du cellier
il reste à jeter au feu
les douelles du tonneau
et la griffe du poème
N'ayant rien à dire
étant sous le charme
je partage
l'accablement du murier
couvert de mouches qui parlent
l'idiome
des lointains carbonisés
étant sous le charme
de la vibration d'un peuple
de guêpes
avant de tomber de l'assiette en l'air
sur une lèvre éclatée
Je suis revenu
par le sentier des falaises
tordant le mouchoir heurtant
le caillou
riant sous le manteau pour éparpiller
la parole
avant d'être à la fin le mort dans la lettre
et la lettre dans la mort
[...]
Jacques Dupin, La mèche, dans Europe, "Jacques Dupin", n° 998-999, juin-juillet 2012, p. 22-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, la mèche, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
06/07/2012
Pierre Silvain, Du côté de Balbec

Longtemps, à Combray, l'enfant avait fait ses délices de la crème dans laquelle le père écrasait des fraises jusqu'à obtenir une certain ton de rose qui devait rester plus tard pour le Narrateur la couleur du plaisir, être celle du désir et du tourment amoureux. De Cabourg où il terminait Du côté de chez Swann, Proust écrivait à Louise de Mornand qu'il avait rencontré sur la digue, « par un soir ravissant et rose », l'actrice Lucy Gérard dont la robe rose, à mesure qu'elle s'éloignait, se confondait avec l'horizon (ajoutant que, pour s'être attardé à la regarder, il était rentré enrhumé). Quand j'allais à la Ferme en fin de journée acheter des cœurs à la crème, ce n'était pas en pensant à l'épisode des fraises écrasées. Comme je n'avais pas lu la Recherche, je ne savais rien non plus du rose que le soleil levant mettait sur la figure de la petite marchande de café au lait, du rose de l'aubépine dans le jardin de Tansonville, j'ignorais qu'un tissu rose doublait la robe de Fortuny que le Narrateur avait offerte à Albertine pour la tenir à sa merci.
La Ferme était une laiterie au rez-de-chaussée d'une bâtisse où de l'enseigne peinte sur sa façade subsistait seulement le contour de grandes lettres que les intempéries et le soleil avaient effacées. On poussait une porte basse, on entrait de plain-pied dans une pièce qui sentait le fade et l'aigri, le linge humide et la cendre. Dans la demi-obscurité, on s'attendait toujours à déranger une poule ou à se cogner contre un baquet. La femme retirait les cœurs de leur moule en zinc, les empaquetait, glissait l'argent dans la poche de son tablier. Personne n'avait gardé le souvenir qu'elle ait jamais engagé la conversation, salué et encore moins reconduit l'acheteur jusqu'au seuil de son antre. Elle pouvait se montrer méfiante, malgracieuse, mais nullement obligée à l'égard de ce dernier, puisqu'il reviendrait.
Pierre Silvain, Du côté de Balbec, L'escampette, 2005, p. 92-93.
©Photo Tristan Hordé.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, du côté de balbec, proust, laiterie | ![]() Facebook |
Facebook |
05/07/2012
Jude Stéfan, La Muse Province
p.[oème] de l'aïeule
Grand-mère
qui écrivais sans ponctuation mais sans faute
j'ai été lu à 11 h 27' 48"" ce 26 janvier 01
qui n'ai jamais pu dire « j'espère » l'arrière
latéral gauche Pignol atteint de cancer Tu
poussais ta brouette tu lavais le linge li-
sais L'Excelsior et n'avais de défauts
ignominieusement emportée par gifle de dieu
comme Toi crispant d'avance les doigts j'
écrivis des poèmes pour rien puis végétai
Tu gis enterrée en face d'une épicerie-café
tes deux fils morts irréconciliés j'incline
encore la clenche je creuse le seuil les
Humains pullulent de plus belle je m'étends
sur la chaise longue à écouter le balancier
ah j'étais au calme Ils croient à Pâques à
leur inexistence Tu ne riais jamais sans
tristesse Tu portais chapeau paillé robe
désuets Leurs chiens gueulards nous oppriment
leur haute Sottise nous suicide
Jude Stéfan, La Muse Province, Gallimard, 2002, p. 14.
©Photo Chantal Tanet (juillet 2010)
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, la muse province, grand-mère | ![]() Facebook |
Facebook |
04/07/2012
Isabelle Ménival, Khôl (recension)

La publication d'un premier livre de poèmes, surtout quand son auteur est très jeune, est un pari : on le souhaite gagné. La quatrième de couverture explicite les raisons du choix de l'éditeur : « Khôl, c'est la singularité et la violence d'un monde qu'elle [Isabelle Ménival] vit et éprouve, c'est déjà une maturité de la langue exceptionnelle. » C'est bien là, un regard particulier sur le monde et l'inventivité de la langue, ce que l'on attend de la poésie.
Pour lire l'ensemble, on partira du titre et de la citation en exergue. "Khôl", qui apparaît également dans le titre d'un poème et à l'ouverture d'un autre, évoque non pas l'Orient nervalien, mais la transformation du visage, le masque, l'indécision entre la figure et son reflet. Ce motif est présent à plusieurs reprises à propos de l'apparence du visage, présenté comme « masque aux yeux cernés » ; le maquillage, ce « papier carbone sur le visage », fabrique une manière de double, « métamorphose écarquillée dans l'absence », et dissimule quelque chose : il signale la difficulté à entrer dans le monde sans apprêt et peut-être oriente-t-il également vers une indétermination généralisée, annule-t-il de façon provisoire la séparation hommes-femmes — « il y a des années / j'habitais les corps / de femmes et d'hommes » (on sait la force qu'a le verbe "habiter"). L'absence de délimitation atteint régulièrement l'expression du lien amoureux, par le questionnement des frontières ( « ton corps c'est le mien ? »), et sans qu'il y ait fusion du masculin et du féminin par la tentative de ne pas choisir, d'accueillir « l'autre inconnu(e) indéterminé(e) ».
Il y a l'idée d'une séparation impossible à surmonter, d'une nécessité du masque pour qu'un passage soit possible entre le sujet et l'autre par les mots :
[...] je rêve que tu rêves à ce que je t'apprenne à foncer nos deux peaux ;
Les voix de la rue comme de petites cendres jetées de moi à toi à toi et sans retour.
Ce jeu des reflets est présent dans la composition même du livre : le second ensemble est titré "recto verso" ; il est encore dans la récurrence des quasi homophones, des anagrammes, des allitérations et des rimes répétées, qui introduisent de multiples échos ; voir par exemple : « de ces corps [...] décor ; tu plaides les plaies que tu planques sous pull ; floues / foule ; si proches tes propres premiers sons / hésitant / tant [...] », etc. — jeu jusqu'à l'ironie vis-à-vis de ce jeu : « perdues perverses perchées perturbées ».
Le trouble de l'identité a pour corollaire une relation malaisée au corps et un questionnement continu sur le temps, ce qu'annonce la citation de Proust mise en exergue : « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre ! » (Du côté de chez Swann) Ce gâchis apparaît aussi dans Khôl, lié à une position du corps défait : « elle avachie par terre / avait perdu vingt ans ». Le temps, rien d'exceptionnel, modifie les corps « au fil des rides », pâlit la couleur des choses, et le désir de quitter « l'enfance interminable » n'aboutit pas à une plénitude rêvée, comme si rien ne tenait et que la menace de disparition obligeait à se saisir de l'instant dans l'instant même (« toutes les secondes qu'on a passées / même pas un jour entier »), parce que l'on sait « que tout s'échappe » et que cette disparition elle-même doit être vécue : « c'était beau cette fois / l'amour qui se délite / emmêlé à ta voix ». On pourrait voir quelque complaisance dans cette visite d'un motif lyrique classique, où l'amour semble bien vaincre le temps : « quatre mêmes mains qui ne se tordent plus ne se lèsent plus / se foulent se découvrent », ce serait ne pas lire la lucidité d'Isabelle Ménival, qui prend ses distances avec la convention : « errer se perdre et jouir cf romantisme ». On ne peut être plus clair.
Cette distance se manifeste aussi dans la pratique du vers, précisément dans l'essai des formes. Le second ensemble débute par des vers courts placés au milieu des pages : on peut dire que c'est là reprendre un poncif de la poésie "moderne", et j'ajoute qu'Isabelle Ménival utilise allègrement tout ce qui signale aujourd'hui la poésie : absence de ponctuation (sauf deux fois un point dans le dernier poème), absence de majuscule en début de vers (sauf dans deux poèmes), petits groupes de vers "libres" séparés par des blancs, décalage des vers les uns par rapport aux autres. Mais elle introduit aussi les vers rimés et comptés, des heptasyllabes — « on rimait quelquefois / saoulés d'impairs » — ou des alexandrins, ou des vers comptés mêlés ; elle n'hésite pas à jouer avec la rime et le sens, associant "doliprane" à "cyclohexane" et "nymphomanes", "versatiles" à "virils" et "stériles"... La poésie n'a pas besoin de mots "poétiques" (d'où l'introduction de "jouable", "grave"), elle est dans cette redécouverte du lyrisme et du vers dans son histoire ; aussi dans le questionnement jamais apaisé de ce lyrisme, ouvert dans le dernier poème avec la répétition de "Regarde" et les deux derniers vers du livre :
Regarde
depuis toujours nos nuits blanches et noires portent ce songe
Il faut espérer qu'Isabelle Ménival continue à « briser la glace des normes », puisqu'elle sait déjà qu'« on peut casser / la norme sur papier ».
Isabelle Ménival, Khôl, éditions Argol, 88 p, 15 €.
Cette recension a été d'abord publiée le 24 juin dans les Carnets d'eucharis de Nathalie Riera.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle ménival, khôl, lyrisme, masque | ![]() Facebook |
Facebook |
03/07/2012
Luis Mizón, Terre brûlée

Mémoire du corps absent.
Le joueur d'échecs
travaille la géométrie de l'écho.
L'éclat des vagues de pierre noire
et le geste qui devine
les moralités du vent.
Je caresse des lèvres de bronze vert
des masques de plâtre.
Je lance des parcelles de soleil
contre murs et angles
forteresses et bateaux de guerre
soldats et marins amnésiques.
J'attaque d'une main souriante avec furie
le raisin vert de l'éclipse.
Je m'assieds sur les traces de l'arbre musicien
pour écouter des histoires de personne
échos anciens.
Histoire et rêve.
La passion du corps invisible
murmure
en effeuillant les grappes
de la fleur de la plume.
Le puits des musiciens
éveille et ressuscite
des scories brillantes
dans la mémoire des enfants
et il guérit de son lait d'ombre
la pierre malade de ton visage
et son ivresse muette.
Le puits pulvérise le ciel.
Arbre de clarté blanche.
Bouche qui murmure
sur la terre brûlée.
Le vent parcourt la mémoire
cherchant les mots
d'un poème ancien échoué dans les vagues
il peint un autre labyrinthe
de pierre transparente
et d'ombre illuminée.
[...]
Luis Mizón, Terre brûlée, traduit de l'espagnol (Chili)
par Claude Couffon, Obsidiane, 1984, p. 55 et 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luis mizón, terre brûlée, mémoire, claude couffon | ![]() Facebook |
Facebook |






