24/02/2024
Esther Tellermann, Votre écorce

Il me fallut inventer
des signes neufs
lire des
corolles. Dans
la peur.
Il me fallut
savoir
appartenir
se
reconnaître
dans le vent
et l’ombre
l’écaille
qui s’effrite.
Esther Tellermann, Votre écorce,
La Lettre volée, 2023, p. 23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, votre corde, signe, ombre | ![]() Facebook |
Facebook |
23/02/2024
Gérard Cartier, le Voyage intérieur
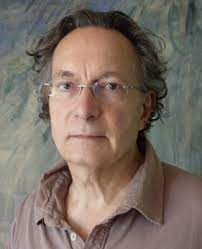
Les amants (Cimetière du Père-Lachaise)
Voyez cette comète à la longue traîne
c’était nous un feu grégeois dans la nuit
soufre et poix qui incendiait nos corps
et tout notre être un même cœur…
mystérieuse unité en 2 natures
puis une éternelle amitié en lettres
et en songes nocturnes qui parfois
plaisir ou jalousie nous déchiraient encore
et de longs silences traversés de signes
un prénom une pierre gravée
2 nuages traçant un instant dans l’éther
des initiales présence irréelle
jetés enfin dans l’éternel oubli n’étaient
ces lettres cachées qu’un jour peut-être
un curieux exhumera nous inventant
un tombeau plus ferme que la pierre ouvragée
où viendront après nous rêver les amants
séparés
(48°51’33,1’’N – 2°23’30,944E)
Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion,
2023, p. 450.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieur, les amants | ![]() Facebook |
Facebook |
22/02/2024
Gérard Cartier, Le Voyage intérieur

La mort de Segalen (Huelgoat)
De retour d'Algérie le maître du voyage
sentant la vie le fuir entra dans le chaos
de Huelgoat forêt maléfique aux grands fonds
tourmentés d'un pâle madrépore avoir
bourlingué à la Chine et à l'Océanie
et mourir de consomption au pied d'un chêne
le talon entaillé par un calame au centre
d'un triangle d'eaux et de roches creuses
seul en compagnie de son double un spectre
bilieux duller shouldst thou be
than the fat weed écoutant dans le soir
se brouiller les paroles prodigieuses tandis
que le suc maudit coulait dans son oreille
de la jusquiame il me faudrait un mètre
qui naisse du lieu aussi bien que la mort
et non ce garrot de fortune qui peine
à nouer les mots et retenir au monde
le passant du voyage illimité
(48°21'50,2"N - 3°43'50,4"O)
Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion, 2023, p. 295.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartie, le voyage intérieur, mort de segalen | ![]() Facebook |
Facebook |
21/02/2024
Gérard Cartier, Le Voyage intérieur

La triperie (Roussillon)
Ayant sillonné la colline en vain
le petit château sur une motte évanoui
en plein ciel du comte de Roussillon
revenant en tournoyant sous les falaises
d'ocre des ruelles tout-à-coup
saisissement une vitrine
frottée au sang-de-boeuf BOUCHERIE CHAIR
CUITERIE et à jamais tripier
que l'on contemple en rêvant à ses amours
tout a disparu les tombes sous les pas
le château abattu du plaisir et de la gloire
ne restent que les noms Guillaume
Sermonde et cette échoppe aux couteaux
étincelants qui se souviennent du cœur
mangé par la comtesse de Roussillon
de son amant haché en ragoût
avec herbes et épices et qui sait
si le comte jaloux n'y avait pas mêlé
l'objet de son déplaisir
(43°54'8,5"N - 5°17'36,8'E)
Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion, 2023, p. 215.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieur, triperie | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2024
Gérard Cartier, Le Voyage intérieur

Le patriarche (Hasparren)
Trop enclin aux poètes minimes Delisle
Coppée Carco et aux ânes
pour éviter à l'écart du chemin de Combo
Eihartzea dernier toit de Francis Jammes
avant la pierre grise à l'ombre d'Ursuïa
et de la grosse croix au bout du village
une ancienne métairie don fortuit du ciel
manigancé en douce par les bénédictins
pour loger sa tribu d'où fuyant en ours
il hantait jusqu'au soir les collines rêches
pêchant et herborisant parmi les chardons
barbe au vent et la rime en conserve
mais qu'a-t-on fait du palais des voyelles
éventré plâtré ascensorisé
chassant le patriarche à coups de taloches
comme Adam du paradis
non moins que nous demain de nos thébaïdes
oubliés de tous malgré nos neuvaines ou minimes
(43°23'19,7"N - 1°18'11,8"O)
Gérard Cartrier, Le Voyage intérieur, Flammarion 2023, p. 216
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieur, le patriarche, paradis | ![]() Facebook |
Facebook |
19/02/2024
Gérard Cartier, Lz Voyage intérieur

Grotte ornée (Gargas)
Exhumer le carnet noir à moleskine
sonnets hâtifs pour Romane aux oiseaux bribes
confuses l’ivresse du chagrin … détachées
de l’accident qui les avait fait naître
et des citations des dessins à la diable
cherchant le poème griffonné sous l’auvent
en sortant de la grotte mais rien
ainsi de tout ce qui nous importait
jusqu’aux amours les plus troublantes moins
désormais que la main aux phalanges coupées
saignant sur la roche qui vit encore
dans le carbone 14 moins
que l’accenteur mouchet à coups de ciseaux
qui loue la création depuis des millénaires
dans la forêt de mélèzes le voilà
à peu près le sens perdu
qui suintait de la roche hérissée de calcite
goutte à goutte dans le silence
(43°3’21,4N - 0°32’10,5"E)
Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion, 2023, p. 203
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieurge, grotte ornée, main | ![]() Facebook |
Facebook |
18/02/2024
Gérard Cartier, Le Voyage intérieur
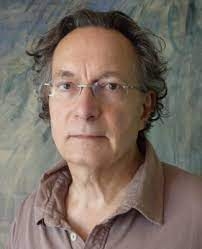
Le mystère des origines (Font-de-Gaume, Les Eyzies)
Comment Racine. Un trouble s’éleva
dans mon âme éperdue naquit-il de la plainte
d’un Mars scarifié courtisant sur la Beune
une Vénus prognathe comment
de 2 silex frappés le bourdon entêtant
de l’alexandrin troublante énigme
mais la société de linguistique interdit
article 2 tout essai sur les origines
du langage humain ce ne fut peut-être
au printemps des âges imitée
des oiseaux qu’un effusion de voyelles
les herbes frémissent un martellement sourd
monte de la rive et soudain Quel mot
inné devant les chevaux pommelés
qui courent échevelés en roulant de shanches
suel cri pour louer plus éloquent à peine
que le silence la langue dans sa prison d’os
se tord en tous sens et frappant au hasard
invente le monde
(44°56’13,3"N - 1°1’35,6"E)
Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion, 2023, p. 340.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieur, le mystère des origines, langue | ![]() Facebook |
Facebook |
17/02/2024
Gérard Cartier, Le Voyage intérieur

La campagne (Ceyzérieu)
Fourgon au cimetière la Faucheuse en visite on s’esbigne
lilas plantes odorantes premier coucou de l’année
botanisant de l’œil et de la langue album de 100 fleurs
prairies de marais derniers vestiges du grand lac de Chautagne
tout paysage est palimpseste tout regard recréation
au géographe aussi prodigue qu’un marchand de tourbe
une trompe rauque au loin motrice en manœuvre en gare de Culoz
on était à la fin du Würm on n’avait pas quitté le siècle
3 ânes gris au pas cassé un baudet du Poitou dans un fossé
nous mangeons nous aussi la corde qui nous tient au piquet
vivre sans art autant qu’on le peut sans philosophie
murets coiffés de lichen petit pont voûté sur le Séran
l’eau passée commence l’Holocène
(45°49’56,9"N - 5°44’38,2"E)
Gérard Cartier, Le Voyage intérieur, Flammarion, 2023, p. 71.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard cartier, le voyage intérieur, campagne, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
16/02/2024
Claude Chambard, Cet être devant soi

Le crayon est le chemin par lequel je peux parcourir le monde. Il me faut y arriver vivant. Ce n’est pas une mince affaire. J’ai toujours pensé que, dans le livre, le monde ne pouvait être vu qu’à hauteur d’enfance. L’écriture commence & prend fin dans une classe du cours préparatoire, pour toute la vie & pour tous les livres, dans toutes les bibliothèques. De même la lecture. Manipulations, transgressions, interprétations, variations — archaïques. Encre violette & papier réglé à grandes marges, encrier en porcelaine, plumes Sergent Major, buvards publicitaires… Apprendre à dessiner — les caractères apprendre à dessiner - les traits portraits &c - lisibilité, blanc, équilibre, approche, classe, ce qu’on ne voit pas permet ce que l’on perçoit - comme on oublie la ponctuation lorsqu’elle est juste, lorsqu’elle va de soi la lecture va de soi — l’écriture jamais. Ton corps est dans le livre, personne ne le voit, même pas moi, mais je le reconnais, aussi les oiseaux dans le ciel & le corps des écrivains dans leur écriture.
Claude Chambard, Cet être devant soi, Æncrages, 2012, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Chambard Claude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude chambard, cet être devant soi, écriture, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
15/02/2024
Animaux de chair et de pierre


Phoyod T. H.
| Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
14/02/2024
Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel

Chute libre
Petite pluie molle et morne presque marron
L’air dans les rues du bled c’est pas gai la province
le seul bistro du coin il faudrait qu’on fût rond
pour lui trouver du charme éviter que ça grince
il s’en faut de très peu qu’on ne se sente prompt
à s’abolir dans le port — est-ce qu’on en pince
pour l’eau froide et le noir néant qui corrom
pent jusques aux os de fond en comble vous rincent ?
Les lumières du bar se reflètent dehors
s’incrustent sur la nuit en occultant le port
ainsi face au réel un cordon sanitaire
est tendu par l’humanité pusillani
me or le réel fair retour façon tsunami
voilà ce que c’est que d’avoir pas su se taire
Laurend Fourcaut, Un morceau de ciel, Tarabuste,
2024, p. 141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau de ciel, tristesse, réalisme | ![]() Facebook |
Facebook |
13/02/2024
Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel

À la fontaine
Un temps mou presque tiède c’est débilitant
fin novembre la pluie n’a pas de caractère
paraît sale lépreuse pas la pluie des Gitans
qui les suit sur les vieilles routes de la terre
Belle lurette qu’on a passé la mi-temps
on se retrouve de plus en plus solitaire
dans les rues livrées à la nuit sans excitant
que le pouls qui se bat contre les délétères
effondrements mondiaux sous le poids de l’argent
dans tous les coups d’Etat trace de ses agents
le triste globe en est devenu invivable
les signes sont partout qui vous crèvent les yeux
même Œdipe a trouvé pire que ses aïeux
le tout anesthésié par le pouvoir des fables
Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel, Tarabuste,
2024, p.105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, fontaine, coup d'etat | ![]() Facebook |
Facebook |
12/02/2024
Niki de Saint Phalle, Traces : recension
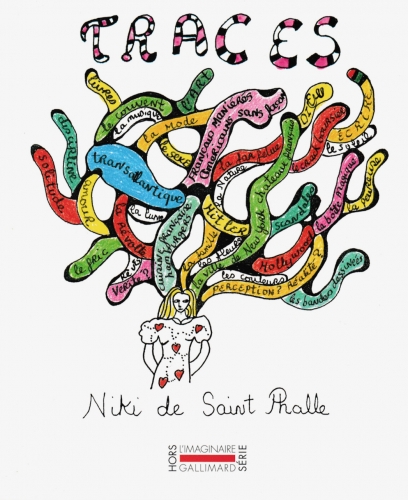
« L’art a été mon ami le plus proche »
Ni mémoires ni Journal, l’autobiographie, constitue, depuis le XVIe siècle un genre littéraire (pensons par exemple aux Commentaires de Blaise de Monluc ou à certaines parties des Essais). Le genre s’est vraiment établi à la fin du XVIIIe (Les Confessions de Rousseau, 1782) et s’est développé au cours du XIXe siècle. Par commodité on peut reprendre la définition qu’en a donné Philippe Lejeune1, « Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité ». En sachant que plusieurs éléments peuvent être absents : L’instant fatal, récit autobiographique de Queneau est en vers. Traces de Niki (née Catherine) de Saint-Phalle ne met pas seulement l’accent sur sa « vie individuelle », mais introduit des éléments non verbaux et reste cependant une autobiographie. E. Lebovici marque clairement dans sa préface la pertinence du titre choisi pour une autobiographie et analyse les traces rassemblées, C. Meurisse représente l’auteure comme une femme volontaire, libre.
Traces est à part dans la collection L’imaginaire, par son format (18x22, au lieu de 12,5x19 habituellement), son emboîtage — et son contenu : le texte, en partie calligraphié par l’auteure (« La calligraphie m’a toujours fascinée »), est accompagné de dessins et de peintures, de poèmes, de montages de photos et de photos, en noir et blanc, colorisés, ce qui accuse leur ancienneté, d’images de films également colorisées. Cette diversité, qui rompt souvent la linéarité du récit, s’accorde avec le projet ; il ne s’agit pas de suivre dans le temps l’"histoire" d’une personne, mais de relever des traces, sans les restituer dans un ordre chronologique. La succession non ordonnée d’éléments plus ou moins distants les uns des autres restitue quelque chose du chaos d’une vie, quelle qu’elle soit, et la difficulté de penser une unité. Ce que Niki de Saint Phalle revendique (texte calligraphié) :
Je suis 2
J’aime être 2.
Double.
1 + 1 font 2.
Non.
Je suis 2 + 2.
au moins.
Je me perds dans les nombres,
sans vraie nationalité
ni racines.
Les versions de trois témoins d’un assassinat, dans le film de Kurosawa, Rashomon, sont toutes différentes, rappelle-t-elle au début de son livre : laquelle est "vraie" ? La couverture du livre donne d’emblée à voir la dispersion ; une trentaine de bandeaux colorés s’échappent de la tête d’une femme — l’auteure —, chacun portant ce qui pourrait être une trace : couleur, la mode (elle a été mannequin), écrire, la ville de New York, châteaux français, etc.
Les premières traces, relevées dans une page calligraphiée qui porte ce mot en titre, sont relatives à la mère : celle d’un jouet de l’enfance, d’une odeur, d’une robe, d’un rouge à lèvres ; traces présentes dans la mémoire pour dire l’absence (« MAMAN vous me manquez »), absence qui sera évoquée plusieurs fois. Niki de Saint Phalle (1930-2002) commence son autobiographie imprimée par d’autres souvenirs d’enfance qui mettent en scène son frère aîné Jean, son oncle, puis son grand-père avant de revenir à son frère. Ce n’est qu’après ces évocations familiales qu’elle revient à son enfance à New York, à ses jeux de fillette surveillée par sa gouvernante. À ses cauchemars et à ses insomnies, à la peur de mourir : « moments d’agitation / où la paix intérieure m’abandonne / J’ai peur de l’ombre. J’ai peur de tout. L’homme en noir. Le masque noir, / la cape noire, les gants noirs. / Viendra-t-il ? Est-ce qu’il me tuera ? » Les aléas de la fortune parentale, les années de guerre, l’ambition de la mère (« vous vouliez être fière de nous ») mais sa détestation de la peinture de Niki, son rejet du mari Harry Matthews, le mariage de ses parents sur un pari, l’abandon au couvent de la croyance religieuse, sa mise en scène, à 11 ans, d’une pièce avec un cuisinier qui mêle le corps de son épouse à d’autres viandes, le château en France, son second mariage avec Jean Tinguely, etc. : tous ces éléments disparates, accompagnés d’œuvres graphiques dans la manière et les couleurs de ses Nanas, sont une invitation au lecteur à s’interroger sur l’étrange désordre de ce qu’est une vie.
Il est nécessaire de s’arrêter à d’autres éléments pour connaître ce qui a, tôt dans le temps, guidé Niki de Saint Phalle. Dans sa jeunesse, elle avait une relation étroite avec une « boîte magique » dans laquelle elle déposait ses poèmes et à qui elle se confiait : « J’avais avec elle des conversations subtiles alors que je ne pouvais avoir d’échanges profonds avec ma famille. De cette époque date mon besoin de solitude. » Si cette solitude est rompue quelque temps par son union avec Harry Matthews qu’elle a épousé tous deux étant très jeunes2, elle la retrouve, sachant que c’est par le retrait qu’elle peut créer, ne pas devenir comme sa mère, « la gardienne d’un foyer ». Le pouvoir appartenait à son époque aux hommes et, écrit-elle, « je voulais le monde ». Elle l’obtiendra par l’art, par la solitude du travail pour peindre et sculpter. L’art a donné une unité à sa vie, « L’art a été mon ami le plus proche. Sans lui, il y a longtemps que je serais morte, / la tête éclatée. »
Niki de Saint-Phalle, traces, préfaces de E. Lebovici et C. Meurisse, L’imaginaire Hors-Série, Gallimard, 2023, 176 p., 20 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 15 janvier 2024.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : niki de saint phalle, traces | ![]() Facebook |
Facebook |
11/02/2024
Laurent Fourcaut, Une morceau de ciel

Lundi place Gambetta
Elle a teint ses cheveux d’une laide couleur
couleur de cuivre rouge il a la chevelure
d’un blanc grisâtre tant pis on se farcit leur
conciliabule entre des milliards — qu’en conclure ?
que silence est une extase qu’aucun dealer
ne fourgue à quiconque il le faut sous son galure
comme jalousement comme ultime valeur
archaïque bientôt à l’instar du silure
Les autres toujours plus nombreux polluent l’air
le monde vous a une minois patibulair
e « en avril je fais l’ouverture de la pêche »
fait le loufiat comme si tout continuait
pourquoi pas aller aux champignons ? y’a pas mèche
autant vaudrait croire encore au père Noë
l
Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel, Tarabuste,
2024, p. 117.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau dded ceil, teinture, médiocrité | ![]() Facebook |
Facebook |
10/02/2024
Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel

Le mort saisit le vif
La vie est impersonnelle elle va de vous
dans les choses le vent elle s’est imprimée
sur la gravure d’après Raphaël envou
tante est partie ailleurs jamais éliminée
lie le haut et le bas même aucun garde-fou
l’empêche d’investir la mort réanimée
Vous allez disparaître sans qu’un jet de fou
dre le signale au monde indifférent – grimée
en rituel social en décès votre mort
vous sera confisquée alors que vous vous dor
mirez enfin au sein de la pure nature
affranchi de la folie qui lance les vifs
dans la fuite en avant générale que bif
fe le divin trépas souveraine rature
Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel,
Tarabuste, 2024, p. 36.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, un morceau de ciel, nature, le mort saisit le vif | ![]() Facebook |
Facebook |








