02/12/2023
Esther Tellermann, Ciel sans prise : recension
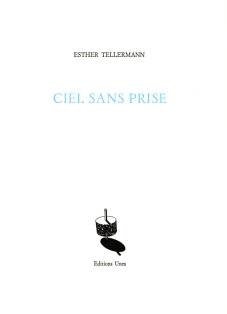
« Voilà / tout finit / et commence »
Il suffit d’ouvrir Ciel sans prise pour reconnaître l’écriture d’Esther Tellerman : poèmes entre dix et quinze vers, lesquels comptent rarement plus de trois syllabes, très peu ponctués mais parfois un blanc introduit une légère pause ; aucune rupture d’une page à l’autre, comme si s’écrivaient par touches les moments d’une histoire, celle peut-être d’un jeet d’un tu/vous très vite présents. L’ouverture du livre donne l’impression que se poursuit un autre livre par la rupture dans une durée :
Soudain nous avions / fermé / les persiennes
Le début rapporte un avant, un passé, où s’est vécu un acte de retrait, le « nous » s’isolant de son entourage et le livre s’achève avec une ouverture, par deux mots détachés, « Qui noue / les chemins et les cercles / toujours arrache / la couleur // fait face ». Ouverture sur l’avenir, vers un autre livre, non pour répéter ce qui a été écrit, mais pour continuer à dire ce qui ne peut être un fois pour toutes énoncé. Parce que rien, ou très peu, de ce qui est écrit ne peut être lu comme "réel", seulement pour une trace possible d’un moment, plus ou moins lisible, plus ou moins transformée : l’un des derniers textes, repris en quatrième de couverture, renvoie ainsi au début du livre, « Qui / soudain / ferme les persiennes », après un autre qui reprend la première scène, « Soudain / nos persiennes étaient closes ».
Comment décider de ce qui est réel, de ce qu’est le réel dans le livre. Dans le premier poème quand le "je " revient au présent après un temps dans le passé (plus-que-parfait, « avions fermé »), cela se passe dans un mouvement où l’univers semble se défaire (« Tout près / les continents / me traversent), est-ce l’image d’un ailleurs que l’on retrouve plus loin (« avant l’incandescence / d’une unique fièvre / où s’engouffrent / les continents ») ? d’une confusion où l’espace s’étire jusqu’à déborder toute limite ? Parallèlement, les divisions temporelles s’effacent pour laisser place à une durée continue, sans présent ni passé, et à la proposition : « un lendemain n’est-il / un jadis suspendu à l’aurore », une réponse : « l’absence de lendemains » d’où naissent l’obscurité, la « ténèbre ». L’écriture ouvre à « un absolu », à « l’infini » (« Nous humions l’infini »), l’absence de verbe parfois ne situant plus rien dans la durée, « l’encre psalmodiant / l’exactitude / des naufrages / le dessin / des univers / tus ». Il suffit d’un mot, « soudain », pour qu’il y ait rupture, l’univers semble se défaire, perd tout contour et sa raison d’être, « Soudain / ne respirent / les vieux mondes / trébuchent / sur les constellations » et plus avant, « les vieux mondes dérivent ». Tout pouvant devenir mots, ce qui était achevé peut recommencer, comme si un changement d’ordre météorologique suffisait à provoquer une métamorphose, « Puis reviendra / l’orage /(…) et notre chemin / sera visible » — futur d’un "nous" dont les composants sont insaisissables.
S’agit-il d’un "nous" amoureux comme le laisseraient supposer, par exemple, les allusions à la chambre close, au mouvement des reins ? Un "nous" complice au regard commun pour observer ce qui est en dehors de lui : « nous écartions / les persiennes pour / deviner / un monde / qui palpite » ? Mais de ce monde bien peu est dit, le lecteur découvre — ou invente en partie — des allusions à l’Histoire passée à partir des « rafales de souvenirs ». Les éléments propres à un récit sont évidemment absents et si l’on cherche des paysages, on ne trouve que des « horizons » ; les noms variés de fleurs et d’arbres participent au rythme des poèmes, non à une description de lieux — dans l’ordre d’apparition : amandier, jasmin, sauge, saule, hibiscus, gardénia, hysope, églantier, myrtille, châtaignier, cyprès, aubépine, lilas, saule, laurier, pavot, orme, hyacinthe. Quant aux noms généraux (terre, ciel, mer, continent), ils ne renvoient à rien de concret et la relation au visible est même explicitement effacée ; ainsi, l’ombre surgit, fabrique d’obscurité (« Tout à coup / une ombre / tourmente le bleu / dépose un peu de nuit »), mais plus souvent l’ombre, et donc l’obscurité, apparaissent comme des éléments intérieurs : « sans ombre que celle du dedans », et il est inutile de chercher à « tresser des chimères / apprivoiser l’ombre ». La mer, présente dans les poèmes, a un statut analogue à celui de l’ombre, ce qui est répété : « sans / mer // que celle du dedans », puis « sans mer / que celle du / dedans ».
Cette présence absence semble définir ce qu’est le "tu / vous", de là toute fondation d’un "nous". L’interlocuteur est lié à une odeur, proche par sa salive, il partage une chambre avec la narratrice et, également, des rêves (« nous inventions des sommeils ») s’avère être une création verbale, « je cherche encore / la langue / où / vous dire ». Construit peu à peu il s’évanouit brusquement (« Puis soudain je vous perds »), comme si les mots manquaient pour maintenir sa consistance. Ils sont bien là, les mots, mais pour exprimer nettement qu’ils sont la seule existence du "tu / vous" ; c’est « celui qui ne fut / à qui je parle », « Vous avez été / serez / (…)/ un dieu absent / ouvrant les paumes / frère / d’un ailleurs ». "Tu" comme suite de mots, seulement une forme nécessaire pour explorer ce que pourrait être un échange, « Je serai / vous / celui qui fut / à qui je parle / ou / qui ne fut pas / mais demeure ». Peut-être qu’une relation entre un "je" et un "tu" n’existe qu’avec les mots — Car / rien n’est / que / l’au-delà de / la forme » —, la présence du "tu" étant plusieurs fois affirmée comme suspendue au désir du "je" ; l’un et l’autre comme des formes à investir — c’est leur statut dans la langue. C’est une condition suffisante pour que les souvenirs, les temps de l’enfance, le passé donc, renaissent dans le présent, souvent avec leur charge émotive qu’on lit proche d’un Verlaine : « Dans les vieux parcs / viennent les chagrins / au souvenir / des pavots et des / musiques ».
On voit là que Ciel sans prise n’a rien d’un livre de poésie abstrait. Parfois énigmatique, qui suggère plus qu’il ne dit, qui demande à être relu, et la forme choisie est un élément important dans le plaisir de la lecture. Esther Tellermann use rarement de la paronomase (jaspe / gypse) et des répétitions de sons (« des paupières et des paumes ») ; outre les ellipses de verbes, elle introduit régulièrement des constructions syntaxiques qui exigent une (re)lecture attentive (compléments multiples ou éloignés du verbe, cascade de relatives) ou dont l’ambiguïté n’est pas immédiatement levée — un exemple : « (…) peut-être / secret / que le / corps porte / et soudain / irradie / la brûlure », où « secret » peut être lu comme sujet de « irradie ».. Livre que l’on peut lire sans rien connaître des ensembles précédents, auxquels on peut le rattacher tant l’œuvre est homogène.
Esther Tellermann, Ciel sans prise, éditions Unes, 2023, 220 p., 20 €.
Cette recension a été publiée par Sitaudis le 12 octobre 2023.
Publié dans RECENSIONS, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, ciel sans prise, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2023
Louis Aragon, Le Roman inachevé
Les mots qui ne sont pas d’amour

Il est inutile de geindre
Si l’on acquiert comme il convient
Le sentiment de n(‘être rien
Mais j’ai mis longtemps pour l’atteindre
On se refuse longuement
De n’être rien pour qui l’on aime
Pour autrui rien rien par soi-même
Ça vous prend on ne sait comment
On se met à mieux voir le monde
Et peu à peu ça monte en vous
Il fallait bien qu’on se l’avoue
Ne serait-ce qu’une seconde
Une seconde et pour la vie
Pour tout le temps qui vous demeure
Plus n’importe qu’on vive ou meure
Si vivre et mourir n’ont servi
Soudain la vapeur se renverse
Toi qui croyais faire la loi
Tout existe et bouge sans toi
Tes beaux nuages se dispersent
Louis Aragon, Le Roman inachevé, dans
Œuvres poétiques complètes, II, édition dirigée par
Olivier Barbarant, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 181-182.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, le roman inachevé, les mots qui ne sont pas d'amour | ![]() Facebook |
Facebook |
30/11/2023
Louis Aragon, En étrange pays dans mon pays lui-même

Marguerite
Ici repose un cœur en tout pareil au temps
Qui meurt à chaque instant de l’instant qui commence
Et qui se consumant de sa propre romance
Ne se tait que pour mieux entendre qu’il attend
Rien n’a pu l’apaiser jamais ce cœur battant
Qui n’a connu du ciel qu’une longue apparence
Et qui n’aura vécu sur la terre de France
Que juste assez pour croire au retour du printemps
Avait-elle épuisé l’eau pure des souffrances
Sommeil ou retrouvé des rêves de vingt ans
Qu’elle s’est endormie avec indifférence
Qu’elle ne m’attend plus et non plus ne m’entend
Lui murmurer les mots secrets de l’espérance
Ici repose enfin celle que j’aimais tant
Aragon, En étrange pays dans mon pays lui-même, dans
Œuvres poétiques complètes, I, édition dirigée par
Olivier Barbarant, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 891.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marguerite ici repose un cœur en tout pareil au temps qui meurt, en étrange pays dans mon pays lui-même, dans Œuvres poétiques complètes, i, édition dirigée par olivier barbarant, pléiadegallimard, 2007, p. 891. apparence, espérance | ![]() Facebook |
Facebook |
29/11/2023
Louis Aragon, La Grande Gaîté

Art poétique
On me demande avec insistance
Pourquoi de temps en temps je vais à
La ligne
C’est pour une raison
Véritablement indigne
D’être cou
Chée par écrit
Aragon, La Grande Gaîté, dans
Œuvres poétiques complètes, I, édition
dirigée par Olivier Barbarant,
Pléiade/Gallimard, 2007, p. 406.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, la grande gaitera, art poétique | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2023
Louis Aragon, Le Paysan de Paris

Je ne veux plus me retenir des erreurs de mes doigts, des erreurs de mes yeux. Je sais maintenant qu’elles ne sont pas que des pièges grossiers, mais de curieux chemins vers un but que rien ne peut me révéler qu’elles. À toute erreur des sens correspondent d’étranges fleurs de la raison. Admirables jardins des croyances absurdes, des pressentiments, des obsessions et des délires. Là prennent figure des dieux inconnus et changeants. Je contemplerai ces visages de plomb, ces chènevis de l’imagination. Dans ces châteaux de sable, que vous êtes belles, colonnes de fumées ! Des mythes nouveaux naissent sous chacun de nos pas. Là où l’homme a vécu commence la légende, là où il vit.
Aragon, Le Paysan de Paris, dans Œuvres poétiques complètes, I, édition dirigée par Olivier Barbarant, Pléiade/Gallimard, 2007, p. 149.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, le paysan de paris, étrangeté | ![]() Facebook |
Facebook |
27/11/2023
Louis Aragon, Les Destinées de la poésie

Le dernier des madrigaux
Permettez Madame
C’est grand liberté
Que je le proclame
Vous atteignez à la beauté
Ce n’est pas peu dire
Ce n’est pas pour rire
C’est même exactement
Pour pleurer
Votre manière agaçante
De manier l’éventail
Vos airs de reine ou de servante
Vos dents d’émail
Vos silences pleins d’aveux
Vos jolis petits cheveux
Ce sont des raisons excellentes
Pour pleurer
Aragon, Les Destinées de la poésie, dans
Œuvres poétiques complètes, I, éditions dirigée
par Olivier Barbarant, Pléiade/Gallimard,
2007, p. 120-121.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis aragon, les destinées de la poésie, le dernier des madrigaux | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2023
Luis Cernuda, La Réalité et le Désir

Avec toi
Mon pays ?
Mon pays c’est toi.
Mon peuple ?
Mon peuple c’est toi
L’exil et la mort
pour moi sont
où tu n’es pas.
Et ma vie ?
Dis-moi, ma vie, qu’est-elle, sinon toi ?
Luis Cernuda, La Réalité et le Désir, traduction
Robert Marrast et Aline Schulman,
Gallimard, 1965, p. 145.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luis cernuda, la réalité et le désir, vie | ![]() Facebook |
Facebook |
24/11/2023
Claude Royet-Journoud, Histoire du reflet
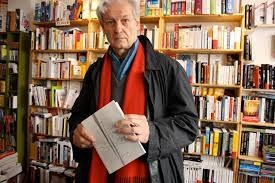
une forme humaine
sans clarifier son objet
ou la noirceur du lieu
retire l’enfant d’une description
corps et voyelles ont beau faire
le réel est encore l’ombre
sous la chaise
par secousses par saccades se prépare
un cercle de respiration
le sol est froid
une accumulation d’outils
neutralise la figure
Claude Royet-Journoud, Histoire du reflet, dans
K.O.S.K.H.O.N.O.N.G.,n° 25, automne 2023, p. 7.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude royet-journoud, histoire du reflet, lieu, réel | ![]() Facebook |
Facebook |
23/11/2023
Emily Dickinson, Du côté des mortels

Je n’oserais pas quitter mon ami,
Au cas où — au cas où il devrait mourir
Pendant mon absence — et que — trop tard —
Je rejoigne le Cœur qui m’attendait —
Si je devais décevoir les yeux
Qui ont scruté — tant scruté — pour voir —
Et ne pouvaient se résoudre à se fermer avant
Qu’ils m’aient « aperçue » — ils m’ont aperçue —
Si je devais poignarder la foi patiente
Si sûre de ma venue —
Bien sûr je suis venue —
À l’écoute — à l’écoute — endormi —
En prononçant mon nom doucement —
Mon ©œur souhaiterait se briser avant ça —
Se briserait alors — alors brisé —
Serait aussi inutile que le prochain soleil du matin —
Là où le givre de minuit — s’étendait !
Emily Dickinson, Du côté des mortels, traduction
François Heusbourg, éditions Unes, 2023, p. 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels, ami, amant | ![]() Facebook |
Facebook |
22/11/2023
Emily Dickinson, Du côté des mortels

Tu m’aimes — tu en es sûre —
Je n’ai pas à craindre de méprise —
Je ne me réveillerai pas trompée—
Par un matin souriant —
Pour trouver l’Aube partie —
Et les Vergers — intouchés —
Et Dollie — envolée !
Je ne dois pas tressaillir — tu en es sûre —
Une telle nuit ne se produira jamais —
Quand apeurée — me précipitant chez Toi —
Pour trouver les fenêtres éteintes —
Et plus de Dollie — vraiment —
Plus du tout !
Sois sûre d’être sûre — tu sais —
Je le supporterais mieux maintenant —
Si tu me le disais simplement —
Plutôt qu’ensuite — un petit Baumier terne ayant poussé —
Sur cette douleur mienne —
Tu piques — encore !
Emily Dickinson, Du côté des mortels, poèmes
1860-1861, traduction François Heusbourg,
éditions Unes, 2023, p. 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2023
Antoinette Deshoulières, De rose alors ne reste que l'épine : recension
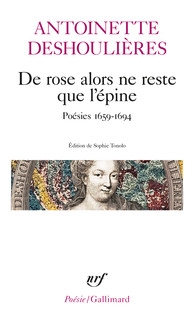
On ne lit plus beaucoup les "classiques" dans les lieux qui ont vocation à les faire connaître et aimer, l’école, le lycée, l’université. Sauf à y être encore obligé pour un concours, parfois un examen ; au fil du temps, ils sont devenus illisibles pour la plupart des lecteurs. Ouvrir La Fontaine ou Racine (n’évoquons pas Ronsard ou Rabelais, qu’il faut « traduire ») implique de comprendre que la langue, comme tout ce qui fait la vie, a changé. Le comprendre devrait / pourrait entraîner le choix de l’effort — comme en demande la lecture d’un écrivain contemporain, Pierre-Yves Soucy ou Esther Tellermann — sachant que toute édition d’un écrivain du passé est aujourd’hui (quand elle est bien faite) assortie de notes. La publication d’un large choix de poésies d’Antoinette Deshoulières (1638-1694) est un modèle du genre ; l’éditrice, Sophie Tonolo, connaît fort bien l’ensemble de la poésie du XVIIe siècle et aplanit toutes les difficultés de lecture : elle a modernisé la graphie, éclairci dans des notes simples le sens de mots disparus (hoirie) ou dont l’usage est autre (cabinet), expliqué ce qu’est un madrigal ou une élégie, remis en mémoire des données historiques (qui était Charles Quint ?), etc. Bref, on ne se plaindra pas de l’abondance des notes, même si quelques esprits chagrins, qui ne voient midi qu’à leur porte, trouveront inutile d’indiquer que « les trois fatales Sœurs » (p. 42) désignent les Moires ou Parques, Clotho, Lachésis et Atropos. Tout cet appareil, que l’on n’a pas à consulter systématiquement, facilite la lecture d’« une grande voix de la poésie française du XVIIe siècle injustement et inexplicablement oubliée. », comme la présente, justement, le site des éditions Gallimard.
On n’approuve pas l’idée que l’oubli de telle ou telle poète est inexplicable, mais il faudrait, il faudra écrire autrement l’histoire de la littérature, expliquer pourquoi tant d’écrits de femmes n’ont pas été publiés, et ceux qui l’ont été souvent "oubliés" aujourd’hui. Nous n’en sommes heureusement pas là et l’on se réjouit de l’abondance des noms de femmes au rayon "poésie" — l’anthologie personnelle de poètes femmes qu’a proposée Marie de Quatrebarbes, Madame tout le monde (Le corridor bleu, 2022) n’aurait pas été possible en 1980, par exemple. Antoinette Deshoulières, elle, a écrit pendant plus de trente ans et maîtrisé les genres poétiques de l’époque, du simple rondeau à l’élégie. Dans les cinq ensembles de cette anthologie, seul un groupement s’attache à des formes (2. Chansons, ballades, rondeaux), les autres sont thématiques (1. Être femme, 3. La plume à la patte, 4. Dans le monde, 5. Penser et combattre).
Contrairement à des idées reçues, le féminisme n’est pas né avec les Pussy Riot ou avec #metoo ; même si la voix d’Antoinette Deshoulières n’a pas fait bouger les pratiques masculines de son époque, elle a dû être entendue, au moins par d’autres femmes. L’ensemble "Être femme" est sans doute le plus surprenant pour le lecteur, qui a ri sans se poser de questions à la lecture des Femmes savantes de Molière — les femmes (celles qui avaient étudié et avaient des loisirs) étaient donc de vilaines pédantes ! Dans une Épître chagrine à Mademoiselle ***, Antoinette Deshoulières fait entendre un autre point de vue ; une femme veut-elle « devenir savante » ? Elle s’expose à toutes les moqueries dans une société où « Personne ne lit pour apprendre, / On ne lit que pour critiquer » :
Pourrez-vous supporter qu’un fat de qualité
Qui sait à peine lire, et qu’un caprice guide,
De tous vos ouvrages décide ?
Si vous allez à la Cour, vous saurez vite que « l’air qu’on y respire / Est mortel pour les Gens qui se mêlent d’écrire ». L’auteure accumule les arguments pour décourager la jeune femme, terminant en livrant son expérience malheureuse,
J’ai su faire des vers avant que de connaître
Les chagrins attachés à ce maudit talent.
Antoinette Deshoulières parlait d’expérience puisque, sans être fortunée, elle a publié ses œuvres et a, en partie, subvenu à ses besoins de cette manière. Si elle n’a pas hésité à tourner le compliment pour obtenir des faveurs, en l’occurrence des subsides, elle a aussi attaqué dans ses vers le comportement des hommes vis-à-vis des femmes ; et l’on constate (sans joie) que peu de choses ont changé. Comment les jeunes gens regardent-ils les femmes ? « Quand ils ne nous font pas une incivilité, / Il semble qu’ils nous fassent une grâce. » Dès qu’il a obtenu les faveurs d’une femme, un homme en cherche une autre, « inconstant / comme tous les autres hommes », et il se comporte selon une règle commune, répétée dans chaque strophe et dans l’envoi d’une ballade, « Tous les hommes sont trompeurs. » Nous ne sommes plus dans la Carte du Tendre, pense-t-elle, nous vivons « Dans un siècle où l’Amour n’est que dans les chansons. »
On accumulerait les citations qui prouvent la lucidité d’Antoinette Deshoulières qui a su analyser ses observations. Parfois elle paraît naïve au lecteur de 2023 dans ses vers de moraliste proches de La Rochefoucauld : nous savons bien qu’il n’y a pas lieu de « s’applaudir d’être belle » puisqu’on « a peu de temps à l’être / Et longtemps à ne l’être plus » ; mais qui sait aujourd’hui regarder la mort « sans changer de visage » ? D’autres poèmes, relatifs à la vie « dans le monde », disent beaucoup à propos des mœurs des puissants de l’époque, des comportements d’une classe qui s’est longtemps imaginée au-dessus de tout ; l’auteure ne relève évidemment pas de front leur nuisance et flatte le roi ou Madame de Maintenon, comme d’autres l’ont fait. Elle prouve dans d’autres poèmes une fantaisie acide qui n’a pas trop vieilli : elle donne la parole à plusieurs chats — comme les hommes le feraient — qui tentent de séduire sa chatte Grisette, mais celle-ci semble suivre les conseils de sa maîtresse et ne s’en laisse pas conter, proposant dans le meilleur des cas son amitié.
Reste à souhaiter que d’autres écrivaines (en vers ou en prose) soient sorties des bibliothèques ou des éditions savantes souvent coûteuses, où elles sont aujourd’hui reléguées. Il est certain qu’elles trouveront des lecteurs : la misogynie n’a certes pas disparu, mais la manière d’accueillir les œuvres des femmes a changé et un retour en arrière peu probable (croisons les doigts !).
Antoinette Deshoulières, De rose alors ne reste que l'épine, édition SophieTonolo, Poésie/Gallimard, 2023, 220 p, 10, 10. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 2 octobre 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoinette deshoulières, de rose alors ne reste que l'épine : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
20/11/2023
Emily Dickinson, Du côté des mortels

Marcher pour toujours à Ses côtés —
La plus petite des deux !
Cerveau de Son Cerveau —
Sang de Son Sang —
Deux vies — Un Être — Désormais —
Partager Son Sort pour toujours —
En cas de chagrin — abandonner ma part
À ce Cœur bien-aimé —
La vie entière — pour connaître l’autre
Que nous ne pouvons jamais apprendre —
Et petit à petit — un Changement —
Appelé Paradis —
Voisinage d’humains en extase —
Découvrant alors — ce qui nous troublait —
Sans le lexique !
Emily Dickinson, Du côté des mortels, poèmes
1860-1861, traduction François Heusbourg,
Editions Unes, 2023, p. 133.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels, vie, apprendre | ![]() Facebook |
Facebook |
19/11/2023
Emily Dickinson, Du côté des mortels

S’il n’avait pas de crayon
Emprunterait-il le mien —
Usé — là — émoussé — mon cher
De t’écrire tant.
S’il n’avait pas de mot —
Ferait-il la Pâquerette,
Presque aussi grande que je l’étais —
Quand il m’a cueillie ?
Emily Dickinson, Du côté des mortels (poèmes
1860-1861), traduction François Heusbourg,
Editons Unes, 2023, p. 57.
18/11/2023
Emily Dickinson, Du côté des mortels, poèmes 1860-1861

Elle est morte en jouant —
Tournoyant tout le long
De son bail aux heures inachevées
Puis elle a glissé aussi gaiement qu’un Turc
Sue un Coussin de fleurs
Son fantôme flottait doucement sur la colline
Hier, et aujourd’hui —
Son vêtement une toison d’argent —
Son visage — un embrun —
Emily Dickinson, Du côté des mortels, poèmes
1860-1861,traduction François Heusbourg,
éditions Unes, 2023, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dickinson Emily | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : emily dickinson, du côté des mortels | ![]() Facebook |
Facebook |
17/11/2023
Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls

mais où s’égare le soleil
où part-il s’égayer
place de la Fraternité
sur de curieux bancs de très grands enfants jouent
ici le temps redouble
il fait nuit brune
j’ignore où commence
la rue que je recherche
oh le terrible
bruit de mon cœur
là dans la fosse de mon corps
incarcéré mais clair comme une gigue
Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls,
Gallimard, 2023, p. 136.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne paulin, poèmes pour enfants seuls, soleil, enfant | ![]() Facebook |
Facebook |





