28/04/2024
Franz Kafka, Lettres à Felice, II

Pour écrire j’ai besoin de vivre à l’écart, non pas « comme un ermite », ce ne serait pas assez, mais comme un mort. Écrire en ce sens, c’est dormir d’un sommeil plus profond, donc être mort, et de même qu’on ne peut pas arracher un mort au tombeau, de même on ne peut pas m’arracher à ma table de travail dans la nuit. Ce n’est pas directement lié à mes rapports avec les gens, il se trouve simplement que je ne puis écrire, et vivre par conséquent, que de cette façon systématique, continue, stricte. (...) Depuis toujours j’ai eu peur des gens, non pas des gens eux-mêmes à proprement parler, mais de leur intrusion dans mon être débile, voir ceux auxquels j’étais le plus lié pénétrer dans ma chambre m’a toujours causé de l’effroi, c’était plus que le pur symbole de cette peur.
Franz Kafka, Lettre à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1990, p. 470.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice ii, ermite, effroi | ![]() Facebook |
Facebook |
27/04/2024
Franz Kafka, Lettres à Felice

(...) Je répugne absolument à parler. Du reste ce que je dis est faux à mon sens. A mes yeux la parole ôte à tout ce que je dis importance et sérieux. Il me semble qu’il ne peut en être autrement, étant donné que mille choses et mille pressions extérieures ne cessent d’influencer le discours. Je suis donc taciturne par nécessité, mais aussi par conviction. L’écriture est la seule forme d’expression qui me convienne.
Franz Kafka, Lettres à Felice, II, traduction Marthe Robert, Gallimard, 1972, p. 511.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Kafka Franz | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franz kafka, lettres à felice, parole, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
25/04/2024
Pascal Quignard, Petits traités, III
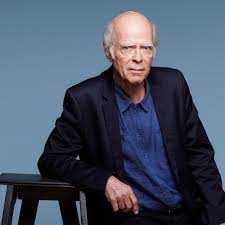
Supposé que l’espoir nous prenne de compenser le peu de nécessité que nous trouvons dans les choses du monde et dans l’ordre désordonné de la nature en écrivant des livres, l’ordre que nous imposons à ce que nous écrivons n’aboutit jamais à élever le livre au niveau du réel, au statut d’une région où le phantasme, le symbole, le sens soient enfin arrachés. Au contraire. Tout l’artifice que nous introduisons à cette fin s’accroît au fur et à masure que nous lisons, fait hyperboliquement retour, et l’existence d’un livre nous apparaît à chaque fois particulière, disproportionnée, chétive, risible, infiniment touchante. Tout l’ordre et l’intention et la maîtrise et la beauté s’effondrent infiniment à tout instant dans l’absence de nécessité de tout livre. Nul n’est jamais contraint de faire un livre. Même les dieux des religions révélées. Et infiniment ils nous semblent vains.
Pascal Quignard, Petits traités, III, Maeght, 1990, p. 78-79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, ordre, désordre, livre | ![]() Facebook |
Facebook |
24/04/2024
Pascal Quignard, Petits traités, II
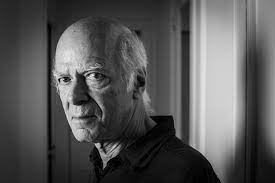
Au fond de chacun de ceux qui ouvrent la bouche, non pas une histoire propre (leur plus privé et profond « ego » n’étant n’étant précisément qu’une catégorie propre à la langue qu’ils utilisent, et sans existence universelle, ni matérielle). De plus, « langue solitaire », individu sans communauté », etc., sont des cercles carrés, des échelles sans échelons) que traduirait une sourde mélopée autistique : mais un tassement, une combinaison temporelle s’un caractère irréversible et dont les éléments sont moins singuliers que leur ordre, leur épaisseur, leur sédimentation.
En ce sens, chaque langue, c’est-à-dire chaque parleur, est incommensurable, sans que tous soient pour autant personnels, ni ne relèvent pourtant d’une unanimité. Il n’y a pas, entre eux, une « unité » de langue qui soit une ressource mise à leur disposition, ni une mesure indiscutable, ni même un élément « national ».
Pascal Quignard, Petits traités, II, Maeght, 1990, p. 16-17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal guignard, petits traités, langue | ![]() Facebook |
Facebook |
23/04/2024
Pascal Quignard, Petits traités, VII

Les vieilles maisons sont des fées. Les vieilles maisons de famille sont invendables parce qu’elles ne sont plus des objets. Les « lèvres velues » disent le sexe féminin. Ridiculement, la moustache au-dessus de la bouche des hommes cherche à les rappeler comme un enfant imite les manies de sa mère.
Pascal Quignard, Petites traités, VII, Maeght ; 1990, p. 75.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, sexe, manie | ![]() Facebook |
Facebook |
22/04/2024
Pascal Quignard, Petits traités,VI
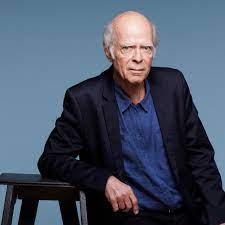
Là où est le silence, celui qui se tait, il lui appartient. Le silence entraîne, de la part de celui qui se tient en lui, le défaut de maîtrise. Car lui-même est cette maîtrise. Sans qu’on puisse dire de lui : « Il gît », ou bien « Il pâtit », il est pourtant sujet à une passion.
Il se sait : il ne se saisit pas du silence. De lui le silence ne se saisit pas. Dans le silence il se dessaisit au silence.
Pascal Quignard, Petits traités, VI, Maeghy, 1990, p. 52.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal guignard, petits traités, vi, silence, passion | ![]() Facebook |
Facebook |
21/04/2024
Pascal Quignard, Petits traités, V

Il ne nous appartient pas de lire absolument. Nous ne lisons pas dans la connaissance que nous lisons. La si curieuse expérience de la lecture n’appartient qu’aux circonstances qui ont procuré, selon certaines civilisations, selon certains siècles, à certains d’entre nous, 1. Une voix tournée vers son silence, 2. L’usage de l’écriture et des livres pour nous maintenir dans ce désir, et dans l’oubli de ce désir, par la disposition si « autistique » et si curieuse — tournée vers soi, mais un soi hors de soi — de lire. D’être dans la langue seul et en silence.
Pascal Quignard, Petits traités, V, Maeght, 1990, p. 10-11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, lecture | ![]() Facebook |
Facebook |
20/04/2024
Pascal Quignard, Petits traités, II
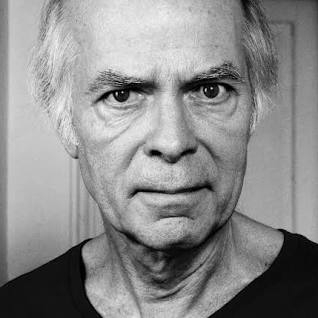
La langue n’est pas liée à la « vie ». Le langage ne répond pas à un besoin. Son usage ne remplit pas une fonction. Le langage dit plus qu’il n’est besoin qu’on dise. Le fait de parler n’est pas un acte nécessaire. Aristote écrivait : la voix est un luxe sans lequel la vie est possible. Tout l’exprimable est sans rapport à ce que suppose la survie d’une espèce — à supposer que l’on ait jamais songé que la survie d’une classe animale suppose l’exprimable.
Luxe, déséquilibre, excès qui les fondent. Qui les entraînent sans qu’une fin les ordonne.
Pascal Quignard, Petits traités, tome II, Clivage, 1982, p. 15-16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, petits traités, déséquilibre, langage, parole | ![]() Facebook |
Facebook |
19/04/2024
Paul Klee, Paroles sans raison

Rêve
Je trouve ma maison vide,
et tout le vin bu
détournée, la rivière
ma nudité volée, —
effacée l’épitaphe.
Blanc sur blanc.
Paul Klee, Paroles sans raison, traduction
Pierre Alferi, éditions Hourra, 2022, p. 20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, paroles sans raison, rêve | ![]() Facebook |
Facebook |
18/04/2024
Ossip Mandelstam, Simple promesse
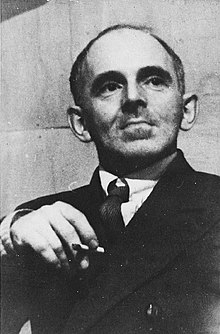
Armé de la vision des guêpes étroites ;
Qui sucent l’axe de la terre, l’axe de la terre ;
Je pressens tout ce qu’il m’a fallu connaître,
Je m’en souviens par cœur et vainement.
Et je ne dessine pas, ne chante pas,
Ne guide pas l’archet à la voix noire :
Je me contente de boire la vie et j’aime
À envier les guêpes fortes et rusées.
Oh, qu’un jour vienne, n’importe quand,
Où la piqûre de l’air et la chaleur de l’été
M’obligent, une fois franchi soleil et mort,
À entendre l’axe de la terre, l’axe de la terre.
8 février 1937, Voronèje
Ossip Mandelstam, Simple promesse
(choix 1908-1937), traduction P. Jaccottet,
L.Martinez, J-C/ Schneider, La Dogana, p. 138
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, simple promesse, guêpe, vanité | ![]() Facebook |
Facebook |
17/04/2024
Ossip Mandelstam, Simple promesse
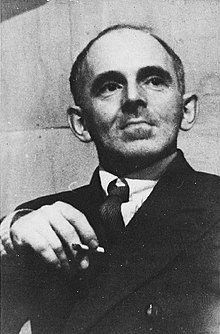
Le poirier a tiré sur moi, le merisier,
De leur force friable, sans jamais me rater.
Les rappes et les étoiles, les étoiles et le feuillage,
Dans quelle floraison le vrai ? quel est ce pouvoir en partage ?
Que ce soit aile ou fleur — blancheur d’air, cela frappe
Contre l’air, assommé par la massue des grappes.
Et de ce parfum double la farouche suavité
Bataille, se prolonge, mélangée, fragmentée.
4 mai 1937, Voronèje
Ossip Mandelstam, Simple promesse
(choix 1908-1937), traduction P. Jaccottet,
L.Martinez, J-C/ Schneider, La Dogana, p. 140.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, simple promesse, arbre, floraison | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2024
Ossip Mandelstam, Simple promesse
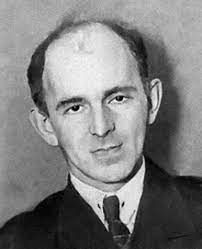
On s’assiéra dans la cuisine tous les deux,
La lampe à pétrole sentira un peu.
Un couteau affûté, une miche de pain…
Gonfle à bloc le primus, si tu veux bien,
Ou ramasse encore de la ficelle pour
Mieux fermer le cabas avant le jour,
Lorsque nous voudrons aller à la gare,
Là où l’on peut échapper aux regards.
Janvier 1931, Leningrad
Ossip Mandelstam, Simple promesse
(choix 1908-1937), traduction P. Jaccottet,
L.Martinez, J-C/ Schneider, La Dogana, p. 86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, simple promesse, regard | ![]() Facebook |
Facebook |
15/04/2024
Ossip Mandelstam, Simple promesse

Ce soir-là, l’ogivale forêt de l’orgue se taisait.
On nous chantait Schubert — notre berceau natal.
Le moulin murmurait, et dans les chants en rafales
L’ivresse aux yeux bleus de la musique riait.
C’était le monde du vieux lied, brun et vert,
Mais simplement jeune éternellement,
Où le roi des aulnes secoue dans sa folle colère
Des tilleuls rossignols les feuillages grondants.
Et la force effrayante du retour de nuit,
Et cette chanson sauvage comme un vin noir,
C’était ce double, ce fantôme vide,
Son regard de fou derrière la vitre froide !
1917
Ossip Mandelstam, Simple promesse
(choix 1908-1937), traduction P. Jaccottet,
L.Martinez, J-C/ Schneider, La Dogana, p. 38.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, simple promesse, lied, musique, chanson | ![]() Facebook |
Facebook |
14/04/2024
Ossip Mandelstam, Simple promesse

Il est vain de rien dire,
Il est vain d’enseigner personne :
Elle est assez triste et bonne,
L’âme animale, obscure.
Elle ne veut pas enseigner,
Ne sait en dire davantage,
C’est un jeune dauphin qui nage
Sur les abîmes argentés.
1909
Ossip Mandelstam, Simple promesse
(choix 1908-1937), traduction P. Jaccottet,
L.Martinez, J-C/ Schneider, La Dogana, p. 13.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Mandelstam Ossip | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ossip mandelstam, simple promesse, enseigner | ![]() Facebook |
Facebook |
13/04/2024
Etel Adnan, Je suis un volcan criblé de météores

Il n’y a pas de grenouilles
dans ce vaste ciel
pas de messages
Il n’y a pas de ciel dans ce cerveau
pas de mots
Il n’y a pas de cerveau
dans ce corps
pas de lien.
Les collines sont sèches
l’or ne fait pas pousser
l’herbe
lions et éléphants
sont morts
Y a-t-il déjà longtemps
que ma mémoire
est terre brûlée ?
La sècheresse
est dans l’esprit
et sur le sol
(…)
Etel Adnan, Je suis un volcan criblé de météores,
Traduction de l’anglais, Poésie/Gallimard,
2023, p. 323.





