16/12/2019
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

Paysage mauvais
Sable de vieux os — Le flot râle
Des glas : crevant bruit sur bruit.
— Palud pâle, où la lune avale
De gros vers, pour passer la nuit.
— Calme de peste, où la fièvre
Cuit… Le follet damné languit
— Herbe puante où le lièvre
Est un sorcier poltron qui fuit
— La lavandière blanche étale
Des trépassés le linge sale,
Au soleil des loups… — Les crapauds
Petits chantres mélancoliques
Empoisonnent de leurs coliques
Les champignons, leurs escabeaux.
Tristan Corbière, Les Amours jaunes,
dans C. Cros, T. C., Œuvres complètes,
Pléiade / Gallimard, 1970, p. 794.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, paysage mauvais, lune, crapaud | ![]() Facebook |
Facebook |
15/12/2019
Claude Dourguin, Paysages avec figure : recension
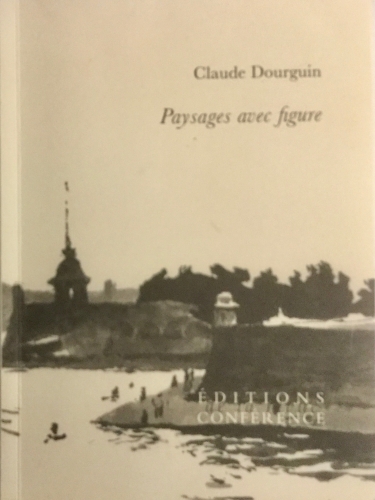
Dans ses écrits sur la peinture, Claude Dourguin a parfois décrit l’« esquisse narrative » de certains tableaux titrés Paysage avec figures, elle choisit ici de retenir des paysages qui, tous, sont des « révélateurs », « cristallisent (...) goûts et affections », habités par une figure, celle du compagnon disparu qui n’apparaît que sous la forme "il" ou partie du "on". Aucune hiérarchie entre les lieux n’est établie ; même si prédominent mer et montagne, ce qui importe est la possibilité de découvrir, apprendre — donc vivre —, et aussi de sortir du temps, de la durée quotidienne, chaque paysage devenant une « réserve imaginaire ».
En 1951, la sculptrice Barbara Hepworth disait à propos de Saint-Ives, en Cornouailles, où elle vivait, « Je fais partie du pays, un paysage marin dont les origines remontent à des centaines de milliers d’années » ; c’est un sentiment analogue qu’éprouve Claude Dourguin dans ce lieu où elle retrouve maintes traces d’un passé ancien, y revivant « la rumeur puissante qui hante le cycle arthurien » et, en même temps, le village a été construit de sorte à prendre une forme favorable pour le regard, où « les collines (...) font amphithéâtre pour observer la mer de près ». On peut être là dans le présent, dans le partage et, cependant, dans un autre temps.
L’émotion d’être, ensemble, « sans âge, relié à quelque chose de très ancien », naît également loin de la mer, dans un autre village. Il est une constante dans ce qui fait aller ailleurs — le lieu du retour à la vie "normale" n’est jamais nommé —, c’est la certitude qu’à chaque fois les heures s’émancipent de l’horloge », que rien ne peut rappeler ce qui, justement, oblige à tenir compte du temps, au fait que vivre dans une société exige une présence. Tous les paysages évoqués, parcourus à un moment ou à un autre en couple, ont permis de saisir le vif des choses du monde. À Naples, par exemple, outre la mer « dont la vue est toujours réconfortante », le visiteur s’arrête à l’un des multiples étals aux poissons pour leur « beauté simple, profuse, offerte, composition sans façon du quotidien » ; la beauté des choses de la nature — arbres, eaux, ciels — est sans cesser remarquée, décrite, et l’est aussi ce qui modifie les connaissances, change la manière de regarder le monde. Dans la vallée du Layon, avec la visite du moulin cavier de Thouancé, est « retrouvée l’humeur franche de qui parcourt, observe, mesure, analyse, comprend le paysage et lui donne sens », donc ce qui permet de vivre en harmonie avec lui. Cette harmonie ne nécessite pas toujours la variété des formes naturelles, elle naît également de la traversée du désert glacé russe quand il n’y a « nul obstacle ni présence, rien pour la [= la vue] limiter » ; alors, « espace et temps [sont] souverains, formes d’ici-bas dans leur nudité ». Paradoxe apparent : l’unité du lieu s’impose comme celle de la haute montagne quand, après un « passage ingrat », on connaît la « blancheur de révélation » de la neige. L’unité n’est pas donnée, il a fallu « s’être colleté au rocher », avoir « surmonté les moraines, bataillé », et les étals napolitains exigent un apprentissage du regard pour être perçus comme offerts.
Quels que soient les lieux parcourus, ils sont ouverture vers autre chose, parfois même ils contiennent un autre paysage ; ainsi, à partir d’une certaine dimension la forêt devient semblable à la mer (« la futaie (...) comme une mer », « on voyage en forêt comme on s’embarque pour la haute mer »), toute limite pour la vue disparaissant. Les paysages sont tremplin vers un ailleurs, l’un présente le « sortilège d’une métamorphose », l’autre, la haute montagne, fait entrer « dans un univers autre où s’opèrerait une transsubstantiation des matières ». Ils appellent aussi les souvenirs et suscitent des rêveries ; un jour, quand on s’égare dans la neige et passe la nuit près d’un feu de branchages, alors « le monde [... est] poreux au rêve, [ouvre] à la littérature et vice versa ». Certes, la nature est toujours bien présente avec par exemple, à l’île de Batz, une flore et une « faune locales (...) exceptionnelles » ou, ailleurs, avec le plaisir d’« affronter le froid et se mêler aux arbres » ; cependant la traversée du monde « jamais ne se détache vraiment des œuvres ».
Rien dans Paysages avec figure qui évoque une anthologie, mais quelques citations et des allusions suffisent au lecteur pour qu’il accompagne le mouvement du paysage aux textes, à la peinture, à la musique même. La mer, la Bretagne très présente, font apparaître Corbière, Gracq, on suit les chemins de Nerval dans le Valois et la montagne a une « unité monumentale, claudélienne » ; on se souvient ici et là de Follain, de Supervielle, de Baudelaire, de Rimbaud, de Valéry, et l’on cherche dans sa mémoire tel tableau de Klee, de Whistler, de Turner, de Constable, on retrouve un fragment du Samson et Dalila de Saint-Saëns ; etc. — une seule exception, dans le désert de l’Asie centrale, « nulle peinture, nul poème, nulle œuvre littéraire (...) ne venait (...) répondre » aux rêveries. Pour en rester aux citations, Claude Dourguin a choisi en épigraphe un fragment d’un poème de Hölderlin ("En bleu adorable") dans la traduction de du Bouchet : « Riche en mérites, mais poétiquement toujours, / Sur terre habite l’homme » : c’est, elliptiquement, énoncer un principe de vie, que l’on reconnaît d’un bout à l’autre de ses parcours.
Claude Dourguin, Paysages avec figure, éditions Conférence, 2019, 144 p., 17 €. Cette note d lecture a été publiée par Sitaudis le 15 novembre 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, paysages avec figure, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2019
Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière
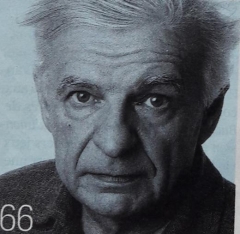
La neige
Elle est venue de plus loin que les routes,
Elle a touchz le pré, l’ocre des fleurs,
De notre main qui était en fumée,
Elle a vaincu le temps apr le silence.
Davantage de lumière ce soir
À cause de la neige.
On dirait que des feuilles brûlent, devant la porte,
Et il y a de l’eau dans le bois qu’on rentre.
Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière, Poésie/Gallimard,
2007, p. 67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bonnefoy Yves | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, ce qui fut sans lumière, neige, temps, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2019
Jean-Loup Trassard, Paroles de laine

L’été, cette année-là, fut d’une sécheresse exceptionnelle. Dans le village où je venais pour la seconde fois en vacances, les yeux commençaient à briller comme s’ils s’identifiaient à l’eau dont ils ne trouvaient point le signe au fond des puits. Je crois que les gens pensaient à des plantes grasses qu’ils auraient pu entamer au couteau et croquer, mais tous les végétaux comestibles avaient déjà donné leurs graines en juin. Les chiens haletaient, les chevaux baissaient la tête, exténués. Le village était silencieux par économie. Les rideaux en perles de bois avaient fait place aux portes pleines de l’hiver, plus protectrices. Le milieu des places n’était plus traversé par personne et mes yeux éblouis ne voyaient rien du peu de circulation qui vers les épiceries, les cafés suivaient l’ombre des murs.
Jean-Loup Trassard, Paroles de laine, Gallimard, 1969, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-loup trassard, paroles de laine, sécheresse, eau, fatigue | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2019
Victor Hugo, Tas de pierres

La misère chargée d’une idée est le plus redoutable des engins révolutionnaires.
— Pourquoi ces terreurs du drapeau rouge ?
— Le drapeau rouge signifie feu et sang.
— Soit ; mais le sang dans les veines, et le feu dans le foyer.
Révolution, mais civilisation.
L’une et l’autre, l’une par l’autre, l’une dans l’autre.
Savoir, c’est pouvoir.
Victor Hugo, Tas de pierres, dans Œuvres politiques complètes, œuvres diverses, Jean-Jacques Pauvert, 1964, p. 856.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor hugo, tas de pierres, misère, révolution, civilisation, drapeau rouge | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2019
Aragon, Elsa

Je n’ai plus l’âge de dormir
J’écris des rimes d’insomnie
Qui ne dort pas la nuit s’y mire
Signe couché de l’infini
Qui ne dort pas veiller lui dure
Des semaines et des années
Sa bouche n’est qu’un long murmure
Dans la chambre des condamnés
Je suis seul avec l’existence
Bien que tu sois à mon côté
Comme un dernier vers à la stance
Jusqu’au bout qu’on n’a point chanté
Ce qui m’étreint et qui me ronge
Soudain contre toi m’a roulé
Je retiens mon souffle et mes songes
Je crains d’avoir soudain parlé
Je crains de t’arracher à l’ombre
Et de te rendre imprudemment
À la triste lumière sombre
Qui ne t’épargne qu’en dormant
(...)
Aragon, Elsa, dans Œuvres poétiques
Complètes, II, Pléiade/Gallimard,
1959, p. 329-330.
Publié dans Aragon Louis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aragon, elsa, nuit, songe | ![]() Facebook |
Facebook |
10/12/2019
Philippe Jaccottet, Le bol du pèlerin (Morandi)

(Une récente nuit, je me suis rappelé une halte marocaine à Ouarzazare : des sables roses et des sables jaunes, des rafales de vent de sables roses et des drapeaux, et ces espèces de forteresses qui tremblaient dans l’excès de lumière sans être des mirages, mais à peine distinctes du sol où elles avaient été bâties, brève entrevision, un matin, pourquoi si poignante ?Je me trouvais dans un endroit du monde où je n’avais même pas désiré passionnément me rendre, et sans qu’aucune aventure personnelle y fût mêlée (car enfin, bien sûr, s’il y avait eu dans un de ces palais ou forteresses entrevus — comme au cinéma ! — une femme captive, ou pas, que je serais allé rejoindre — délivrer ! —, mon émotion fût allée de soi et personne ne s’en fût étonné — sinon du fait que c’était moi le héros ! mais non). Et ce que j’avais entrevu ainsi à quelque distance n’était même pas un site imprégné par la présence, ou l’absence de dieux, comme l’Égypte ou la Grèce m’en avaient offert en d’autres occasions. Alors un pur mirage, tout de même ? Le « leurre du seuil », plutôt : car là commençait le désert, l’idée de ce qui s’ouvre devant nous sans limites — et moins étranger à mon goût que l’océan —, l’ivresse que cela procure, ce socle pour la lumière, tout empoussiéré de feu, ces sables faits pour les pieds nus des voyants gardant l’entrée (...).
Philippe Jaccottet, Le bol du pèlerin (Morandi), La Dogana, 2001, p. 63-64.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jaccottet Philippe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe jaccottet, le bol du pèlerin (morandi), désert, forteresse, imaginaire | ![]() Facebook |
Facebook |
09/12/2019
Georg Trakl, Poèmes

Dans un vieil album
Tu reviens toujours, mélancolie,
O douceur de l’âme solitaire.
Pour sa fin s’embrase un jour doré.
Humblement devant la douleur
S’incline celui qui s’est fait patience.
Résonnant d’harmonie et de tendre folie.
Vois ! Il va faire noir déjà.
La nuit revient, quelque chose de mortel se plaint
Et quelque autre souffre avec elle.
Tremblant sous les étoiles d’automne
Chaque année la tête penche davantage.
Georg Trakl, Poèmes, traduits et présentés par
Guillevic, Obsidiane, 1981, p. 11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Trakl, Georg | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georg trakl, douleur, album, souffrance | ![]() Facebook |
Facebook |
08/12/2019
Huysmans, Marthe

Tiens, vois-tu, petite, disait Ginginet, étendu sur le velours pisseux de la banquette, tu ne chantes pas mal, tu es gracieuse, tu as une certaine entente de la scène, mais ce n’est pas encore cela. Écoute-moi bien, c’est un vieux cabotin, une roulure de la province et de l’étranger qui te parle, un vieux loup de planche, aussi fort sur les tréteaux qu’un marin sur la mer, eh bien ! tu n’es pas encore assez canaille ! ça viendra, bibiche, mais tu ne donnes pas encore assez moelleusement le coup des hanches qui doit pimenter le « boum » de la grosse caisse. Tiens, vois, j’ai les jambes en branches de pincettes faussées, les bras en ceps de vigne, j’ouvre la gueule comme la grenouille d’un tonneau (...), vlan ! la cymbale claque, je remue le tout, je râpe le dernier mot du couplet, je me gargarise d’une roulade ratée, j’empoigne le public. C’est ce qu’il faut. Allons, dégosille ton couplet, je t’apprendrai, à mesure que tu le goualeras, les nuances à observer.
Huysmans, Marthe, dans Romans et nouvelles, Pléiade / Gallimard, 2019, p. 5.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : huysmans, marthe, chanteuse, cabotin | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2019
Eugène Savitzkaya, Les couleurs de boucherie

Odorant véhicule apparu, le maî-
tre garçon, conducteur de limon,
parle de debora odorante, le jas-
min apparu, d’herbe envahie de-
bora brûlait ses lotus, dévorait,
colorait sa poupée jaune, morceau
de machine, debout au milieu des
fleurs, au pré et la flamme lé-
chait l’intérieur, l’index, l’ocre
bâton mouillé, parfumé, ogre odo-
rant, méchant. Le pourpre apparu,
l’archer immobile, le doigt vers
la debora mouillée,, morte odorante
et sainte, sa lingerie transper-
cée, le suc sur la paume, et du
giovanni le chalumeau encore au
pot et transparent, humide, petit
pinceau.
Eugène Savitzkaya, Couleurs de boucherie,
Poésie / Flammarion, 2019, p. 154.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, les couleurs de boucherie, ogre, odeur | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2019
Durs Grünbein, Presque un chant

Mantegna, peut-être
Un jour, dans le demi-sommeil... entre recevoir et donner,
J’ai vu mes mains, leur peau rouge, jaunâtre,
Comme celles d’un autre, d’un cadavre à la morgue.
Au repas, elles tenaient couteau et fourchette, ces outils
De cannibale qui faisaient oublier la chasse
Et le vacarme de l’égorgement.
Vide comme l’assiette,
Une paume était devant moi, relief charnu
Du dernier singe à qui tout était devenu accessible
Dans un monde de primates. Mantegna, peut-être,
Aurait pu les peindre dans toute leur cruauté, sans les enjoliver,
Ces callosités crasseuses.
Qu’était l’avenir
Résultant des lignes de la main, bonheur ou malheur,
Comparé à la terreur des pores par lesquels perlait la sueur
Comme la légende de la compréhension silencieuse sur un front.
Durs Grünbein, Presque un chant, traduction de l’allemand Jean-Yves
Massson et Fedora Wesseler, Gallimard, 2019, p. 90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : durs grünbein, presque un chant, mantegna, main, cadavre | ![]() Facebook |
Facebook |
05/12/2019
Robert Desnos, À la mystérieuse

À la faveur de la nuit
Se glisser dans ton ombre à la faveur de la nuit
Suivre tes pas, ton ombre à la fenêtre,
Cette ombre à la fenêtre, c’est toi, ce n’est pas une autre, c’est toi.
N’ouvre pas cette fenêtre derrière les rideaux de laquelle tu bouges.
Ferme les yeux.
Je voudrais les fermer avec mes lèvres.
Mais la fenêtre s’ouvre et le vent, le vent qui balance bizarrement la flamme et le drapeau entoure ma fuite de son manteau.
La fenêtre s’ouvre : ce n’est pas toi.
Je le savais bien.
Robert Desnos, À la mystérieuse, dans Domaine public, Gallimard, 1953, p. 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Desnos, Robert | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert desnos, À la mystérieuse, domaine public, déception | ![]() Facebook |
Facebook |
04/12/2019
Fernando Pessoa, Poèmes jamais assemblés d'Alberto Caeiro : recension
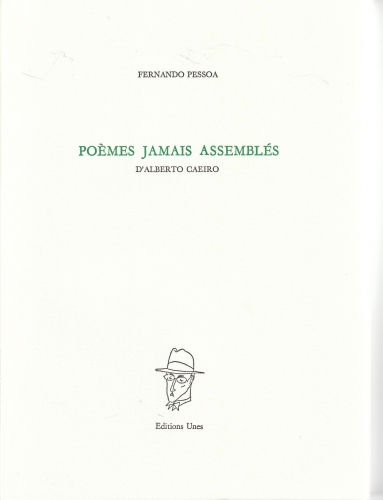
Alberto Caeiro n’est pas le premier, en septembre 1914, d’une longue liste d’hétéronymes de Pessoa, mais il est présenté comme le « Maître ». Ce personnage fictif, « blond clair yeux bleus », « peu instruit », serait né à Lisbonne en 1869, aurait vécu à la campagne, puis serait revenu dans la capitale du Portugal pour y mourir de la tuberculose (comme le père du poète) en 1915. Pessoa en fait l’auteur du Gardeur de troupeaux, d’un journal, Le Berger amoureux et, avant de mourir, des Poèmes jamais assemblés. Comme l’écrivait le "berger", ces derniers poèmes refusent les correspondances du symbolisme et ce qu’elles impliquent et prônent la nécessité de voir les choses telles qu’elles sont.
Il faut, d’abord, accepter ce qui est visible, c’est-à-dire la réalité devant soi, et donc ne pas « exiger du monde qu’il soit autre chose que le monde », monde qui n’a pas besoin de nous pour exister, qui est extérieur à nous, mais auquel nous appartenons comme toutes les choses. Cette acceptation évite des dépenses d’énergie inutiles : si la pluie est présente, ou le soleil, il ne sert à rien de les refuser, et les accueillir pour ce qu’ils sont agrémente la vie. Alors, tenter de changer le réel est contraire à la nature, il faut toujours « laisser vivre le monde extérieur et l’humanité naturelle ». Cette absence d’intervention vaut dans tous les domaines, y compris celui des sentiments amoureux, « Je n’ai pas été aimé pour une seule et bonne raison, / Parce que je n’ai pas été aimé ».
Il n’y a cependant pas à reprendre le point de vue de Cioran — ce serait un inconvénient d’être né ; être vivant permet au contraire d’apprécier le réel, d’ « écouter passer le vent », de regarder les choses et d’être heureux qu’elles soient ce qu’elles sont. Ce n’est pas parce que les choses du monde, fleurs ou arbres, sont "belles" qu’elles peuvent être appréciées, aimées, mais elles le sont plus simplement du fait qu’elles sont fleurs ou arbres. Aucune hiérarchie dans la nature, l’homme n’a pas à classer les éléments par rapport à lui, seulement à constater qu’il est différent de la pierre ou de l’arbre, et Caeiro insiste sur ce point : « Je ne sais pas ce qui est plus ou ce qui est moins » ; qu’il écrive des poèmes est un aspect de cette différence, rien de plus. Entre deux humains, c’est ce qui se passe entre leur naissance et leur mort qui les différencie : la manière dont chacun a saisi le réel est unique, non reproductible, et c’est cela qui forme l’identité de chacun.
La vie, en effet, ne peut être évaluée que d’après la capacité à voir le réel et non par l’accumulation de biens ou la reconnaissance publique, ni même par le fait d’être « en paix avec [sa] conscience ». Alberto Caeiro se définit lui-même comme regardant les choses, sans intervenir sur ce qu’elles sont ; ce qui n’est plus devant ses yeux n’existe plus Aussi est-il sans intérêt de déborder de l’instant présent, de penser ce qui est à venir puisque hors de notre connaissance ou de regretter le passé puisqu’il n’est plus modifiable. De là, « Préoccupons-nous seulement de l’endroit où nous sommes. » La conséquence est claire : vouloir changer les choses et « inventer la machine à bonheur », c’est aller contre la nature ; il est exclu alors de chercher à transformer la société, tout en sachant que la « souffrance sociale » existe, Caeiro la constatant écrit, « J’accepte l’injustice comme j’accepte qu’une pierre ne soit pas ronde ». Le choix est plus général et se formule ainsi, « Ce qui doit être est ce qui n’existe pas ».
Le contenu des poèmes de Caeiro, ici comme dans Le gardeur de troupeaux, s’oppose totalement aux idées de son temps sur la poésie, précisément au symbolisme. En effet, si rien n’existe en dehors de la « réalité immédiate », toute interprétation du monde est nulle, « Tout est défini, tout est limité, tout est choses ». On distingue donc les choses concrètes, que l’on peut voir et toucher, de ce qui est nommé mais n’appartient pas à l’ensemble des choses ; "printemps" est un mot pour désigner une "saison", « c’est une façon de parler », tout comme le vocabulaire de la renaissance du printemps. Le poète refuse du même coup toute personnification, l’eau n’est pas ma sœur, « si elle est eau, autant l’appeler eau » ; il rejette les correspondances entre les choses, la métaphore ou l’analogie, toutes les figures qui ne sont que trahison de la réalité. Une fois pour toutes, une chose « n’est rien d’autre que ce qu’elle est ».
Il faudrait relire ces Poèmes jamais assemblés avec le premier livre de Caeiro pour comprendre les objectifs de Pessoa, le rejet du symbolisme étant un aspect de sa poétique. Ce qui est clair, c’est que le primat de l’immédiat, du visible n’a pas grand-chose à voir, comme cela est parfois écrit, avec la phénoménologie dans ses versions nées après Husserl.
Fernando Pessoa, Poèmes jamais assemblés, traduction collective, éditions unes, 56 p., 16 € ; Cette note de lecture a été publié par Sitaudis le 30 octobre 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fernando pessoa, poèmes jamais assemblés d'alberto caeiro | ![]() Facebook |
Facebook |
03/12/2019
Pierre Reverdy, Cale sèche
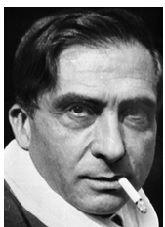
Tourbillon de la mémoire
Si tout ce qu’on n’attend pas allait venir
Si tout ce que l’on sait allait finir
Nouveau décor
Une porte s’ouvre lentement
Un homme entre avec une lampe qui le cache
C’est exactement le même
Avec une lampe à la main
Derrière on ne voit plus rien
Autour de la table c’est un triste jeu
Au milieu du monde on n’y voit pas mieux
Un point sur la tête de l’un de nous deux
Le mur s’étale
Et là-haut
Le vent fait fuir les étoiles
On cherche en vain un air nouveau
Celui qui a parlé le premier est trop loin
Et l’on ne fait pas autre chose que lui en ce moment
On tourne plus vite
La promenade est une fuite
Tout le monde suit
On a vraiment peur de la nuit
Quand toute la colonne s’abattra d’un coup
Tout le long de la route les feuilles trembleront
Peut-être à cause de la pluie
Pierre Reverdy, Cale sèche dans Œuvres complètes, II,
Flammarion, 2010, p. 398-399.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, cale sèche, tourbillon de la mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2019
Cioran, De l'inconvénient d'être né
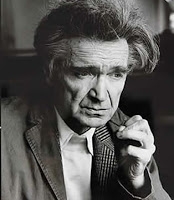
Nous n’avions rien à nous dire, et, tandis que je proférais des paroles oiseuses, je sentais que la terre coulait dans l’espace et que je dégringolais avec elle à une vitesse qui me donnait le tournis.
Se tuer parce qu’on est ce qu’on est, oui, mais non parce que l’humanité entière nous cracherait à la figure !
Vivre, c’est perdre du terrain.
Pour nos actes, pour notre vitalité tout simplement, la prétention à la lucidité est aussi funeste que la lucidité elle-même.
Cioran, De l'inconvénient d’être né, Idées/Gallimard, 1973, p. 112, 114, 115, 116.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, vide, vivre, lucidité, de l'inconvénient d’être né | ![]() Facebook |
Facebook |





