28/12/2019
Cédric Le Penven, Verger : recension
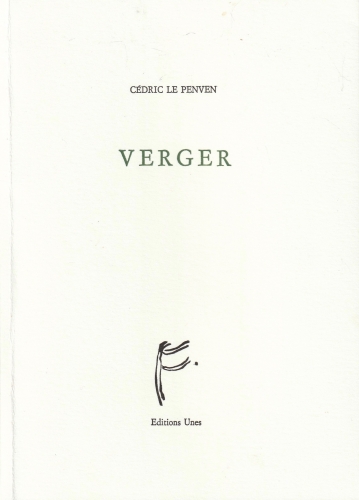
Le livre s’ouvre sur les gestes du narrateur, ouvrier à la fin de l’adolescence dans un champ de cerisiers : il ne les cueille pas pour les manger, pour les offrir mais pour que l’arboriculteur les vende ; le travail commence quand « le jour point à peine », demande soin une longue journée et, répétitif, donne le temps de penser quand on disparaît au milieu des branches, « à l’abri des regards ». Poèmes en prose autour de l’obligation pour l’étudiant de travailler pendant les vacances d’été pour « continuer d’aller à l’université » et n’avoir pas ensuite à reprendre la ferme des grands-parents. Les souvenirs d’enfance se mêlent à ce passé, moments où cueillir les fruits participait du jeu et non d’une nécessité ; est rappelé aussi que le grand-père est mort d’avoir utilisé des pesticides pour "protéger" les plantations. C’est là une première partie ; la seconde, qui occupe la plus grande partie du livre, est consacrée à la vie du narrateur dans son propre verger.
Le lecteur suit les travaux au cours d’une année dans un verger amoureusement construit et pourra être déconcerté par la précision du vocabulaire : monilia ou amandon, parmi d’autres, ne font pas partie des mots de la poésie qui a pour thème la nature, pas plus que l’évocation ou la description des travaux nécessaires, toute l’année, pour qu’un verger et un potager produisent fruits et légumes. Il ne s’agit certes pas pour Cédric Le Penven d’écrire un traité d’horticulture — on en est loin —, cependant la relation forte à la nature ne peut se dire avec des généralités et le vocabulaire d’un élève de l’école primaire, comme c’est souvent le cas ; sur ce point, on ne peut qu’approuver cette remarque du narrateur, « je n’ai jamais compris les poèmes qui accrochent une lune au coin des pages ».
On suit donc les mouvements de la nature, la lente transformation des déchets en humus, cette matière noire odorante, l’ouverture du noyau de pêcher qui aboutira à un scion à replanter ; on comprend quelle précision exige une greffe et qu’il faut apprendre à interpréter les signes de passage d’une saison à l’autre. On accepte de regarder l’arbre vivant comme un humain, « étonné d’être nu », les feuilles « affolées » sous le vent qui « hésitent » à tomber, tant le lien du narrateur à son milieu est vivant. L’écriture en laisses rythmées donne à l’ensemble son harmonie et favorise le passage du jardin à la littérature ; dans les « cicatrices boursouflées » de l’écorce se devinent des fragments de vers, d’Apollinaire ou de Baudelaire. Elle facilite également le mouvement du narrateur entre le verger et la vie personnelle, la vie sociale.
La minutie des gestes à accomplir dans le terrain, le soin des arbres ou des plantes potagères occupent entièrement l’esprit et, jusqu’à un certain point, écartent des questions qui devront être résolues, font oublier un temps des blessures anciennes non refermées. Le narrateur n’est pas dupe, le travail du verger terminé, il constate : « je suis nu dans le jour » et, dans un dialogue avec lui-même explicite l’effet d’une souffrance morale : « cette douleur qui fait parler des heures entières entre des livres, dès que tu te retrouves seul ». Le lecteur ne saura rien à propos de l’inquiétude qui le pousse à se lever à cinq heures du matin pour chercher un apaisement dans le verger. Sans doute y a-t-il ces « mots d’amour qui s’amoncellent au travers de la gorge » et qui ne sont pas prononcés, des « rancœurs inavouées » et, par ailleurs, le peu d’enthousiasme à rejoindre chaque matin le lycée, l’obligation de se construire une apparence pour l’extérieur, mais l’essentiel n’est peut-être pas là, plutôt dans « une histoire d’enfant meurtri » qui n’a pu être dite.
Que le lecteur n’apprenne rien de précis importe peu ; ce qui séduit dans Verger, c’est ce qui est écrit du va-et-vient entre les gestes au milieu des arbres et la vie sociale, le dehors et le dedans, du mouvement entre l’étrangeté de la beauté des choses et la difficulté de vivre le passé comme le présent — ce que résument les derniers mots de Verger, un vers emprunté à "Rhénane d’automne" d’Apollinaire, « l’automne est plein de mains coupées ».
Cédric Le Penven, Verger, éditions Unes, 2019, 80 p., 16 €. Cette note de elcture a été publiée sur Sitaudis le 2 décembre 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric le penven, verger, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2019
Cédric Le Penven, Verger
ce matin d’octobre, je cherche entre mes arbres la suite d’une phrase commencée pendant la nuit
elle m’arrache à la terre que je foule, transforme le paysage en simple décor, les arbres en silhouettes grisâtres. Il s’agissait d’une histoire d’enfant meurtri qui parvenait à prononcer distinctement son nom, au cœur même d’une salve de coups, et l’arrêtait net
je pose la paume contre le tronc froid et humide du cerisier. J’exerce une faible pression pour que les gouttes de rosée restent suspendues au bouton dont elles ne connaîtront jamais les fleurs
si le temps reste trop à la brume, la pellicule d’eau qui couvre les écorces favorise les maladies. La monilia est un miel détestable qui commence à perler dans la moindre ride de l’écorce, et contamine le rameau, puis la branche, puis la charpentière, et l’arbre entier suffoque
la maladie ne doit pas être prise à la racine, mais à la pointe de la branche, dont il faut se départir, en espérant que le coup de sécateur n’accélère pas sa propagation
Cédric Le Penven, Verger, éditions Unes, 2019, p. 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric le penven, verger, arbres, brume, maladie | ![]() Facebook |
Facebook |
26/02/2014
Paul de Roux, Entrevoir , préface de Guy Goffette
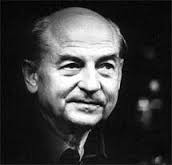
Verger abandonné
La mousse du vieux poirier
patiente et douce murmure :
« Ne bougez pas »
et la solidité du bois
du bon vieux tronc
est douceur aussi
et sûr appui.
Stèle pour un corbeau
Lui aussi menait sa vie, ce corbeau
dont je n'ai vu que le cadavre efflanqué
les plumes noires collées à la terre gluante
sous la frondaison des châtaigniers en fleurs
— c'était en mai. Ce matin de septembre
parmi les premières bogues chues
je ne retrouve pas une plume.
Mais tandis que je bats les feuilles mortes, soudain
dans le bois de la Montagne de Reims
un croassement s'élève, comme en écho
à ma rêverie mélancolique.
Paul de Roux, Entrevoir suivi de Le front contre la vitre et de La halte obscure, préface de Guy Goffette, Poésie / Gallimard, 2014, p. 98, 105.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, entrevoir, guy goffette, verger, corbeau, mélancolie, rêverie | ![]() Facebook |
Facebook |






