29/01/2022
Hélène Sanguinetti, Et voici la chanson : recension
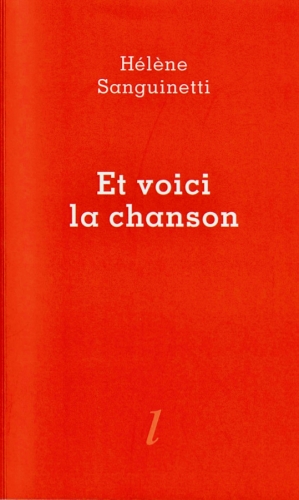
Le livre avait été publié par les éditions de l’Amandier en 2012 et c’est une excellente idée de le rééditer pour de nouveaux lecteurs. Ils commenceront peut-être par lire la quatrième de couverture qui les éclairera sur deux des personnages principaux du livre : « Joug et Joui sont le jour et la nuit, la lune et le soleil, l’eau et la soif, Éros et Thanatos, mais aussi bien le Méchant et le Gentil des contes, le malheur et le bonheur, malchance et chance, douleur et plaisir, tantôt lui, tantôt elle, tout le monde, personne. » On trouvera d’autres personnages au fil de la lecture, notons que ceux-là renvoient à une image du monde bien ancrée dans la tradition : voisinent le meilleur et le pire.
Les aspects négatifs apparaissent tôt, avec le premier des deux ensembles titrés "Voici la chanson". La chanson rappelle des moments tragiques de la Seconde Guerre mondiale avec l’évocation d’un des camps d’extermination nazis :
C’était le grand camp de l’Allemagne du Nord.
Camp maudit camp méconnu.
Il baigne dans un marais.
Il baigne dans un marais ce sont les premiers jours de mars.
Camp méconnu NEUENGAMME.
Quand la défaite allemande ne faisait plus de doute, les déportés qui avaient survécu furent embarqués sur des bateaux, qui furent bombardés par les Alliés, et « ont péri ont péri ont péri 7500 déportés ». Seul un autre fait historique est rapporté précisément, consacré alors à une seule personne, Wyllie White (1930-2007) ; cette afro-américaine passa une partie de son enfance à travailler dans les champs de coton et devint une athlète qui participa cinq fois aux Jeux Olympiques. Le lecteur la voit sur son lit d’hôpital, morte, par les yeux d’un laveur de carreaux — « il aime le jour là-haut » et le récit est isolé dans la page dans un rectangle, mis ainsi en valeur.
« Tous les temps roses et noirs s’égrènent » et un des embryons de récit juxtapose le noir et le rose : « Guerre Est Horrible / J’ai 28 ans 3 enfants 1 femme / (bouche de fraise) je descends déchiqueté / des baisers sous la mer / il en reste ». On ne lira pas d’autres épisodes liés à des événements de l’Histoire, mais un grand nombre d’allusions plus ou moins directes à des contes, à des romans, à des mythologies, etc. Ainsi, le lecteur reconnaîtra dans le nom de "Boulbas" associé aux steppes le roman de Gogol, Tarass Boulba, mais les jeux avec les noms et avec les amorces de contes sont si divers qu’il faut sans doute relire Et voici la chanson pour ne pas s’égarer. Quand on lit « écarter les branches — / (les ronces les rosiers / s’ouvriront merveilleusement / au passage du prince) », on pense à La Belle au bois dormant, de Perrault ou Grimm. Au gré de la lecture, on relève « elle a des pantoufles de verre ou de vair ? », « un verger sans pommier », « l’eurydice et l’orphée qui dansent à reculons (...)/ Aboiements lointains / une forge », « "Ce soir, amenez-lui une Pucelle du Village" », « il n’est pas de botte qui aille loin », également des esquisses avec Ysengrin, avec le loup et l’agneau. Ici, « Automne vivant et adoré » rappelle « Automne malade et adoré » d’Alcools, etc. ; là, il est fait mention d’une Marie Thérèse Paule Roland née à Carpentras en 1758 : il y a eu une femme née en 1767 dans cette ville, avec ces prénoms et ce nom, mais écrit Rolland, nom qui entraîne "Roncevaux", puis « roncevelle chanson d’étape ».
On lit avec « flamenco/flamenca », puis « bimbo/bimba », une allusion au couple Pamino et Pamina de La Flûte enchantée de Mozart et, au fil des pages, quantité d’autres récits peuvent surgir, « c’était le récit d’autre / chose sur un / journal » ; Et voici la chanson est à sa manière un "chaudron" à histoires dont le lecteur a les amorces :
Les histoires descendent (...)
peuple s’installe
en tailleur, stop ! ça commence !
Qu’est-ce qui fut raconté
ce jour-là cette nuit-là
dans ce pays-là
homme à la flûte ?
Il s’agit sans doute de "L’homme à la flûte de Hamelin", dont la légende a été transcrite par Grimm. Tous les récits peuvent être racontés, l’histoire de la déesse cobra égyptienne Ouadjet comme celle de la danseuse et de son fiancé chocolatier ; chaque nom de personnage porte une vie qui vaut d’être racontée, celle de Jeanne (« elle eut ce nom, combien d’autres »), d’un cavalier, d’un prisonnier, de Frankie, qui veut devenir pianiste, de Stefania, de Louis, de Medea, d’un « petite morveux » et Audrey, de Jacqueline, de Paolo, de Gilberte, du chien Vlan...Tous les récits peuvent être créés et si l’on se demande « Qui parle vraiment à la fin ? », on répondra peut-être « tantôt lui, tantôt elle, tout le monde, personne » comme on l’a déjà noté. Une bonne partie des récits possibles seraient à compléter, et même à inventer, par le lecteur, et sont donc parfois obscurs (« Qui est "elle" ? »). Le narrateur non seulement revendique la possibilité de l’obscurité mais en rajoute, « Combien de fois on entendit cela ne veut / rien dire et tiens ! il prend sa bouche la / suspend au clou du tablier, ne veut rien dire, quoi ! ».
Et voici la chanson est un peu comme une scène où les embryons de récits, les noms se rencontrent, disparaissent, reviennent — des fragments sont repris tels quels ou avec de légères variantes —, le tout dans un désordre apparent. Les critères de la lisibilité sont constamment, et avec jubilation ! mis en cause. On ne peut compter les jeux de mots, voici l’un des derniers du livre, « Chantez chantez héros hérons lapons de Laponie / la peau (...) ». L’utilisation de caractères de dimensions variées, le jeu entre romain et italique perturbent la lecture, comme l’introduction de mots italiens (« Pezzi di pane, bouts de pain / ucello che beve à petits coups de bec ») et espagnols (Se acabo), l’usage de néologismes (« Ça gogole écarlate, ça pouiffe », etc.) et d’onomatopées classiques (boum boum, hop hop), transformées (vroom, vrooommmm) ou nouvelles (ppffffuuuuuufffffff, yahhhhhhhhh). Certains passages sont écrits comme une page de dictée, en décalage avec l’ensemble du texte qui s’écarte de diverses façons des règles classiques de la syntaxe et de la ponctuation. Des symboles de cartes à jouer (par l’image de l’as), du masculin et du féminin, des dessins, des flèches (¬ ® ¯) contribuent à faire du livre une scène à changements multiples.
Le livre s’ouvre et se ferme avec le même huitain qui débute par « la parole se cassa ». Le poème est précédé d’un signe, qui ressemble à une grande virgule, et suivi de deux signes analogues de dimensions différentes* ; la place de ces signes est inversée à la fin du livre comme si l’on retournait à son début — la chanson ne peut s’interrompre, ce que pourrait confirmer la fin du huitain, « Chanson va ! roule et se / Cassant se réveilla ». La représentation, polyphonique, n’a donc pas de raison de s’arrêter, et d’autant moins de raison qu’est promis au lecteur le plaisir, « Dessus dessous joïr viendra ». Voici une lecture jubilatoire !
Hélène Sanguinetti, Et voici la chanson, éditions Lurlure, 2021, 112 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 11 janvier 2022.
———————————————————————————————————
*Notons que ces signes sont présents dans le texte (p. 65), cette fois ensemble.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hélène sanguinetti, et voicci la chanson, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
17/01/2022
Pierre Vinclair, Portrait de John Ashbery, Une cérémonie improvisée : recension
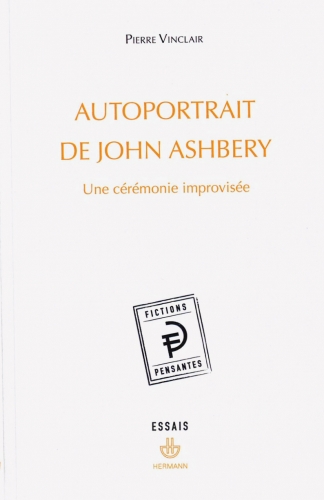
Le livre de Pierre Vinclair appartient à un ensemble qui se veut un « travail critique d’explication "avec" quelques grandes œuvres du modernisme, qui s’appuie sur une tentative d’explication "de" » ; il a été précédé en 2018 d’une lecture de The Waste Land de T. S. Eliot, accompagnée de sa traduction (Terre inculte). C’est le caractère énigmatique de l’Autoportrait dans un miroir convexe*, long poème (552 vers) éponyme du recueil de John Asbery, qui a retenu Pierre Vinclair. Il ne s’agit pas pour le critique de lire le poème comme un jeu inconnu dont il faudrait mettre au jour les règles et classer des éléments dont la liste existe déjà ailleurs ; la tâche, plus ambitieuse, vise à changer l’activité qu’est la lecture en donnant au lecteur « l’ensemble des éléments qui permettent de faire l’expérience optimale d’un texte » ; la création est conçue comme une expérience construite par tâtonnements et qui ne peut être reproduite ; il y a ce que Pierre Vinclair nomme un "effort" du texte, un travail de la forme, une fabrication qui aboutit à restituer le mieux possible quelque chose de la vie et propre à agir sur son lecteur.
C’est à un type d’approche qui laissera de côté la poétique traditionnelle qu’est invité le lecteur pour aborder l’Autoportrait de John Ashbery. En restituer le détail ici n'est ni possible ni utile, il est plus intéressant de comprendre la méthode suivie. Pierre Vinclair commence par le premier poème du recueil pour avancer quelques questions et suggérer des moyens pour ne pas s’arrêter de lire devant l’obscurité d’un poème. Chacun, par exemple, en constatant le peu de rapport entre le titre et les premiers vers, peut soupçonner que le titre a été emprunté et retrouver son origine grâce à internet. La suite de la recherche, passionnante, suppose une somme de connaissances utilisables et quand l’auteur écrit qu’il avance « naïvement » dans le poème d’Ashbery, comprenons que sont exclus les classements qui ont le plus souvent cours pour lire poèmes ou proses.
Reprenons les opérations qu’il suggère pour entrer dans un poème "obscur". On essaie d’abord de décrire les régularités, les collages, etc., puis de résumer, ensuite de comparerl’ensemble des vers à un autre texte : Pierre Vinclair retient un passage de l’Ulysse de Joyce et sa lecture par Nabokov, pour conclure à une différence capitale : Ashbery est hors de tout travail rhétorique, contrairement à Joyce. On constate les exigences de cet exercice critique, ce qu’il implique de recherches ; quand après avoir examiné sans succès le mode d’emploi interne, on passe au mode d’emploi externe, qui s’appuie sur un portrait d’Ashbery publié dans le New Yorker. La démarche est efficace, le lecteur sait maintenant qu’il n’a pas à chercher une interprétation, qu’il doit accepter ce qui lui apparaît étrange — et continuer sa lecture. Avant d’entamer la lecture de l’Autoportrait lui-même, quelques réflexions autour de l’idée de puzzle. Il s’agit de ne pas se limiter au seul poème mais de le lire comme pièce d’un ensemble, le livre ; cependant le puzzle renvoie à une image spatiale et à la possibilité d’une lecture qui peut être complète une fois les pièces assemblées, alors que, selon Ashbery, le livre devrait être lu comme une pièce musicale, le poème comme fragment d’un flux, donc dans le temps. C’est armé de ces préalables qu’est lu l’Autoportrait.
Pierre Vinclair lit le poème section par section, plus en détail la seconde (51 vers) qui est la plus brève des six. L’objectif est de rendre compte de la manière dont Ashbery brouille la lecture grâce aux ambiguïtés lexicales et syntaxiques et contraint à abandonner l’idée qu’il y aurait à chercher la (les) signification(s) du poème. Cela entraîne, sans aucun doute, une déception du lecteur qui construit difficilement, ou pas du tout, "quelque chose" de cohérent, et cette déception possible arrête l’auteur : « Je vous entends grommeler, chère lectrice, cher lecteur : Ashbery veut-il vraiment dire quelque chose à la fin ? ». Ce qui importe, c’est dénoncer des hypothèses et rechercher la signification ne devrait être qu’un prétexte. Pierre Vinclair compare cette démarche — cela paraîtra-t-il inattendu ? — à celle de l’amour ; il faudrait « penser avec son esprit en face d’un poème comme on pense avec ses doigts quand on caresse [etc.]. », soit se laisser aller en acceptant le mouvement du poème. Un point essentiel soutient la démarche, c’est ce que fait le poème au lecteur, non ce qu’a voulu faire le poète.
Ce que l’on retient de cette approche du poème d’Ashbery, c’est qu’elle ouvre d’autres voies à la lecture d’autres textes qui, chacun à leur manière, apparaissent d’accès difficile — s’ils sont immédiatement lisibles, le lecteur les abandonne comme il le fait d’un journal. On peut retenir une phrase qui résume ce que peut être la relation entre un poème et sa réception : « Ce que le poème offre à son lecteur (...) c’est (...) un rite aux gestes d’une fragilité extrême, se présentant sous la forme d’un millefeuille de vers aux relations ambigües, toujours en jeu. » Aucune lecture, en effet, ne peut être achevée et c’est pourquoi Racine est toujours notre contemporain.
La clarté de l’exposé de Pierre Vinclair, son souci d’être suivi dans sa démarche doivent inciter le lecteur à reprendre des éléments théoriques qui fondent sa lecture critique ; on lira avec profit Vie du poème (2020) et deux articles récents, "Penser l’effort des textes. Et déraciner les études littéraires avec Platon" (Le Philosophoire, printemps 2021) et "La radicale intéressante" (Lignes, octobre 2021). Pierre Vinclair, Portrait de John Ashbery, Une cérémonie improvisée, Hermann, 2021, 132 p., 22 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 13 décembre 2021.
* John Ashbery, Self-Portrait in a Convex Mirror (1975), aujourd’hui en français : Autoportrait dans un miroir convexe, Joca Seria, 2020. Le poème portant ce titre est traduit par Pierre Alferi, les autres poèmes par Olivier Brossard et Marc Chénetier qui a également écrit une postface
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, portrait de john ashbery, une cérémonie improvisée | ![]() Facebook |
Facebook |
29/12/2021
André Breton, Jean Paulhan, Correspondance
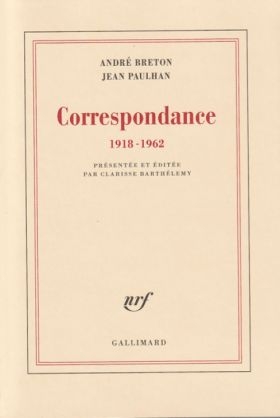
La correspondance entre André Breton et Jean Paulhan, remarquable par sa durée, introduit le lecteur à des aspects mal connus des relations des surréalistes avec l’institution littéraire représentée par la Nouvelle Revue Française et permet de comprendre, malgré l’absence d’un grand nombre de ses lettres, combien les liens d’amitié avec Paulhan ont été essentiels pour Breton. En outre, on retrouve à diverses occasions le polémiste vigoureux qui a dirigé le mouvement surréaliste. Les premières années de la correspondance, les lacunes empêchent de suivre les réactions de Paulhan aux propos de Breton, c’est pourquoi l’éditrice, Claire Barthélémy, reconstruit précisément le contexte des échanges et rappelle le parcours des deux écrivains et, pour Breton, la mise en œuvre de la revue Littérature, ses relations avec Jacques Rivière qui dirigeait la NRF. Les notes nécessaires pour éclairer le contexte sont précieuses ; le sont aussi les fac-similés de lettres dans le volume et les annexes (textes de Breton, de Paulhan et de Jouhandeau liés à la correspondance), et l’on n'oublie pas les très utiles appendices (index des noms, des titres, table des illustrations).
La première lettre publiée de Breton (18 juin 1918) répond à une offre d’amitié de Paulhan, offre recopiée et envoyée à Aragon. Breton souhaite se lier avec son aîné (douze années les séparent) et l’exprime nettement ; « Vous ne savez pas encore le prix que j’attache à ce qui me vient de vous », écrit-il et, un peu plus tard, en juillet, « Vous êtes précisément l’ami que j’attendais à cette époque de ma vie ». Il considère alors que Paulhan, à qui il a dédié son premier texte publié, peut dans leurs échanges apporter des réponses à des questions littéraires qu’il se pose ; lecteur attentif de Valéry (dont il recopie des poèmes dans ses lettres), il admet les lacunes de sa lecture : « Vous tenez le sens total du poème quand je fais encore, moi, le jeu des mots ». Le premier numéro de la revue Littérature, qu’il dirige avec Aragon et Philippe Soupault, ouvre son sommaire avec un texte de Gide ("Les Nouvelles nourritures") et un poème de Valéry ("Cantique des colonnes"), mais aussi avec "La Guérison sévère" de Paulhan qui publiera dans trois numéros en 1920 "Si les mots sont des signes ou Jacob Cow le pirate". Cette étude rencontre des préoccupations de Breton, « ces pages sur les mots me sollicitent en tous sens », écrit-il à Paulhan.
De son côté, Paulhan, ce que relève Clarisse Barthélémy, « dans cette ardeur vitale, initiatique, radicale qui caractérise Breton, (...) retrouve son goût de la liberté et une forme de pureté, — ainsi, sans doute, que ses premières convictions anarchistes ». Ils avancent tous deux avec des questions analogues concernant l’expression ; cependant, la transformation progressive de la revue, qui devient le 1erdécembre 1924 La Révolution surréaliste éloigne Paulhan du surréalisme. Le projet lui-même, énoncé dans le premier numéro, ne pouvait lui convenir : « Le procès de la connaissance n'étant plus à faire, l’intelligence n’entrant plus en ligne de compte, le rêve seul laisse à l’homme tous ses droits à la liberté ».
Jacques Rivière, qui dirigeait la Nouvelle Revue Française, meurt en février 1925 et Paulhan, qui assurait le secrétariat depuis 1920, prend sa place. Les divergences entre la revue, Paulhan et les surréalistes, tant pour les choix esthétiques que politiques, s’accroissent jusqu’à la rupture, consommée par une brève lettre de Breton le 4 mars 1926, « J’ai l’honneur de vous informer que je vous tiens pour un con et un lâche » ; l’intéressé répond sur le même ton par pneu, « Il y a longtemps que vous m’emmerdez. Vous auriez dû comprendre plus tôt que je vous tiens pour aussi lâche que fourbe ». Un an plus tard, l’adhésion du surréalisme au Parti communiste, justifiée dans un tract, Au grand jour, entraîne dans la NRF une réponse d’Antonin Artaud, À la grande nuit, et un commentaire de Paulhan, sous le pseudonyme de Jean Guérin. Breton réagit par une lettre ordurière, Paulhan lui envoie ses témoins mais il refuse le duel. La rupture durera jusqu’en 1935.
L’éditrice trace à grands traits l’histoire du surréalisme pendant les années 1930. C’est la séparation d’avec le Parti communiste, dont Breton explique les raisons en 1935 dans la préface de Position politique du surréalisme, qui permet à nouveau le dialogue avec Paulhan ; il accuse notamment le pouvoir soviétique d’avoir trahi les espoirs de la révolution de 1917. Les échanges épistolaires reprennent mais, surtout, Paulhan publie Breton dans la NRF et dans Mesures, la revue amie d’Henry Church, puis prend L’Amour fou dans sa collection "Métamorphoses". Le silence reprend avec l’exil de Breton aux États-Unis à partir de 1941. Il revient en France en juillet 1946, sans pourtant rencontrer Paulhan ; ils ne se verront qu’au cours de leur engagement, pour un temps, dans l’organisation pacifiste "Citoyens du monde" initiée par Robert Sarrazac, qui fera connaître à Breton le village de Saint-Cirq-Lapopie où le poète s’installera. Ils se retrouvent pleinement sur des questions de critique littéraire, en 1949, avec la publication le 19 mai d’un faux de Rimbaud, La Chasse spirituelle, avec une préface de Pascal Pia ; le faux est défendu par une partie de la critique, par exemple avec force par Maurice Nadeau. Dès le 21 mai, Breton dénonce dans une lettre au journal Combat le « caractère particulièrement méprisable » du pastiche — la lettre n’est publiée que le 26 ; il publie la même année sur cette affaire Flagrant délit, Rimbaud devant la conjuration de l’imposture et du trucage, salué par Paulhan, « c’est une grande joie de l’esprit et du cœur que donne Flagrant délit ». Une autre affaire les rapprochera en 1960, celle de l’élection du "Prince des poètes" pour succéder à Paul Fort ; malgré ses efforts Breton, qui déteste Cocteau, n’empêchera pas qu’il soit choisi. Il semble que les échanges cessent dans le courant de l’année 1962 — Breton meurt en décembre 1966, Paulhan en octobre 1968 —, sans que l’on en connaisse vraiment la raison.
L’un et l’autre, intransigeants dans leurs choix intellectuels, se sont reconnus et rencontrés sur des questions littéraires essentielles pour eux. Breton a souvent regretté de trop peu rencontrer Paulhan et il lui écrivait en 1959, « Je mourrai sans avoir compris pourquoi vous et moi nous ne serons vus, pourtant parfois de si près, que par intermittences mais seul le sentiment de chance demeurera ». Dans le numéro de la NRF en hommage à Breton, Paulhan concluait son article par ces mots « il n’est pas toujours possible à un homme de dire ce qu’il sait. Breton est mort. Tout est à recommencer ». On lit souvent dans cette correspondance de précieux témoignages d’une vraie amitié.
Correspondance André Breton-Jean Paulhan, 1918-1962, présentée et éditée par Clarisse Barthélémy, Gallimard, 2021, 268 p., 22 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 2 décembre 2021.
Publié dans Breton, André, Paulhan Jean, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : a 13breton, jean paulhan, correspondance | ![]() Facebook |
Facebook |
23/12/2021
Christian Viguié, Fusain : recension
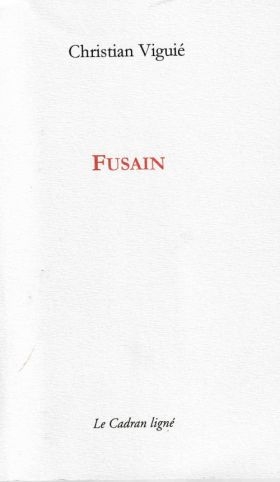
Christian Viguié a reçu début novembre le prix Mallarmé 2021 pour un livre de poèmes, Damages, publié en 2020 aux éditions Rougerie comme la majorité de ses livres ; ce prix récompense une œuvre qui s’est développée à partir de 1996, aujourd’hui riche d’une trentaine de titres. Damages, comme l’écrit son auteur, est « un chant de deuil, un presque murmure, la ligne brisée d’un horizon. » Fusain est très différent dans son propos ; le mot évoque une esquisse, un dessin qui doit être fixé par un vernis, ici il s’agit de très brefs poèmes, en majorité de trois vers, qui jouent souvent avec le sens des mots, interrogent leur rapport avec ce qu’ils désignent. C’est ce questionnement qui donne leur unité aux quatre parties du livre.
Le premier poème de "Possible indéfiniment" apporte une idée de l’ensemble : « À cause d’un parfum / le temps va recommencer ». L’énoncé perd son caractère étrange si l’on introduit un contexte pour que la relation causale devienne acceptable, comme : « au réveil, un parfum dans la chambre, etc. » Mais cette réduction, qui implique un préalable — « ça ne veut rien dire » — n’est pas nécessaire, le lecteur peut simplement accepter l’incompatibilité entre la cause et le résultat, et par la suite apprécier des rapprochements pour leur apparente incongruité ; ainsi à nouveau avec la présence d’un parfum, « Des milliers d’étoiles / tiennent à cause / d’un parfum. »
On se souvient des transformations qu’opérait Théophile de Viau dans ses visions d’un monde renversé (« Un ruisseau remonte vers sa source », etc.). Viguié, s’adressant à son lecteur, lui demande « As-tu vu un étang / se refléter dans l’arbre ? », ce qui n’est pas exclu quand telle photographie utilise l’illusion optique, mais hors de propos pour le poème. De nombreux poèmes impliquent cette hésitation devant la réalité ; si une observation simple établit une relation entre l’eau et la libellule, l’introduction d’un verbe qui rend vivante l’eau modifie cette relation et l’énoncé, sans du tout devenir incompréhensible, présente autrement la réalité : « La fontaine réclame / ses ailes de libellule. »
Les poèmes sont toujours lisibles sans le recours à une explication ; pour l’un d’eux, « Le vent / autour d’un puits /s’étonne qu’aucune parole / n’en sorte », on est tenté de penser à un énoncé sous-jacent, représenté précisément par le tableau de Jean-Léon Gérôme, dont le titre est l’amorce d’un récit, "La vérité sortant du puits avec son martinet pour châtier l’humanité", tableau qui, en 1896, semblait un manifeste contre ceux d’un Manet. La surprise du lecteur peut aussi naître d’un oxymore aussitôt annulé (« Pas plus étonné / que la neige chaude / d’un pêcher ») ou, plus classiquement, d’une analogie entre la couleur du soleil couchant et un fruit.
Dans la partie consacrée au brouillard, la nature de ce phénomène météorologique entraîne régulièrement les énoncés vers le fantastique, quand Viguié suggère, par exemple, que le brouillard cache le vrai brouillard ou qu’il ne dissimule pas tant les choses que leurs noms. De là le changement dans la manière de regarder, comme si le brouillard faisait gagner une certaine innocence, ou ignorance : « Le brouillard t’apprend / à regarder / comme un enfant / qui enlève tous les mots au paysage. » La partielle dissimulation par le brouillard des choses du monde est perçue comme un retour à un état antérieur, où les arbres, les chemins, etc., n’étaient pas entièrement formés et redevenaient « brouillons ». D’autres poèmes tournent autour de ce point, les choses existent indépendamment du fait qu’elles ont été nommées, et avant qu’elles l’aient été ; « Le brouillard / en avance sur le mot » « appelle » les choses « avec du silence ».
Le silence, « parmi les choses », constitue la « matière de la matière » ; on retrouve l’idée d’un monde où les langues n’étaient pas encore là pour nommer les choses, où les choses elles-mêmes n’étaient pas : avant ciel, arbres, oiseaux, « avant tout » « démarre l’opéra fabuleux du silence ». La parole ne serait pleine qu’appuyée sur le temps du silence, comme semble le conclure le dernier poème de cet ensemble, « Se taire / ou parler / pour moi / sont une seule et même chose. » Viguié demandait « Existe-t-il une marée du silence ? », c’est une évidence si l’on pense à l’ombre, « Plus vieille marée du monde ». Elle est partout et peut-être y a-t-il « une ombre de l’ombre ». La fonction fantastique de l’ombre, classique, est présente, elle qui transforme les figures qu’elle projette sur les murs ou qui soude les pas des passants « comme s’ils n’allaient nulle part ». On lira encore des poèmes avec des éléments incompatibles (l’ombre du cri du coq) ou un jeu entre le complément d’un nom, fonction grammaticale, et le sens de complément pour "ce qui s’ajoute à une chose donnée" : on passe de « l’ombre du cerisier » à « le cerisier de l’ombre » « pour ne pas oublier / que je [= l’ombre] suis d’abord / le complément d’un nom ».
Les poèmes de Fusain présentent des figures neuves dans un monde où les relations entre humains et choses sont modifiées. Ce sont les éléments de la nature qui dominent dans les énoncés (ciel, eau, arbres, fleurs, pierre, etc.), toujours vivants ; il n’y a cependant pas d’anthropomorphisme mais un humanisme orienté vers le non -humain et qui accepte le mystère des choses, mystère représenté par les arbres dessinés au fusain en frontispice.
Christian Viguié, Fusain, frontispice de Cécile A. Holdban, Le cadran ligné, 2021, 64 p., 14 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 14 novembre 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian viguié, fusain : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
19/12/2021
Alexander Dickow, Déblais : recension

Aujourd’hui comme hier les écrits à propos de la poétique prennent diverses formes ; à côté d’essais véritables manifestes (Pierre Vinclair, Agir non agir) ou défense argumentée de choix d’écriture (Jacques Réda, Entretiens avec Monsieur Texte), d’essais qui débordent le domaine littéraire (Philippe Beck, Traité des sirènes), de recensions pour exposer sa propre pratique (Laurent Albarracin, dans Catastrophes et Poezibao), se maintiennent bien vivants des ensembles de notes à la manière de Reverdy ou de Jean-Luc Sarré, et c’est le choix qu’a fait Alexander Dickow, poète, romancier et essayiste. Les déblais, c’est ce que l’on ôte pour faciliter le travail, pour voir plus clair sur le chantier, ce qu’explicite la quatrième de couverture du livre, sans se dissimuler que, dans ce genre d’écrits, on « échoue nécessairement » et l’on se satisfait si l’on peut trouver quelques « splendides faux-fuyants » : le livre, composé de « fragments », d’« aphorismes », « chacun ouvert puisque sériel », vise à énoncer des « choses vraies ».
Pas de synthèse, donc, et dès l’ouverture Dickow manifeste sa méfiance vis-à-vis de la théorisation ; c’est laisser l’œuvre pour la « prose réflexive », or aucune thèse ne rend compte de la pratique. De plus, « le fragment aspire à parler de tout » et c’est sans doute pourquoi certains s’éloignent de la réflexion autour de la poésie ou du roman, ou la resituent dans une réflexion plus générale, l’écriture faisant partie de la vie – deux exemples de ce choix de l’hétérogénéité : « Pas d’amour sans ambivalence : l’amour nous coûte », « Le mythe de Pygmalion explique comment Galatée a elle aussi façonné Pygmalion ». C’est pourquoi aussi Dickow joue avec le genre en proposant des alexandrins rimés dans le style fin XIXesiècle ou un pastiche (« Obèle broche antique épingle des beaux vers/Douteux comme tes yeux étoilés d’univers »), aussitôt commenté avec une adresse au lecteur, « Ce pastiche d’un air/Digne d’Apollinaire/Te tape sur les nerfs/Je te dis na na naire ». Cette mise à distance semble encore s’affirmer quand un fragment renseigne seulement sur un choix musical de l’auteur (« Émouvoir comme la onzième Étude de Scriabine (op. 8 n° 11). Culbuter les attentes comme les dégringolades de la deuxième »), mais ce renvoi à une œuvre complexe, non littéraire, s’accorde avec un autre choix, le refus de la spontanéité, d’un prétendu « naturel ».
Si l’on accepte avec Dickow que le propos théorique soit toujours à côté de l’œuvre, on comprend qu’il écrive « J’essaie d’être ailleurs ». Il vise à briser les habitudes, se préoccupant plus des « fissures » que des surfaces et, ce faisant, se situe hors de certains choix contemporains qui prétendent « dépasser le cloisonnement des genres littéraires » ; il déplore avec ironie cette « erreur de marketing » en assurant que « les lecteurs aiment savoir quel genre de produit ils consomment ». C’est là mettre à l’écart tout un pan de la poésie d’aujourd’hui, mais Dickow ne craint pas la polémique, dénonçant notamment l’abus de « l’espace blanc » : pour lui, « ce sont les mots mêmes, à la rigueur, qui doivent atteindre à l’effacement ». De même, l’absence de ponctuation, si courante dans la poésie et la prose contemporaines ne fait le plus souvent que dissimuler une syntaxe convenue, tout comme les coupes au milieu d’un mot en fin de vers gêne la lecture sans qu’il y ait de véritable perturbation. Il énonce clairement ses choix quand il conseille de relire attentivement Paulhan et renvoie à Hopkins, Fondane et Beckett, mais aussi quand il se méfie des fleurs et des oiseaux, qui conduisent tout droit à Christian Bobin, et qu’il rappelle que Bonnefoy est comparé à Leconte de Lisle et Jaccottet à Lamartine.
Certes, il faut tenter de restituer quelque chose du réel en en mesurant toutes les difficultés, en sachant d’entrée que « Nulle valeur n’est plus fausse en art que l’authenticité », que rien n’est « naturel » en poésie pas plus que dans toute écriture, dans la « pleurnicherie romantique » comme dans la poésie blanche. Dickow défend d’ailleurs la présence du narratif en poésie, qu’il définit comme « un tissu de lacunes mouvantes », « jeu du vide et du plein » – dans un aphorisme, « Narrer : tisser des trous ensemble » –, par quoi le narratif rejoint « à la fois la poésie et le réel ». Il s’agit toujours dans ce jeu de déborder toutes les limites, celles de l’imagination comme celles du sens, de tenter chaque fois de « rendre le tremblé de la perception » pour « faire perdre l’équilibre » au lecteur avec l’auteur. Cet auteur a d’ailleurs un statut particulier : quand il écrit un de ses poèmes en anglais et en français, il en donne deux versions et non pas une traduction, ce qui donne « à voir le désir, impossible à assouvir, de se rejoindre » – ou « de se tenir définitivement à distance ». C’est bien encore s’éloigner du continu pour « l’intempestif », comme le veut Dickow.
Il s’appuie régulièrement sur une expérience d’enseignant à l’université, dit (trop modestement) le caractère composite de son essai, « Tout ceci relève autant de l’humble calepin que du grimoire d’initié » ; ces « déblais » sont bien l’un et l’autre, ils ne cherchent pas l’assentiment, ils suscitent la discussion et ce devrait être un des rôles de ce genre d’écrit.
Alexander Dixkow, Déblais, Louise Bottu, 2021, 104 p. 14 €. Cette recension a été publiée dans Libr-critique le 4 novembre 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexander dixkow, déblais | ![]() Facebook |
Facebook |
12/12/2021
Joseph Joubert, Carnets : recension
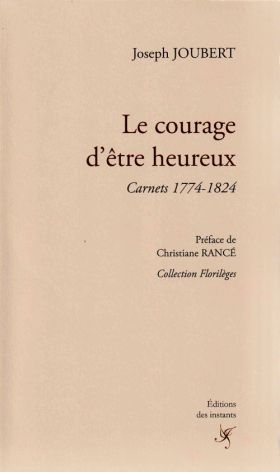
La totalité des carnets de Joubert (1754-1824) ont été publiés seulement au XXème siècle, en 1938, sous le titre Carnets par André Beaunier qui a établi le texte à partir des manuscrits ; ils ont été réédités en 1994. On ne peut attendre d’un recueil de 180 pages de restituer un ensemble qui en compte plus de 1300 mais, pour le moins, qu’il ne réduise pas Joubert à n’être qu’un moraliste dans la lignée de Pascal, La Bruyère, Vauvenargues, etc., ce qu’ont fait la plupart des anthologies proposées depuis l’édition intégrale : chacun a eu son Joubert, chrétien, moraliste, penseur de la poésie ou « poète platonicien » pour Georges Poulet dans ses Études sur le temps humain. La brève préface de ce nouveau choix insiste sur la volonté de Joubert de « saisir l’essence du langage, de la création artistique » et, heureusement, le choix préparé par Stéphane Bernard ne reproduit pas pour l’essentiel les manques habituels de lecture.
Il est nécessaire de rappeler que Joubert n’a pas publié de son vivant une ligne de ce qui lui tenait à cœur, ses carnets, contrairement à son ami Chateaubriand ou aux écrivains qu’il a connus, comme Diderot et Restif de la Bretonne : « Je suis, je l’avoue, comme une harpe éolienne qui rend quelques beaux sons, mais n’exécute aucun air. » Il écrivait régulièrement, cherchant à comprendre ce que devait être un écrit, un livre, ce parcours n’aboutissant qu’à des questions qui n’excluaient pas la possibilité d’une publication mais elle était soumise à des conditions précises :
22 octobre [1799]
Mais en effet quel est mon art ? quel est le nom qui distingue cet art des autres ? quelle fin se propose-t-il ? que produit-il ? que fait-il naître et exister ? Que prétends-je et que veux-je faire en l’exerçant ?
Est-ce d’écrire en général et m’assurer d’être lu ? Seule ambition de tant de gens ! est-ce là tout ce que je veux ? (...)
C’est ce qu’il me faut examiner attentivement, longuement et jusqu’à ce que je le sache.1
Il défend parallèlement le fait de publier peu, en renvoyant aux classiques du XVIIè siècle et en concluant que « les très bons écrivains écrivent peu parce qu’il faut beaucoup de temps pour réduire en beauté leur abondance et leur richesse. » De là vient le rejet des ouvrages de circonstance, à propos de faits passagers, toujours « bavards », « faits par babil ». De là aussi le report à un temps indéfini du projet d’un livre, « Quand ? dites-vous. Je vous réponds : — Quand j’aurai circonscrit ma sphère. »2 Il est resté, selon la formule de Maurice Blanchot dans Le Livre à venir (p. 63) « Auteur sans livre, écrivain sans écrit ».
On comprend avec ces interrogations sur sa propre écriture que les carnets de Joubert tenaient pour lui du journal intime, il suffit de rappeler que rien n’en a été diffusé de son vivant. On relève en effet de nombreux passages qui ne concernent que leur auteur, à commencer à la mort de sa mère par la très simple notation, « Ma pauvre mère ! ma pauvre mère ! », reprise plusieurs jours. Il a multiplié les notes à propos de son propre comportement, qui éclairent d’ailleurs sur sa manière de vivre, comme « L’occupation de regarder couler le temps », « Que le monde est enchanté » ou « Le silence — Délices du silence — (etc.), « ... mais à la fin vient une année où l’on vieillit. » On réunirait aisément un florilège autour des multiples sujets qui intéressent la vie de l’esprit et les relations humaines, les carnets étant fondés sur la vie dans tous ses aspects, sans que Joubert ait cherché à introduire un ordre exclu pour préserver la discontinuité des notations journalières, « Je suis comme Montaigne, « impropre au discours continu » notait-il.
Il aborde la question du style en renvoyant à Chateaubriand ou à Tacite, il juge favorablement des écrivains (Corneille) ou non : Voltaire, sa bête noire, il s’interroge sur l’ambiguïté de certains propos, sur l’étymologie des mots, il s’oppose à tout fanatisme, etc. Il réfléchit aussi très souvent à ce qu’est la religion, vrai « remède » : pour lui, « Dieu est le lieu où je ne me souviens pas du reste », ce qui entraîne d’ailleurs une remarque générale, « Il faut que quelque chose soit sacré ». C’est cet éclatement de l’écriture, la variété des sujets qui expliquent la tentation de ne retenir que certains passages et d’oublier les développements de la pensée, pourtant fréquents, et de présenter un Joubert moraliste. Lui-même ne rejetait pas les préceptes et écrivait : « Chercher la vérité. Oui, s’il ne s’agit que de sçavoir [sic] ; mais s’il s’agit de vivre ? Alors, la sagesse vaut mieux » et l’année de sa mort : « La sagesse est le repos dans la lumière »3, sagesse qui s’exprimait par des aphorismes de portée générale (« Ne coupez pas ce que vous pouvez dénouer »), à propos du comportement dans la société (« Hommes droits comme des roseaux. C’est-à-dire prêts à plier au moindre vent ») ou dans les relations humaines (« Quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil »).
Esprit exigeant, Joubert n’a pas cédé aux injonctions de ses amis (Chateaubriand, Fontanes) pour qu’il publie ses méditations journalières. On suit l’analyse de Blanchot4 qui lit dans les Carnets « une obstination lucide à se porter vers le but ignoré, une extrême attention aux mots, à leur figure, à leur essence et, enfin, le sentiment que la littérature et la poésie sont le lieu d’un secret qu’il faut peut-être préférer à tout, même à la gloire de faire des livres. » On suivra en filigrane cette recherche de Joubert dans cette nouvelle anthologie, avec le plaisir de l’agréable présentation qu’offrent les éditions des instants nées avant l’été.
Joseph Joubert, Carnets, préface Christiane Rancé, collection Florilèges, éditions des instants, 2021, 192 p., 15 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 9 novembre 2021.
1 Joseph Joubert, Carnets, I, 309. Seul le recours à l’édition intégrale est signalé par une note. Les autres citations sont empruntées à l’édition recensée.
2 id., I, 394.
3 Carnets, II, 292.
4 Maurice Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, 1959, p. 71.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joseph soubert, carnets : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
15/11/2021
Marcel Sauvage, Mémoires 1895-1981 : recension
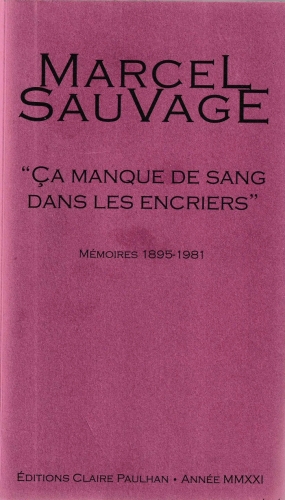
Marcel Sauvage (1895-1988), comme nombre d’écrivains du XXème siècle, n’est plus beaucoup lu bien que plusieurs de ses écrits (romans et essais) soient toujours réédités. Ses Mémoires ne le feront peut-être pas redécouvrir, mais ils se suffisent à eux-mêmes ; recueillis en 1980 par Jean José Marchand, restés inédits et déposés à l’IMEC, ils constituent un ensemble énorme et passionnant d’informations sur la vie littéraire mais qui déborde ce domaine. Dans cette traversée du siècle, Marcel Sauvage s’attribue parfois un rôle qu’il n’a pas eu, cherchant parfois une reconnaissance qu’il estimait lui faire défaut, les notes de Vincent Wackenheim, on y reviendra, remettent toujours les choses en place et complètent les données chaque fois que nécessaire.
Anarchiste pacifiste, engagé volontaire en 1914, Marcel Sauvage a appartenu à la génération des tranchées et des massacres de la Première Guerre mondiale. Il a vu un soldat le corps « écartelé » par un obus : « Des images comme celles-là m’ont rendu encore plus pacifiste dès le début ». Alors qu’il a été atteint par le gaz au chlore, un lieutenant exige qu’il parte à l’attaque et le traîne au bord de la tranchée : ses camarades fusillent ce fou de guerre et lui sauvent la vie. Il a conservé longtemps son idéal, acceptant progressivement des compromis pour, à la fin des années 1920, accepter des concessions, « Mon anarchisme muait peu à peu en scepticisme souriant ». Plus tard, il se rangera du côté du pouvoir en place ; alors qu’il passe la plus grande partie de la Seconde Guerre mondiale en Tunisie pour éviter une probable arrestation, donc qu’il connaît le sort des habitants, il ne comprend pas la révolte de Sétif du 8 mai 1945, violemment réprimée ; pour lui les exactions des Algériens, dont plusieurs milliers sont tués, sont aussi condamnables que la répression par l’armée.
Si l’on revient à sa petite enfance parisienne, elle ne fut pas des plus heureuses. Après quelques années à Vendôme, il rejoint le lycée de Beauvais ; élève brillant, il prend en charge un jeune boursier pauvre, Pierre Pucheu, qui devient ministre de l’intérieur dans le gouvernement de Pétain. Marcel Sauvage prouve jusqu’au bout que l’amitié n’est pas un vain mot et a défendu Pucheu, essayant devant le tribunal militaire réuni en Algérie de démontrer qu’il n’était pas inféodé au nazisme, sans peut-être comprendre le rôle des uns et des autres dans la politique de Vichy. Son plaidoyer n’a pas convaincu les juges et Pucheu a été fusillé le 20 mars 1944 ; quant à Marcel Sauvage il sera violemment attaqué par les communistes pour son témoignage et même agressé physiquement.
On ne peut résumer cinquante années d’activité d’écriture. Marcel Sauvage, après 1918, trouve une place de correcteur, donne des contes au journal Le Matin dont Colette est directrice littéraire : c’est sa première entrée dans le monde de la presse, qu’il ne quittera plus. Poète très influencé par Max Jacob (il sera lauréat du prix Max-Jacob en 1953) et André Salmon, il a observé les mouvements littéraires, participé à plusieurs d’entre eux, collaboré à de très nombreuses revues (dont les Cahiers du Sud), travaillé comme journaliste, puis grand reporter à L’Intransigeant, ensuite à l’agence internationale de presse Opera Mundi quand le journal est racheté et prend une orientation plus à droite. Gérant d’un hôtel à Tunis pendant la guerre, il écrit dans Tunis-soir avant de diriger en 1942 Tunisie, Algérie, Maroc (T.A.M.). Après 1945, il a animé des émissions de radio.
Membre du jury du prix Renaudot à partir de 1927 et jusqu’en 1981, très tôt critique d’art et critique littéraire, il a connu des écrivains et des peintres : Malraux dès 1920 (publié dans la revue Action qu’il avait fondée avec Florent Fels), Cendrars, Édouard Dujardin, Laurent Tailhade, Léon-Paul Fargue (qui « avait en tête les endroits de Paris ouverts nuit et jour »), etc., et les peintres Pascin, Kisling, Vlaminck, etc. Lecteur attentif, il parle, dans une conférence de 1925, de Jouve, Supervielle, Picabia et Éluard, tous fort peu connus. Dans les années 1950 il découvre, pour la Série Noire de Marcel Duhamel, Albert Simonin (Touchez pas au grisbi) et Auguste Le Breton (Du rififi chez les hommes). Il fait aussi dans ces mémoires le portrait toujours précis et vivants de quelques-uns de ses contemporains, ainsi d’André Suarès, rencontré au début des années 1920 :
(..) malgré mes articles toujours favorables, je n’ai pas bien connu André Suarès. Je savais seulement qu’il avait refusé qu’on lui installe l’électricité (ne parlons pas de téléphone) et qu’il recevait un flambeau à la main à son domicile de la rue Cassette, dans la puanteur de ses innombrables chats. Il pensait qu’il n’était pas à sa place, et c’était vrai en un sens, car il mérite d’être considéré comme un très grand. Cependant il est déjà apprécié et considéré par un petit nombre comme un génie. (etc.)
Il faut lire la préface de Vincent Wackenheim, elle retient les moments saillants de la vie de Marcel Sauvage et ajoute des éléments absents des Mémoires, notamment à propos de sa vie privée. Le lecteur d’aujourd’hui serait perdu dans l’abondance des faits relatés et les notes qui accompagnent le texte sont indispensables pour les comprendre, reconstituer des contextes et, ce qui n’est pas négligeable, elles sont toujours agréables à lire. Elles sont précieuses jusque dans les détails ; ainsi, le premier numéro de la revue Action étant imprimé en caractères Plantin (p. 142), une note précise (note 6) porte sur Christophe Plantin (1520-1589) et la création du caractère ... Elles apportent aussi régulièrement un peu de fantaisie dans une matière, les notes, qui en manque habituellement ; par exemple, quand Marcel Sauvage raconte qu’il observait à la jumelle, avec un ami, les « priapées » qui avaient lieu dans le petit square derrière Notre-Dame, une note commente avec humour « Nous n’avons pas pu confirmer que ce parc était alors connu comme lieu de débauche ».
Vincent Wackenheim a ajouté de brèves mais abondantes annexes : des articles critiques des livres de Marcel Sauvage, la préface d’Édouard Dujardin pour Cicatrices, un portrait par André Salmon, un autre par Armand Guibert, etc. Suivent le catalogue de la vente aux enchères en 1983 des eaux-fortes, aquarelles, gouaches de MS, des repères biographiques précis, une liste des noms cités — plusieurs centaines ! Comme tous les livres des éditions Claire Paulhan, une riche iconographie accompagne le texte.
Marcel Sauvage, Mémoires 1895-1981, recueillis par Jean-José Marchand, édition et préface de Vincent Wackenheim, Claire Paulhan, 2021, 524 p., 33 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 14 octobre 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel sauvage, mémoires 1895-1981, recueillis par jean-josé marchand | ![]() Facebook |
Facebook |
03/11/2021
Marie de Quatrebarbes, Les vivres

Marie de Quatrebarbes, d’un livre à l’autre, explore des formes. Avec Les vivres, elle choisit de revisiter celles du Journal. On sait bien que Stendhal et Kafka ne tenaient pas un Journal en vue de la publication, les choses ont changé quand le Journal a été édité du vivant même de son auteur, que l’on pense à Gide ou Julien Green hier, aujourd’hui à Charles Juliet ou Pierre Bergounioux : le Journal est devenu un genre littéraire. Traditionnellement, il s’agit d’un écrit autobiographique en prose dont l’auteur est le narrateur, qui est le personnage principal. Il implique une écriture à peu près régulière, même si toujours fragmentaire. Les vivresprésentent un Journal tenu pendant cinquante-six jours de juillet à décembre et toujours ouvert le 1er de chaque mois ; suivent des notations pendant quelques jours, qui s’espacent ensuite ou disparaissent. L’année n’est pas indiquée mais mention est faite à la fin du livre de la publication d’extraits à partir de 2014 et il est précisé que le texte du mois d’août a été écrit « en écho » au séminaire de Georges Didi-Huberman de 2014-2015, ce qui laisse penser à un décalage entre l’écriture de juillet et d’août et renforce l’idée d’un jeu avec le genre, confirmé par une brève adresse au lecteur en août : « Si vous lisez ceci ».
La subjectivité est bien présente avec le « je » et si d’autres pronoms apparaissent (tu, elles) qui peuvent l’inclure (on, nous), aucune figure n’a de consistance en dehors de celle dont est indiquée la disparition évoquée par une notation au passé le 1er juillet — le mot est employé le 2 —, et qui semble annoncée par l’extrait de Zanzotto choisi en exergue, « Je serai lointaine, mais je ne t’abandonnerai pas ». Si l’on prend Les vivres aussi comme un jeu avec un genre, il importe peu que la disparition soit, dans la réalité, celle de la grand-mère de l’auteure comme quelques indices plus ou moins précis le laissent entendre, par exemple « Je ne suis pas là lorsqu’elle me quitte » et, en septembre, « Se peut-il être, un de ces jours terrestres, la disparition hâtive d’un lien ? ».
De nombreuses images de l’enfance sont attachées à cette disparition tout au long du livre et sont un des éléments solides de son unité, depuis en juillet « l’enfant que je fus » à « les enfants savent lorsqu’il faut jouer désespérément » en décembre. Tout un passé de moments perdus émerge ici et là, à peine suggérés, comme s’ils composaient seulement une « jeunesse fictive », mais les traces dispersées aident cependant à reconstruire des étapes, depuis « mustela » (produit de soins pour bébé) à « poupée », à « ça crie des chambres d’enfants » et à l’annonce d’une autonomie, « Bientôt nous serons seules comme des grandes » et, enfin, à la photographie dans un médaillon ; il est aussi question de l’ennui des enfants », toujours présent chez l’adulte qui chante « pour tromper l’ennui ». Ces indications toujours discrètes esquissent pour le lecteur l’idée d’un autre temps avec lequel il y eut rupture (« Puis l’enfant quitta sa cage et s’excusa d’un oubli »), suffisamment forte pour qu’elle ait conservé un rôle (« Je me promène sans doute dans cet oubli-là »).
Si la disparition importe, c’est aussi parce qu’elle révèle l’incohérence du monde réel et ce qui remonte de l’enfance ne peut aider à rétablir un ordre acceptable ; les notations sont dispersées, fragmentaires, et leur retour échoue à construire une continuité. Comme si un récit ne pouvait être que fiction : « Une fiction s’achemine : l’après-midi, les enfants... fiction à laquelle on ne peut répondre qu’en hochant la tête ». La perte de repères liée à la disparition laisse devant une réalité peu avenante à tous les niveaux (« les grèves, les tempêtes »), où il faut trouver sa/une place — « Remets-toi au monde et plante-toi dans le décor, à nouveau » —, alors même que cette instabilité trouble jusqu’à l’usage de la langue.
On sait bien que rien n’impose dans un vrai Journal d’écrire des énoncés compréhensibles pour un lecteur autre que son auteur ; il suffit de lire celui de Kafka pour s’en convaincre, on y rencontre des phrases obscures, des allusions difficilement interprétables. Marie de Quatrebarbes, jouant avec le genre, ne se prive pas de ces incidents dans la rédaction qui ne peuvent que renforcer l’impression d’authenticité, bien plus que les pages ordonnées et lisses des Journaux écrits pour être publiés. Aussi trouve-t-on maints énoncés déconcertants pour le lecteur mais que l’auteure d’un vrai Journal n’aurait pas besoin d’expliciter, comme la juxtaposition de phrases sans rapport entre elles (« Tu parles d’une image aux chaussettes tirebouchonnées. La faïence n’a pas de prix. »), l’emploi de mots abrégés (« Se peut-il que lui-même soit abs. ext. air ? »). D’autres énoncés semblent plutôt refléter le désordre du monde, son absence de sens : un schéma syntaxique simple est brisé, un nom ne pouvant être en même temps complément et sujet dans une phrase (« Si je la cueille et la place dans ma main brille »), la compatibilité sémantique entre les mots est absente (« On ne ruse pas avec elle. Et si elle tombe, on la confie à des abeilles. »).
Rien de complètement obscur, le lecteur peut toujours inventer un contexte pour que les textes deviennent acceptables ; cependant, on lit des énoncés qui, littéralement, semblent dérailler, par exemple quand une phrase qui ouvre une page du Journal est reprise pour l’achever, ce que l’auteure commente, « Je ne fais que répéter ». On peut rapprocher ce type de reprise d’un rêve d’emboîtement des phrases à la manière des poupées russes, rêve d’un discours qui n’aurait pas de fin, de figures multipliées (« C’est toi peut-être en plus petit ? ») comme celles d’un « théâtre de cire ». Il y a toujours dans Les vivres un double mouvement ; si « frêne » entraine « réfrénez », presque aussitôt après cette paronomase vient : « Nous n’irons plus au bois », comme s’il fallait que les « lieux communs [soient] mille fois traversés ».
Ce qui traverse aussi le livre, propre à l’univers de Marie de Quatrebarbes, ce sont les références au cinéma, par des mots (gros plan, photographie, focal), le nom d’un acteur réalisateur (Clint Eastwood) et des allusions plus ou moins repérables à des films, par exemple « le reflet de l’œil grossi à la loupe » renvoie-t-il au Chien andalou de Bunuel ou à Peeping Tom (Le Voyeur) de Michael Powell — ou le lecteur invente-t-il ce qui lui convient ? Le titre lui-même n’est pas immédiatement lisible ; il ouvre la journée du 3 septembre : « Ce qui se mange : les vivres » et « vivres » est repris deux fois en novembre (« nous manquons à nos vivres » et « ils débarquent nos vivres ») : dans ce balancement du manque et de la présence, on est tenté de reconnaître en vivres une nourriture spirituelle, ce dont on se souvient, ce qui s’écrit et se lit — vivres si proche de livres. Trouble toujours : la force de ces proses souvent dérangeantes conduit heureusement à quitter ses certitudes de lecteur.
Marie de Quatrebarbes, Les vivres, P.O.L, 2021, 96 p., 12 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 5 octobre 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie de quatrebarbes, les vivres, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
29/10/2021
Homère, L'Odyssée : recension
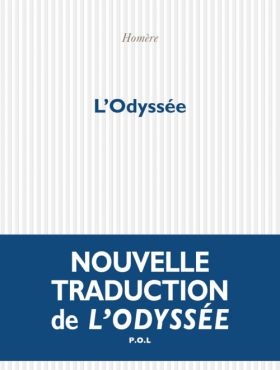
Mais pourquoi donc traduire une fois de plus Homère ? Il existe de nombreuses éditions de L’Odyssée qui restituent l’épopée en vers blancs, en décasyllabes, en alexandrins, en prose, depuis 1604 (Salomon Certon) jusqu’au XXe siècle avec, notamment, la traduction de Victor Bérard (1931) reprise dans la bibliothèque de la Pléiade, et celle de Philippe Jaccottet (1955) republiée en format de poche. La question n’a de sens que si l’on oublie que toute traduction, d’un auteur contemporain et, plus encore peut-être, d’une œuvre ancienne plusieurs fois traduite et souvent enfouie sous les commentaires, implique de la part du traducteur un choix de lecture.
Emmanuel Lascoux, helléniste, explique précisément dans un long "Prélude" ce qui sous-tend sa lecture d’Homère. D’abord, L’Iliade n’est pas un commencement de l’épopée — Homère ne surgit pas du vide — et il y a au moins une autre Odyssée après L’Odyssée. Ensuite, il est nécessaire de se souvenir, ou de savoir, que « la langue d’Homère n’a jamais été parlée par personne d’autre qu’Homère, c’est-à-dire les aèdes ». C’est là un point essentiel, ce qui est désigné aujourd’hui par "grec ancien" était un ensemble complexe de divers dialectes, la langue épique n’ayant aucune unité et, jusqu’à un certain point, reste intraduisible. En outre, dans l’antiquité grecque, dès l’épopée, « la musique réglait tout, jusqu’à la politique », aussi l’aède était-il « le premier polyphoniste, l’homme-orchestre ».
Ce vertige épique de l’écartèlement entre la singularité du vers et son addition indéfinie, cette corde qui tient, où l’on marche, sans pourtant toujours savoir si elle est lâche ou très tendue, c’est la haute voix qui le donne, qui la sent. Raison première qui m’interdisait de traduire. (Lascoux)
Les difficultés résumées, comment restituer le bruit des voix, passer du grec d’Homère, des aèdes au français ? Victor Bérard emploie l'alexandrin, équivalent pour la longueur de l’hexamètre grec, mais un alexandrin souple qui enjambe « sur la rime » et « peut avoir toutes les tailles » ; la rime « étant supprimée, il aboutit à une prose qui permettrait d’obtenir en français un rythme équivalent à celui du texte homérique », retrouvant quelque chose de ce qu’il nomme la « diction épique ». La démarche d’Emmanuel Lascoux est différente, il ne propose pas une traduction comme les diverses éditions disponibles de L’Odyssée le prétendent, mais une "Version française" (en page titre, sous le titre L’Odyssée), en partant du principe qu’il est nécessaire de restituer quelque chose de la voix de l’aède, de « l’esthétique de la bigarrure » de L’Odyssée.
Il supprime le « regard chronologique » en employant, à quelques exceptions près, le présent de narration. Pour que les personnages ne soient pas fixés dans un registre, il mêle les manières de s’exprimer, faisant ainsi passer quelque chose de la polyphonie ; on peut comparer la manière dont est restitué dans différentes éditions, par exemple celui où la déesse Calypso répond à une proposition d’Ulysse (V, 182) :
Lascoux : Eh bien, tu ne manques pas de culot, ça non, ni d’esprit, il est vrai.
Bérard : Le brigand que tu fais ! Tu connais la prudence !
Jaccottet : Tu es injuste, ami, mais non point sans malice.
Il est toujours possible de s’adapter au contexte et, plutôt que de traduire par un seul mot, développer par une périphrase, comme dans l’ouverture de L’Odyssée :
Certon (1604) : Muse, raconte moy l’homme fin et rusé
Leconte de Lisle (1871) : Dites-moi, Muse, cet homme subtil
Jaccottet : Muse, conte-moi l’aventure de l’inventif
Lascoux : Muse, dites-moi l’homme aux détours, l’homme aux ruses
Dans le même esprit, Lascoux varie la traduction des épithètes et, par ailleurs, quand il rencontre un calembour étymologique (Ulysse — haïr) il l’adapte à notre langue à la manière de Bobby Lapointe (cf I, 52, « pourquoi telle haine, Zeus, que tu l’y sacrifies ») ; Jaccottet, lui, le laisse de côté « pour ne pas tomber dans la jonglerie », en ajoutant : « Les Grecs aimaient sûrement ces tours ; ils n’en sont pas moins rares dans l’épopée » — le calembour est également absent dans la traduction de Leconte de Lisle. Lascoux accompagne la voix des personnages par celle du conteur, donc ajoute des éléments au texte : « Écoutez alors ce qu’il lui dit : » (IV, 803), « Voyez-le debout (...) » (XXII, 332), etc. S’ajoutent des onomatopées pour rendre présents les bruits (paf ! boum ! pff !, etc.) et des appuis de discours, nombreux, qui aident le lecteur à saisir le caractère parlé de l’épopée (tiens, va !, vois-tu, ça y est, etc.) — on peut trouver trop fréquents le retour de oui et de pardi(un peu vieillot ?) : « Il n’aura qu’à le surveiller, pardi » (X, 444), « il suit, pardi : hé, c’est qu’il aura eu peur » (X, 448). Cette voix à côté est déjà présente dans le Prélude, mais cette fois Lascoux s’adresse au lecteur : « Homère (...) nous balance, vlan !, ses deux fragments géants, oui, d’un tout qui n’existe pas » (p. 44).
Voilà des remarques trop sommaires pour présenter cette « Odyssée parlée, jouée familière », revisitée avec bonheur ; on peut commencer à la lire avec près de soi une ou deux autres traductions, non pour comparer — on ne préfère pas Bérard, Leconte de Lisle ou Jaccottet à Lascoux, chacune a ses particularités —, mais pour lire autrement. On se plonge ensuite entièrement dans cette tentative heureuse d’approcher la mélodie de l’épopée et on la goûtera d’autant mieux que l’on écoutera Lascoux, performeur jouant le texte grec, accompagné de Pierre Baux pour la partie française (Maison de la poésie, sur Youtube).
Homère, L’Odyssée, nouvelle traduction d’Emmanuel Lascoux, P.O.L, 2021, 496 p., 23, 90 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 24 septembre 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : homère, l'odyssée, emmanuel lascoux | ![]() Facebook |
Facebook |
10/10/2021
André Suarès, Vues sur Baudelaire
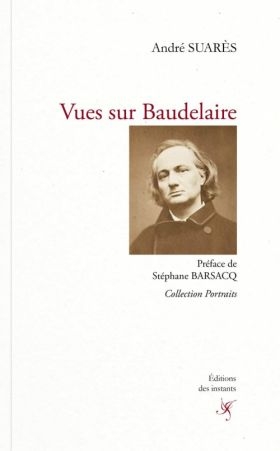
Il serait intéressant de comprendre pourquoi sans être oublié un écrivain reconnu perd une partie de ses lecteurs. C’est le cas d’André Suarès (1868-1948), pilier de la NRF à ses débuts, collaborateur régulier quand Paulhan en prend la direction, et dont l’œuvre poétique et les nombreux essais ont été appréciés aussi bien par Gide que par Joyce, Malraux, Artaud ou Claudel. Le voyage du condottière, écrit après plusieurs longs séjours, repris en Livre de Poche en 1996, reste indispensable pour qui aime l’Italie, mais il est l’auteur d’autres ouvrages toujours d’actualité. Yves-Alain Favre (1937-1992) avait entrepris d’en rééditer quelques-uns ; Stéphane Barsacq a pris le relais en rééditant Sur la musique (2013), Miroir du temps (2019) et, en 2017, un essai politique, Contre les totalitarismes : André Suarès, ardent dreyfusard, a dénoncé très vite ce que représentait Mussolini et analysé les dangers liés à l’accession d’Hitler au pouvoir.
Tout en poursuivant une œuvre poétique, il était aussi un essayiste passionné qui a écrit notamment à propos de Tolstoï, Villon, Pascal, Rimbaud, Shakespeare..., et de celui qu’il considérait comme le fondateur de la poésie moderne, Baudelaire. Tous les écrivains étudiés étaient « autant de masques », écrit Stéphane Barsacq qui a réuni sept articles publiés de 1911 à 1940, dont l’un autour des Fleurs du Mal et une préface au Spleen de Paris ; dans son introduction, s’appuyant parfois avec justesse sur les analyses d’Yves Bonnefoy, il relit l’œuvre de Baudelaire, et montre que Suarès a été le premier, dès 1911, à en affirmer l’importance. Si Baudelaire a « vécu d’imaginer », il est cependant présent dans son œuvre et « d’autant plus qu’il ne s’y est pas mis ».
Dès sa première étude, Suarès met à part Baudelaire, affirmant qu’il n’est pas un poète pour les « esprits parasites que le vent de la rhétorique soulève seul de la crasse des livres ». Le ton des essais est donné. L’œuvre de Baudelaire est « un raccourci d’homme avec toutes ses passions, ses folies, ses goûts, ses caprices, ses recherches exquises ou perverses, ses grâces et ses affectations, ou même ses ridicules. » L’essentiel est dit. Suarès ajoute, et c’est un propos récurrent, que Baudelaire conserve une forme ancienne — le sonnet — pour inventer une poésie nouvelle : poète classique, donc, par sa rigueur formelle, ce qui ne l’a pas empêché de comprendre « les temps nouveaux » — qu’il « a détestés » ; il qualifiait les journaux de son temps de « taudis de l’esprit ». Suarès voit en Baudelaire le vrai créateur du poème en prose : il a fait « à dessein ce qu’on a fait par hasard avant lui », il y a introduit le rythme, « mouvement même de la passion intérieure » et, en même temps, il sait « le prix du symbole, et la nécessité de l’inclure dans une arabesque stricte ».
Poète intérieur et, pour cela, séparé des hommes, sa vie étant un « désert pour l’anecdote » : il a vécu dans la solitude, comme le chat « toujours solitaire dans la maison ». Il a certes partagé une partie de sa vie avec Jeanne Duval, mais c’est sans doute pourquoi il a écrit que « La femme est naturelle c’est-à-dire abominable » — mot de théologien pour Suarès, qui voit l’œuvre de ce catholique dans l’impiété tourner autour de la damnation. Il voit aussi que la grande découverte de ce poète solitaire est sans doute d’avoir compris le rapport entre la mort et l’amour, rapport central chez plusieurs écrivains du XXe siècle. Il analyse par ailleurs le rôle de Paris, soit de la Ville — « la Ville avec un grand V » — qui donne aux poèmes leur unité : « elle est la seule, celle de l’esprit et de toutes les formes que peut prendre la vie ». Le mystère de la ville a suffi à Baudelaire qui a compris que l’exotisme, le seul peut-être indéfiniment à explorer, résidait dans le « voyage en esprit ».
Il y a une relation très forte de Suarès à Baudelaire et l’on n’a fait que suggérer l’étendue de ses analyses ; il faudrait reprendre ce qu’il écrit du lien de Baudelaire à Wagner, de la relation à Gœthe, à Keats, etc., mais également suivre son écriture. On peut en avoir une idée en lisant son portrait physique de Baudelaire :
Ces yeux brûlants et démesurés, si intenses dans la profondeur du retour sur soi-même ; ce front énorme, une esplanade d’Elseneur, cette tour dévastée, terrasse d’un clocher dont la pointe est tombée, et cette bouche ! C’est la bouche du prophète, aux bords repliés sur des paroles défendues, aux coins abaissés par le dégoût, gonflées par la colère, les lèvres de l’exil qui, dès longtemps, a résolu de désapprendre le baiser. [etc]
Stéphane Barsacq a réuni dans des annexes quelques textes de Suarès qui, sans être consacrés entièrement à Baudelaire, complètent heureusement l’ensemble, en particulier des articles à propos du vers, de la rime et du sonnet. Il joint une bibliographie qui retient toutes les rééditions après la disparition du poète et quelques ouvrages de référence, dont le "Dossier Suarès" de la revue Nunc (n° 49, 2020). Vues sur Baudelaire est publié par les éditions des instants en même temps qu’un livre de poèmes de Denise Le Dantec, Ô Saisons, tous deux dans une présentation élégante et soignée. Il faut louer ce pari de commencer son activité d’éditeur en donnant à lire en même temps un écrivain de notre proche passé trop négligé et une écrivaine d’aujourd’hui.
André Suarès, Vues sur Baudelaire, préface Stéphane Barsacq, éditions des instants, 2021, 192 p., 15 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le11 septembre 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré suarès, vues sur baudelaire, stéphane barsacq | ![]() Facebook |
Facebook |
06/10/2021
La revue de belles-lettres : recension

La revue de belles-lettres avait consacré en 1999 une livraison à l’œuvre de Pierre Chappuis (1930-2020) et publie maintenant un ensemble écrit par des proches, auquel il faut ajouter les souvenirs de Michel Antoine Chappuis ; il évoque l’appartement de son enfance et a choisi avec Marion et Hans-Jorg Graf dix des tableaux d’amis qui s’y trouvent : ils sont superbement reproduits à la suite de la première version d’une prose du poète, La nuit des temps. Pierre Bugart s’attache au dernier livre publié, qui reprend notamment le premier ensemble paru (Ma femme ô mon tombeau), et insiste sur l’unité de l’œuvre. Frédéric Wandelère évoque sa première rencontre et une vie d’amitié, tout comme un autre poète, Pierre Voélin, qui rappelle que Chappuis était toujours devant « le monde et sa réalité de face(...) sans se détourner ». Ariane Luthi insiste sur la présence constante, à côté de l’écriture de poèmes, de la réflexion critique ; elle se souvient aussi des longs échanges au cours de leurs marches. C’est encore un Pierre Chappuis très proche qui apparaît dans les pages de Sylviane Dupuis qui raconte son engagement pour préparer une lecture devant des étudiants et répondre à leurs questions ; elle montre sa proximité à Jaccottet pour la poétique du paysage, « nourrie de l’expérience physique de la marche », cite des extraits de lettres, y compris l’une écrite après le décès de son épouse dans laquelle il a recopié un poème de Jean-Luc Sarré. Amaury Nauroy présente vingt lettres échangées entre les deux poètes qui « se reconnaissaient une même passion pour les images et quelques maîtres communs ». Ils se lisent attentivement : à propos de Dans la foulée, Sarré se dit « très sensible à cette poésie parfois proche de la note » et aux retours « sur un mot ou une phrase pour mieux les affûter, dépecer, prolonger » ; Chappuis apprécie le « ton narquois et tendre » de La Part des Angeset « toutes les petites choses, les petits riens » qui ont « une résonance commune » et « un prolongement au-delà ». C’est un bel ensemble qui incite à relire ces deux poètes discrets, Jean-Luc Sarré (1944-2018) disparu un peu avant Pierre Chappuis.
Bruno Pellegrino, dans la rubrique "L’inventaire", sous le titre Marthe, se livre à une enquête passionnante à propos d’une femme "ordinaire", donc oubliée, comme toutes celles qui ne laissent qu’un nom sur une tombe et, parfois, un souvenir pour des proches. Il lit le compte rendu, publié en 1919, qui « liquide en quelques lignes » un livre de poèmes publié par Marthe, Et j’ai noué ma gerbe..., et cherche à reconstituer la vie de son auteure. Il dépouille des journaux, des notices nécrologiques, accumule les éléments et reconstitue quelques éléments de l’existence de cette infirmière active pendant la guerre de 1914-1918, décédée en 1971 ; il retrouve la trace d’une de ses amies, également infirmière avec laquelle elle a vécu, mais pas sa date de sa naissance. Avant cette enquête, Bruno Pellegrino avait classé les archives d’une écrivaine connue pour qu’elles soient conservées — elles seront plus tard étudiées et aboutiront à des thèses. « Marthe (...) n’aura jamais droit à ce traitement, dont d’ailleurs elle n’aurait sans doute pas voulu ». Ce genre d’enquête minutieuse donne à réfléchir sur ces "vies minuscules", aussi riches d’enseignements que la vie de célébrités, elles aussi vouées pour la plupart à l’oubli.
Fabio Pusterla, traducteur en italien de Philippe Jaccottet et préfacier de ses œuvres dans la Pléiade, a été surtout traduit et publié par des éditeurs suisses et il reste encore peu connu en France. C’est à Jaccottet, en citant longuement Notes du ravin, que Pusterla recourt pour répondre, dans une des deux conférences traduites, à la question souvent posée : que peut la poésie dans notre société ? Il conclut qu’on peut « croire encore possible, encore sensé, un dialogue de profondeur entre le texte et ses lecteurs » et, ainsi, de « se reconnaître égaux devant le mystère de la beauté ». Plusieurs longs poèmes, traduits notamment par Mathilde Vischer (qui l’a introduit en français en 2001 avec Me voici là dans le noir) sont construits à partir de la destruction des populations aborigènes de Tasmanie, méditation autour de la relation entre aujourd’hui et un temps hors de l’Histoire ; c’est sous un autre angle que cette méditation se poursuit par sa rencontre avec la grotte Chauvet. Pusterla propose à la lecture quelques poètes quasiment inconnus en français (traduits par M. Vischer et Laurent Cennamo), toujours avec le texte original, Francesco Scarabicchi, Massimo Gezzi et Stefano Simoncelli.
La première partie de la revue est consacrée à la poésie, avec des textes très variés. On lira avec intérêt des extraits d’un Livre de palabres, de Henri-Michel Yéré, qui présente un poème en argot d’Abidjan, le nouchi, avec sa version en français, exemple rare de bilinguisme dans une langue :
Un soir on s’en gabassait de plages
Orage était dans ciel fatigué
C’était un soir où nous tournions le dos aux plages
Le ciel était rempli d’orages
Patrick McGuinness a écrit autour du thème de la disparition, du départ dans plusieurs poèmes, dont le premier, le plus étendu, à propos de tours de refroidissement qui, n’ayant plus de fonction, sont abattues ; Gilles Ortlieb avait déjà traduit le poète anglais avec le recueil Guide bleu en 2015. La revue donne aussi des poèmes de Julien Burri et Laurent Cennamo et s’ouvre avec un poète chinois de Taïwan, Wang Wen-hsing, traduit par Camille Loivier : notes à propos de la création, de la vie quotidienne, des choses de la vie, comme cette question qui clôt l’ensemble, « À présent je ne crains plus la mort, mais comment pourrais-je ne pas avoir peur pour la vie ? »
La revue de belles-lettres, 2021, I, 232 p., 30 € (abonnement, 56 €, La revue de belles-lettres, Case postale 6741, Lausanne, Suisse). Cette recension a paru dans Sitaudis le 6 septembre 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la revue de belles-lettres, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2021
James Sacré, Broussaille de bleus : recension
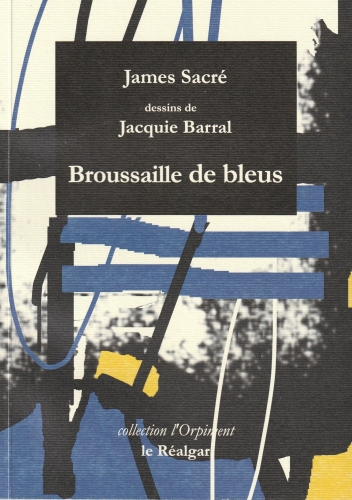
Le titre engage deux thématiques récurrentes dans l’œuvre de James Sacré. "Broussaille", déjà apparu dans un titre en 2007 (Broussaille de prose et de poésie où se trouve pris le mot paysage), porte l’idée d’enchevêtrement, ici des divers bleus rencontrés dans les paysages. Le long poème du premier ensemble "Broussaille de bleus", évoque un moment et un lieu de l’adolescence ; le « bleu fougereuse » est rapporté à un village des Deux-Sèvres (Saint-Maurice-la-Fougereuse) pas trop éloigné du village natal ; la qualification arrête le lecteur : on pourrait donc proposer une nuance de bleu qui n’existe que pour soi ? le mot "fougereuse" entraîne le surgissement de souvenirs (la pause dans le travail de la ferme, la sortie du dimanche, le bal). Mais la couleur bleue n’est pas particulière à un moment et à un lieu, elle est présente dans « tous les paysages », dans tout ce que la mémoire peut remettre au jour, couleur liée à des rêveries et des désirs anciens, couleur des « charrettes peinturées de bleu », couleur aussi mêlée à d’autres — comme le rouge, absent ici mais essentielle dans l’imaginaire de James Sacré.
Se remémorer les bleus de l’enfance, c’est surtout savoir que cette enfance est « perdue ». Ces bleus sont trop éloignés pour pouvoir être réellement restituables, sinon dans l’imaginaire ; « la broussaille ça peut être / Aussi bleue que des oranges » ou « comme un dimanche ». On se souvient des vers d’Éluard dans L’amour la poésie, « la terre est bleue comme une orange / jamais une erreur les mots ne mentent pas ». Les mots ne mentent pas, renvoyant plus à une idée qu’à une image : le mot "orange" emporte dans un temps à jamais disparu, celui d’une enfance d’après-guerre où, au moment de noël, l’on recevait en présent non un jouet mais une orange, fruit alors encore peu répandu. Ainsi, avec le mot "bleu" est regroupée une variété de couleurs « bleues », c’est-à-dire une variété d’expériences dont la singularité échappe à la transmission. Serait-elle plus aisée si le poème était écrit avec des couleurs ? Mais la relation entre le mot écrit en bleu avec les autres mots ne dépend en rien de la couleur des caractères — le mot n’est pas la chose ; ce qui importe dans le poème, rappelle James Sacré, c’est le rythme et l’oublier, écrit-il avec humour, c’est s’exposer à avoir « un bleu au désir d’écrire ». On notera justement le souci constant du rythme dans cette poésie lue parfois à tort comme de la prose plus ou moins arrangée ; James Sacré choisit d’enfreindre une règle morphologique pour préserver un rythme, « Un assemblage de chose’ en bois : ses bras / ».
Au cours du temps, le même bleu se retrouve dans les pays parcourus, du Maroc aux États-Unis, par exemple celui d’un arbre tropical, le jaracanda, et les souvenirs d’autres bleus surgissent, mais éparpillés, mêlés, brouillés, comme si la mobylette bleue si souvent rencontrée autrefois s’était éloignée dans le temps plus que dans l’espace. Ce qui reste des souvenirs, ce sont les mots écrits, ce qui a été regardé se réduit aujourd’hui à quelques mots qui peut suggérer un autre temps au lecteur mais ne peut lui présenter une couleur. Peut-on alors restituer un paysage ?
Le second ensemble, "Relation paysages" débute par un poème, "Écrire un paysage", un des aspects les plus constants de la poésie de James Sacré. L’enchevêtrement des bleus est aussi important dans l’espace que dans le temps. Qu’en disent les mots de James Sacré quand il s’interroge à propos des quatre lieux qui sont le socle de sa poésie, Maroc, Italie, Vendée, États-Unis ? qu’est-ce que l’on peut « donner à voir » pour reprendre à nouveau Éluard ? Quoi qu’on fasse, le mot écrit ne restitue pas ce qui est « perdu ». Le peintre Jacquie Barral note au début du livre que les paysages « sont comme une trame de pensée, de mots, de noms de pays, lieux-dits perdus, bouts du monde devenus bouts de nous-mêmes » et James Sacré doute que l’écriture soit susceptible de faire partager cet ensemble hétéroclite et complexe. Est-il possible que le passé — le ruisseau de l’enfance ou les bleus rencontrés — soit transmis par la poésie ? Ou ne peut-il revenir au jour que pour celui qui l’a vécu ? Le simple fait de fréquenter les musées trouble toute tentative de transmission : ces arbres ne forment pas un paysage pour moi, ils ne sont pas visibles pour eux-mêmes mais évoquent très vite un Corot, un Cézanne, etc.
Écrire un paysage ça n’est pas le photographier
Pas le peindre non plus, ni même le décrire
Écrire un paysage on ne sait pas trop
Ce que cela veut dire.
James Sacré écrit sur le motif, dans un quartier de Montpellier ; devant une rangée d’arbres, il note le mot "peupliers", mais il ne renvoie pas plus aux peupliers vus à un moment précis qu’à ceux de l’enfance vendéenne ou à ceux d’un paysage du Colorado ou du Maroc. Ce que restituent les mots du poème, d’abord une forme et des sons, pas une image ni une singularité, et ce d’autant plus que ce qui constitue le paysage n’est pas immobile, aussi le poème ne peut-il être, à sa manière, qu’ « abstrait », et James Sacré invite justement à lire « Le poème comme un paysage » : sens et rythme.
James Sacré, Broussaille de bleus, Dessins de Jacquie Barral, collection l’Orpiment, Le Réalgar, 2021, 60 p., 12 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 15 août.
Publié dans RECENSIONS, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, broussaille de bleus, dessins de jacquie barral | ![]() Facebook |
Facebook |
12/09/2021
Cole Swensen, Poèmes à pied : recension
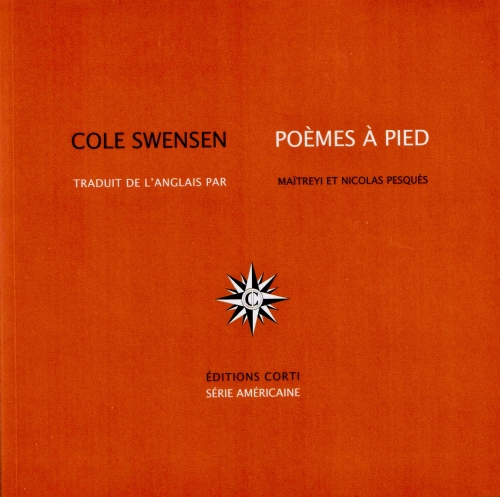
Avant Poèmes à pied, Cole Swensen, traductrice de poètes français, de Jean Tortel à Pierre Alferi, a publié trois livresux éditions Corti, écrits chaque fois à partir de créations françaises, le premier avait pour départ Les très riches heures du duc de Berry, le second prenait pour prétexte des tableaux de Pierre Bonnard, le troisième s’attachait aux jardins de Le Nôtre. Cette fois, le matériau est né de la lecture d’une douzaine d’écrivains qui, plus ou moins longuement, ont écrit à propos de leurs marches, de Chaucer et ses Contes de Canterbury, pour le plus ancien, à la poète américaine Harryette Mullen (née en 1953) — une bibliographie à la fin du livre énumère les titres retenus. On notera que Maïtreyi et Nicolas Pesquès ont traduit les quatre volumes, ce qui restitue à l’ensemble des livres son unité formelle.
L’un des thèmes qui sous-tend le livre apparaît dans le premier poème : Geoffroy Chaucer au long de ses pèlerinages à Rome marche avec le manuscrit de ses Contes de Canterbury ; aucune ambiguïté, Poèmes à pied lie l’écriture et la marche. Un exemple éclairant de ce lien est fourni par Rousseau qui, dans les promenades des Rêveries du promeneur solitaire, exprime avec ses marches son lien profond à la nature ; son manuscrit est « griffonné » — « la main court » —, et dans sa prose « Il y a un lien viscéral entre le rythme de son pas et celui de son écriture ». Dans l’écriture autour des Rêveries, le "je" de Rousseau alterne avec la construction progressive d’une poétique, que résumerait abruptement Wordsworth pour qui, annulant toute différence, « marcher c’était simplement écrire ».
Le lien, quasiment l’équivalence, marcher-écrire, est au centre de la relation à l’environnement et à partir de là plusieurs motifs se développent, celui de l’errance, de la perte, la prise de conscience de soi, très présent notamment chez Rousseau, et de l’étrangeté du monde. Le sentiment de perte est marqué en particulier dans les écrits de Thoreau qui, complètement absorbé par ce qui l’entoure, ou l’absorbant, finit par ne plus s’en distinguer. Alors le temps ne compte plus, ni à certains moments le langage, car peu importe que les espèces sauvages d’arbres fruitiers rencontrés ne soient pas dans les nomenclatures. Ce qui s’éprouve alors dans ce qui est rencontré dans la marche a plus d’importance pour le sujet que ce qui peut en être dit ; comment, par exemple, rendre compte de « l’étonnante variété de blancs » ? Mais cette confusion répétée dans la marche, cette perte temporaire de soi, conduisent à vivre autrement son corps que dans la relation à autrui, il devient comme « un ciel qu’on peut tenir contrairement au ciel qui semble se replier », et l’écriture fait que la marche « littéralement structure la littérature comme une charpente ».
Marcher aboutit souvent à se perdre dans le paysage, et cela d’autant plus aisément le soir ; Stevenson finit même par sentir qu’il « devient le paysage » et George Sand, cette « marcheuse extatique », dans ses errances se perd réellement quand vient la nuit. Les marcheurs nocturnes sont les plus nombreux dans Poèmes à pied ; alors, pour Dickens, le corps est « tel une lame de lumière à la fois improbable et inachevée ». Et le plus souvent il s’agit d’une marche dans la ville ; si Karl Gottlieb Schelle se partage encore, au début du XIXe siècle, entre « le champêtre et le citadin », soit entre « la rêverie et la raison », un de Quincey est « un arpenteur des rues de Londres » et, un peu plus tard, la marche est majoritairement urbaine. On lit encore chez Walser que « marcher toujours sur la même route change le temps en espace », mais c’est surtout le labyrinthe de la ville nocturne qui favorise l’errance et la perte dans l’imaginaire. Pour Sebald écrire à propos de ses marches devient une manière particulière de voyager ; chaque motif en suscitant un autre, ses phrases s’étendent et semblent ne pas pouvoir s’achever, « écriture associative » analogue au mouvement de la marche. Si l’on pouvait conserver les traces de celles accomplies toute une vie, les marches constituaient bien, selon le mot de Borges donné en exergue, « un dessin sur le temps » ; passé impossible à conserver et que la marche a effacé, comme écrire effacerait la mémoire pour Iain Sinclair.
En alternance avec les marches lues, Cole Swensen écrit aussi les siennes, toutes nocturnes, en les datant, pour en garder la trace. Presque toutes sont des ruptures d’avec la vie ordinaire, diurne.
Virginia Woolf rencontrait un chat, que la nuit faisait disparaître, Cole Swensen en croise plusieurs qui avancent avec un but connu d’eux seuls, l’un simplement né d’un jeu de lumière. Elle se trouve dans un parc où un octogénaire lit un magazine près d’un bassin, à plusieurs reprises sur un pont, lieu d’observation d’où elle voit des scènes surprenantes. La marche nocturne permet des rencontres que le jour exclut, comme si la nuit était indispensable pour transformer les choses et les manières de se comporter, comme si tous les actes sociaux diurnes perdaient une partie de leur sens. Cole Swensen remarque que les mouettes « tournent sans but », mais également qu’à onze heures du soir beaucoup de monde est dans la rue et que « personne ne va nulle part. » Comme si marcher devait aboutir à se perdre.
Cole Swensen, Poèmes à pied, traduction Maïtreyi et Nicolas Pesquès, Corti, 2021, 120 p., 17 €. Cette recension a été publiée dans libr- critique.com le 19 juillet 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cole swensen, poèmes à pied, traduction maïtreyi et nicolas pesquès | ![]() Facebook |
Facebook |
11/07/2021
Philippe Jaccottet, La Clarté Notre-Dame : recension
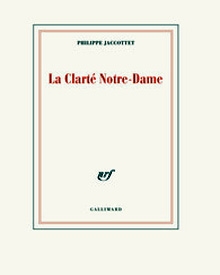
Philippe Jaccottet, disparu le 24 février, a pu préparer la publication de trois livres, Bonjour monsieur Courbet (le bruit du temps) qui rassemble des essais sur l’art, de l’âge roman à Paul Vergier, Le dernier livre de madrigaux et La Clarté Notre-Dame (Gallimard). Ce dernier livre rassemble cinq textes de dimension différente, écrits du 19 septembre 2012 au 6 septembre 2016 et suivis d’un post-scriptum du 7 juin 2020. Il s’agit d’un ensemble de réflexions autour de la fragilité de la condition humaine, de ce que l’écriture peut en dire, également du gouffre infranchissable entre la beauté du monde et les forces de destruction, entre la naissance toujours renouvelée de la nature et la « traversée impensable » qu’est la mort.
Ce qui « hante » Jaccottet depuis qu’il en a eu connaissance, c’est le récit d’un homme arrêté dans la Syrie de Bachar al-Assad, comme bien d’autres sans savoir pourquoi et qui, libéré de sa prison, traverse un couloir et entend les cris de ceux qui sont torturés. Le contraste entre la beauté des ruines de Palmyre — qui dissimulent peut-être prison souterraine et lieu de tortures — et ces cris rendent inutile cette beauté, ou plutôt empêchent de « croire encore aux enchantements », à la grâce de ce qui a subsisté d’une civilisation. La coexistence est impossible entre ce qui procure de la joie et une violence destructrice qui nie l’humain, comme si l’on se trouvait devant un mur infranchissable avec en outre le sentiment qu’il n’y a rien derrière.
Il est tout autant impossible de mettre de côté ces cris quand on entend le son de la cloche du couvent La Clarté Notre-Dame, point de départ de la méditation. Le son limpide, « cristallin », évoque l’eau d’un ruisseau, par exemple celle qui coule le long des jardins du couvent, et il est « à garder vivant comme un oiseau dans la paume de la main ». Il entraîne le surgissement de poèmes d’Hölderlin qui, précise Jaccottet, sont « au centre de ce qui m’a fait écrire » (1). Parmi ces poèmes, d’une « pureté (...) insensée », plusieurs associent l’eau vive et les oiseaux, « les deux messages privilégiés de la poésie » ; sont cités des vers de "Patmos", un des élégies : « Donne-nous une eau innocente / Oh donne-nous des ailes », et c’est la présence de l’oiseau qu’invoque Jaccottet pour la « traversée impensable », la mort.
Le son de la cloche est entendu pour la première fois en mars, dans la grisaille et le silence, dans un espace qui figure une « profonde absence », un vide, et il est perçu comme une parole qui ne peut être immédiatement comprise, « saisie », impossible à assimiler à des mots mais cependant entendu comme un « appel » ou un « rappel », appel bien réel pour les vêpres dans le couvent et voix vers le sacré pour Jaccottet. Il constate la continuité de ses écrits, citant ce qu’il écrivait en 1946, où apparaissaient l’eau vive dans la montagne, les sources qui « tintent ». Le souvenir de la montagne écrite conduit à celui d’un séjour à Soglio (dans le canton des Grisons), véritable « nid », « berceau » entouré de montagnes et lié aux écrits de Rilke, plus encore peut-être à ceux de Jouve, et dans ce lieu à la beauté « presque surnaturelle », les dents des montagnes figurent « le suspens prolongé d’une migration de grands oiseaux blancs ».
Il semble que l’écriture soit impuissante à restituer ce que l’on éprouve à entendre la cloche du couvent, de là l’emploi de « comme » et des analogies établies avec d’autres sensations : ce que l’on verrait enveloppé d’une averse de grésil ou au lever avec la rosée matinale. Tout se passe pour Jaccottet comme s’il avait été chargé de recueillir un ensemble de signes, signes attachés à la lumière, et toujours celle du printemps croît quand parallèlement, avec le grand âge, s’approche la mort. Cette proximité lui fait ressentit plus fortement le fait, écrit-il, de n’avoir pas compris « quoi que ce soit à quoi que ce soit ». Il a pu seulement noter des signes, « dont la singularité est d’être toujours infimes, fragiles, à peine saisissables », toutes ces rencontres de signes allant toutes dans le même sens, dirigées vers le Sacré, les Dieux, pour reprendre faute de mieux les métaphores d’Hölderlin. On peut avoir ét persuadé longtemps que tout poème, comme la liturgie, était plus nécessaire que l’utile, selon les mots de Cristina Campo ; cependant, l’effroi provoqué par les cris des torturés dévalue peut-être toute poésie. C’est pourquoi reviennent des poèmes qui portent des mots essentiels pour chacun, un haïku, des fragments de Claudel, Goethe, Leopardi, un vers encore de Hölderlin : « Énigme, ce qui sourd pur ».
Ces pages sont restées longtemps « en réserve », Jaccottet éprouvant le sentiment d’échouer à écrire ce qui devait l’être du réel, un doute persistant quant à la capacité de l’usage de la langue à en rendre compte. Peut-être n’y a-t-il pas de réponse à la fin de la vie, sans pourtant que toute poésie soit dévaluée. La certitude qu’il faut rechercher la beauté et des moments — fragiles — de lumière est toujours présente, me semble-t-il. Ainsi, le son de la cloche rapporte aussi au temps de l’enfance, rappelant le bruit de la clochette à l’entrée du jardin lors des visites à l’oncle au début de l’année. Ainsi en suivant le ruisseau, Jaccottet se souvient de la fin de L’Enfer où Virgile et Dante suivent un sentier qui monte vers les étoiles.
1 On se souvient que Jaccottet a dirigé l’édition des œuvres d’Hölderlin dans la Pléiade et en a traduit une partie
Philippe Jaccottet, La Clarté Notre-Dame, Gallimard, 2021, 48 p., 10 €. Cette recension a été publiée dans libr-critique le 6 juin 2021.
Publié dans Jaccottet Philippe, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
05/07/2021
Laurent Fourcaut, Dedans Dehors : recension
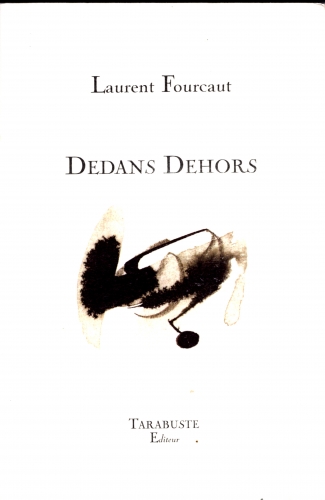
Quand il ne publie pas des études à propos de poètes (Apollinaire, Dominique Fourcade) et de romanciers (Giono, Simenon), Laurent Fourcaut écrit des sonnets. Cette forme, bien en usage encore depuis le début du XXe siècle (de Valéry à Queneau, Bonnefoy ou Jaccottet), connaît parfois des transformations, par exemple par Robert Marteau (sonnets non comptés non rimés) ou Jacques Roubaud (sonnets en prose). Elle est toujours vivante grâce à sa souplesse, même si l’on joue plus (Valérie Rouzeau) ou moins (Pierre Vinclair) avec les règles classiques de construction. Les sonnets de Laurent Fourcaut, pour la majorité d’entre eux, conservent avec quelques accommodements une forme (ABAB ABAB CCD EED) courante au XVIe siècle et y sont investis des motifs lyriques (la nature, le temps, l’amour), inscrits dans notre époque de manière très personnelle.
Le premier sonnet est comme un "programme" en bonne partie suivi dans les 158 sonnets du livre. Dans le tableau de Brueghel cité, Chasseurs dans la neige, comme dans un poème, le spectateur, le lecteur peuvent reconstruire un état du monde et y découvrir « le même fouillis que l’intenable vrai », le peintre, l’écrivain ayant eu le même « désir » de donner une forme au « périssable ». C’est de ce périssable que les sonnets se nourrissent, voué à la disparition et cependant se renouvelant sans cesse : l’œuvre exige de parcourir un « labyrinthe » (c’est le titre de ce premier sonnet) et c’est ce parcours qui « comble » l’auteur comme le lecteur. Ce qui, pour tous, se défait et renaît, ce sont les saisons, avec les changements de la lumière, des couleurs du ciel, des mouvements du vent et très nombreux sont les sonnets qui s’ouvrent avec une description d’éléments de la nature :
Le jour s’affaiblit vire tout doux dans les gris (sonnet 4)
Un vent fort et très froid le faux été est mort (sonnet 5)
L’air se charge d’une humidité grise et lourde (sonnet 126)
Le temps joue dans l’espace sa partie patiente (sonnet 127)
Au fil du livre on lit "Hiver", "Printemps", "De l’été", "Soleil couchant", "Saison" — un titre d’Apollinaire est repris pour le second sonnet, "Automne malade ", un autre de Baudelaire, "Harmonie du soir", et "Les merveilleux nuages" est une reprisse des derniers mots d’un poème en prose ("L’étranger"). En même temps que l’on retrouve au bord de la mer « la perpétuité du même », c’est la nature dans toute sa variété qui est sans cesse louée, la « radieuse fraîcheur dorée » du soir comme « la douceur de cette pluie petite », la rencontre d’une chouette le jour, de hérons « au dos de cendre » ou de marcassins avec la laie. Il n’est pas surprenant qu’apparaisse l’évocation d’une vie frugale, où l’on se contenterait d’olives et de galettes de blé — mais ce n’est pas le choix du narrateur.
Cette vie proche de la nature, possible en province, avec « les vrais gens » — la vie Dehors —, s’oppose complètement à ce qui est vécu Dedans, avec « l’hystérie urbaine » où les relations humaines sont mises à mal. D’un côté « le parfum de l’aubépine blanche », de l’autre « l’air puant pourri ». Tout est dit. La vie urbaine semble réunir tout ce qui est destruction, le bruit incessant, la pollution, la « fête de la marchandise » et les effets de la mondialisation, tout ce qui contribue aussi à ne plus être dans le réel et dans le temps, chacun « scotché sur son smartphone ». Cependant, pour qui vit en ville, les bistrots peuvent être perçus comme des refuges, où l’on boit une Leffe, un Sancerre, où le narrateur peut « lorgner les filles », admirer une « jolie Black » puisque « le leurre féminin / remplit une vie d’homme ». On peut aussi, dans certains quartiers ou dans les allées du Père Lachaise, retrouver des traces du passé, sortir ainsi d’un espace aux liens humains défaits. Mais l’opposition entre nature et grande ville (Paris) ne doit pas tromper : à propos de la nature, il faut faire « attention à ne pas se prendre les pieds dans l’œuvre » et ne pas revenir à un rousseauisme naïf : ce qui est en cause, c’est le « règne imbécile » de l’argent, l’aveuglement des hommes concernant leurs pratiques.
Revenons à ce qui est éloigné de la « bêtise au front d’argent », aux créations humaines. Baudelaire est encore présent dans les titres, cette fois implicitement, avec "L’informe d’une ville" qui renvoie à la seconde strophe du "Cygne", « (la forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel) », et l’on pense aussi au titre du livre de Jacques Roubaud qui remplace "mortel" par "humain". Le lecteur rassemblera d’autres allusions dans les titres qui inscrivent Dedans Dehors dans un ensemble littéraire ("La vie sans les plis" pour "La vie dans les plis", Michaux ; "Tempête sous les crânes", pour "Tempête sous un crâne", Hugo ; "Un balcon en ville" pour "Un balcon en forêt", Gracq, etc.). On repère également des références à des films ("Apocalypse now", Coppola ; implicitement, "Deux ou trois choses que je sais du réel", Godard, "Suzanne de 5 à 6", Varda ; etc.), à des chansons et des chanteurs (Eric Clapton ; "L’important c’est la rose", Bécaud), à des compositeurs et des interprètes, noms présents dans un titre ou dans un sonnet, de Bach à Glenn Gould, Al Jarreau, Erroll Garner et Herbie Hancock, à des peintres (Pissaro, Picasso). La littérature tient une place de choix avec des fragments de citations (« plein d’usage et de raison », l’« aboli bibelot », etc.) et des noms (Proust, Vailland, Verheggen, etc.) Relever noms et allusions n’aboutit pas à construire un catalogue mais à souligner le fait que les poèmes se construisent à partir, entre autres, d’une culture partagée et sans exclusive. On se rend compte, par ailleurs, que Laurent Fourcaut est aussi observateur du monde autour de lui, à Paris et en province — Dehors —, dans les bistrots qu’il fréquente — Dedans.
L’écriture des sonnets en vers de douze syllabes, très maîtrisée, entraîne le lecteur dans une histoire de la forme et de la langue. Laurent Fourcaut introduit dans un contexte contemporain le démonstratif médiéval cil (= celui-ci), mêle à un vocabulaire parfois recherché des mots connotés familiers ou argotiques, souvent propres à l’oral, (on est grave frustré, les meufs, en loucedé, c’est pas laid, roubignolles, morfler, etc.). Il utilise des licences classiques (certe, encor, jusques), joue avec les rejets : par exemple, pour une rime avec "réel", il propose "la coupe "él / égante" ; si besoin est, une syllabe est ajoutée après le vers 14 : la rime "creux / "chartreu" laisse "se" en vers 15 supplémentaire. On relèvera aussi quelques assonances ("novembre"/ "vendre", "infirme" / "grime", etc.), des allusions littéraires ("plumage"/"ramage") et des jeux de mots pas du tout innocents, comme "émirats" /"aime rat". Rien de ces détails n’interrompt évidemment la lecture, mais ce sont eux qui donnent à l’ensemble ce ton vif, revigorant propre à ses livres de sonnets.
Laurent Fourcaut, Dedans Dehors, Tarabuste, 2021, 178 p., 16 €. Cette recension a été publiée dans Poezibao le 31 mai 2021.
Labyrinthe
« Quelle vanité que la peinture » et pourtant
quoi de plus radicalement indispensable !
dans la matière d’une pâte un palpitant
désir de prendre forme au creux du périssable
Les Chasseurs dans la neige avec au loin l’étang
gelé marchant pour n’être pas bus par le sable
blanc d’où ces traces rouges d’un sang qui s’étend
capillarité rhizome en l’air insatiable
C’est le même fouillis que l’intenable vrai
mais de cette matière ne vous sèvrerait
nulle mère vous conservez l’initiative
de la perte ayant façonné ex nihilo
le labyrinthe convoité où tout vous prive
vous comble à l’aide de la brosse ou du stylo
Laurent Fourcaut, Dedans Dehors, p. 7.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent goutcaut, dedans dehors | ![]() Facebook |
Facebook |





