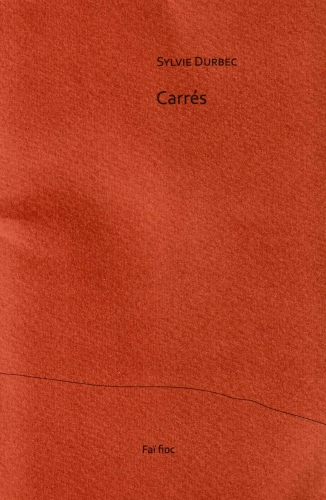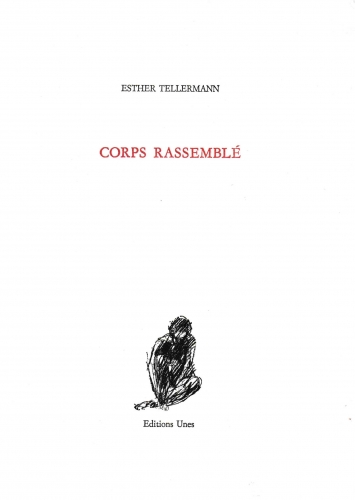05/07/2021
Laurent Fourcaut, Dedans Dehors : recension
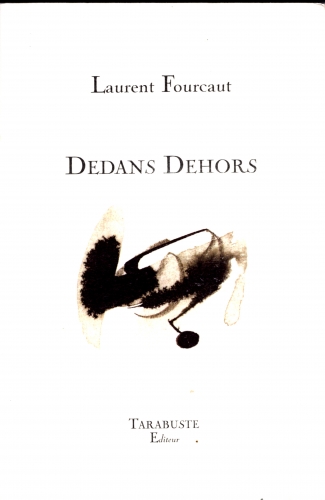
Quand il ne publie pas des études à propos de poètes (Apollinaire, Dominique Fourcade) et de romanciers (Giono, Simenon), Laurent Fourcaut écrit des sonnets. Cette forme, bien en usage encore depuis le début du XXe siècle (de Valéry à Queneau, Bonnefoy ou Jaccottet), connaît parfois des transformations, par exemple par Robert Marteau (sonnets non comptés non rimés) ou Jacques Roubaud (sonnets en prose). Elle est toujours vivante grâce à sa souplesse, même si l’on joue plus (Valérie Rouzeau) ou moins (Pierre Vinclair) avec les règles classiques de construction. Les sonnets de Laurent Fourcaut, pour la majorité d’entre eux, conservent avec quelques accommodements une forme (ABAB ABAB CCD EED) courante au XVIe siècle et y sont investis des motifs lyriques (la nature, le temps, l’amour), inscrits dans notre époque de manière très personnelle.
Le premier sonnet est comme un "programme" en bonne partie suivi dans les 158 sonnets du livre. Dans le tableau de Brueghel cité, Chasseurs dans la neige, comme dans un poème, le spectateur, le lecteur peuvent reconstruire un état du monde et y découvrir « le même fouillis que l’intenable vrai », le peintre, l’écrivain ayant eu le même « désir » de donner une forme au « périssable ». C’est de ce périssable que les sonnets se nourrissent, voué à la disparition et cependant se renouvelant sans cesse : l’œuvre exige de parcourir un « labyrinthe » (c’est le titre de ce premier sonnet) et c’est ce parcours qui « comble » l’auteur comme le lecteur. Ce qui, pour tous, se défait et renaît, ce sont les saisons, avec les changements de la lumière, des couleurs du ciel, des mouvements du vent et très nombreux sont les sonnets qui s’ouvrent avec une description d’éléments de la nature :
Le jour s’affaiblit vire tout doux dans les gris (sonnet 4)
Un vent fort et très froid le faux été est mort (sonnet 5)
L’air se charge d’une humidité grise et lourde (sonnet 126)
Le temps joue dans l’espace sa partie patiente (sonnet 127)
Au fil du livre on lit "Hiver", "Printemps", "De l’été", "Soleil couchant", "Saison" — un titre d’Apollinaire est repris pour le second sonnet, "Automne malade ", un autre de Baudelaire, "Harmonie du soir", et "Les merveilleux nuages" est une reprisse des derniers mots d’un poème en prose ("L’étranger"). En même temps que l’on retrouve au bord de la mer « la perpétuité du même », c’est la nature dans toute sa variété qui est sans cesse louée, la « radieuse fraîcheur dorée » du soir comme « la douceur de cette pluie petite », la rencontre d’une chouette le jour, de hérons « au dos de cendre » ou de marcassins avec la laie. Il n’est pas surprenant qu’apparaisse l’évocation d’une vie frugale, où l’on se contenterait d’olives et de galettes de blé — mais ce n’est pas le choix du narrateur.
Cette vie proche de la nature, possible en province, avec « les vrais gens » — la vie Dehors —, s’oppose complètement à ce qui est vécu Dedans, avec « l’hystérie urbaine » où les relations humaines sont mises à mal. D’un côté « le parfum de l’aubépine blanche », de l’autre « l’air puant pourri ». Tout est dit. La vie urbaine semble réunir tout ce qui est destruction, le bruit incessant, la pollution, la « fête de la marchandise » et les effets de la mondialisation, tout ce qui contribue aussi à ne plus être dans le réel et dans le temps, chacun « scotché sur son smartphone ». Cependant, pour qui vit en ville, les bistrots peuvent être perçus comme des refuges, où l’on boit une Leffe, un Sancerre, où le narrateur peut « lorgner les filles », admirer une « jolie Black » puisque « le leurre féminin / remplit une vie d’homme ». On peut aussi, dans certains quartiers ou dans les allées du Père Lachaise, retrouver des traces du passé, sortir ainsi d’un espace aux liens humains défaits. Mais l’opposition entre nature et grande ville (Paris) ne doit pas tromper : à propos de la nature, il faut faire « attention à ne pas se prendre les pieds dans l’œuvre » et ne pas revenir à un rousseauisme naïf : ce qui est en cause, c’est le « règne imbécile » de l’argent, l’aveuglement des hommes concernant leurs pratiques.
Revenons à ce qui est éloigné de la « bêtise au front d’argent », aux créations humaines. Baudelaire est encore présent dans les titres, cette fois implicitement, avec "L’informe d’une ville" qui renvoie à la seconde strophe du "Cygne", « (la forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel) », et l’on pense aussi au titre du livre de Jacques Roubaud qui remplace "mortel" par "humain". Le lecteur rassemblera d’autres allusions dans les titres qui inscrivent Dedans Dehors dans un ensemble littéraire ("La vie sans les plis" pour "La vie dans les plis", Michaux ; "Tempête sous les crânes", pour "Tempête sous un crâne", Hugo ; "Un balcon en ville" pour "Un balcon en forêt", Gracq, etc.). On repère également des références à des films ("Apocalypse now", Coppola ; implicitement, "Deux ou trois choses que je sais du réel", Godard, "Suzanne de 5 à 6", Varda ; etc.), à des chansons et des chanteurs (Eric Clapton ; "L’important c’est la rose", Bécaud), à des compositeurs et des interprètes, noms présents dans un titre ou dans un sonnet, de Bach à Glenn Gould, Al Jarreau, Erroll Garner et Herbie Hancock, à des peintres (Pissaro, Picasso). La littérature tient une place de choix avec des fragments de citations (« plein d’usage et de raison », l’« aboli bibelot », etc.) et des noms (Proust, Vailland, Verheggen, etc.) Relever noms et allusions n’aboutit pas à construire un catalogue mais à souligner le fait que les poèmes se construisent à partir, entre autres, d’une culture partagée et sans exclusive. On se rend compte, par ailleurs, que Laurent Fourcaut est aussi observateur du monde autour de lui, à Paris et en province — Dehors —, dans les bistrots qu’il fréquente — Dedans.
L’écriture des sonnets en vers de douze syllabes, très maîtrisée, entraîne le lecteur dans une histoire de la forme et de la langue. Laurent Fourcaut introduit dans un contexte contemporain le démonstratif médiéval cil (= celui-ci), mêle à un vocabulaire parfois recherché des mots connotés familiers ou argotiques, souvent propres à l’oral, (on est grave frustré, les meufs, en loucedé, c’est pas laid, roubignolles, morfler, etc.). Il utilise des licences classiques (certe, encor, jusques), joue avec les rejets : par exemple, pour une rime avec "réel", il propose "la coupe "él / égante" ; si besoin est, une syllabe est ajoutée après le vers 14 : la rime "creux / "chartreu" laisse "se" en vers 15 supplémentaire. On relèvera aussi quelques assonances ("novembre"/ "vendre", "infirme" / "grime", etc.), des allusions littéraires ("plumage"/"ramage") et des jeux de mots pas du tout innocents, comme "émirats" /"aime rat". Rien de ces détails n’interrompt évidemment la lecture, mais ce sont eux qui donnent à l’ensemble ce ton vif, revigorant propre à ses livres de sonnets.
Laurent Fourcaut, Dedans Dehors, Tarabuste, 2021, 178 p., 16 €. Cette recension a été publiée dans Poezibao le 31 mai 2021.
Labyrinthe
« Quelle vanité que la peinture » et pourtant
quoi de plus radicalement indispensable !
dans la matière d’une pâte un palpitant
désir de prendre forme au creux du périssable
Les Chasseurs dans la neige avec au loin l’étang
gelé marchant pour n’être pas bus par le sable
blanc d’où ces traces rouges d’un sang qui s’étend
capillarité rhizome en l’air insatiable
C’est le même fouillis que l’intenable vrai
mais de cette matière ne vous sèvrerait
nulle mère vous conservez l’initiative
de la perte ayant façonné ex nihilo
le labyrinthe convoité où tout vous prive
vous comble à l’aide de la brosse ou du stylo
Laurent Fourcaut, Dedans Dehors, p. 7.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent goutcaut, dedans dehors | ![]() Facebook |
Facebook |
13/05/2021
Sylvie Durbec, Carrés : recension
On ne s’habitue pas à lire une poésie qui se contente, pour reprendre Jacques Réda, « d’aller à la ligne », sans que l’on repère un rythme quelconque, et l’on retrouve toujours avec plaisir la lecture de poèmes avec des contraintes d’organisation, même s’il ne s’agit pas de vers comptés, rimés ou non. Sylvie Durbec choisit dans ses proses de les inscrire dans un carré, contrainte arbitraire qu’elle présente analogue à celle « que l’on se donne marchant sur un trottoir de ne pas mettre le pied sur la ligne ». Mais ce n’est pas la seule qu’elle s’invente dans les cinquante carrés, plus un « en guise d’au revoir », de son livre.
Toutes les proses se terminent par le mot "carré", substantif ou (11 fois) adjectif — sauf dans "carré zutique" où la figure géométrique, de dimension réduite, est de guingois avec un angle sur ce qui aurait été un côté du carré normal. Quelques carrés comptent une ligne de trop et l’une des figures, "carré compact", est un rectangle : il s’agit de la prose ouverte avec une citation de Peter Handke ; c’est la seconde contrainte qui donne une unité au livre, chaque texte comprenant le nom du romancier, ou une périphrase (« le romancier autrichien »), ou une citation, ou une allusion à un livre. Enfin, toutes les proses contiennent la suite « comme ça » et un Cmajuscule, alors que l’ensemble est sans majuscule « pour dire non à la hiérarchie » et « sans ponctuation pour que le lecteur s’égare ». Si le lecteur s’égarait, ce serait pour d’autres motifs, la construction très rythmée suppléant presque toujours à l’absence de toute démarcation dans le texte.
À côté du nom "handke" (en minuscules, comme tous les noms de personne) et de commentaires à partir de ses textes (« rêver handke écrirait rêvasser ce serait bien mieux »), d’autres noms d’écrivains apparaissent, parfois avec un contexte : « On lit azam » (d’où ailleurs « azamesque ») — Sylvie Durbec a illustré un livre d’Édith Azam —, « rousseau parlait en marchant » ; la mort de Barthes dans la rue est évoquée, comme les broussailles de James Sacré et les non-lieux de Perec ; mais es noms sont aussi simplement cités, références de l’auteure, Dickinson, Walser, Sebald. Lisant « Capitales des douleurs », on pense à Éluard (Capitale de la douleur) et « chien stupide » appelle le nom de John Fante (My Dog Stupid). C’est Chaïm Soutine qui semble pouvoir traduire par la peinture de manière satisfaisante les variations de sentiment, « un seul tableau de soutine et tout en est violemment éclairci ou assombri ça dépend de l’endroit où l’on se tient chaïm ».
Carrés a les caractéristiques d’un Journal, Sylvie Durbec évoquant sa ville natale (Marseille) et rapportant souvent des moments de la vie de tous les jours, notamment sa relation avec les éléments naturels. Après carré un et carré deux, carré éden porte sur la transformation d’un lieu « boueux » en éden grâce aux fleurs semées et ce thème est récurrent. C’est dans une caravane placée dans le jardin qu’elle se réfugie pour écrire et qui lui donne la possibilité de s’isoler — « vieillesse solitude lecture goûter au paradis sans compagnie ». Ce faisant elle peut renouer avec le temps de l’enfance, temps de la cabane et de la lecture d’illustrés, temps où les enfants n’avaient pas le droit d’approcher le bureau du grand-père. Dans ce « monde très ancien », les choses avaient un aspect que l’on ne reconnaît plus, le bureau si impressionnant hier n’est aujourd’hui qu’un meuble comme un autre.
Carrés contient aussi une partie des usages du mot "carré" ; d’abord, tout le livre est composé de « carrés » d’écriture, analogues aux divisions du jardin en carrés et où « subsiste », pour poursuivre la métaphore, « le fouillis de broussailles chères à James Sacré ». C’est aussi la parcelle pour la pierre tombale et Sylvie Durbec, évoquant Perec, se souvient que pour lui le carré ressemble à une chambre ; de là le passage aux sinistres chambres à gaz et — pour en éloigner l’image ? — le souvenir d’enfance des petits carrés Gervais, « ces fromages frais que nous mangions enfants au goûter (...) avec les petits suisses ronds ». Pour compléter les emplois du mot est évoqué « le mouchoir de batiste (...) carré de fil négligemment noué ».
Sylvie Durbec est attentive au vocabulaire, pensant même qu’il serait bon d’énumérer les mots « méprisés », en en citant quelques-uns liés à la vie quotidienne (pain, vinaigre) et à des fonctions du corps (urine, dent de devant). Elle s’interroge ici et là sur l’usage des mots (« dit-on encore ce mot [fichtre] pas plus que foutre ») et elle-même les associe pour les faire entendre autrement : plaisir des homophonies (s’en fiche / sans fiche) et des paronomases (branches/bronches), goût pour les allitérations (gouffre, grotte, gorge, rouge, manganèse), avec par exemple un commentaire à propos du B, « B la bienveillante aux deux petits ventres bedon bedaine rigodon dondaine brume boueuse brouillard au-dessus de la vézère brou de noix elle est comme ça cette lettre [etc.]».
Dans les proses de Sylvie Durbec le temps passé est évoqué sans regret, c’est plutôt l’incertitude des jours présents et à venir qui l’inquiètent ; pensant à un tableau de Van Gogh où deux personnages sont « en grande conversation », la narratrice commente « plus je me rapproche de la fin moins j’ai de chance de les entendre ». Cependant, le jardin, le paysage, le visible sont toujours là pour sauver les jours, comme chez Handke : « le fou de champignons », dans le "carré" final, renvoie au livre Essai sur le fou de champignons, Une histoire en soi, traduit en 2017.
Sylvie Durbec, Carrés, Faï fioc, 2021, 72 p., 11 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 25 mars 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sylvie durbec, carrés : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
01/05/2021
Esther Tellermann, Corps rassemblé : recension
Les échanges entre écrivain et peintre sont toujours passionnants, pas plus le peintre n’illustre un texte que l’écrivain ne décrit un tableau — laissons de côté une fascination qui aboutit parfois à des monographies autour de tableaux —, écrit et peinture forment un tout, construire l’unité de l’ensemble reste complexe. Corps rassemblé se distingue par sa singularité : Les 121 poèmes ont été composés, comme le précise Esther Tellerman à la fin, sur une page isolée, « après les visites du 21 avril 2017 et des 17 juillet, 1er et 28 août 2019 à l’atelier et au domicile du peintre Claude Garache. » La relation au travail du peintre apparaît dans le titre quand on sait qu’il peint des corps nus de femmes, sans aucun décor, Corps rassemblé c’est-à-dire corps devenu lui-même, dans son équilibre et déséquilibre, donc sa présence.
Le jeu des pronoms — je, il, vous, nous — est très souvent ambigu, cependant le peintre est bien présent dans le livre, avec des paroles rapportées, « Le rouge est un peu / trop fort sur l’épaule », remarque reprise sans les guillemets de citation. Il semble même prendre la parole et préciser une manière de travailler quand on lit, « Pour vous j’inventais des enduits que / perce / la transparence », comme s’il s’adressait avec le "vous" aux nus des toiles. Cette recherche de la transparence (mot récurrent) lui est d’ailleurs attribuée par la narratrice, « Il voulait que / le corps manifeste / l’évidence ». Plus largement on relève une série de mots propre au vocabulaire du peintre, comme "châssis, "cadre", "glacis", "pigment", et le premier poème ouvre sur l’esquisse d’un tableau avec « la forme / rouge /près de 3 pinceaux / dans le carmin ». ; par la suite, des noms de couleur reviennent (bleu, jaune, vert, gris, blanc), toujours liés aux tableaux de Claude Garache.
Le plus souvent peints en rouge, les corps nus le sont dans des poses variées (« une pose accroupie », par exemple) et toujours appartiennent au vivant, parfois comme s’ils étaient prêts à sortir du cadre (« Sœur nage / soudain cogne / le châssis »). La proximité avec une femme présente peut être encore accentuée puisque l’on voit « entre les cuisses un filet de sang », puisque cette figure nue « répand la musique », que les formes vibrent, que devant elles on ne peut qu’être fasciné : « elles absorbent qui les regarde ». Le corps nu est aussi corps de désir, non pas seulement par la représentation du sexe — « la fissure », « le triangle » —, mais parce qu’il n’est pas qu’une image, vu comme « la brûlure du dessous », parce que tout ce que le corps nu vivant manifeste est lié au désir, ainsi « l’odeur des aisselles / des sueurs âcres ». Ces corps proches appellent une série d’associations et une sortie de la peinture.
Les mots de « légende », de « conte » (« un conte frémit au bas des reins ») orientent vers des constructions de l’imaginaire — « là palpitent des / chemins / de forêts bleues » —, chemins nombreux où les nus suscitent des « métamorphoses », où le féminin est premier. Ici c’est l’image de la Sybille, la femme prophétesse, qui s’impose vigoureusement, « Il fallut / les Sybille / crevant la surface / et les pigments broyés ». Une autre, ce que préparait l’appellation de « sœur », est la figure d’Ariane (« ô sœur Ariane ») et, par touches successives, c’est son sort qui est rappelé, « Ariane fut-elle / rugueuse ou / douce / qui l’abandonne ». Sort tragique peut-être à nouveau évoqué à la fin d’un autre poème avec « vous la laissiez au bord », qui reporte le lecteur à la Phèdre (I, 3) de Racine, « Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée », « vous » renvoyant aussi bien au Thésée de la fable qu’au peintre, réalité des tableaux et sortie dans l’imaginaire étant toujours étroitement mêlés. Ainsi, les motifs de l’oubli et de la mémoire conduisent à l’enfance, « une oasis / qui perdure / et sombre » et l’on ne peut s’empêcher de retourner à la fable et de reconnaître l’enfant Moïse quand on lit « le berceau / appelle des esquifs / qui l’emportent ».
L’ensemble compose un récit à partir des corps nus de Claude Garache — « il inventa le corps / qui respire » ; récit qui débute par l’alternance passé simple-imparfait caractéristique, même si elle est abandonnée ensuite. Récit des tableaux sans autres personnages que les corps et ce qu’ils suggèrent : les espaces se font et se défont, changeant à peine mis en place et des ruptures interviennent dans le temps avec « soudain », « tout à coup », comme est donnée aussi une continuité avec « puis ». Toute une série de mots (« oubli », « transparence », « ombre », « orage ») et de fragments de phrases participent à l’unité de l’ensemble ; ainsi, « un sexe posé sur / l’inquiétude » (p. 12) est repris avec une variation, « le sexe posé / sur l’inquiétude » (p. 70), on lit trois fois « dans l’instant / qu’irradie la durée » (p. 14, 86, 110) ; etc. Dans ces courts poèmes au vers très brefs pas toujours alignés, caractéristiques de l’écrire d’Esther Tellermann, on repère ici et là quelques paronomases, celle-ci avec un des mots récurrents de son écriture, « désirs d’ombres et d’ambres ». On laissera un moment la complexité du récit pour la simplicité, toujours, des poèmes, et la beauté de ce "corps rassemblé" dans le dernier poème :
Face au visible
que signifie
la justesse
de la fleur ?
Aujourd’hui de nouveau
illumine
les effluves
de mémoire
pour une floraison
qui jamais ne s’éteint
jamais
ne s’enlise
parmi les ronces
Esther Tellermann, Corps rassemblé, éditions Unes, 2020, 128 p., 21 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 11 mars.
Publié dans RECENSIONS, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, corps rassemblé | ![]() Facebook |
Facebook |
22/04/2021
Julien Gracq, Nœuds de vie : recension

Bernhild Boie, responsable de la publication dans la Pléiade des œuvres de Gracq, a puisé, pour construire Nœuds de vie, parmi les fragments de prose conservés dans le fonds déposé à la Bibliothèque nationale. Pour conserver les habitudes de l’écrivain, elle a divisé le livre en quatre chapitres, dont les « contours (...) restent flous, (les) frontières poreuses » : "Chemins et rues", "Instants", "Lire", "Écrire" ; chaque chapitre, à la place d’un exergue, s’ouvre avec une photographie empruntée aux archives de Gracq. On retrouve dans ces proses les thèmes et l’écriture des Lettrines, des Carnets du grand chemin, l’aigu du regard dans l’observation du monde et des choses de la vie, les sorties régulières dans l’imaginaire.
Personne ne restitue jamais par l’écriture un paysage "tel qu’il est", chez Gracq l’espace est souvent perçu en mouvement, de nature complexe, ce qu’un simple "comme" introduit ; un soir, quand il se déplace en Sologne, il semble que l’eau est à l’origine de l’obscurité, « la nuit gagnait peu à peu comme la crue d’un étang noir ». La nuit aidant, la transformation des choses se développe : les yeux « de bête luminescents » devinés sur les côtés de la route sont « comme ceux qui brûlent dans les grands fonds de la mer » : ces passages du vivant d’un milieu de vie à un autre, conduisent au conte de fées, conte qui s’achève avec l’arrivée en ville au sortir de la forêt. La confusion des bruits de la forêt et de ceux de la mer revient régulièrement, on parle pour les bois de « son air compact et vert d’aquarium », de « fosse marine » et même les noms signalés aux carrefours « enflent en vague dans la conque du silence une rumeur submergeante de cloche sourde et de coquille marine ».
Une autre forme de passage peut produire dans la réalité un « déclic magique » analogue à celui que donne le rêve, la découverte d’un sentier ignoré : est franchie « une porte clandestine », « un passage caché » et c’est alors pour le promeneur une traversée du miroir — « comme lorsque, dans le château enchanté des contes (...) » —, et à sa disposition l’« excès dans le don ». Mais ce regard sur l’environnement est de moins en moins partagé. Gracq remarquait qu’avec le temps la relation de la plupart des habitants à la nature disparaît, il constatait qu’en 1978 seule une minorité dans un village cultivait encore un potager : la pelouse avait remplacé les légumes et l’éloignement de la nature était irréversible, quelles que soient les « jérémiades écologiques ».
Ces changements, survenus en quelques décennies, l’écrivain les notait dans d’autres domaines, par exemple dans l’usage de l’outillage le plus répandu aujourd’hui pour écrire. Le choix de refuser l’ordinateur et ce qui lui est attaché, mais également la « promotion » de ses livres, me rangent, écrivait-il avec humour, parmi les « survivances folkloriques » après du « pain Poilâne et du jambon fumé chez l’habitant ». Les décalages entre ses pratiques et l’air du temps expliquent qu’il y a quelque chose de désabusé dans ses remarques à propos de la littérature de son temps ; après 1945, elle n’a fait selon lui que proposer des variations sur des thèmes anciens, souffrant, comme en politique, d’une « crise de l’expression ». « L’univers littéraire » lui apparaissait « en voie d’éclatement », et notamment la poésie, où s’étaient développés progressivement des « univers clos » sans aucun lien entre eux ; pour la critique, ce ne sont plus le désir et l’exigence du lecteur qui seraient premiers mais une lecture conçue, comme « un champ d’investigations, c’est-à-dire, comme elle dit, la substitution au voyage de la carte routière ». Pour ce qui est de l’enseignement de la littérature, qui se refuse à toucher aux « anciennes momies » — pourtant, « Qui lit Homère ? Qui lit Pindare ? » —, il a abouti à leur rejet par les lycéens qui ne veulent plus "commenter" que « Boris Vian, Charlie Hebdo et les bandes dessinées ».
Gracq, lui, s’il n’avait lu de l’Ulysse de Joyce que des fragments (« admirable ouverture »), s’interrogeait sur ce qui lui faisait apprécier tel écrivain, les « qualités visuelles » de Colette, la prédominance « du détail sur l’ensemble » chez Proust, le « génie de grand rhétoriqueur » de Lautréamont, etc. Analysant ce qu’avait été la réception de Ponge, d’abord encensé par Sartre, puis un temps par « le tandem Barthes-Sollers », Gracq craignait que cette œuvre ne soit plus lisible dans l’avenir : en 1976, déjà, « la langue, son support unique, se décolore, se désarticule et s’en va ».
Ces transformations rapides de la langue, qui empêchent dans les années 1970 de penser qu’un livre pourra être lu un siècle plus tard, Gracq les vivait, pensant qu’en France le « support linguistique pourrit (...) à vue d’œil ». Cela ne le détournait pas de l’écriture qu’il assurait pratiquer « en amateur » : l’écrivain professionnel, qui ne cesse d’écrire, accepte de n’être « à chaque instant littéralement que ce que l’écriture va tirer » de lui, position intenable pour Gracq. Il écrivait en amateur, c’est-à-dire qu’il était "celui qui aime", et ce qu’il voulait exprimer ce sont d’abord des « nœuds de vie », « Une sorte d’entrelacement intime et isolé, autour duquel flotte le sentiment de plénitude et de l’être-ensemble ». Cela implique une « réussite de forme », un accord entre son et sens, manière peut-être d’aboutir à la « saisie d’une vérité ».
Bernhild Boie, responsable de la publication dans la Pléiade des œuvres de Gracq, a puisé, pour construire Nœuds de vie, parmi les fragments de prose conservés dans le fonds déposé à la Bibliothèque nationale. Pour conserver les habitudes de l’écrivain, elle a divisé le livre en quatre chapitres, dont les « contours (...) restent flous, (les) frontières poreuses » : "Chemins et rues", "Instants", "Lire", "Écrire" ; chaque chapitre, à la place d’un exergue, s’ouvre avec une photographie empruntée aux archives de Gracq. On retrouve dans ces proses les thèmes et l’écriture des Lettrines, des Carnets du grand chemin, l’aigu du regard dans l’observation du monde et des choses de la vie, les sorties régulières dans l’imaginaire.
Personne ne restitue jamais par l’écriture un paysage "tel qu’il est", chez Gracq l’espace est souvent perçu en mouvement, de nature complexe, ce qu’un simple "comme" introduit ; un soir, quand il se déplace en Sologne, il semble que l’eau est à l’origine de l’obscurité, « la nuit gagnait peu à peu comme la crue d’un étang noir ». La nuit aidant, la transformation des choses se développe : les yeux « de bête luminescents » devinés sur les côtés de la route sont « comme ceux qui brûlent dans les grands fonds de la mer » : ces passages du vivant d’un milieu de vie à un autre, conduisent au conte de fées, conte qui s’achève avec l’arrivée en ville au sortir de la forêt. La confusion des bruits de la forêt et de ceux de la mer revient régulièrement, on parle pour les bois de « son air compact et vert d’aquarium », de « fosse marine » et même les noms signalés aux carrefours « enflent en vague dans la conque du silence une rumeur submergeante de cloche sourde et de coquille marine ».
Une autre forme de passage peut produire dans la réalité un « déclic magique » analogue à celui que donne le rêve, la découverte d’un sentier ignoré : est franchie « une porte clandestine », « un passage caché » et c’est alors pour le promeneur une traversée du miroir — « comme lorsque, dans le château enchanté des contes (...) » —, et à sa disposition l’« excès dans le don ». Mais ce regard sur l’environnement est de moins en moins partagé. Gracq remarquait qu’avec le temps la relation de la plupart des habitants à la nature disparaît, il constatait qu’en 1978 seule une minorité dans un village cultivait encore un potager : la pelouse avait remplacé les légumes et l’éloignement de la nature était irréversible, quelles que soient les « jérémiades écologiques ».
Ces changements, survenus en quelques décennies, l’écrivain les notait dans d’autres domaines, par exemple dans l’usage de l’outillage le plus répandu aujourd’hui pour écrire. Le choix de refuser l’ordinateur et ce qui lui est attaché, mais également la « promotion » de ses livres, me rangent, écrivait-il avec humour, parmi les « survivances folkloriques » après du « pain Poilâne et du jambon fumé chez l’habitant ». Les décalages entre ses pratiques et l’air du temps expliquent qu’il y a quelque chose de désabusé dans ses remarques à propos de la littérature de son temps ; après 1945, elle n’a fait selon lui que proposer des variations sur des thèmes anciens, souffrant, comme en politique, d’une « crise de l’expression ». « L’univers littéraire » lui apparaissait « en voie d’éclatement », et notamment la poésie, où s’étaient développés progressivement des « univers clos » sans aucun lien entre eux ; pour la critique, ce ne sont plus le désir et l’exigence du lecteur qui seraient premiers mais une lecture conçue, comme « un champ d’investigations, c’est-à-dire, comme elle dit, la substitution au voyage de la carte routière ». Pour ce qui est de l’enseignement de la littérature, qui se refuse à toucher aux « anciennes momies » — pourtant, « Qui lit Homère ? Qui lit Pindare ? » —, il a abouti à leur rejet par les lycéens qui ne veulent plus "commenter" que « Boris Vian, Charlie Hebdo et les bandes dessinées ».
Gracq, lui, s’il n’avait lu de l’Ulysse de Joyce que des fragments (« admirable ouverture »), s’interrogeait sur ce qui lui faisait apprécier tel écrivain, les « qualités visuelles » de Colette, la prédominance « du détail sur l’ensemble » chez Proust, le « génie de grand rhétoriqueur » de Lautréamont, etc. Analysant ce qu’avait été la réception de Ponge, d’abord encensé par Sartre, puis un temps par « le tandem Barthes-Sollers », Gracq craignait que cette œuvre ne soit plus lisible dans l’avenir : en 1976, déjà, « la langue, son support unique, se décolore, se désarticule et s’en va ».
Ces transformations rapides de la langue, qui empêchent dans les années 1970 de penser qu’un livre pourra être lu un siècle plus tard, Gracq les vivait, pensant qu’en France le « support linguistique pourrit (...) à vue d’œil ». Cela ne le détournait pas de l’écriture qu’il assurait pratiquer « en amateur » : l’écrivain professionnel, qui ne cesse d’écrire, accepte de n’être « à chaque instant littéralement que ce que l’écriture va tirer » de lui, position intenable pour Gracq. Il écrivait en amateur, c’est-à-dire qu’il était "celui qui aime", et ce qu’il voulait exprimer ce sont d’abord des « nœuds de vie », « Une sorte d’entrelacement intime et isolé, autour duquel flotte le sentiment de plénitude et de l’être-ensemble ». Cela implique une « réussite de forme », un accord entre son et sens, manière peut-être d’aboutir à la « saisie d’une vérité ».
Julien Gracq, Nœuds de vie, avant-,propos de Bernhild Boie, Corti, 2021, 176 p., 18 € . Cette recension a été publiée par Sitaudis.
Gracq, Nœuds de vie, avant-propos de Bernhild Boie, Corti, 2021, 176 p., 18 € Cette recension a été publiée par Sitaudis.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, nœuds de vie, avant-, propos de bernhild boie | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2021
Julien Gracq, Nœuds de vie : recension

Bernhild Boie, responsable de la publication dans la Pléiade des œuvres de Gracq, a puisé, pour construire Nœuds de vie, parmi les fragments de prose conservés dans le fonds déposé à la Bibliothèque nationale. Pour conserver les habitudes de l’écrivain, elle a divisé le livre en quatre chapitres, dont les « contours (...) restent flous, (les) frontières poreuses » : "Chemins et rues", "Instants", "Lire", "Écrire" ; chaque chapitre, à la place d’un exergue, s’ouvre avec une photographie empruntée aux archives de Gracq. On retrouve dans ces proses les thèmes et l’écriture des Lettrines, des Carnets du grand chemin, l’aigu du regard dans l’observation du monde et des choses de la vie, les sorties régulières dans l’imaginaire.
Personne ne restitue jamais par l’écriture un paysage "tel qu’il est", chez Gracq l’espace est souvent perçu en mouvement, de nature complexe, ce qu’un simple "comme" introduit ; un soir, quand il se déplace en Sologne, il semble que l’eau est à l’origine de l’obscurité, « la nuit gagnait peu à peu comme la crue d’un étang noir ». La nuit aidant, la transformation des choses se développe : les yeux « de bête luminescents » devinés sur les côtés de la route sont « comme ceux qui brûlent dans les grands fonds de la mer » : ces passages du vivant d’un milieu de vie à un autre, conduisent au conte de fées, conte qui s’achève avec l’arrivée en ville au sortir de la forêt. La confusion des bruits de la forêt et de ceux de la mer revient régulièrement, on parle pour les bois de « son air compact et vert d’aquarium », de « fosse marine » et même les noms signalés aux carrefours « enflent en vague dans la conque du silence une rumeur submergeante de cloche sourde et de coquille marine ».
Une autre forme de passage peut produire dans la réalité un « déclic magique » analogue à celui que donne le rêve, la découverte d’un sentier ignoré : est franchie « une porte clandestine », « un passage caché » et c’est alors pour le promeneur une traversée du miroir — « comme lorsque, dans le château enchanté des contes (...) » —, et à sa disposition l’« excès dans le don ». Mais ce regard sur l’environnement est de moins en moins partagé. Gracq remarquait qu’avec le temps la relation de la plupart des habitants à la nature disparaît, il constatait qu’en 1978 seule une minorité dans un village cultivait encore un potager : la pelouse avait remplacé les légumes et l’éloignement de la nature était irréversible, quelles que soient les « jérémiades écologiques ».
Ces changements, survenus en quelques décennies, l’écrivain les notait dans d’autres domaines, par exemple dans l’usage de l’outillage le plus répandu aujourd’hui pour écrire. Le choix de refuser l’ordinateur et ce qui lui est attaché, mais également la « promotion » de ses livres, me rangent, écrivait-il avec humour, parmi les « survivances folkloriques » après du « pain Poilâne et du jambon fumé chez l’habitant ». Les décalages entre ses pratiques et l’air du temps expliquent qu’il y a quelque chose de désabusé dans ses remarques à propos de la littérature de son temps ; après 1945, elle n’a fait selon lui que proposer des variations sur des thèmes anciens, souffrant, comme en politique, d’une « crise de l’expression ». « L’univers littéraire » lui apparaissait « en voie d’éclatement », et notamment la poésie, où s’étaient développés progressivement des « univers clos » sans aucun lien entre eux ; pour la critique, ce ne sont plus le désir et l’exigence du lecteur qui seraient premiers mais une lecture conçue, comme « un champ d’investigations, c’est-à-dire, comme elle dit, la substitution au voyage de la carte routière ». Pour ce qui est de l’enseignement de la littérature, qui se refuse à toucher aux « anciennes momies » — pourtant, « Qui lit Homère ? Qui lit Pindare ? » —, il a abouti à leur rejet par les lycéens qui ne veulent plus "commenter" que « Boris Vian, Charlie Hebdo et les bandes dessinées ».
Gracq, lui, s’il n’avait lu de l’Ulysse de Joyce que des fragments (« admirable ouverture »), s’interrogeait sur ce qui lui faisait apprécier tel écrivain, les « qualités visuelles » de Colette, la prédominance « du détail sur l’ensemble » chez Proust, le « génie de grand rhétoriqueur » de Lautréamont, etc. Analysant ce qu’avait été la réception de Ponge, d’abord encensé par Sartre, puis un temps par « le tandem Barthes-Sollers », Gracq craignait que cette œuvre ne soit plus lisible dans l’avenir : en 1976, déjà, « la langue, son support unique, se décolore, se désarticule et s’en va ».
Ces transformations rapides de la langue, qui empêchent dans les années 1970 de penser qu’un livre pourra être lu un siècle plus tard, Gracq les vivait, pensant qu’en France le « support linguistique pourrit (...) à vue d’œil ». Cela ne le détournait pas de l’écriture qu’il assurait pratiquer « en amateur » : l’écrivain professionnel, qui ne cesse d’écrire, accepte de n’être « à chaque instant littéralement que ce que l’écriture va tirer » de lui, position intenable pour Gracq. Il écrivait en amateur, c’est-à-dire qu’il était "celui qui aime", et ce qu’il voulait exprimer ce sont d’abord des « nœuds de vie », « Une sorte d’entrelacement intime et isolé, autour duquel flotte le sentiment de plénitude et de l’être-ensemble ». Cela implique une « réussite de forme », un accord entre son et sens, manière peut-être d’aboutir à la « saisie d’une vérité ».
Julien Gracq, Nœuds de vie, avant-propos Bernhild Boie, Corti, 2021, 176 p., 18 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 18 février 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien gracq, nœuds de vie, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
07/03/2021
Alexandre Castant et Iwona Totarska-Castant, Visions de Mandiargues: recension
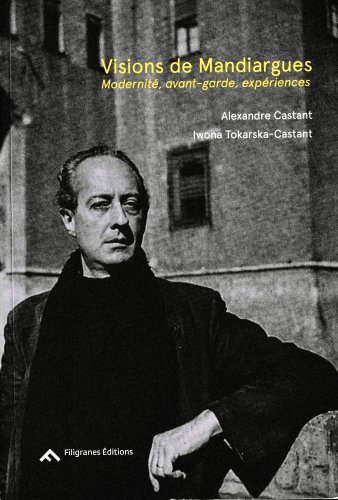
André Pieyre de Mandiargues (1909-1991) est né dans une famille où les arts comptaient beaucoup — son grand-père Paul Bérard a été un mécène de Renoir. Il découvre à la fin des années 1920 le surréalisme, mais il n’a rencontré André Breton qu’en 1947 et, la même année, la nièce du peintre et poète Filippo de Pisis, la peintre Bona de Tibertelli de Pisis qu’il épouse en 1950. Son ami d’enfance Henri Cartier-Bresson lui présente en 1931 Leonor Fini avec qui il vécut plusieurs années. Il reste très proche de la génération surréaliste d’après-guerre, partageant avec Breton le goût des objets insolites, l’admiration pour le Mexique, en accord aussi avec des prises de position politiques, comme le soutien à la révolution hongroise ou au droit à l’insoumission pendant la guerre d’Algérie. Mais ses rencontres et ses amitiés débordent le cadre du surréalisme : il est, notamment, lié avec Jean Paulhan (1) et son œuvre comprend, à côté de poèmes, de récits (2), d’ensembles critiques sur la littérature et la peinture, aussi des romans, genre rejeté par Breton.
On ne tentera pas de suivre dans une brève note tous les éléments d’un livre très dense ; les auteurs, qui ont beaucoup écrit à propos de Mandiargues et de l’image dans plusieurs domaines (peinture, photographie, cinéma) ont étudié dans le détail la manière dont Mandiargues, explorant dans son œuvre « la visualité du langage », s’inscrit ainsi dans une tradition qui, par exemple depuis James Joyce, s’est souciée du passage de l’image au mot, du mot à l’image. Les liens du poète avec les peintres ont été constants, qu’il s’agisse de son admiration pour Magritte, avec qui l’on assiste au « renversement des mots et des images », de Marcel Duchamp, ou de son intérêt pour les « anagrammes plastiques » de Hans Bellmer.
Il a porté la plus grande attention à la multiplicité des supports visuels et à leur rencontre avec l’écrit, c’est pourquoi il a toujours cherché à ce que ses poèmes dialoguent avec le travail du peintre, tentant de construire « une concordance entre le signe linguistique et le signe plastique ». Il s’agit bien d’un accompagnement réciproque, comme le voulait le collectif (auquel appartenait Mandiargues) de la revue Paroles peintes, qui connut cinq numéros entre 1962 et 1975 ; un chapitre de Visions... est réservé à une étude des éditions d’art de ses poésies, accompagnées par plusieurs peintres proches. Retenons les eaux-fortes de Miró : ici, « le texte (...) est à considérer comme un élément formel, qui exploite et met en valeur la couleur des mots, pour répondre, en écho, au chromatisme du peintre » ; pour un autre poème de Mandiargues, l’eau-forte de Bona de Tibertelli de Pisis, en blanc sur fond noir, « s’inscrit sur la page imprimée (...) comme un négatif : blanc sur noir, contraste et complémentarité. »
L’importance accordée à l’image explique la place dans l’œuvre du miroir qui ne donne qu’un reflet des choses, une figure évoquant une « rhétorique des contraires ». Mandiargues, toujours attentif à cette figure, relève quand il préface L’Homme-Jasmin d’Unica Zürn la parenté entre la construction du récit et l’image donnée dans un miroir. On comprend le prix qu’il attachait à l’oxymore, « figure de la contradiction à ciel ouvert et utopie de l’unité », comme le définit Visions de Mandiargues.
On comprend aussi que le monde soit perçu régulièrement comme un théâtre, avec ses changements de formes, que certains lieux soient pour cette raison privilégiés dans les récits tout comme ils l’étaient dans l’esthétique baroque. Ainsi du jardin, lieu récurrent et souvent décrit dans l’œuvre de Mandiargues, vu comme le lieu par excellence des artifices, du spectacle : décor avec changements de scène, il peut devenir « un monde d’artifices où les paysages reproduits ont plus de couleurs, de reliefs, de plasticité, de visualité ou de théâtralité que la nature elle-même. » Mandiargues décrit par exemple, situé dans la province de Viterbe, le parc de Bomarzo — souvent nommé "le parc des Monstres"—, créé au XVIe siècle ; le parc est habité d’inscriptions, de sculptures sur des thèmes de la mythologie grecque parmi lesquelles une tête de Méduse, lue comme figure du féminin, symbolisant à la fois la femme, l’idéal, et le miroir, l’abîme, la naissance et la mort. Les espaces décrits, paysages, jardins ou villes, se présentent toujours comme « réseaux de signes », entre le lisible et le visible. La ville est d’ailleurs un des lieux privilégiés par Mandiargues, avec ses enseignes elle est faite « d’images et de mots », « espace fictionnel par excellence ».
Tout récit chez Mandiargues est lié à la vision, voyage de signes stimulé par les rêves, les images mentales, et il comporte de minutieuses descriptions : leur force naît de leur extrême précision, mais cet « absolu descriptif » aboutit souvent, c’est son but, à ce que « les listes de mots (...) retirent peu à peu le sens de leur objet pour exister en dépit de leur modèle. » Mandiargues, dans une lettre à Jean Paulhan (Correspondance, p. 289) notait : « les mots sont pour moi des figures, encore plus que des sens » ; cette conception de l’écriture donne à l’œuvre son caractère propre. Mais il faudrait suivre aussi dans Visions... l’étude du temps dans les récits érotiques et les relations à la littérature classique, en particulier le lien étroit entre Balzac et Mandiargues. Le livre est une somme qui aura des prolongements, A. Castant et I. Tokarska-Castant, avec P. Taminiaux, organisent un colloque à Cerisy, en août 2021, autour de l’œuvre de Mandiargues (http://cerisy-colloques.fr//mandiargues2021/)
- La correspondance entre André Pieyre de Mandiargues et Jean Paulhan (1947-1968, "Cahiers de la NRF", Gallimard, 2009) a été publiée par Iwona Totarska-Castant et Éric Dussert.
- Les poèmes sont disponibles dans deux volumes de Poésie/Gallimard (2010) et la collection Quarto a publié ses Récits érotiques et fantastiques (2009).
Alexandre Castant Iwona Totarska-Castant, Visions de Mandiargues, Modernité, avant-garde, expériences, Filigranes éditions, 2020, 192 p., 25 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 février 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre castant iwona totarska-castant, visions de mandiargues, modernité, avant-garde, expériences | ![]() Facebook |
Facebook |
26/02/2021
Pierre Vinclair, Le Confinement du monde : recension
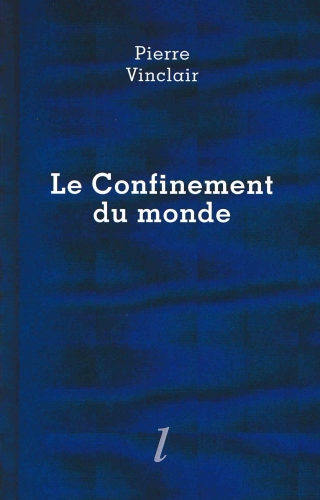
De nombreux textes ont paru autour du confinement, le plus souvent textes politiques qui fustigent les différents aspects de la politique gouvernementale en matière de santé, en effet pour le moins erratique, mais l’inusable et dominant yaka ne l’améliorerait pas — laissons de côté, à propos de la pandémie, le flot nauséabond complotiste et anti-vaccins qui a envahi les réseaux dits "sociaux". Le livre de Pierre Vinclair se situe ailleurs ; il propose avec 23 sonnets, dont un "Prologue", ("Chansons covides"), une chronique de ce que fut sa vie pendant le premier confinement ; une seconde partie de 15 sonnets titrée "Une couronne", est dédiée « aux morts du corona », puis dix "Sonnets de chiffon" en vers mêlés, « À l’inachevé », sont suivis de notes sur quelques poèmes et de remerciements.
Ce n’est sans doute pas la relation de la vie quotidienne de la famille Vinclair avant et, surtout, après l’épidémie qui retiendra le lecteur ; cependant, à côté de "l’effet de réel" ainsi introduit, elle apporte un témoignage à propos de la manière dont a été vécu le premier confinement — ici, dans de bonnes conditions matérielles, à Londres où Vinclair enseignait : les enfants en bas âge à prendre en charge, le télétravail pour l’épouse, ce qui redouble le confinement comme les visio-cours à dispenser, les cauchemars, etc. L’évolution de la maladie est suivie de près, notamment grâce aux membres de la famille proche qui, tous, travaillent dans un hôpital et qui, chaque jour, vivent la difficulté d’apporter des soins aux malades. Ce qui est aussi ressenti, c’est le contraste entre le « temps infécond » des humains et celui de la nature quand on regarde « le printemps s’éveiller ».
Ceci dit, « Pourquoi composes-tu des sonnets tout le temps ? » Plusieurs réponses. Quitte à être enfermé, mieux vaut essayer de se construire un autre lieu et le sonnet en est un : « le premier quatrain est comme un vestibule / spacieux, lumineux, digne des magazines / le second un salon-salle à manger-cuisine /[etc.] » Mais on tombe vite dans l’escalier en allant à l’étage... Laissons de côté l’humour et, ce qui est rappelé au lecteur,
nous ne passons du temps,
toi comme moi, des deux côtés de ce sonnet,
qu’en attendant de pouvoir ouvrir notre porte.
Avant d’ouvrir cette porte pour revoir l’horizon, ne pas oublier que les sonnets sont aussi une modeste offrande aux morts du virus, « cris domptés, écrits, qu’on fait lire aux vivants ».
Ces motifs cependant pourraient être considérés comme de bien pauvres justifications et Vinclair le sait bien, qui connaît l’usage de cette forme fixe inusable qu’est le sonnet. Il cite en exergue des extraits d’un sonnet de Du Bellay autour de la fièvre et, à sa suite il peut écrire :
Dans un carré de vers, on fourre à peu près tout :
le décompte des morts, la blague de la toux —
il y faut s’y réjouir autant que s’y morfondre.
Alors, puisqu’on peut se réjouir, un autre intérêt apparaît à écrire « cette poésie de mirliton », l’exploration d’une forme déjà entreprise avec virtuosité dans un livre récent (La Sauvagerie, 2020).
Pour l’essentiel, les règles classiques de construction des quatrains sont respectées (ABBA x 2), avec parfois une variante (CDDC pour le second quatrain) ; pour les tercets, les possibilités combinatoires sont largement utilisées, celle du sonnet marotique dominante (CCDEED). Mais on lit aussi un sonnet construit sur quatre rimes (AAAA/BBBB/CCC/DDD), un autre en vers mêlés, un troisième organisé en trois groupes (3/8/3). Dans le second ensemble, "Une couronne", le dernier vers du premier sonnet devient le premier vers du second, et ainsi de suite, le quinzième sonnet étant composé de l’ensemble des derniers vers. Le dernier ensemble, "Sonnets de chiffon", sort des règles — tous les sonnets étaient jusqu’alors de 12 syllabes : « Voici quelques vers pairs sans rime / dont les mètres variés / compensent leur écart par des tabulations ». Pour faire bonne mesure, Vinclair introduit dans les "Chansons covides" une vilanelle, genre prisé au XVIe siècle.
Le jeu avec les règles de la forme fixe, de la syntaxe et du vocabulaire est très présent et donne un ton propre à l’écriture de Vinclair, une apparence de facilité, mais qui suppose une maîtrise dans la construction des rythmes que n’ont pas toujours les tenants du vers libre. C’est évidemment dans un ensemble qu’il faut lire un relevé, pas du tout exhaustif, du jeu : rimes pour l’œil, y compris avec un mot anglais (cough - joues), mots coupés en fin de vers (i/Pad – cla/sses ; Wor/d – Mor/t), rimes avec le même (dieu – dieu), vers en anglais, etc. On lira des élisions "fautives (« j’hurle », « s’hérisse » (deux fois))", ici et là des anagrammes (« La Terre, en attendant la reprise, respire »), l’emploi d’une onomatopée par strophe dans un sonnet (bip-bip, tic-tac, pimponpin, boum-boum) et d’allitérations (« monceaux / de monstres »). Ajoutons à côté de citations attribuées — Du Bellay pour l’usage du sonnet, George Oppen et Di Manno pour le caractère objectiviste de la poésie — des fragments de poèmes aisément reconnaissables, comme par exemple « Ô toi qui le savais », « la joie après la peine ».
Le livre dit quelque chose à propos du confinement, de la mort, de la solitude, mais est aussi un livre de poète curieux d’exploiter les ressources de la langue sans rien s’interdire. On apprécie, inattendus, que les notes et les remerciements qui ferment le livre prennent aussi la forme du sonnet.
Pierre Vinclair, Le Confinement du monde, éditions Lurlure, 2020, 72 p., 9,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 1er février 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, le confinement du monde, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
20/02/2021
Silvia Majerska, Matin sur le soleil
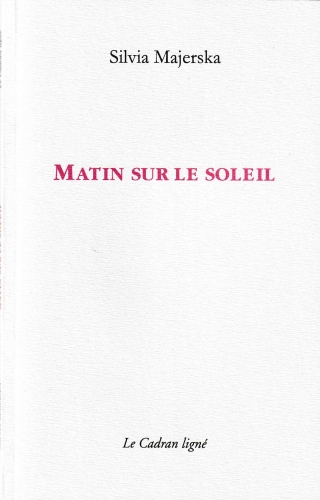
Les poèmes du livre, presque toujours en strophes brèves, se répartissent en trois parties, "Le cube de Pandore", "Matin sur le soleil" et "Portraits de l’eau". Le titre, repris pour le second ensemble, est une énigme jusqu’à la lecture, dans la seconde séquence, du dernier vers de "Yeux", « La valeur de certains désirs, c’est d’être aussi irréalisables que le matin sur le soleil ». On comprend immédiatement la force de cette « comparaison inattendue », qui pose la question de "l’impossible", le désir consistant peut-être d’abord à valoriser ce qui est désirable. Mais d’autres propositions dérangent aussi l’ordre, pas seulement celui de la langue.
Il faut d’abord revenir à la mythologie grecque : Pandore est créée par le dieu forgeron, Héphaïstos, d’un peu de terre et d’eau. Le poème d’ouverture, "Premier contact", esquisse justement un rapport amoureux avec la terre, « Au toucher de mes cuisses / et de la surface de la terre // la sueur coule lentement / vers le sol en fins ruisseaux » : le corps en eau épouse la terre et, plus avant, le ciel devient corps qui « s’allonge » sur ce corps. Cette étreinte fusionnelle de l’humain et de la nature est le motif dominant de cette partie ; ici la femme et la terre, deux principes de fécondité, sont en étroite liaison, ensuite se rencontrent les relations terre (= corps) / ciel et eau, montagne / humain (embrasser la montagne), vent / femme (sous la forme de « sous-vêtements féminins »).
Si le livre s’ouvre sur une relation intime à la terre et à l’eau, il se ferme avec quatre poèmes autour de l’eau vivante : il s’agit de « portraits ». D’emblée l’eau est bien rapportée au vivant et à la beauté — « sa chair » est dite « photogénique » —, et à la lumière, l’eau « jetant une lumière sèche ». Elle est reliée à la mythologie grecque puisque "eau" appelle l’Hydre (= eau) aux multiples têtes — on y voyait parfois un serpent d’eau ; énigme, l’eau se transforme sans que l’on puisse imaginer ses changements, tout comme la chrysalide ou comme « un visage humain recyclé depuis la nuit des temps ». C’est une des caractéristiques essentielles de l’eau, elle « chante le temps » et le lecteur revient à des origines mythologiques, à la création de Pandore. Dans la dernière séquence du livre, les éléments énumérés pourraient, eux aussi, paraître énigmatiques : ils rassemblent ce qu’est le corps vivant dans le temps, « L’eau — l’aïeule, l’emballage, le culte de la pureté, la loi, l’insoluble » ; dès le second poème, il était dit qu’elle était nourricière et « la langue maternelle », soit liquide amniotique.
Par le lien entre le vivant et la nature s’introduit la figure du double qui s’exprime de diverses manières. Ainsi le squelette est le « frère intérieur », l’ombre est un « rêve que fait le soleil » et la mémoire s’apparente à une ombre ; ainsi encore peut-on imaginer qu’avec deux bouches, comme on a deux yeux, on pourrait donner un corps (« trois dimensions ») à la langue. La langue, les mots constituent d’ailleurs une ligne de force du livre ; les mots sont inscrits dans le temps, « souvenir / des hommes oubliés / depuis longtemps » et impossibles à compter, proliférant depuis qu’ils sont écrits. Ils sont motifs à des propositions bâties sur l’absurde, par exemple dans le poème titré "Mors inexistants" dont le début évoque un raisonnement carrollien :
Parmi les mots inexistants
il a fallu distinguer ceux
qui n’existeront jamais
Bien d’autres énoncés ne présentent pas de relation à la réalité, sans pour autant ne pas être "lisibles" ; dans les deux dernières séquences d’un poème titré "Bleu", est nommé un personnage de la mythologie grecque, qui a donc sa place dans l’ensemble, mais si un lien avec le titre est immédiat, la relation avec les autres séquences du poème est difficile à établir : « Sous la pluie quelqu’un applique le bleu. Le blanc tète le pigment au goût de feuille, de pétale, de fruit ; les nuances peuplent l’espace de la tâche. // Pendant ce temps-là, vêtu d’un simple jean bleu, Orphée descend très haut, jusqu’au vouvoiement. » Faudrait-il tenter de « résoudre l’énigme » ? Il faut bien plutôt l’accepter comme telle, comme toutes les « étranges comparaisons », sauf à vouloir que la poésie soit seulement analogue à un document.
Matin sur le soleil, est le premier livre de Silvia Majerska (née en 1984). Traductrice du slovaque, elle a publié jusqu’à maintenant des poèmes dans des revues en France et en Slovaquie et elle a une activité critique. On souhaite que se poursuive son goût de l’insolite dans l’usage de la langue.
Silvia Majerska, Matin sur le soleil, Le Cadran ligné, 2020, 49 p., 12 €. Cette recension à été publiée par Sitaudis le 28 janvier 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : silvia majerska, matin sur le soleil, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
12/02/2021
Ezra Pound, Cathay : recension
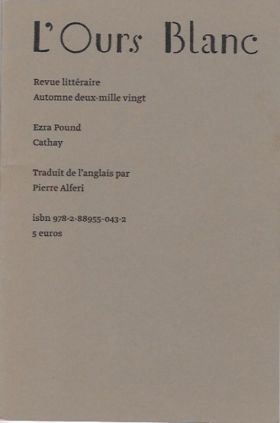
Il est bon de rappeler que "L’Ours Blanc", revue sans parution régulière (qui doit son nom à un vers de Valère Novarina), propose dans chaque livraison un seul texte, traduction (Charles Reznikoff, Jack Spicer, Russell Edson, etc.) ou non (Fabienne Raphoz, David Lespiau, Marie de Quatrebarbes, etc.). Le numéro 27 a paru en même temps que la traduction de Pound, Ombres blanches sur fond presque blanc, de Baptiste Gaillard, écrivain de Suisse romande. Cathay rassemblait, en 1915, les traductions par Pound de poèmes du poète chinois Rihaku (transcription du nom en japonais) ou Li Bai (701-762), de l’époque Tang. Pound pensait qu’il fallait ne pas rester coincé dans sa langue et lire d’autres langues, traduire aussi, plaçant l’activité du traducteur au même niveau que l’écriture de poèmes — ce qui est aussi la position d’Alferi. Il reçut en 1913 de sa veuve les carnets d’Ernest Fenollosa qui avait transcrit et traduit littéralement des poètes de la poésie classique chinoise ; sans rien connaître de la langue, Pound travailla à partir de ces notes pour donner une version anglaise, faisant de Rihaku/Li Bai « un précurseur de Make it New, ce modernisme qui prend le contre-pied de l’avant-garde et parie sur le renouvellement de la tradition » (A. Lang). L’édition de L’Ours Blanc reproduit dans sa page titre la disposition de la première édition de Cathay que le lecteur retrouvera aisément par l’internet de Cathay, fort utile si l’on est angliciste pour apprécier les choix d’Alferi*.
Les poèmes de Rihaku sont ancrés dans son temps : on y lit des noms de lieux et de personnages (So-Kin), des allusions (« l’Empereur est à Ko »), des comportements (« À quatorze ans j’ai épousé mon Seigneur »...) ») qui reportent à une époque et à des faits bien étrangers au lecteur d’aujourd’hui. Ce n’est pas l’essentiel, toute poésie ou prose ancienne sur ces points reste peu lisible — sinon comment regarder une pièce d’Euripide ou de Shakespeare ? —, ce qui importe est que « cette distance nous donne avec une immédiateté d’autant plus fulgurante les sentiments les plus communs à l’humanité : la faim et le froid, l’espoir et le désespoir, le désir et l’attente » (A. Lang). Ce sont notamment les difficultés de la vie pendant les troubles et guerres de son époque que Rihaku restitue, « Un déferlement d’hommes de guerre sur tout le royaume du milieu, / ( ...) Et la peine, la peine comme la pluie, / La peine à partir, et la peine, la peine à revenir, / Les champs désolés, désolés / ». Et la restitution n’est jamais simple récit dans la traduction d’Alferi traduisant Pound.
La syntaxe du français oblige à plus de liens qu’en anglais, ce qui peut gêner la simplicité recherchée dans l’expression et surtout briser le rythme des vers ; Alferi, dans le premier poème traduit de Kutsugen (IVe s avant J._C.), choisissant une construction elliptique, supprime pronom et verbe présents dans le texte de Pound :
« Sorrowful minds, sorrow is strong, we are hungry and thirsty, /»
est traduit par
« Âmes attristées, la tristesse est âpre, et la faim, la soif, / »
Dans "Lettre d’un exilé" de Rihaku, la forme du récit fait par l’exilé à un ami est remarquable : dans la traduction de Pound comme dans celle d’Alferi, absence de tout apprêt, vocabulaire et syntaxe sans détours qui font penser aux choix des poèmes objectivistes des années 1930 aux États-Unis : « (...) Le plaisir continu, avec des courtisanes allant et venant sans obstacle. / Avec les flocons qui tombaient des saules comme de la neige, / Et les filles fardées soûles au crépuscule, / ». L’exilé n’obtenant pas de promotion à la cour, doit repartir dans la montagne, c’est-à-dire loin des chansons, loin des échanges, et le lecteur notera le vif de sa réponse à l’ami qui demande comment vivre l’exil : après l’image qui associe à la nature le sentiment de regret éprouvé (« Comme la chute des fleurs à la fin du Printemps / Confuse, tourbillonnante »), deux vers fortement coupés (6/6, 6/5) expriment dans la traduction d’Alferi l’inutilité de toute plainte :
À quoi sert de parler, parler n’a pas de fin,
Il n’y a pas de fin aux choses du cœur.
Ailleurs, dans une énumération, Pound coordonne dans chacun des cinq vers deux groupes, « To high halls and curious food, / To the perfume air and girls dancing [etc.] » ; Alferi construit un autre rythme en supprimant le lien, « Vers les salons vastes, les mets curieux, / vers l’air embaumé, les filles qui dansent » ; dans le vers conclusif de la séquence, c’est le verbe qui est abandonné : « Night and day are given to pleasure » est traduit par « Jour et nuit dédiés au plaisir ».
Alferi suit fidèlement la traduction de Pound, mais construit par de légers décalages un rythme propre au français. Il s’agit bien d’un travail de re-création, pour qui a déjà traduit John Donne à côté de contemporains comme Cole Swensen, J. H. Prynne ou Zukofsky.
Ezra Pound, Cathay, traduction Pierre Alferi, "L’Ours Blanc", n°28, Héros-Limite, automne 2020, 28 p., 5 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 12 janvier 2021.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, cathay, traduction pierre alferi, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
31/01/2021
Étienne Faure, Et puis prendre l'air : recension

"Prendre l’air", c’est sortir de chez soi, de ses habitudes, comme l’écrivait Flaubert dans sa correspondance, « Je comptais cet été sur un peu d'argent pour prendre l'air ». C’est ce que les dix ensembles du livre explorent, avec en ouverture le sous-titre Sortir et en clôture Prendre l’air ; entre ces deux bornes, l’idée de mouvement peut être explicite ("Changement de saison", "Dix postures pour cueillir les mûres", "Aux coins du globe") ou sembler être contredite dans l’énoncé ("Voyage à la cave") : dans ce cas, le texte de Khlebnikov cité en exergue, « O cave de la mémoire », oriente vers une autre forme de sortie ; plusieurs sous-titres valorisent plutôt l’immobilité, comme "Claustrales", mais le premier poème de cet ensemble s’achève par « Abstraites errances », noté en italique. Et puis prendre l’air, outre son unité thématique, s’inscrit dans une tradition, celle du poème en prose depuis Baudelaire, privilégiant surtout la description des choses de la vie et, souvent, la méditation à leur propos.
Le narrateur marche beaucoup, observe sans cesse les personnes autour de lui, les oiseaux dans les jardins parisiens et à la campagne, les changements du ciel. Il écoute des étrangers qui tentent de se comprendre, il songe à la campagne en voyant des jeunes femmes qui, assises en amazone sur un banc, évoquent des cavalières et, toujours dans un square, il prend le temps de regarder des acteurs improvisés. Ce qui est recueilli, ce sont tous ces gestes, ces bruits, ces mots qui forment l’essentiel des jours, c’est-à-dire tout ce qui s’oublie, comme a été oublié le trot des charrettes qui naguère livraient le lait dans les grandes villes. Il y a quelque chose proche du spleen baudelairien dans la tentative de rassembler ce qui s’échappera toujours, ce que figure ce qui est vu lors d’un voyage en train, « on aperçoit les arbres qui fuient, les buissons, les lapins, tout un monde qui détale ». On peut croire voler des moments en passant dans la rue et parfois penser faire sienne la ville, on comprend cependant « qu’on ne s’approprie rien, que tout n’est qu’emprunt, mimétisme, camouflage ». Peut-on commencer, parce qu’on se trouve à son aise dans une ville, à « s’en faire une patrie » ? Étienne Faure cite ici Mme de Staël et a sans doute en tête la suite du texte de Corinne ou de l’Italie : « voir des visages humains sans relation avec votre passé ni avec votre avenir, c’est de la solitude et de l’isolement sans repos et sans dignité ».
La marche reste indispensable pour « ne plus voir contraires réel et imaginaire, passé et futur, haut et bas », et sur ce point le lecteur est renvoyé à André Breton, mais il est nécessaire de s’arrêter pour (se) construire. Sur le banc naît le questionnement, « où suis-je, où en suis-je, qui suis-je, quel jour est-on ? », et le banc lui-même suscite le départ dans l’imaginaire : il se souvient qu’il a été arbre, il vit son usure, l’inscription des amours. Bien des éléments du quotidien renvoient à autre chose qu’eux-mêmes, notamment au passé ; ce journal qui emballait un objet engage un voyage dans le temps de sa publication, les vêtements d’automne ressortis on y découvre les traces de la saison passée (châtaigne, gland, faîne) et « Telle une lecture interrompue (...) on reprend la tournure d’esprit de la saison où on l’avait laissée : mélancolique ». Des photographies retrouvées de parents ramènent à l’entre-deux guerres ; l’Histoire, celle des conflits du XXe siècle, s’impose aalors comme dans les précédents livres, et les enfants passent du statut de « titis du peuple à enfants de la patrie, prêts à leur tour pour la prochaine guerre ». Analogues aux animaux faisandés accrochés autrefois aux crocs des boucheries, les souvenirs connaissent « un temps de faisandage » et, en même temps, ce qui a été vécu par les uns se reproduit autrement ; dans un hôtel en 1919, mort de Jacques Vaché, retrouvailles de Gide et Maria Van Rysselberghe, écriture d’un livre par Breton et Soupault, « cent ans après, 2019, les séjours à l’hôtel étaient toujours au rendez-vous : écrire, aimer, mourir ».
Les sentiments du narrateur ne sont donc pas absents du texte, cependant est marqué l’effort dans l’écriture pour éviter toute confidence, « on reprise dix fois le texte, le rature, laissant passer trop de clarté de soi ». C’est plutôt la pratique de l’écriture qui est décrite à différents moments du texte, comme l’usage d’un carnet employé tête-bêche où sont notés prose et vers ou le parallélisme entre l’ortie et l’écrit, entre l’écureuil et l’écrivain : l’animal « amasse des idées, les oublie, n’en finit pas d’aller de branche en branche ainsi qu’un écrivain — nouveaux chapitres, paragraphes, à la ligne ne sachant s’arrêter ». Chaque ensemble est précédé d’un exergue, et des écrivains du passé sont cités dans les poèmes (outre les noms relevés ci-dessus, La Fontaine, Desnos, Crevel, Conrad, Wilde, Jean-Jacques [Rousseau], Jules Renard, Laforgue), mais aussi leurs textes, notamment Baudelaire, Rimbaud, Aragon, textes rarement attribués mais aisément reconnaissables même quand ils sont intégrés dans celui d’Étienne Faure : mots repris à Apollinaire, à Baudelaire (« Ni luxe ni calme ni volupté ») ou fragment de Rimbaud augmenté d’une parenthèse (« Jeunesse (hardie aventure) à tout asservie »). Relevons encore une allusion transparente à la Commune de Paris avec l’idée d’un roman titré Le temps des merises, la mention du mur des Fédérés (où est la tombe de Jean-Baptiste Clément, auteur du "Temps des cerises") et de paroles de la chanson. Le titre du précédent livre d’Étienne Faure, Tête en bas, est aussi présent mais au pluriel, présence qui suggère de repérer d’éventuels liens formels entre poèmes en prose et poèmes en vers.
On retrouve en effet le plaisir des échos, avec par exemple « oiseaux oisifs », « champ de courses, chevauchées, courses aux Champs », « requin /requiem », jusqu’au jeu anagrammatique : « Offusqué » ouvre un poème que ferme « Suffoqué », figure de la construction du livre. On lira parfois à la fin d’une prose un ou deux mots séparés qui font une sorte de titre, « Perdre sa place », « Raccords », etc., pratique constante dans la poésie en vers, et l’on reconnaîtra aussi le goût pour un vocabulaire donné comme "familier" ou "populaire" (« ça caille », « à la revoyure », « piaule », « pas un carat », etc.). Mais la construction de chaque prose est bien différente de celle des poèmes en vers souvent construits en une seule longue phrase ; ici, la syntaxe est variée, de la phrase réduite à un mot jusqu’à la longue énumération : on pense à celle du mobilier d’un déménagement réuni sur le trottoir.
Prose ou vers, le même regard attentif vers le monde, des retours analogues vers le passé, le même amour de la littérature : pour qui ne connaîtrait pas encore la poésie d’Étienne Faure, Et puis prendre l’air est une belle entrée.
Étienne Faure, Et puis prendre l’air, Gallimard, 2020, 136 p., 14,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 16 décembre 2020
Publié dans Faure Étienne, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, et puis prendre l’air, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
21/01/2021
Jacques Réda, Le Fond de l'air : recension
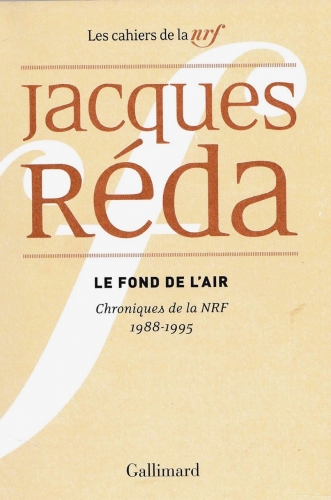
« Ainsi va le monde »
Jacques Réda s’est vu proposer de prendre la direction de La NRF en 1987 quand Georges Lambrichs, qui l’avait fait entrer chez Gallimard comme lecteur, abandonna la tâche à cause de l’état de ses yeux. La situation des revues, à ce moment, était médiocre, loin des tirages des années 1930, désaffection du public comme des auteurs, « le règne des revues littéraires avait touché à son déclin, faute de représenter pour les auteurs une sorte d’étape naturelle sur le chemin de la publication en livre. » Réda est resté jusqu’en 1995 à la tête de la revue, créant, après Le temps, comme il passeet L’air du temps, la rubrique Le fond de l’air. Ce sont ses contributions qui sont réunies dans ce livre.
Les contributions traitent des sujets les plus divers, souvent ouvertes avec "la question...", de "La question toponymique" dans les villes à "La question du paysage" ; d’autres titres suggèrent parfois un traitement humoristique comme, anagrammatique, "Vélos volés" ou "Contribution à la définition d’une langue européenne". L’importance du sujet dépasse bien souvent les limites d’un bref article mais Réda y met en évidence l’absence de logique de la plupart des décisions ou propositions, parfois leur absurdité ; ce faisant, l’humour lie tous les textes, sans exception. On retiendra quelques sujets relatifs à la langue et aux Lettres.
"La question poétique" part d’un article paru dans Libération, qui reprend le refrain bien connu du divorce entre la poésie et le public, mais l’un des poètes qui regrette cet écart écrit par ailleurs des vers, reproduits (« Toi cloche vespertinale / des tablettes le nombril /les cinnames et les baumes / le manger et le dictame ! [etc.] ») qui ne deviendraient (peut-être ?) compréhensibles qu’accompagnés d’un commentaire, alors que deux autres vers cités en note, d’un autre écrivain, laissent perplexe (« Tmol / Fst hrt »). Toujours sur ce sujet, sont reproduites quelques lignes d’un écrit théorique dont la simplicité n’est pas la première qualité ; à sa suite est mise en cause la politique éditoriale de Gallimard qui se contenterait d’avoir une « production raréfiée limitée à quelques "poètes maison" », ce qui évidemment est inexact et une liste d’auteurs le prouve. Sur les trois points, Réda ne fait rien d’autre que mettre en évidence ce qui contredit les affirmations de la journaliste, et du même coup montre que le problème, pour le moins mal posé, est seulement une « fièvre récurrente qui, de loin en loin, ressaisit, à propos de la poésie française actuelle, des gens dont c’est le dernier des soucis. »
Cette manière de faire, citer ce qui est à examiner pour que le lecteur puisse juger du bien-fondé de la lecture critique, met efficacement en cause l’inanité de bien des projets. Il y a des « États généraux de la poésie » annoncés ? Réda retourne au sens des mots et à ce que furent les États généraux de 1789 : en sortira-t-il pour la poésie une Constituante, d’où une Législative, puis une Convention et, pourquoi pas une Terreur ? Ironie à l’égard de ceux — qui les mandate ? — qui prétendent discuter de « la création poétique elle-même » et l’on se demande si ce genre de réunion n’aboutirait pas à une « définition officielle, administrative, voire obligatoire » de la poésie. Les organisateurs de ce genre de réunions ont eu comme successeurs ceux qui ont tenté en 2020 de congeler Rimbaud et Verlaine au Panthéon, mais déjà en 1991 avait été formée une « délégation générale aux Années Rimbaud » : « le fait consterne et le pluriel terrorise », commente Réda, qui suggérait alors pour faire bon poids un « Parc de loisirs Arthur Rimbaud dans les environs de Charleville » avec tout ce qui accompagne ce genre d’établissements.
Réda est également attentif aux changements dans la langue, relevant l’abondance de mots anglais en entrée dans le Petit Robert, édition de 1992, alors que pour chacun un mot français existe ; l’emprise de la civilisation américaine est restée forte depuis et, sans se poser de question sur la nécessité de s’exprimer en leur langue, ministres et journalistes parlent de cluster pour ce qui est un « foyer de contagion » — trop long sans doute et moins in... L’abandon du vocabulaire est parfois moins visible, Réda relève en 1989 que dans tous les contextes générer remplace « engendrer, déterminer, produire, amener, entraîner, occasionner, conduire à », que sur s’emploie pour « à, vers » ("je vais sur Paris"), qu’à « oui / non » se sont substitués absolument, tout à fait / pas du tout — « Je crois, dit le présentateur, que vous êtes née à Coutances ? - Tout à fait, répond la vedette », etc. C’est évidemment l’ensemble des remarques sur la langue qu’il faudrait relever, Réda n’a rien d’un puriste grincheux et n’ignore pas que, par exemple, l’abondance des anglicismes doit plus à la puissance économique des États-Unis et à la fascination d’un mode de vie qu’à la paresse ; de la Corée à la banlieue parisienne les téléspectateurs ont vu la série Dallas et ont des images communes, une « culture » commune comme on dit aujourd’hui ; c’est bien la « médiocrité la plus nauséeuse qui devient la règle » dans les programmes télévisés. On se demande ce qu’écrirait Réda aujourd’hui : alors que règnent les sondages les plus absurdes et, plus encore, les réseaux dits sociaux, "nauséeux" serait un aimable euphémisme.
Les brèves chroniques de Réda n’avaient pas d’autre objet que de susciter la réflexion à propos des choses du monde, qu’il s’agisse du langage, du comportement vis-à-vis des femmes, des « vélos volés », et, observateur sans complaisance, de le faire avec humour. On sourit souvent à le lire, en approuvant ses observations toujours justes. Revenant par exemple sur ce marronnier d’un certain journalisme, les extra-terrestres, il affirme que nous serions bien gênés s’ils venaient sur terre, car comment leur dire : « voici une famine, une guerre civile, un massacre, un camp de concentration ; voici une centrale nucléaire fondue, des colonnes de Buren, une commission de Bruxelles, un jeu télévisé. »
Et, en effet, nous supportons tout cela.
Le commentaire de sitaudis.fr
"Chroniques de la NRF" (1988-1995)
Les Cahiers de la nrf, Gallimard, 2020
128 p.
12,50 €
« Ainsi va le monde »
Jacques Réda s’est vu proposer de prendre la direction de La NRF en 1987 quand Georges Lambrichs, qui l’avait fait entrer chez Gallimard comme lecteur, abandonna la tâche à cause de l’état de ses yeux. La situation des revues, à ce moment, était médiocre, loin des tirages des années 1930, désaffection du public comme des auteurs, « le règne des revues littéraires avait touché à son déclin, faute de représenter pour les auteurs une sorte d’étape naturelle sur le chemin de la publication en livre. » Réda est resté jusqu’en 1995 à la tête de la revue, créant, après Le temps, comme il passeet L’air du temps, la rubrique Le fond de l’air. Ce sont ses contributions qui sont réunies dans ce livre.
Les contributions traitent des sujets les plus divers, souvent ouvertes avec "la question...", de "La question toponymique" dans les villes à "La question du paysage" ; d’autres titres suggèrent parfois un traitement humoristique comme, anagrammatique, "Vélos volés" ou "Contribution à la définition d’une langue européenne". L’importance du sujet dépasse bien souvent les limites d’un bref article mais Réda y met en évidence l’absence de logique de la plupart des décisions ou propositions, parfois leur absurdité ; ce faisant, l’humour lie tous les textes, sans exception. On retiendra quelques sujets relatifs à la langue et aux Lettres.
"La question poétique" part d’un article paru dans Libération, qui reprend le refrain bien connu du divorce entre la poésie et le public, mais l’un des poètes qui regrette cet écart écrit par ailleurs des vers, reproduits (« Toi cloche vespertinale / des tablettes le nombril /les cinnames et les baumes / le manger et le dictame ! [etc.] ») qui ne deviendraient (peut-être ?) compréhensibles qu’accompagnés d’un commentaire, alors que deux autres vers cités en note, d’un autre écrivain, laissent perplexe (« Tmol / Fst hrt »). Toujours sur ce sujet, sont reproduites quelques lignes d’un écrit théorique dont la simplicité n’est pas la première qualité ; à sa suite est mise en cause la politique éditoriale de Gallimard qui se contenterait d’avoir une « production raréfiée limitée à quelques "poètes maison" », ce qui évidemment est inexact et une liste d’auteurs le prouve. Sur les trois points, Réda ne fait rien d’autre que mettre en évidence ce qui contredit les affirmations de la journaliste, et du même coup montre que le problème, pour le moins mal posé, est seulement une « fièvre récurrente qui, de loin en loin, ressaisit, à propos de la poésie française actuelle, des gens dont c’est le dernier des soucis. »
Cette manière de faire, citer ce qui est à examiner pour que le lecteur puisse juger du bien-fondé de la lecture critique, met efficacement en cause l’inanité de bien des projets. Il y a des « États généraux de la poésie » annoncés ? Réda retourne au sens des mots et à ce que furent les États généraux de 1789 : en sortira-t-il pour la poésie une Constituante, d’où une Législative, puis une Convention et, pourquoi pas une Terreur ? Ironie à l’égard de ceux — qui les mandate ? — qui prétendent discuter de « la création poétique elle-même » et l’on se demande si ce genre de réunion n’aboutirait pas à une « définition officielle, administrative, voire obligatoire » de la poésie. Les organisateurs de ce genre de réunions ont eu comme successeurs ceux qui ont tenté en 2020 de congeler Rimbaud et Verlaine au Panthéon, mais déjà en 1991 avait été formée une « délégation générale aux Années Rimbaud » : « le fait consterne et le pluriel terrorise », commente Réda, qui suggérait alors pour faire bon poids un « Parc de loisirs Arthur Rimbaud dans les environs de Charleville » avec tout ce qui accompagne ce genre d’établissements.
Réda est également attentif aux changements dans la langue, relevant l’abondance de mots anglais en entrée dans le Petit Robert, édition de 1992, alors que pour chacun un mot français existe ; l’emprise de la civilisation américaine est restée forte depuis et, sans se poser de question sur la nécessité de s’exprimer en leur langue, ministres et journalistes parlent de cluster pour ce qui est un « foyer de contagion » — trop long sans doute et moins in... L’abandon du vocabulaire est parfois moins visible, Réda relève en 1989 que dans tous les contextes générer remplace « engendrer, déterminer, produire, amener, entraîner, occasionner, conduire à », que sur s’emploie pour « à, vers » ("je vais sur Paris"), qu’à « oui / non » se sont substitués absolument, tout à fait / pas du tout — « Je crois, dit le présentateur, que vous êtes née à Coutances ? - Tout à fait, répond la vedette », etc. C’est évidemment l’ensemble des remarques sur la langue qu’il faudrait relever, Réda n’a rien d’un puriste grincheux et n’ignore pas que, par exemple, l’abondance des anglicismes doit plus à la puissance économique des États-Unis et à la fascination d’un mode de vie qu’à la paresse ; de la Corée à la banlieue parisienne les téléspectateurs ont vu la série Dallas et ont des images communes, une « culture » commune comme on dit aujourd’hui ; c’est bien la « médiocrité la plus nauséeuse qui devient la règle » dans les programmes télévisés. On se demande ce qu’écrirait Réda aujourd’hui : alors que règnent les sondages les plus absurdes et, plus encore, les réseaux dits sociaux, "nauséeux" serait un aimable euphémisme.
Les brèves chroniques de Réda n’avaient pas d’autre objet que de susciter la réflexion à propos des choses du monde, qu’il s’agisse du langage, du comportement vis-à-vis des femmes, des « vélos volés », et, observateur sans complaisance, de le faire avec humour. On sourit souvent à le lire, en approuvant ses observations toujours justes. Revenant par exemple sur ce marronnier d’un certain journalisme, les extra-terrestres, il affirme que nous serions bien gênés s’ils venaient sur terre, car comment leur dire : « voici une famine, une guerre civile, un massacre, un camp de concentration ; voici une centrale nucléaire fondue, des colonnes de Buren, une commission de Bruxelles, un jeu télévisé. »
Et, en effet, nous supportons tout cela.
Jacques Réda, Le Fond de l’air, ‘’Chroniques de la NRF’’, (1988-1995), Les Cahiers de la nrf, Gallimard, 2019, 128 p., 12,50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 7 décembre 2020.
Publié dans RECENSIONS, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, le fond de l'air : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
10/01/2021
Jehan Rictus, Les Soliloques du pauvre : recension

Le lecteur dispose aujourd’hui d’une édition complète des poésies de Jehan Rictus, de son autobiographie et même de son journal pour 1898 et 1899*, mais le 555ème volume de la collection Poésie de Gallimard est bienvenu, il rassemble ses deux principaux livres. Leur contenu donne une idée précise de ce qu’était une partie des textes lus dans les cabarets à la fin du XIXème siècle ; en outre, le rejet total du capitalisme par l’auteur peut rencontrer aujourd’hui bien des échos.
Avant d’entrer dans Les Soliloques du pauvre, il est bon de lire la préface et la notice biographique de l’éditrice du volume pour situer Jehan Rictus dans son temps. Jehan Rictus (1867-1933), né Gabriel Randon, choisit tardivement son pseudonyme, sans doute lié à un vers de Villon (« Je ris en pleurs ») mais peut-être, selon Patrice Delbourg, anagramme approximative de "Jésus Christ". Élevé par sa mère, battu et humilié, il file à Paris à dix-huit ans, écrit des poèmes, fréquente la bohème et connaît la misère, celle qui sera plus tard au centre de ses écrits ; il est remarqué et encouragé par José de Hérédia, Albert Samain et protégé par Leconte de Lisle. Il fréquente les anarchistes, abandonne le vers parnassien pour une forme bien présente dans les années 1880, celle du monologue en vers à dire dans les cabarets. Les poèmes sont alors en vers (l’octosyllabe domine) comptés et rimés ; ils tentent de restituer un parler paysan, avec des mots en patois, comme chez Gaston Couté (« Bon Guieu ! la sal’ commune ! À c’souère, / Persounne a voulu m’ar’cevouèr / Pou’ que j’me gîte et que j’me cache / Dans la paille, à couté d’ses vaches »). Plus souvent, c’est le parler parisien qui est le modèle à imiter, comme par exemple dans les poèmes d’Aristide Bruant, « Moi, je n’sais pas si j’suis d’Grenelle / De Montmartre ou de la Chapelle, / D’ici, d’ailleurs ou de là-bas / Mais j’sais ben qu’la foule accourue, / Un matin m’a trouvé su’ l’tas / Dans la rue » ("Dans la rue").
Jehan Rictus pratique de façon beaucoup plus systématique l’élision pour mieux traduire une manière de s’exprimer qu’il a bien connue. Le début du Soliloque du pauvre réunit à peu de choses près les transformations opérées. Le e disparaît souvent, y compris à l’intérieur d’un mot (« lanc’ments ») et entraîne aussi celle du r, du l en finale (« mett’, peint’s, muff’ »). Sans entrer dans le détail linguistique des modifications, on peut en énumérer quelques-unes qui indiquent que Jehan Rictus a transcrit fidèlement le parler du milieu ouvrier parisien tel que les études de la dernière partie du XIXème siècle en donnent l’image : ceux devient « ceuss », ou = « ousque », métier = « méquier », tiens = « quien », le monde = « eul monde », manière = « magnièr’ », une = « eune », plus = « pus », les employés = « les empoyés », millions = « meillons », il y a un = gna z’un », je vais = « j’vas » , etc. Le vocabulaire emprunte à ce que l’on désigne toujours par "français populaire", une partie des mots relevés est sortie de l’usage (« purotain » = miséreux, « se faire balader les rognons »), contrairement à la plupart d’entre eux, comme « carapater, gambiller, bath, mendigot, vieux birbe, bouffer, dèche, briffer, plaquer, claquer, foutre », etc. Pour Jehan Rictus, cette restitution d’une langue parlée est en accord avec les contenus quand on se veut, comme l’écrit Patrice Delbourg, « le chantre des vaincus, des trahis, des réprouvés, des sans-espoir » — cela ne l’empêchait pas d’employer des mots étrangers au vocabulaire commun ou d’introduire des allusions à la bible hébraïque.
Jehan Rictus est résolument du côté des miséreux, des sans-dents (comme disait l’autre énarque), non pour gagner de l’argent comme, par exemple, Victor Hugo (« Nous avons not’ Victor Hugo / Qui a tiré des mendigots / D’quoi caser sa progéniture »), ni pour se faire élire puisque, pour être populaire, « l’moyen l’pus pratique / C’est d’chialer su’la Pauvreté ». Défendre les pauvres, c’était la mission qu’avait, selon Jehan Rictus, le Christ auquel il consacre un long monologue ("Le Revenant"), dit au cabaret du Chat noir et qui le fit sortir de la misère. Le Christ, donc, revient, accomplissant le vœu du narrateur qui le rencontre un soir dans la rue ; image traditionnelle, il est pâle et triste : « T’as tout à fait l’air d’un artiste ! / D’un d’ces poireaux qui font des vers » ; après avoir constaté avec lui qu’il n’intéressait plus personne, le narrateur lui propose un travail, aux Halles, et Jehan Rictus aborde l’une des questions politiques des années 1890, l’antisémitisme : où le Christ peut-il aller ? « N’va pas chez Drumond on t’bouffrait / Après tout tu n’étais qu’un youtre ! » Il rappelle que le Christ promettait le « Royaume des cieux » aux pauvres, mais : « C’est avec ça qu’on nous empaume », et il conclut « L’Homme doit êt’ son Maître et son Dieu ».
Il y a un radicalisme chez Jehan Rictus qui s’exprime notamment dans une lettre à Léon Bloy dans laquelle il dénonce le sort des ouvriers avec le capitalisme : « Tout vaut mieux, même le retour à la barbarie, à la caverne primitive, qu’une pareille organisation sociale ». Il rêve sans illusion d'ouvrir un lieu, une « Maison des Pauvres », « pour les vaincus... les écrasés, / Les sans espoir... les sans baisers ». Le Cœur populaire, écrit « en langue populaire », rassemble les poèmes écrits entre 1900 et 1913 et s’ouvre, significativement, par une "Idylle" : la déclaration d’amour (« Mom’, c’que t’es chouatt’ ! Mom’, c’que t’es belle ! ») est suivie d’un tableau de la vie possible du couple qui exclut que la femme soit poussée à se prostituer, « Jamais je n’te mettrai su’ l’tas ». Ce n’est pas le seul poème qui défend la dignité de la femme pauvre ; "La grande Irma", un des poèmes écrit sans élision, est une adresse d’un homme à sa mère qui s’est prostituée pour qu’il puisse faire ses études et il promet un engagement, « Désormais j’aurai ma chimère / et rêverai d’une Patrie /où la Femme ne sera plus / traquée, vendue, forcée, flétrie, / à l’abri de nos trois couleurs ». Parmi d’autres poèmes, "Conseils" a une valeur particulière puisqu’il s’agit d’inciter les ouvriers à gagner eux aussi leur dignité, d’abord par la propreté, l’hygiène, pour refuser une image répandue, y compris en effet dans les romans de Zola.
La veine de Jehan Rictus s’est tarie après la première Guerre mondiale, cependant ses poèmes rageurs, à l’écart de tout engagement politique — le"ni dieu ni maître" de l’anarchisme — , témoignent d’une époque, les années 1880-1890, où la violence de l’État s’exerçait contre le monde ouvrier bien plus qu’aujourd’hui — faut-il rappeler la fusillade de Fourmies (dix morts) contre ceux qui réclamaient pacifiquement la journée de huit heures ?
La lecture de Jehan Rictus est ici facilitée par un glossaire qui ne laisse rien passer. L’éditrice a ajouté une bibliographie et des poèmes absents de l’édition qu’elle a retenue : un travail rigoureux, complété par la préface toute de sympathie de Patrice Delbourg.
Jehan Rictus, Les Soliloques du pauvre, suivi de Le Cœur populaire, édition Nathalie Vincent-Munnia, préface Patrice Delbourg, Poésie/Gallimard, 2020, 402p., 9, 50 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 2 décembre 2020.
* Poésies complètes, La Part commune, 2012 ; Fil de fer [autobiographie], La Part commune, 2011 ; Journal quotidien 1898-1899, Claire Paulhan, 2015.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jehan rictus, les soliloques du pauvre, suivi de le cœur populaire | ![]() Facebook |
Facebook |
31/12/2020
Vladimir Pozner, Un pays de barbelés : recension
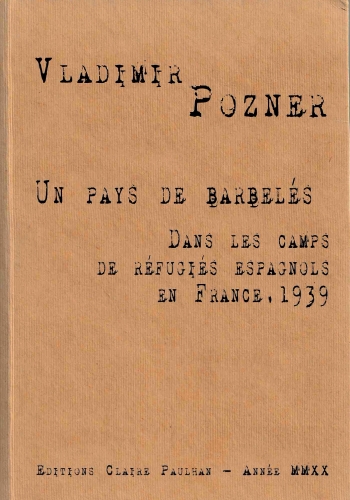
La guerre d’Espagne et la défaite de la République espagnole ont suscité une abondante bibliographie : essais, témoignages, œuvres de fiction ; moins de livres portent sur l’exil des républicains (la Retirada) en France qui a suivi la guerre et, surtout, sur leur enfermement dans des camps — d’abord nommés "camp de concentration", puis "d’hébergement", "d’accueil", enfin "camp" — par un gouvernement du Front populaire débordé et qui craignait la diffusion d’idées considérées "dangereuses". Un pays de barbelés est un document sur ces camps ; la préface présente Vladimir Pozner et précise quel a été son rôle avant de donner à lire ses archives.
Il est en effet indispensable de disposer du contexte pour comprendre ce que furent les camps de réfugiés. Vladimir Pozner (1905-1992), né à Paris de parents qui avaient fui la Russie tsariste, était cependant retourné à Moscou et avait connu la Révolution de 1917 ; poète, il a alors fréquenté le milieu littéraire russe et, de retour à Paris dans les années 1920, il a traduit par exemple Victor Chklovski. Devenu journaliste et écrivain, il a publié dans les revues littéraires de l’entre-deux guerres et dans la presse de gauche ; après l’accession de Hitler au pouvoir, il a aidé les réfugiés antifascistes allemands au sein de l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires, proche du Parti communiste fondée en 1932 et dirigée par Paul Vaillant-Couturier ; il est devenu secrétaire de rédaction de Commune, revue de l’association.
C’est en février 1939 qu’un Comité d’accueil aux intellectuels espagnols est formé, présidé par Renaud de Jouvenel ; Aragon, par le biais du journal communiste Ce soir, qu’il dirige avec Jean Richard-Bloch, a lancé un appel international aux dons après avoir constaté l’état de dénuement des réfugiés dans les camps : l’argent était indispensable puisqu’un réfugié ne pouvait sortir d’un camp qu’avec un « permis spécial » payé 2000 francs. Jean Cassou écrivait dans Ce soir le 20 juin 1939, « En aidant les intellectuels espagnols à vivre, c’est nous-mêmes que nous défendons, c’est le meilleur de notre histoire que nous réhabilitons » — allusion transparente au fait que le gouvernement français n’avait rien fait contre l’attaque de la République espagnole par l’armée franquiste et que, selon les mots de Pozner, il n’offrait aux réfugiés qu’ « un morceau de sol français entouré de barbelés français ».
Vladimir Pozner est arrivé à Perpignan le 23 mars 1939, chargé par le Comité d’accueil de visiter les camps pour tenter d’en faire sortir des intellectuels ; tâche difficile, les autorités n’étant que rarement prêtes à coopérer : Alexis Buffet rapporte dans la préface la diplomatie dont a su faire preuve Pozner. Il analyse également comment « Dans le sillage des Choses vues de Victor Hugo, les notes et descriptions de Pozner construisent une fiction d’instantanéité. Nerveuses, brutes de décoffrage, elles (...) révèlent la réalité des camps ».
Les documents réunis dans le livre sont de plusieurs types : lettre, article de journal, carnet de notes, rapport, photographie. Le premier ensemble est constitué de 16 cartes postales, chacune commentée par Pozner ; ne sont retenus dans les descriptions que quelques détails : bras dans le plâtre fixé avec du fil de fer, un rideau sur les épaules contre le froid, et pour un décor : « Une impasse, une cour, un bout de rue, de toute façon dehors » ; dans un camp sur la plage, des tentes faites de trous dans le sable recouverts de morceaux de bois et l’immense foule des réfugiés espagnols en face des officiers de la garde mobile. Ces brèves notations sont complétées par celles, le plus souvent elles aussi lapidaires, d’un "Carnet de notes" tenu de mars à mai 1939, base des rapports de Pozner sous forme de lettres à Renaud de Jouvenel, de ses articles dans la presse et, plus tard, de Espagne premier amour (1965).
Tout ce qui se rapporte aux réfugiés, observé au cours de ces deux mois, est relevé : de la discussion à propos de la prononciation du latin à la recherche d’un vacher parmi les réfugiés par un éleveur. Pozner voit des réfugiés menottés, il apprend qu’un jeune espagnol est frappé par un policier qui l’accuse d’avoir tué cinquante ( !) prêtres, il recopie les paroles d’une chanson écrite dans le camp de Saint-Cyprien, dont il reproduira dans un article deux strophes qu’il a traduites ; on y lit : « Que je serais heureux / Si je pouvais me reposer /Dans les bras de la France / Et de son Front populaire ». Il décrit ce qui précède le départ pour le Mexique d’un ensemble de réfugiés, l’entassement des femmes et des enfants dans les Haras de Perpignan dans la paille et les parasites, avec
les valises que les gardes mobiles fouilleront une fois de plus, une dernière fois, ces misérables valises en simili, en toile cirée, en papier mâché, ces nœuds de linge sale, de couvertures déchirées, cette chair à poubelles, articles pour chiffonniers, témoins de trois ans de guerre, de l’exode, des camps de concentration que les mobiles fouilleront une fois de plus — pour laisser aux partants un bon souvenir de la France.
Il rencontre dans un ancien hôpital militaire de Perpignan un réfugié menuisier qui passe son temps à réparer ce qui peut l’être avec pour outil un couteau de poche, il n’oublie pas le petit cahier avec des dessins et de courts textes politiques qui circule au camp de Barcarès, il présente le consul mexicain, Fernando Gamboa, dont l’amical Buen viaje, compañeros accompagne ceux qui rejoignent le navire vers le Mexique.
On retrouve l’essentiel des informations du "Carnet de notes" dans les trois rapports, sous forme de lettres, envoyés à son ami Renaud de Jouvenel. On lit aussi d’autres exemples de la violence manifestée vis-à-vis des réfugiés, un chef de cabinet de préfet assurant qu’ « ils sont bien à Bram [camp dans l’Aude], trop bien même, à mon avis, puisqu’ils ne veulent pas retourner en Espagne ». On comprend que Pozner doit être — et il l’est — fin diplomate pour obtenir ce qu’il veut, des listes d’intellectuels espagnols et la possibilité de les sortir des camps. L’indifférence, au mieux, quant au sort de réfugiés est partagée par une partie de la population, si l’on en juge par un article paru dans la presse locale après le déplacement d’un camp : « Les camps, les réfugiés, la troupe, la police donnaient beaucoup d’animation au Roussillon ». Dans le même texte inédit où il a recopié cet extrait, Pozner relate sa visite du camp de Montolieu et l’on devine sa rage quand il écrit : « [Les réfugiés] dormaient sur la paille, mangeaient des lentilles et, après avoir combattu les avions italiens et les tanks allemands, luttaient contre le plus impitoyable des ennemis, la vermine française. » `
Outre une substantielle bibliographie, plusieurs annexes prolongent les textes de Pozner : les plans de travail des réfugiés — enseignements dispensés, conférences, préparation pour le départ au Mexique —, le rapport de Jean Cassou (juin 39) qui insiste notamment sur le fait qu’ « il s’agit d’accueillir une armée vaincue qui s’est battue pour un idéal semblable à celui qu’a toujours défendu la nation française ». De nombreuses illustrations et fac-similés aident à se représenter des situations trop oubliées aujourd’hui. Tout le livre aide aussi à réfléchir sur le sort des immigrés d’aujourd’hui qui tentent de rejoindre ce qu’ils pensent être un lieu d’accueil.
Voilà un livre politique, c’est-à-dire qui concerne les citoyens, à lire et faire lire.
Vladimir Pozner, Un pays de barbelés, édition établie et préfacée par Alexis Buffet, éditions Claire Paulhan, 2020, 288 p., 33 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 27 novembre 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir pozner, un pays de barbelés : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
18/12/2020
Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance 1920-1959 : recension
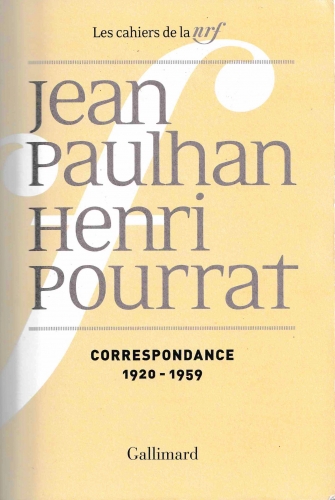
La correspondance commence avec une lettre de Paulhan du 19 avril 1920, demandant à Pourrat une note, pour La NRF, à propos d’un livre de Francis Jammes ; la note est écrite et les deux écrivains s’envoient leurs livres. Paulhan regrette l’éloignement de Pourrat, qui vit à Ambert, et sollicite rapidement une collaboration régulière. Après quelques échanges d’éléments plus personnels — mais les lettres de Pourrat sont absentes jusqu’au 26 septembre —, Paulhan termine sa longue lettre du 15 juin 1920 par « Je suis votre ami » et débute la suivante par « Mon ami », à quoi répond un « Cher ami » suivi, comme ce sera souvent le cas, de nouvelles développées.
Tout semblait séparer les deux hommes, outre l’éloignement géographique : Paulhan (1884-1968) avait un métier, en même temps qu’il assurait le secrétariat de La NRF avant d’en prendre la direction, en 1925, à la mort de Jacques Rivière ; cette fonction lui faisait rencontrer le milieu littéraire, de Gide et Valéry aux surréalistes : il écrivit dans Littérature, la revue d’André Breton. Henri Pourrat (1887-1959), souffrant de la tuberculose, avait dû abandonner sa formation d’agronome et vivre à Ambert ; il publia très tôt des poèmes, collaborait à des journaux régionaux en Auvergne et trouva sa voie avec la publication de Les Vaillances, farces et aventures de Gaspard des montagnes en 1921. Les différences ont été mises entre parenthèses et les deux hommes se sont vite découvert des motifs d’échanger.
Pourrat exprime souvent un lien très fort, vivant, à la nature qui l’environne, soucieux d’aménager un potager, de planter des arbres fruitiers, et il écrit à propos des changements dans la montagne au fil des saisons, de la dureté des hivers, des plaisirs simples de la campagne (« Je cueille des champignons rosés dans de jolis prés »). Toute son œuvre est écrite principalement « sur les gens d’Auvergne, leurs coutumes, leurs mœurs », c’est-à-dire à propos du monde paysan dont, en observateur avisé, il observe la mort possible et, écrit-il dès 1928, « Ce pourrait être intéressant (...) ces transformations qu’on a sous les yeux, et [de] se séparer de tout un régionalisme. » Ses descriptions du quotidien, comme ses livres, ont toujours été très favorablement accueillis par Paulhan qui était également un observateur de la nature. Il raconte qu’à Paris une marchande de journaux gardait dans son kiosque une salamandre qu’elle nourrissait de salade, ou que Paul Éluard lui « a apporté un caméléon de Tunisie » ; lui-même élevait des lézards verts, des poissons rouges. Il note qu’au moment de la migration des hirondelles, les plus anciennes s’occupent des plus jeunes et, qu’au mois de juin, son jardin est « pris d’une sorte de folie bien plus animale que végétale, et lance de tous côtés des fleurs et des tiges que l’on reconnaît à peine ». Il serait aisé de multiplier les traces du souci de la nature dans leur correspondance ; en octobre 1937 encore, Pourrat ajoute à la fin d’une lettre, « Hier nous avons vu une si belle monstrueuse salamandre. J’ai pensé à la capturer pour toi. »
Les échanges portent aussi régulièrement sur les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne, personnelle et professionnelle. Pourrat et Paulhan se font part de leurs problèmes de santé, de ceux de leurs proches : pour le premier, il souffrira beaucoup de la mort de sa fille aînée, âgée de dix ans, en mai 1940, pour le second, il voit l’évolution de la maladie de Germaine, son épouse, qui perd toute sa mobilité. Les rationnements au cours de la guerre ont donné à Pourrat l’occasion d’apporter à Paulhan, alors installé à Paris, une aide efficace en lui expédiant des sacs de charbon de bois pour le chauffage et des vivres, pommes de terre, topinambours et miel. On lit des deux côtés une attention constante à l’autre et les témoignages réciproques d’amitié sont aussi nombreux en ce qui concerne leur travail, chacun tenant l’autre au fait de ce qu’il écrit.
Dès le début de leur relation, en 1920, Pourrat remercie Paulhan d’avoir publié dans La NRF quelques poèmes qui contribuent à le faire connaître ; il ne cessera les décennies suivantes de lui savoir gré de ses lectures attentives et critiques. On peut voir par les remarques de Paulhan ce que pouvait être alors un éditeur ; à propos d’un roman de Pourrat, Le Mauvais garçon, il détaille tout le bien qu’il en pense (délicatesse, justesse, poésie) et, ensuite, précise ce qui lui paraît à reprendre — « Il faut que je te tracasse sur deux ou trois points » —, à alléger ou supprimer dans la première partie, etc. Cet éditeur savait découvrir dans Pourrat autre chose qu’un écrivain "régional", lisant dans un récit un « sentiment d’horreur ou d’effroi (...) qui donne à ton œuvre une raison tragique ». Il ne se posait pas pour autant en supérieur, insistant sur le rôle positif de Pourrat pour lui, «Tu es mon homme libre ; il y a beaucoup de choses que je choisis ou que je juge à partir de toi, ou de ce que je serais si j’étais toi », projetant d’écrire deux romans ensemble lors d’une rencontre, lui demandant son avis quand il publiait un livre ou l’écrivait (« Ça ne t’ennuie pas que je te parle un peu des Fleurs de Tarbes ? »). Pourrat, de son côté, a toujours sollicité et apprécié les remarques et conseils de son ami : « Je pense à toi comme à celui qui m’a donné le sens de la qualité et comme au meilleur des témoins, des juges, des parrains », lui écrit-il, et il a régulièrement commenté les livres de Paulhan dans ses lettres et dans des articles*, très intéressé notamment par l’art du récit.
Pourrat publiait beaucoup (c’était son gagne-pain), en partie aux éditions Gallimard, et il a souvent sollicité l’aide de Paulhan pour régler des problèmes de tirage, de promotion de ses livres, et il était parfois furieux par la désinvolture — le mépris ? — manifesté par certains membres des éditions, comme Brice Parain ; ses lettres reviennent régulièrement sur ces difficultés, accrues par son éloignement de Paris. Paulhan intervient chaque fois qu’il le peut et, par ailleurs, lui donne des nouvelles de la vie de l’édition (en 1931, « Tout va vraiment très mal pour les livres »), des revues. Tous deux échangent à propos des écrivains qu’ils apprécient, Francis Jammes, Cingria, Bove, Ramuz, Joë Bousquet, etc., de Vialatte, que Pourrat a présenté à Paulhan.
Pendant la période de la guerre les confidences se font plus rares. Paulhan s’est engagé très vite dans la résistance, fondant notamment dès 1941 avec Jacques Decour Les Lettres françaises, alors que La NRF était passée sous la direction de Drieu La Rochelle en novembre 1940. Il batailla après la guerre contre les excès de l’épuration, sachant que sa revue, « souillée » sous l’occupation, ne pouvait reparaître — ce sera La Nouvelle Nouvelle Revue française en 1953. Pourrat, de son côté, a d’abord vu dans Pétain celui qui résistait au nazisme ; il recueillit des Juifs dans les années sombres et, plus tard, reconnut qu’il avait été en partie aveugle, « je pense à tout ce que j’aurais dû comprendre mieux auprès de toi ». La maladie gâcha ses dernières années et il voyait la disparition accélérée du monde qu’il avait décrit, « l’homme vient travailler à Ambert pour bénéficier des lois sociales », écrivait-il en 1957.
Ce fort volume est une traversée de quarante ans d’histoire littéraire ; on y découvre l’acharnement de Paulhan pour que sa revue se développe et devienne une référence dans le monde des lettres, l’énorme travail de Pourrat pour restituer la vie et les mœurs d’une région rurale. On y suit également les développements d’une belle amitié.
Jean Paulhan, Henri Pourrat, Correspondance, 1920-1959, édition Claude Dalet et Michel Lioure, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 2020, 816 p., 45 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 18 novembre 2020.
* On lira la liste de ses recensions en appendice et celle des Fleurs de Tarbes reprise intégralement.
Publié dans Paulhan Jean, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, henri pourrat, correspondance, 1920-1959, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
06/12/2020
Hervé Brunaux, Poèmes de près et de loin, Dessins de Jean-Luc Parant : recension

Poèmes de près et de loin procure (m’a procuré !) un double plaisir, retrouver le graphisme de Jean-Luc Parant et lire des poèmes qui évitent complètement le ton bêtifiant de ce qui s’écrit trop souvent "pour les enfants".
Le premier, "perché", joue sur la répétition du mot titre avant chaque strophe de deux vers, sur l’anaphore — chaque strophe s’ouvre avec « sur » pour indiquer un lieu où se percher —, et la première strophe est reprise pour finir avant de clore le poème, la disposition des strophes mimant les mouvements successifs pour se percher :
perché
sur la branche
du tilleul du parking
il ne reste plus qu’à chanter
quand on est bien perché
Sur la page de gauche (mais l’illustration déborde vers la droite), Jean-Luc Parant a dessiné un arbre sans feuilles où sont perchés deux oiseaux verts (un troisième vole sous l’arbre), l’arbre constitué de minuscules boules caractéristiques de ses dessins ; sur deux portées musicales, feuilles jaunes dans le vent, sont recopiées la strophe finale pour l’une, une autre strophe pour l’autre. Le nombre de boules est noté au pied de l’arbre. Cette description sommaire vise à donner une idée de la construction élaborée du livre. On retrouvera les oiseaux verts, d’autres rouges et bleus, et les portées musicales, d’autres figures apparaissent : un cheval (un Pégase ailé), un poulpe, un soleil bleu, etc., le nombre de boules mentionné dans chaque dessin, précision qui arrêtera la curiosité de tout lecteur.
Hervé Brunaux1 ne se limite évidemment pas au jeu du chat perché ; si les animaux ont leur place dans les poèmes, ils ne sont pas du tout majoritaires : l’un énumère quelques animaux... empaillés — mais la planète et les enfants le sont aussi —, un autre, "histoires", met en scène un oiseau qui plonge son bec dans l’encrier et les histoires écrites occupent les arbres. On observe aussi des ours au fond de la mer et des ouistitis sur la lune. Etc. Mais on sait bien que « La seule imagination ne rend compte que de ce qui peut être », écrivait André Breton (cité par Georges Jean : 2), et les poèmes ici font la part belle à l’imaginaire, variant les motifs sans négliger le réel. Ainsi l’amour / l’amitié avec "dans nos mains" :
dans ta main
les lignes de ma vie
dans ma main
les lignes de ta vie
qui s’achève par ces deux vers « dans nos deux mains enchevêtrées / le labyrinthe de l’avenir ». On voit que les mots employés débordent, et c’est toujours le cas dans le livre, le vocabulaire des enfants. Comme l’analyse Georges Jean, « Des mots difficiles sont éclairés par les autres, et même (et heureusement) parfois restent pour longtemps incompréhensibles, indéchiffrables, magiques ».2 On lira aussi de brefs poèmes-récits qui ressemblent à des souvenirs d’enfance.
D’une manière générale, l’organisation des poèmes rompt plusieurs fois avec les conventions et se rapproche des découpages de la poésie contemporaine, disons depuis Apollinaire, y compris avec l’absence de majuscule en début de vers. Hervé Brunaux privilégie l’emploi de refrains, l’anaphore, les répétitions — y compris d’un vers entier avec seulement une variante, à la manière de Prévert —, la polysémie, le découpage des mots, le jeu des sonorités, tout l’éventail des moyens propres à donner le plaisir de lire.
Les poèmes et les illustrations faussement naïves qui les accompagnent forment un ensemble que l’on voudrait voir dans les bibliothèques, celles des écoles, celle des enfants de tous âges. À offrir sans restriction !
Hervé Brunaux, Poèmes de près et de loin, dessins de Jean-Luc Parant, Lanskine, 2020, 56 p., 13 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 5 novembre 2020.
1 Hervé Brunaux a fondé en 2002 le festival expoésie à Périgueux (lectures (y compris dans des écoles), conférences, expositions). Il a publié plusieurs livres de poésie et des romans.
2 Georges Jean, "L’enfant lecture et poésie", dans Communication et Langages, 1977, n° 34, p. 75.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé brunaux, poèmes de près et de loin, dessins de jean-luc parant | ![]() Facebook |
Facebook |