24/11/2018
Charles Reznikoff, La Jérusalem d'or : recension
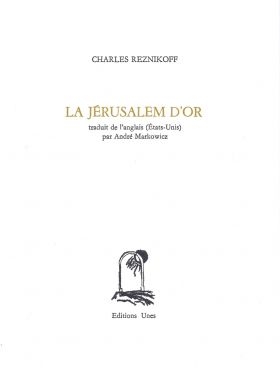
Longtemps ignoré en France, comme les autres poètes du mouvement objectiviste1(Louis Zukofky, George Oppen, Carl Rakosi notamment), Charles Reznikoff (1894-1976) est aujourd’hui largement traduit. The Golden Jerusalem l’a d’abord été partiellement par Jacques Roubaud en 1977 (8 poèmes), ensuite par Sabine Macher en 2000 (15 poèmes).2Publiés en 1934, les 79 poèmes, numérotés et parfois titrés — le dernier a le titre de l’ensemble —, sont de dimension très variable : un seul vers pour le 29ème, plus de trois pages pour le 75ème.
Le livre s’ouvre par des références à la tradition hébraïque, le nom de Sion et l’allusion au Cantique des cantiques avec le passage où Salomon chante l’amour de la Sulamite. Il est d’autres renvois au Tanakh, certains poèmes sont même construits à partir des livres sacrés ; à partir : cela signifie que Reznikoff les retient non pour un retour à un passé révolu mais pour vivre le présent. Ce qui importe par exemple dans le poème issu de Josué, XXIV, 13, c’est la mise en valeur du mouvement des Hébreux, chassés par leur dieu dès qu’ils commencent à se sédentariser ; dispersés, ils deviennent « citoyens des grandes villes, / parlant hébreu dans toutes les langues sous le soleil ». De même le théologien juif Luzzato a quitté Padoue où il vivait pour se rendre à Jérusalem, comprenant la nécessité de l’exil pour lire autrement les textes de la tradition, « j’ai perdu ma patience devant ce que disent les rabbins », lui fait dire Reznikoff. Presque toutes les évocations de la tradition mettent l’accent sur la nécessité de garder en mémoire ce qui appartient à une culture et, en même temps, de penser le passé par rapport à aujourd’hui ; écrire avec ce qui nous a précédés : un poème, titré "Les Anglais en Virginie, avril 1607" est accompagné d’une note pour préciser qu’il a emprunté des données aux « Œuvres du capitaine John Smith publiées par Edward Arber ». Si l’on revient aux premiers poèmes du livre, on construit le passage de la tradition à la vie contemporaine, ainsi des vers sur la « lune dévergondée » « montrant son sein de rose et d’argent / à la ville tout entière, » précèdent une allusion à des « rois David » aux affaires aujourd’hui et à une Bethsabée au bain. Ainsi, après les vers relatifs à la destruction d’Israël — les Hébreux ayant négligé leur Dieu, préoccupés par des choses futiles (« envoyer des baisers à la lune ») — le narrateur s’interroge : « que doit-il m’arriver / à moi qui regarde la lune, les étoiles et les arbres ? »
Il n’arrivera rien au marcheur dans la ville — Reznikoff vivait à New York —, sinon toujours rencontrer la lune lors de ses errances, nocturnes ou non, la lune et ce qui appartient auss à la vie d’une ville : les changements visibles de saison, la neige de l’hiver puis sa disparition et, alors, « les haies ont reverdi, les arbres sont verts. » Au cours de ses marches survient l’inattendu, un moineau seul au milieu de la rue qui finit par s’envoler « dans un arbre poussiéreux ». L’irruption d’éléments de la nature dans le monde urbain y introduit parfois des caractères à la limite du fantastique ; un jour, deux chevaux, l’un noir l’autre blanc qui tirent une charrette « semblent fabuleux », un autre jour, le narrateur rencontre un cheval présenté comme s’il était seul, « Que fais-tu dans notre rue au milieu des voitures, cheval ? Comment vont tes cousins, le centaure et la licorne ? » La présence de la nature dans la ville, avec les feuilles et les fleurs, est signalée à plusieurs reprises ; ici, on arrive à un « arbre blanc de fleurs », là, « Sur le chemin du métro, ce matin / le vent nous souffle des poignées de pétales blancs ».
Ce n’est pas dire que la ville est un lieu de vie idéal ; on voit des mouettes blanches voler, mais c’est au-dessus du fleuve « où les égouts déversent / leurs vaguelettes lentes », la fumée des pots d’échappement d’un « bleu brouillé » figure des fleurs, mais des « fleurs puantes ». Cependant, pour le marcheur, c’est le métro, évoquant le monde souterrain de la mythologie grecque avec Héphaïstos, qui représente ce que la ville a de plus détestable : image d’une forêt, mais « bois de piliers d’acier », « terre stérile », « lumière sans crépuscule », et partout poussière, bouts de papiers. Les papiers ne sont certes pas rares dans la rue, ils n’ont pourtant pas le même aspect, « pas un morceau qui n’ait souffle de vie ». Ce qui domine, dans la vision du marcheur, c’est la capacité des éléments naturels à absorber et transformer les détritus rejetés dans le fleuve par les hommes :
Lorsque le ciel est bleu, l’eau, sur fond de sable, est verte.
On y déverse des journaux, des boîtes de conserve,
un ressort de sommier, des bâtons et des pierres :
mais les uns, les eaux patientes les corrodent, les autres
une mousse patiente les recouvre.
La ville est aussi un milieu où l’amour a sa place. Reznikoff approuve les pratiques simples, anciennes pour dire le sentiment amoureux : « le cœur et les flèches — les soupirs, les yeux embués ; et les vieux poèmes — je les crois vrais ». La pauvreté d’une partie importante de la population dans les années 1930 des États-Unis pourrait expliquer la forme choisie des échanges amoureux, mais il y a aussi fortement le refus du paraître dans leur expression : offrir un café plutôt qu’une fourrure, apprécier la beauté des réverbères plutôt que celle d’un autre pays, sont de vraies marques d’amour, et l’aimée ne s’y trompe pas, « c’est bien assez, disait-elle ».
Il n’est pas toujours aisé de lire Reznikoff, il me semble que la traduction, au plus près du texte, nous y aide : elle restitue avec justesse son écriture sans apprêt et il appartient alors au lecteur de reconstruire un contexte. Il y a dans La Jérusalem d’or un souci constant de ne pas hiérarchiser les cultures, de ne pas se figer sur un moment du temps — le dernier poème commence avec "Le livre de Juda", continue avec "Le bouclier de David", puis "Spinoza" et s’achève avec "Marx". Un souci également d’insister sur la valeur du mouvement, de l’exil même, pour s’ouvrir aux choses du monde sans préjugé.
__________________________________________________________________
1 À lire, la conférence de P. Blanchon et É. Giraud, Des objectivistes au Black Mountain College, La Nerthe, 2014.
2 Europe, juin-juillet 1977 pour les traductions de Jacques Roubaud, reprises dans Traduire, journal, NOUS, 2018 ; If, n 16 ; 2000, pour celles de Sabine Macher.
Charles Reznikoff, La Jérusalem d’or, traduction André Markowicz, édition unes, 2018, np, 15 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 20 octobre 3018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles reznikoff, la jérusalem d’or, traduction andré markowicz, recension | ![]() Facebook |
Facebook |






Les commentaires sont fermés.