16/06/2012
Jean Tardieu, Jours pétrifiés (1942-1944)
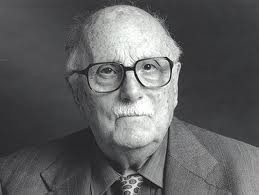
Regina terrae
À Albert Camus
Comme un souvenir
je t'ai rencontrée,
personne perdue.
Comme la folie,
encore inconnue.
Fidèle fidèle
sans voix sans figure
tu es toujours là.
Au fond du délire
qui de toi descend
je parle j'écoute
et je n'entends pas.
Toi seule tu veilles
tu sais qui je suis.
Le terre se tourne
de l'autre côté,
je n'ai plus de jour,
je n'ai plus de nuit ;
le ciel immobile
le temps retenu
ma soif et ma crainte
jamais apaisés,
pour que je te cherche,
tu les as gardés.
Sœur inexplicable,
délivre ma vie, laisse-moi passer !
Si de ton mystère
je suis corps et biens
l'instant et le lieu,
ô dernier naufrage
de cette raison,
avec ton silence
avec ma douleur
avec l'ombre et l'homme,
efface le dieu !
Faute inexpiable
je suis sans remords.
Dans un seul espace
je veux un seul monde
une seule mort.
Jean Tardieu, Jours pétrifiés, 1942-1944,
Gallimard, 1948, p. 77-79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tardieu, jours pétrifiés, regina terrae | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2012
Jean-Philippe Salabreuil, L'inespéré

Au corps perdu de la beauté
Ô dans l'obscur délice de l'issue
Vers toi qu'est-ce qui soudain m'illuminait
D'une brûlure graciée lorsque je sus
Qu'il est au-delà du suffocant ressaut de neige
Dans l'être le feu d'un monde qui se leva ?
Mais regarde une fois encore (et tu vas
Te fermer bientôt sur l'or de la vie
Comme l'œil noir de l'eau) mes yeux sont dans la mort !
Je te vois n'ai-je su te ravir à toi ravie
Déjà que tu étais d'une aile blanche au corps
Perdu de la beauté au creux de terre
Et ne t'aimerai-je plus jamais en ce monde clair ?
À moi fermée ! ne me regarde plus demeure
Une porte d'or close au fond des cieux meurs
Heureuse de m'aimer mourir de moi aimée
(Je te veille en ta nuit veille à mes jours mais
Ne te sois pas rouverte aux neiges de l'oubli
Quand je te rejoignais te rouvrir accomplie)
Et dans le blanc délire de l'essor
En moi de ces lys en démence vers elle
Était un ange d'or qui parmi le réel
Voluptueux et noir a brillé comme l'aurore
Éclairant de ses dons les panneaux condamnés !
J'allais dans les feux de la voûte où sont nés
Les nuages dorés du rêve (ils montent
Leurs yeux clos dans la gloire éternelle mais
Jamais s'éveilleront-ils ?) dans les anneaux du monstre
Où l'âme a reconnu la crypte du secret !
Qu'est-ce alors qu'il n'y eut plus que moi parmi
Les régions neigeuses de l'étoile ennemie ?
Alors à l'extrême le mur éternel blanc
Chanta comprenant une porte qui chante
Et s'ouvre dans le noir à l'état du soleil
(Une flamme s'élevait qui fut toi) merveille
Que ce feu dans le froid de la mort quand nous
Fûmes ce feu ô l'astre où les âmes renouent !
Jean-Philippe Salabreuil, L'inespéré, collection "Le Chemin",
Gallimard, 1969, p. 93-94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-philippe salabreuil, l'inespéré, la beauté, amour | ![]() Facebook |
Facebook |
14/06/2012
Bernard Vargaftig, Distance nue

Saisissement et souffle
Un mur bruissait
Les dahlias toujours un geste
Et l'échelle appuyée
Brindilles dispersion
Mouvement orge
Prairie l'écho avec l'ombre
Que le vent oubliait
L'étreinte
Et l'avalanche près du
Pommier quel mot
Vient s'effacer en moi
Quand soudain le virage
Était le même et cela
Dans la durée
Si furtive s'éloigne
Craint appelant comme
Dans le vertige
Les bouquets et l'éclaircie
Sans cesser de trembler
Bernard Vargaftig, Distance nue,
André Dimanche, 1994, n. p.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard vargaftig, distance nue | ![]() Facebook |
Facebook |
13/06/2012
Tommaso Landolfi, La Muette

[...]
Oui, je voudrais parler un peu d'elle, mais vraiment d'elle, de cette elle-là, avant d'en venir à l'autre. Je voudrais, mais je ne sais pas ; je ne sais dire qu'une seule chose, et pour la dire, il faut que je reprenne pour la troisième fois cette malheureuse phrase dans laquelle je me suis enfermé, je ne sais pas pourquoi. Oui, je me débats et je tâtonne : je voudrais au moins savoir qui est celle que j'ai tuée, que j'ai faite mienne pour l'éternité, et ce n'est certainement pas ainsi que je le saurai. (Du moins, je ne le crois pas, mais il m'arrive de ne pas pouvoir résister à la tentation peccamineuse de la définir , et avec le froid langage de la raison.) Mais finissons-en ! J'ai dit au commencement : son regard était muet de quelque chose ; puis j'ai contredit partiellement cette proposition pour la réaffirmer d'une certaine manière tout de suite après ; et maintenant, à force de me balancer sur cette image médiocre et fort relative, je devrais me reporter à la première affirmation, misérable que je suis ! Et pourtant il en est presque ainsi : son âme, comme son regard, était muette de quelque chose. De tout. Ou plutôt, c'étaient ses quinze ans qui étaient muets, muets de tout autant qu'avides de tout. Je ne peux rien dire d'autre, mais peut-être déjà que tout est là ; et le lac de sang qui bouillonne dans mon cœur. De ce qui était le plus important (de son amour ?) elle ne parlait jamais ; qui sait ? elle ne pouvait peut-être pas ; et sa mutité m'enveloppait, m'assourdissait, m'ôtait la mémoire, comme la voix même du silence. Ets-ce que j'aurais pu ne pas...
Tommaso Landolfi, La Muette [Tre racconti], nouvelles, traduit de l'italien par Viviana Paques, Gallimard, 1970, p. 29-30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tommaso landolfi, la muette, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2012
Georges Bataille, La Littérature et le mal : Baudelaire

La poésie est toujours en un sens un contraire de la poésie (à propos du Baudelaire de Sartre)
[...] Inhérente à la poésie, il existe une obligation de faire une chose figée d'une insatisfaction. La poésie, en un premier mouvement, détruit les objets qu'elle appréhende, elle les rend, par une destruction, à l'insaisissable fluidité de l'existence du poète, et c'est à ce prix qu'elle espère retrouver l'identité du monde et de l'homme. Mais en même temps qu'elle opère un dessaisissement, elle tente de saisir ce dessaisissement. Tout ce qu'elle put fut de substituer le dessaisissement aux choses saisies de la vie réduite : elle ne put faire que le dessaisissement ne prît la place des choses.
Nous éprouvons sur ce plan une difficulté semblable à celle de l'enfant, libre à la condition de nier l'adulte, ne pouvant le faire sans devenir adulte à son tour et sans perdre par là sa liberté. Mais Baudelaire, qui jamais n'assuma les prérogatives des maîtres, et dont la liberté garantit l'inassouvissement jusqu'à la fin, n'en dut pas moins rivaliser avec ces êtres qu'il avait refusé de remplacer. Il est vrai qu'il se chercha, qu'il ne se perdit, qu'il ne s'oublia jamais, et qu'il se regarda regarder ; la récupération de l'être fut bien, comme l'indique Sartre, l'objet de son génie, de sa tension et de son impuissance poétique. Il y a sans nul doute à l'origine de la destinée du poète une certitude d'unicité, d'élection, sans laquelle l'entreprise de réduire le monde à soi-même, ou de se perdre dans le monde, n'aurait pas le sens qu'elle a. Sartre en fait la tare de Baudelaire, résultat de l'isolement où le laissa le second mariage de sa mère. C'est en effet le « sentiment de solitude, dès mon enfance », « de destinée éternellement solitaire », dont le poète lui-même a parlé. Mais Baudelaire a sans doute donné la même révélation de soi dans l'opposition aux autres, disant : « Tout enfant, j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie ». On ne saurait trop attirer l'attention sur une certitude d'irremplaçable unicité qui est à la base non seulement du génie poétique (où Blake voyait le point commun — par lequel ils sont semblables — de tous les hommes), mais de chaque religion (de chaque Église), et de chaque patrie.
Georges Bataille, La littérature et le mal, "Baudelaire", dans Œuvres complètes, IX, Gallimard, 1955, p. 197-198.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, la littérature et le mal, baudelaire, poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2012
Christiane Veschambre, Triptyque de la chambre secrète

Un triptyque est un ouvrage de peinture, dit le dictionnaire, composé d'un panneau central et de deux volets mobiles susceptibles de se rabattre sur le panneau en le recouvrant exactement.
Celui-ci n'a que des volets.
Sur le premier volet, la chambre secrète est précédée de l'antichambre.
L'antichambre tient de la grotte par son obscurité. Mais n'est pas archaïque. Plutôt infernale. On s'y tient sur une chaise. On a vingt ans. On attend : c'est une salle d'attente. On peine à voir celles qui se tiennent sur les autres chaises disposées autour de la salle, visages baissés vers l'ombre.
Aux murs, des tableaux. Nombreux, encadrés, cossus. Visibles, eux, malgré l'ombre dont ils ne semblent pas affectés.
Aujourd'hui, où j'écris ceci, leur propriétaire est mort depuis longtemps. C'était un marchand de viande morte. Un passeur pour clandestines. Chacune d'entre elles avait dû au préalable rassembler l'argent du passage.
Lorsque vient son tour, on entre dans la salle où cela se passe. Après l'obscurité de la salle d'attente, la lumière y est violente. Crue : comme de la chair. Le marchand est là, il est vieux moins par l'âge que par cette ombre sale déposée on ne saurait dire où sur sa face. Il est sans visage sinon celui du passeur marchand qui voit défiler les clandestines comme autant de cadres à poser dans la salle d'attente autour des gravures et peintures où tente de se représenter le vivant.
Il est sans regard aussi, et l'on n'aura aucun souvenir de sa voix (une voix sans timbre, comme la face sans visage) qui, d'abord, exige le prix convenu. La lumière de la salle, c'est pour l'argent ; l'argent, ici, est lumière. Fait lumière dans la lumière. Ne glisse pas de l'ombre d'un sac à l'ombre d'un tiroir. Cru, lui aussi, il s'ouvre dans les mains froides sous la lumière blanche portée à sa plus grande intensité. La face un peu sale du marchand s'efface sous l'argent cru.
Christiane Veschambre, Triptyque de la chambre secrète, "Poésie en voyage", La Porte, 2012, np.
6 nos, 20 €, Yves Perrine, 215 rue Moïse Bodhuin, 02000 Laon.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, triptyque de la chambre secrète | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2012
Jacques Roubaud, Ciel et terre et ciel et terre, et ciel
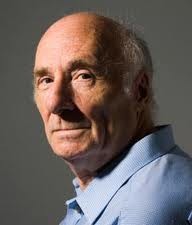
Chapitre 1
Ciel, septembre 1943
Il falalit d'abord franchir le barrage. La retenue d'eau, à l'abandon, en arrière, était envahie d'arbres. La petite rivière se déversait dans le bas, répide, bouillonnante, écumeuse, impétueuse, bordée de roseaux légers. Grâce au barrage, elle était habillée de ronces, de peupliers à l'odeur de miel lourd, de trembles, de frênes, d'aulnes ; feuilles, feuilles vertes ; feuilles déjà jaunes ; feuilles à dessous presque blancs. Un peu plus haut, des arbres, renversés par le vent ou consumés de vieillesse, formaient une sorte de digue : un mur vert, un mur végétal impénétrable. L'eau filtrait à travers ces débris. Elle en sortait toute meringuée d'écume, de libellules, grandes libellules aux yeux de diamant. Les pierres, sur le dessus du barrage, çà et là s'étaient effondrées, disjointes ; couvertes d'herbes, de graminées. Entre elles, des couleuvres d'eau fuyaient en chuintant. Il sautait d'une pierre à l'autre, en espadrilles, restant du côté gauche, du côté de l'eau, par prudence. Il savait nager ; il n'avait pas peur de tomber dans l'eau. Traverser n'était qu'un jeu ; à dix ans, un jeu d'enfant.
Ensuite commençait la garrigue, son territoire personnel, la tranquillité sans menaces, la solitude, son bien. Personne. Il montait par le sentier dans les poussières, es thyms, les muscaris, les lavandes, les buissons de genièvres, les chênes-lièges nains, les vignes abandonnées, quelques pins. Aux coins des vieilles vignes, des pêchers de vigne, des amandiers aux fruits couverts de fourrure verte et grise, comme des oreilles d'âne. Chemin ponctué d'insectes, de froissements, de lézards. L'appel des chiens et des chasseurs, oin. Les passages de vent. Le continuum des grillons comme un silence protecteur. Sur le sentier son pas faisait jaillir des sauterelles. Elles étaient brunes, comme poussiéreuses. Pendant leurs bonds on voyait se déployer le drapeau de leurs élytres; les unes bleues, les autres rouges.
Jacques Roubaud, Ciel et terre et ciel et terre, et ciel, John Constable, Flohic éditions, 1997, p. 7 et 9.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, ciel et terre..., l'eau, enfance, garrigue | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2012
Virginia Woolf, La Dame dans le miroir : réflexion

Virginia Woolf par Roger Fry
On ne devrait pas davantage laisser les miroirs accrochés aux murs qu'on ne laisse traîner son carnet de chèques ou des lettres avouant d'odieux forfaits. En cet après-midi d'été, on ne pouvait quitter des yeux le long miroir suspendu dans l'entrée. Le hasard en avait décidé ainsi. Depuis les profondeurs du divan du salon, on pouvait voir, réfléchis dans ce miroir vénitien, non seulement la table au dessus de marbre qui lui faisait face, mais au-delà, un morceau de jardin. On pouvait voir une longue allée herbeuse longeant des talus plantés de grandes fleurs, et que le cadre doré coupait net dans un angle.
La maison était vide, et seul dans le salon on pouvait se prendre pour un de ces naturalistes qui, sous un camouflage d'herbe et de feuilles, se livrent à l'observation des bêtes les plus farouches — blaireaux, loutres, martins-pêcheurs — prenant leurs ébats librement et, pour leur part, en toute invisibilité. Cet après-midi-là, la pièce était pleine de ces créatures craintives, toute en ombres et lumières, rideaux soulevés par le vent, chute de pétales — toutes choses qui, semble-t-il, n'arrivent jamais en présence d'un observateur. Avec sa chemise de pierre, ses tapis, sa bibliothèque surchargée et ses cabinets de laque rouge et or, le paisible vieux salon campagnard regorgeait de ces bêtes nocturnes. Elles venaient faire des pirouettes sur le sol, avançaient délicatement, pattes hautes, queue étalée, et picoraient à coups de bec allusifs, se donnant des airs de grues, de troupeaux élégants de flamants roses délavés, ou de paons à la traîne veinée d'argent. Il y avait aussi des rougeoiements et des obscurités diffuses, comme si une seiche eût tout à coup répandu de la pourpre dans l'air ; la pièce avait ses coups de passion, de fureur, d'envie, et de chagrin, qui la submergeaient et l'assombrissaient, tout comme un être humain. Rien ne demeurait inchangé, ne fût-ce qu'un instant.
[...]
Virginia Woolf, La Dame dans le miroir : réflexion, traduction par Michèle Rivoire, dans Œuvres romanesques, II, édition publiée sous la direction de Jacques Aubert, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2012, p. 1255-1256.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virginia woolf, la dame dans le miroir : réflexion | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2012
Jean-Philippe Salabreuil, La liberté des feuilles

Chant du chien
Saint François et la Fontaine
Essenine et Supervielle !
C'est ce chien de Salabreuil
Avec sa pelisse en deuil
Qui vous jappe cantilène
Au bord du poème obscur
Depuis sa niche d'étoiles
Et l'ombre à son souffle impur
Se replie au creux du monde
Quelle honte quelle honte
Vous êtes en plein soleil
Et des lambeaux de sommeil
Faseyent sur vos épaules
Quand passe dans la nue molle
Un tourbillon d'or poisseux
Mais voici que parmi ceux
Qui se lèvent tôt sur terre
Vous prêtez à la lumière
Votre oreille en papier blanc
Et ma voix de chien descend
Noire depuis cette vie
Sur ces fleurs qu'elle déplie
Comme fait l'aube au printemps
Avec celles éclatantes
De vieux pommiers pour qu'y entre
Le bourdon lourd et en creux
Du jeune orage d'avril
Ne soyez pas mécontents
Ce chien fou avec sa queue
Fouette ce n'est pas facile
Un lait d'astres poussiéreux
Non sans mouches et taons bleus
Souvenez-vous l'air s'attarde
Un soir de mauvaise garde
À l'odeur de foin coupé
Dans des profondeurs sans âge
Puis l'os long d'un paysage
Un peu de lune à laper
Qu'on nous jette de la route
Bouillon triste maigre croûte
Pour que meure la chanson
Au mâchis des rogatons
Mais c'est à minuit
Que hurle le jeune chien
Moi j'ai peur et le vent tourne
Autour de tout et de rien
Et je le sens qui me flatte
Soulève abaisse ma patte
Je grogne de vieille peur
J'aboie après des lueurs
Vagabondes qui m'entraînent
Ayant rompu toutes chaînes
Pardonnez-moi de toujours
Vous cherchez au lin du jour
Me lamenter à vos trousses
Quand votre mort est si douce
Et si grand votre plaisir
À marcher seul et n'offrir
Plus aucun chant au silence
Pardonnez-moi ma constance
À vous suivre et vous trouver
Ma gueule jamais lavée
Mes ongles rongés de boue
Lorsque je me tiens debout
À votre épaule très chaude
Ma langue pend j'ai faim l'ode
Mauvaise me met en soif
Que toute une vie radieuse
Me fut donnée mais lépreuse
La fis pour mourir au coin
Noir du paradis des chiens.
Jean-Philippe Salabreuil, La Liberté des feuilles,
collection "Le Chemin", Gallimard, 1964,
p. 63-65.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-philippe salabreuil, la liberté des feuilles, chant du chien | ![]() Facebook |
Facebook |
07/06/2012
Michaël Palmer, Première figure
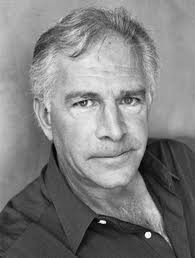
Le village de la raison
Ceci est un gant
ou un livre du club du livre
C'est le soleil
ou un couche de boue
Ceci lundi
ceci un mot altéré
Ceci le village de la raison
et ceci un œil arraché
Ceci le père
ou un nombre sur un tableau
Ceci un substitut
ceci la chose que tu es
Ceci une peinture vernie
ou autrement une réponse acceptée
Ceci la porte
et ceci le mot pour porte
Ceci un réflexe causé en tombant
et ceci un prisonnier avec une orange
Ceci un nom que tu connais
et ceci le poison pour te faire aller bien
Ceci le mécanisme
et ceci l'ombre d'un pont
Ceci une courbe
et cei sa soif
Ceci lundi,
ceci son mot abîmé
Ceci la trace
et ceci le terme sans marque
Ceci le sonnet
et ceci sa maison brûlante
Tu es dans ce jeu
tu es son paysage
C'est une hypothèse
la longueur d'un bras
Ceci un coquelicot
ceci un épilogue
Michaël Palmer, Première figure, traduit de l'anglais
par Virginie Poitrasson et Éric Suchère, "Série
américaine", José Corti, 2011, p. 51-52.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
06/06/2012
Louise Warren, Bleu de Delft : Archives de solitude

Déchirure
Nous sommes dans la déchirure. On peut vire aussi dans la déchirure.
Henri Bauchau
Alors que notre vie est faite d'efforts de réconciliation, de pardon, la littérature, elle, permet non seulement la déchirure, mais elle la reconnaît.
Dessaisissement
La poésie serait la forme la plus libre de la mystique. Le dessaisissement son plus proche voisin.
Enfant
J'ai trois ans et on emporte ma joue.
Fable
Je reconduis les cerceaux et les paupières dans le même été, le même ciel. Il n'y a ni animaux ni bol de lait, seulement les fragments.
Fougère
Entre mes mains et la fougère, le feuille se froisse, pleine de jour.
Livre
Du don que nous font les livres, nous nous devons d'en garder l'esprit, la source vive. Ainsi je crée, plongée dans le paysage qui se prolonge tout autour de moi, avec ce qu'il porte, avec l'essence, l'énergie qui existe entre l'espace et le vide, entre le pas, l'objet, le nuage.
Matière
Ce que je lis, je pourrais le comparer à du compost. De la philosophie, de la poésie, des albums pour enfants, des essais, des mystiques, des baroques, tout cela j'en suis certaine se dépose au fond de moi, se mélange à ma langue.
J'ai toujours cru que cette matière invisible que vous laisse la lecture s'organise, se transforme, afin de se préparer au lent travail de transfiguration que produit la pensée.
Louise Warren, Bleu de Delft, Archives de solitude, Montréal, éditions Trait d'union, 2001, p. 29, 30, 33, 36, 40, 67, 69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
05/06/2012
Guillaume Apollinaire, La Loreley (Alcools)

Le rocher de la Loreley
La Loreley
À Bacharach il y avait une sorcière blonde
Qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde
Devant son tribunal l'évêque la fit citer
D'avance il l'absolvit à cause de sa beauté
O belle Loreley aux yeux pleins de pierreries
De quel magicien tiens-tu ta sorcellerie
Je suis lasse de vivre et mes yeux sont maudits
Ceux qui m'ont regardé évêque en ont péri
Mes yeux ce sont des flammes et non des pierreries
Jetez jetez aux flammes cette sorcellerie
Je flambe dans ces flammes ô belle Loreley
Qu'un autre te condamne tu m'as ensorcelé
Évêque vous riez Priez plutôt pour moi la Vierge
Faites-moi donc mourir et que Dieu vous protège
Mon amant est parti pour un pays lointain
Faites-moi donc mourir puisque je n'aime rien
Mon cœur me fait si mal il faut bien que je meure
Si je me regardais il faudrait que j'en meure
Mon cœur me fait si mal depuis qu'il n'est plus là
Mon cœur me fit si mal du jour où il s'en alla
L'évêque fit venir trois chevaliers avec leurs lances
Mener jusqu'au couvent cette femme en démence
Va-t-en Lore en folie Lore aux yeux tremblants
Tu seras une nonne vêtue de noir et blanc
Puis ils s'en allèrent sur la route tous les quatre
La Loreley les implorait et ses yeux brillaient comme des astres
Chevaliers laissez-moi monter sur ce rocher si haut
Pour voir une fois encore mon beau château
Pour me mirer une fois encore dans le fleuve
Puis j'irai au couvent des vierges et des veuves
Là-haut le vent tordait ses cheveux déroulés
Les chevaliers criaient Loreley Loreley
Tout là-bas sur le Rhin s'en vient une nacelle
Et mon amant s'y tient il m'a vue il m'appelle
Mon cœur devient si doux c'est mon amant qui vient
Elle se penche alors et tombe dans le Rhin
Pour avoir vu dans l'eau la belle Loreley
Ses yeux couleur du Rhin ses cheveux de soleil
Guillaume Apollinaire, Alcools, dans Œuvres poétiques avant-propos, chronologie, établissement du texte, bibliographie et notes par Marcel Adéma et Michel Décaudin, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1965, p. 115-116.
© Photo Chantal Tanet, mai 2012.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : apollinaire, la loreley, alcools, le rhin, légende | ![]() Facebook |
Facebook |
04/06/2012
William Butler Yeats, L'escalier en spirale (traduit par J.-Y. Masson)

Jeunesse et vieillesse d'une femme
II
Avant la création du monde
Si je mets du noir sur mes cils,
Si je fais mes yeux plus brillants
Et mes lèvres plus écarlates,
Ou vais de miroir en miroir
En leur demandant si tout va bien,
Nul étalage de vanité en cela :
Je cherche le visage que j'avais
Avant la création du monde.
Et si je regardais un homme
Comme s'il était mon bien-aimé,
Alors que mon sang reste froid
Et que mon cœur est indifférent ?
Pourquoi devrait-il m'estimer cruelle
Ou s'estimer trahi ?
Je voudrais qu'il aime ce qui était
Avant la création du monde.
V
Consolation
Oui, il y a bien de la sagesse
Dans les sentences des sages :
Mais étends ce corps un instant
Et laisse reposer ta tête
Jusqu'à ce que j'aie dit aus sages
En quel lieu l'homme trouve son réconfort.
Comment la passion pourrait-elle être aussi violentc
Si je n'avais jamais pensé
Que le crime d'être né
Assombrit tout notre destin ?
Mais au lieu même où le crime est commis,
Le crime peut aussi être oublié.
Father and child
She heards me strike the board and say
That she is under ban
Of all good men and women,
Being mentioned with a man
That has the worst of all bad names;
And thereupon replies
That his hair is beautiful,
Cold at the March wind his eyes.
Consolation
O but there is wisdom
In what the sages said:
But strecht that body for a while
And lay down that head
Till I have sold the sages
Where man is comforted.
How could passion run so deep
Had I never thought
That the crime of being born
Blackens all our lot ?
But where the crime's committed
The crime can be forgot.
W. B. Yeats, L'escalier en spirale [The Windox Stairs and Other Poems], présenté, annoté et traduit de l'anglais par Jean-Yves Masson, Verdier, 2008, p. 131 et 135, 130 et 134.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : w. b. yeats, l'escalier en spirale, j.-y. masson, vieillesse, consolation | ![]() Facebook |
Facebook |
03/06/2012
Franck Venaille, Chaos

On naît déjà mort
Ah! ce mur d'anxiété
qui
peu à peu
m'enserre
ALORS
que
je demande simplement à quitter la scène
fût-ce par la sortie bon secours
Ce sont toujours les mêmes qui pratiquent l'autopsie
De leur propre corps
Cela vient du cheval vapeur ouvert dégoulinant de viscères
noirs.
Rien !
On naît rien.
Vite on recoud vite le cadavre vite !
— déjà fané avant l'heure légale —
Vite !
Franck Venaille, Chaos, Mercure de France, 2006, p. 90.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franck venaille, chaos, naître, mourir | ![]() Facebook |
Facebook |
02/06/2012
Tristan Corbière, Paris nocturne

Paris nocturne
— C'est la mer : — calme plat — et la grande marée,
Avec un grondement lointaine, s'est retirée.
Le flot va revenir, se roulant dans son bruit —
— Entendez-vous gratter les crabes de la nuit...
— C'est le Styx asséché : Le chiffonnier Diogène,
Sa lanterne à la main, s'en vient errer sans gêne.
Le long du ruisseau noir, les poètes pervers
Pêchent ; leur crâne creux leur sert de boîte à vers.
— C'est le champ : Pour glaner les impures charpies
S'abat le vol tournant des hideuses harpies.
Le lapin de gouttière, à l'affut des rongeurs,
Fuit les fils de Bondy, nocturnes vendangeurs.
— C'est la mort : La police gît — En haut, l'amour
Fait la sieste en tétant la viande d'un bras lourd,
Où le baiser éteint laisse sa plaque rouge...
L'heure est seule — Écoutez : ... pas un rêve ne bouge.
— C'est la vie : Écoutez : la source vive chante
L'éternelle chanson, sur la tête gluante
D'un dieu marin tirant ses membres nus et verts
Sur le lit de la morgue... Et les yeux grand'ouverts !
Tristan Corbière, Poèmes retrouvés, dans Charles Cros, Tristan Corbière, Œuvres complètes ; Tristan Corbière, édition établie par Pierre-Olivier Walzer, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1979, p. 888.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ristan corbière paris nocturne, la mer, la mort, la vie | ![]() Facebook |
Facebook |





