31/05/2012
Pascal Quignard, La barque silencieuse

Le chat
Une goutte d'encre rejoint un peu de la nuit qui était en amont de la source de chaque corps. Lire, écrire, vivre : champs magnétiques où sont jetées les limailles des aventures, des chagrins, des hasards, des épisodes, des fragments, des blessures. C'était une bibliothèque entière de petits classeurs noir et rouge où je consignais mes lectures. Ces classeurs me suivirent quarante ans durant dans la vallée de la Seine et dans la vallée de l'Yonne. Je ne savais plus si j'écrivais avec eux ou pour eux. Un jour on demanda à Isaac Bashevis Singer pourquoi il persistait à rédiger ses livres en Yiddish alors que tous ses lecteurs avaient été exterminés dans les camps de la mort.
— Pour leur ombre, répondit-il.
On écrit mieux pour les yeux de ceux qu'on aimait que dans le dessein de se soumettre au regard de ceux qui vous domineront.
On écrit pour des yeux perdus. On peut aimer les morts. J'aimais les morts. Je n'aimais pas la mort chez les morts. J'aimais la crainte qu'ils en avaient eue.
La mort est l'ultima linea sur laquelle s'écrivant les lettres de la langue et s'inscrivent les notes de la musique.
La narration que permettent les mots entre-blanchis et découpés de la langue écrite récipite les hommes en spectres.
Le malheur hèle en nous des yeux morts pour être diminué.
D'animaux à hommes, un regard suffit pour comprendre.
Un vrai livre est ce regard sûr.
*
Je connaissais une légère démangeaison au centre de la paume. C'était cela, un fantôme. Une caresse qui manque. J'avais déjà dans la main le désir de caresser un animal qui fût doux et chaud et dont l'échine fasse cercle soudain sous les doigts tandis qu'un son tout bas halète, ronronne, enfle, s'égalise, bourdonne enfin continûment comme le bourdon de l'orgue.
Dans les chaussures, au fond de l'armoire, là où le chat aimait se retrancher quand il n'était pas heureux, il désira mourir.
Il s'était glissé au-dessous du lit d'appoint pour les nourrissons, au-dessus du transat replié, près de la boîte en bois qui contient le marteau, les clous, les crochets pour les tablettes et les ampoules qu'on visse dans les douilles des lampes.
Pascal Quignard, La barque silencieuse, Dernier royaume VI, Folio Gallimard, 2011 [Seuil, 2009], p. 216-217.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES, Quignard Pascal | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal quignard, la barque silencieuse, le chat, la mort | ![]() Facebook |
Facebook |
30/05/2012
Jean-Pascal Dubost, et leçons et coutures (recension)

Le titre est suivi, comme on le faisait par exemple au XVIe siècle, d'un long sous-titre qu'on peut lire comme un poème, avec un jeu facétieux de rimes et assonances (inachevable /improbable /gaillarde) ; repris page 75, il convient tout à fait pour dire ce que sont les poèmes de Michel Leiris. Titre et sous-titre se prêtent à de multiples interprétations, ce qui correspond au contenu du livre ; leçons cumule ici nombre de significations, dont celle courante au Moyen Âge et toujours en usage de "lecture" : lecture des 99 auteurs convoqués ; quant à coutures, qui se rattache à "coudre", il avait en ancien français pour homonyme couture (que l'on retrouve aujourd'hui en toponymie), doublet de culture, lié à cultiver ; les deux mots du titres sont d'ailleurs réunis dans le mot valise "lec[ons/cou]tures". Les coutures, affirme d'emblée le sous-titre, sont faites de « bousigues assez visibles » ; cette indication présentée comme une explication déroute : ne peut être visible que l'observable, or "bousigues" est absent des dictionnaires que le lecteur consultera et le contexte n'est pas éclairant — son sens, "coutures grossières", n'est donné, en note, que plus tard, dans les "Notes préambulaires" (p. 7). D'autres surprises attendent le lecteur quand il entre dans la broussaille du sous-titre trompeur, qui semble ne rien dissimuler quand il définit le livre comme une "lectobiographie", mais il est précisé qu'elle est « complexe », « cryptée », « inachevable »... Les derniers mots, entre parenthèses, « (livre de dettes) », pourraient accompagner toute publication, si l'on accorde que rien ne s'écrit sans la mémoire, vive ou non, de ce qui a été lu.
Comment Jean-Pascal Dubost règle-t-il ses dettes ? D'abord en donnant en exergue trois citations qui, de manière différentes, répètent que toute écriture se construit à partir de lectures : Montaigne (très présent ensuite), Valérie Rouzeau et Haroldo de Campos. Aucun hasard dans ce choix : un écrivain du XVIe siècle, qui reporte à un passé que Jean-Pascal Dubost affectionne, une écrivaine contemporaine dont on sait qu'elle intègre (comme Montaigne) dans sa poésie ce qu'elle lit et voit, un écrivain hors de nos frontières qui a su relire la tradition poétique. Une courte introduction précise en quoi le plagiat est « un des fondements de la littérature » (p. 7), donnée comme une « longue chaîne citationnelle et re-citationnelle ad infinitum, aux transformations personnalisées au gré des époques traversées » (p. 8).
Ces transformations, Jean-Pascal Dubost les pratique « en une autre langue, assavoir dans la langue naturelle de l'auteur : hors du commun ; cryptée » (p. 9), « une langue tout à la fois populaire, vulgaire, verte, littéraire et documentée » (p. 12). Cette langue comporte de nombreux mots et tours du Moyen Âge et de la Renaissance, mais aussi des créations verbales — qui peuvent être dites telles : « le mot "babouineur" est une invention », p. 19 —, des énumérations (voir Rabelais), le goût de la fatrasie, l'emploi parodique d'allitérations : « Qui veut connaître [...] s'enfoncera dans une forêt fabuleuse fichu d'un foutu fonds de forces fidèles pour lutter [...] » (p. 93), etc. Ajoutons encore dans cette introduction le recours aux notes ; elles seront abondantes ensuite, pour préciser un point, définir un mot ou une expression, proposer au lecteur d'aller lire autre chose — ou l'égarer.
Viennent ensuite les poèmes, puis une table des auteurs et le livre se ferme sur "Le complexe Dubost (phrases lares)", formé d'un ensemble de citations sur l'écriture et la lecture, sur la complexité, dont la dernière, isolée, avec le nom de son auteur (James Sacré) en tête, suggère que la composition du livre n'est pas aussi préparée qu'on la souhaitait : quel que soit le plan prévu, « le livre quand même / Se continue / Autrement qu'on l'avait prévu » (James Sacré, cité p. 131).
Quels auteurs sont présents ? 99, nombre qui donne plus l'idée de l'inachevable, à mes yeux, que 100. Il s'agit pour un bon tiers d'écrivains français du XXe siècle, pas toujours "poètes" (Pierre Michon), pas toujours reconnus (Henri Simon Faure), parfois essayiste (Paul Zumthor) ; le Moyen Âge (8) et la Renaissance (10) ont une belle part ainsi que les écrivains de langue anglaise (19), plus que le XIXe siècle (9, dont un gastronome écrivain, Grimod de la Reynière) ou le XVIIe siècle (5) français. On ne peut dans un court article lire et chiffrer ce qui est écrit pour chaque écrivain retenu. Lisons la prose poème consacrée à James Sacré puisque lui sont prêtés les derniers mots du livre ; on peut y repérer quelques aspects du travail de Jean-Pascal Dubost.
James Sacré Comme tout le monde se plaint
de la cruelle envie que la nature porte aux longueurs
de nos jours et comme tut rien turne en declin,
quoiqu'on vous jure sur la tête d'un God
qu'on va moraliser les banques et les patrons
voyous, il était acquis d'avance que ce poème
sué, soufflé, rendu, raterait la couche du moche
et serait raté ni d'aucune aide, et du coup, n'en
est pas un —
On sait que James Sacré progresse parfois dans un poème en s'interrogeant sur ce qu'il écrit et, ce faisant, doute de la nécessité du poème : c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Par ailleurs, James Sacré a publié un choix de poèmes de Jean de Sponde, d'où la citation de deux vers tirés d'un sonnet. Le vers de Wace qui suit (tiré de la fin du prologue du Roman de Rou) renvoie, lui, aux textes qu'apprécie Jean-Pascal Dubost, et le contrepet ("la couche du moche") est une des manières qu'il a de bousculer les bonnes manières dans l'usage de la langue, tout comme l'inexistence d'un lien entre les deux propositions [quoiqu'on vous jure...] et [il était acquis...].
Il est, évidemment, exclu de découvrir la source de toutes les citations, et je soupçonne quelques inventions dans ce domaine. Pour les textes, on se réjouit par exemple de lire un pastiche de Pascal Quignard (un autre amateur du passé) dans les premières lignes qui lui sont consacrées, et l'on ne peut qu'approuver un passage de la longue note accompagnant le poème "Jehan de Bretteville" — dont le nom est absent du catalogue de la Bibliothèque nationale...—, à propos de la « déambulation hasardeuse et meneuse de trouvailles inattendues », que l'on applique sans peine à ce livre qu'il faut lire et relire.
On peut s'attarder aux proses-poèmes d'ouverture et de fermeture : la première, pour William Carlos Williams, affirme une absence, « Aucune idée pour ce poème — », et la dernière, en image inversée, l'infinité des lectures avec Pierre Michon, « J'écris sous la tutelle d'un vieux Pan de bibliothèque ». On peut lire aussi une manière d'art poétique dans le second poème consacré à un écrivain imaginé, Tortore1 ; est répété à deux endroits, huit fois de suite, « travailler la langue » et sont énumérés des substituts à "poésie" et "poème" (comme on pourrait les lire, par exemple, chez Ponge ou Stéfan) : pohésie, pouème, pohérésie, proème. S'ajoute l'emploi d'un mot dialectal et d'un mot de l'époque médiévale (avec note explicative pour chacun), une construction syntaxique pour le moins inhabituelle (« or qu'ici non donc, ») et un renvoi, avec « en façon bien estrange », à la naissance de Gargantua (chapitre 6). Un programme loin de tout lyrisme : on comprend qu'Alphonse de Lamartine soit rejeté :
Voici par ailleurs une fondamentale détestation
qui ne peut se taire ores car, j'ai tué le temps
longtemps souvent, j'ai tué Dieu dans l'œuf et
Pieu le der, j'ai tué les muses au berceau, j'ai
tué le génie dla langue, j'ai tué mon père, ma mère,
mes frères et mes sœurs, et c'était le bonheur,
j'ai tué le bonheur, j'ai tué ma langue de bœuf rude,
j'ai tué la beauté, trop assise, j'ai tué l'âme en faisant
l'âne, du moins je crois, [...] j'ai tué Alphonse
et Lamartine et tant bien d'autres encore jusques
y compris des toujours vivants, mais récatonpilu2, ne
me pardonnez pas, car je savais ce que je faisais,
j'ai tant et tellement tué, que je suis bien vivant —
(p. 107)
Jean-Pascal Dubost est bien vivant, en effet, et ses leçons et coutures (pas si visibles que ça) sont une lecture des plus revigorantes.
Jean-Pascal Dubost, et leçons et coutures, éditions Isabelle Sauvage, 2012, 136 p., 20 €.
1 "Tortore" est absent des catalogues de la Bibliothèque nationale et inconnu de la Toile — on pense à tortorer, "manger" et donc tortore, "nourriture".
2 On reconnaît ici Jean Tardieu ; aux noms d'écrivains en entrée, il serait bon d'ajouter les dizaines d'autres présents par le biais des citations.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pascal dubost, et leçons et coutures, biographie, anthologie | ![]() Facebook |
Facebook |
29/05/2012
Joë Bousquet, La Connaissance du Soir
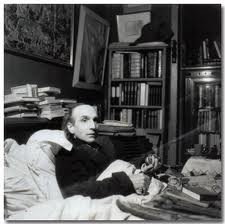
La nuit mûrit
à Jean Paulhan
En cherchant mon cœur dans le noir
Mes yeux cristal de ce que j'aime
S'entourent de moi sans me voir
Mais leur ténèbre est l'amour même
Où toute onde épousant sa nuit
Dans mes jours se forge un sourire
Afin qu'aux traits où je le suis
Sa transparence ait pour empire
Mon corps en soi-même introduit
*
Passer
Enfance qui fus dans l'espace
Un vol poursuivi jusqu'au soir
J'appelle ton ombre à voix basse
Avec la peur de te revoir
Sœur en deuil de tes robes claires
Ta fuite est l'oiseau bleu des jours
Que de son chant fait la lumière
Des gestes rêvés par l'amour
C'est par ton charme qu'une fille
D'un corps ébauché dans les cieux
A formé la larme des villes
Qui s'illuminent dans ses yeux
Et ce fut ton âme de rendre
Mon doute plus que moi vivant
Passerose aux ailes de cendre
Qui m'ouvrais ton cœur dans le vent
Joë Bousquet, La Connaissance du Soir, Gallimard,
1947, p. 30 et 53.
* * *
Un appel du cipM :
En 2008 Marseille Provence 2013 a été sélectionnée capitale européenne de la culture, ce qui a suscité, notamment de la part des acteurs culturels qui avaient travaillé à sa préparation, d’immenses espoirs.
C’est donc avec enthousiasme et énergie que nous nous sommes attelés à la préparation de projets à proposer à Marseille Provence 2013, fiers de vivre et de travailler dans la ville qui allait devenir capitale, ville qui s’engageait résolument vers un avenir culturel, comme l’avait fait quelques années plus tôt la ville de Lille.
Pour le centre international de poésie Marseille,
aujourd’hui, c’est la douche froide…
• Alors que nous participons à des projets acceptés et financés par Marseille Provence 2013,
Pasolini (juin-juillet), Le vrai et le faux (juillet-août), ActOral (septembre-octobre),
• Alors que nous portons un projet accepté et financé par Marseille Provence 2013,
Le colloque de Tanger qui se tiendra à Marseille et à Tanger (printemps),
• Alors que le Centre national du livre nous a missionné pour porter et organiser un projet de lectures en plusieurs langues du pourtour de la Méditerranée (à partir des ateliers de traduction créés par le cipM : IMPORT / EXPORT) lors du temps fort consacré au livre par Marseille Provence 2013 (17-20 octobre),
• Alors qu’il était spécifié dans le dossier de présélection adressé à la commission européenne que : « Les adhérents de la Charte conviennent qu’il s’agit d’un budget constitué exclusivement de mesures nouvelles permettant le financement du projet
Marseille Provence 2013, sans réduction des budgets structurels préexistants… »,
• Alors que nous sommes à quelques mois du début de l’année capitale,
après avoir amputé notre budget de 30 000 € en 2011,
la Ville de Marseille nous supprime 30 000 € supplémentaires cette année, faisant ainsi passer la subvention au cipM (7 salariés)
de 260 000 € en 2010 à 200 000 € cette année !!!
À ce rythme-là, nous ne toucherons plus que 20 000 € en 2018, et nous pourrons programmer notre mort définitive pour l’an 2019.
Vous pouvez adresser un message de soutien à : cipm@cipmarseille.com
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joë bousquet, la connaisance du soir, la nuit, passer, enfance | ![]() Facebook |
Facebook |
28/05/2012
P. N. A. Handschin, Abrégé de l'histoire de ma vie

Encore une fois, je suis reparti sur les routes en solitaire, craintif et timide, j' avais peu — pour ne pas dire pas — d'amis adolescent, j'ai découvert la musique avec Léo Stinato, les Choux Facis et Bob Dylan m'a mis le pied à l'étrier en me donnant l'occasion de chanter (La Carmagnole, a cappella) sur scène (au Concertgebouw d'Amsterdam soudainement déserté) mes débuts ont été assez difficiles — pour ne pas dire désastreux — c'est certain, nos vies sont faites de tout un réseau de voies mêlées et inextricables, parmi lesquelles un instinct fragile nous guide, équilibre toujours précaire entre la raison et le cœur léger (mais n'exagérons pas), j'ai quitté le lycée (au lycée j'étais tellement peu sociable que j'avais l'air presque dément) et ai commencé à faire des petits boulots pas forcément très catholiques, mes parents (catholiques intégristes (et antisémites opiniâtres et racistes déclarés et homophobes incurables) oui) m'ont causé plus de mal somme toute que ne l'aurait fait un ennemi féroce, et acharné, et sont allés je ne mens pas jusqu'à me faire interner en hôpital psychiatrique (HDL, hospitalisation à la demande d'un tiers) où ils m'ont laissé pourrir le terme n'est pas trop fort plus d'un an (un an avec des "collègues" braqueurs de bureaux de tabac, détraqués sexuels, atrophiés du cerveau, camés, SDE, schizophrènes, obèses boulimiques, suicidés ratés... un an trois cent soixante-cinq jours multiplié par vingt et un cachets par jour — sept mille six cent soixante cinq cachets j'étais devenu un zombie, on devait se lever à sept heures tapantes du matin pour ne RIEN faire de la journée, et quand on avait été "sage" on était autorisé à la rigueur à mettre ses propres habits (si en état) sinon c'était le port du pyjama bleu turquoise (avec fermeture à glissière dans le dos, inaccessible au patient) de l'établissement. Exceptionnellement on pouvait sortir dans la cour, qu'il me faudrait plus justement nomme courette — espèce de fonds de puits pathétique, sans écho —, avec son minuscule carré de mauvaise herbe dure et maigre enceint de murailles noirâtres assez hautes hérissées de tessons et de pointes sournoises et de fil de fer barbelé, pour horizon ce déplorable séjour qui m'a brisé (l'orgueil et la volonté), m'a enfoncé (dans l'ombre épaisse et la brume), m'a anéanti.
Anéanti par le décès accidentel (sur l'autoroute A13 à Épône dans les Yvelines) de ma compagne Évelyne, j'ai erré sans but çà et là entre la France et la Belgique jusqu'en juin avant de m'installer de nouveau au rez-de-chaussée d'un hôtel sordide de Bellevue), borgne et louche, à Paris, j'ai travaillé dans une conserverie de poisson (Baltika Importation Exportation, rue Frédéric-Schneider dans le XVIIIe), puis dans une blanchisserie un moment j'ai même été incarcéré — pour fraude à la carte bleue et trafic de faux champagne rosé (mille cent une bouteilles) et d'amphétamines — à la prison de la Santé et l'humeur déjà bien chancelante de ma mère se sont détériorées sévèrement tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de fiche en l'air de gâcher ma jeunesse et peut-être ma vie, je l'ai passée à me défendre péniblement de l'envie dévorante et maligne d'y mettre fin octobre, j'ai trouvé un emploi [...]
P. N. A. Handschin, Abrégé de l'histoire de ma vie, Argol, 2011, p. 66-69.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : p.n.a. handschin, histoire de ma vie, autobiographie et fiction | ![]() Facebook |
Facebook |
27/05/2012
Yves Bonnefoy, Genève 1993

Il est vrai qu'on peut supposer que quand la voix se fait [...] chant, et que de mot en mot les éléments sonores s'unissent pour une musique et donc un bonheur, c'est peut-être d'abord parce que le désir qui gouverne notre inconscient — et là y écoute les sons autant que le sens, nous le savons et les retient dans sa propre langue — s'est mis à rêver à l'harmonie possible de celle-ci, à imaginer de par le leurre des nombres qu'elle peut s'étendre sans rencontrer résistance à tous les objets qui l'attirent. Des mots musicalisés ne naîtraient alors, et ainsi, que ce que "L'invitation au voyage" appelle « la douce langue natale », celle du pays d'avant la nécessité, du « là-bas » où l'on peut « aimer à loisir ». Et quand Baudelaire, dans un autre de ses poèmes, et d'ailleurs à propos de la musique — celle des instruments, mais qu'il sait parente de son travail sur les mots —, écrit : « La musique souvent me prend comme une mer », après quoi il se dit « bercé », on ne peut certes douter que le son du mot "mer" a fait plus qu'être pour lui, il a signifié — la présence maternelle —, et que c'est partiellement au moins pour cela que ce poète s'est laissé "prendre", "bercer" par la vague de la musique. Ce serait ainsi l'éros qui contrôlerait le son des mots, ce serait encore le moi qui s'exprimerait par sa voix, en bref l'intuition de l'indéfait du monde, de l'unité n'aurait pas survécu au passage du simple mot à la phrase : le désir d'être ayant dû céder le pas à cet autre, l'éros, qui tient en main le langage.
Peut-être. Mais demeure ce fait qu'au moment premier, celui où l'enfant, ou l'adulte, ont pleinement entendu le son d'un mot, y ont perçu l'appel de la réalité indivise, y ont désiré qu'elle fasse toute présence, eh bien, le désir ordinaire, l'éros, aura donc bénéficié, en son moment de reprise, d'un regard sur l'objet moins pauvrement réduit à un signifié, moins de l'abstraction et du réifié, que dans sa pratique antérieure. Il a appris qu'il pouvait y avoir bien plus, dans la rencontre de son objet, que les aspects discontinus, irréels qu'il en connaissait, il en a entrevu une plus grande richesse, au plan cette fois de leur appartenance, non plus aux réseaux du fantasme, mais au réel, à la beauté du réel. Et que la musique des mots soit celle ou non de l'éros ensuite, un peu de l'immédiat s'est maintenu dans le poème — où il va peut-être être médité, être rappelé.
Yves Bonnefoy, Genève 1993, L'Herne, 2010, p. 40-42.
Publié dans Bonnefoy Yves, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves bonnefoy, genève 1993, poésie, éros, musique, langue natale | ![]() Facebook |
Facebook |
26/05/2012
Isabelle Ménival, Khôl

Vieillesse vue d'ailleurs
je dégoupille mes veines
en fondues sonores
j'ai monté tant de roches
la fatigue me prend près d'un roc immuable
où des pianos
jouent
comme des fous
j'aimais les musiques leur barbarie souvent
belle
souvent la même que celle qu'on tient
au creux des paumes
souvent j'aimais le bruit des courses à contretemps
les sentiers pleins d'empreintes
je comprenais
déjà
la foule infatigable frappant aux portes
je courais
aussi j'existais
je ne priais jamais dieu
ni le fils
apeuré
ni ses pairs
incestueux
j'étais sage en défaut
insolence par mots
tout dépités crépitant dans le cœur encore gose
je dégoupille mes veines
corps qui transite
sourires aux lèvres
les murs âpres d'eau
Isabelle Ménival, Khôl, éditions Argol, 2012, p. 73-74.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle ménival, khôl, vieillesse, exister | ![]() Facebook |
Facebook |
25/05/2012
Federigo Tozzi, Les Bêtes (traduction Philippe Di Meo)

Je reviens dans les grandes prairies, que j'aimais avant même de lire Pétrarque, pour voir les fleurs que j'aurais offertes, il y a bien des années, à une jeune fille que j'imaginais comme je la vois maintenant dessinée dans certain livre. Elle devait être surtout gentille et sentimentale ; et elle devait m'aimer toujours autant, même si je l'avais épousée Et, parfois, relisant nos lettres, nous aurions soupiré à l'unisson.
Mais cette année aussi, il y a des fleurs et peut-être même davantage, car le temps a été moins sec ; et alors, l'envie me prend de courir vers l'horizon pour voir si je parviens à étreindre cette femme qui me semble plus vivante que parle passé.
Mais il y a seulement une hirondelle qui trisse.
*
J'ai toujours eu peu de temps pour aimer quelqu'un
Cet été était si chaud que dans le ciel lui-même, il n'y avait pas de place pour lui. On eût dit que le soleil se levait toujours plus grand, et il était impossible d'imaginer le moment où il se coucherait.
Haies empoussiérées, cyprès sur le point de sécher, semble-t-il, arbres morts, sorghos et maïs devenus blancs, réseaux d'araignées si brillants qu'ils semblaient faits d'un métal qui couperait les mains, portes crevassées, tonneaux défoncés, la terre si dure que plus personne ne la travaillait, les lits des torrents sans libellules et à l'herbe fanée, saules qui ne poussaient plus, mûriers à feuilles minuscules, socs luisants, pierres qui échaudaient, nuages rouges comme des flammes, étoiles filantes !
Sur le nœud d'un olivier chante une cigale : je l'aperçois. Je m'approche, sur la pointe des pieds, en équilibre d'une motte de terre à l'autre. Je l'attrape. Je lui arrache la tête.
Federigo Tozzi, Les Bêtes, traduction de Philippe Di Meo, collection Biophilia, José Corti, 2012, p. 34-35, 48.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : federigo tozzi, les bêtes, philippe di meoété | ![]() Facebook |
Facebook |
24/05/2012
Tristan Tzara, Phases, "Pour Robert Desnos"

Pour Robert Desnos
dans le blanc de ma pensée
hurle un merle l'herbe chante
sur la ville décapitée
siffle l'ai subit du sang
d'où s'ébranle l'arbre mûr
mendiant de lumière
mademoiselle voulez-vous
et la mort montre sa montre
des dents vides au bracelet
et les os de mille témoins
mademoiselle voulez-vous
le bois mort des fortes mâchoires
ferme doucement la marche
à la tête d'un seul espoir
dans la tête une forêt
par le brisement d'étoiles
j'ai connu la mélodie
d'où se lève la mémoire
il n'y a plus de voix sonnante
dans Paris pavé de feuilles
un été manque à l'appel
je suis seul à le savoir
oubliez vos fils vos mères
le jeunesse les printemps
les baisers des amoureuses
l'or du temps
un nom nu voltige encore
dans les nuits autour des lampes
et le poing serré des villes
dresse jusqu'au cœur du jour
cette lumière cette révolte
que l'on offre aux passants
dans la paume de la main
celle du monde
dans les bras que vague emporte
un oiseau rien de plus sauf la colère
un visage à ma fenêtre
une joie flotte
mon secret ma raison d'être
et le monde
Tristan Tzara, Phases, "Poésie 49", éditions Pierre Seghers, 1949, p. 27-28.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan tzara, robet desnos phases | ![]() Facebook |
Facebook |
23/05/2012
Valérie Rouzeau, Vrouz (lecture)

Humour et mélancolie
Valérie Rouzeau mentionne à la fin du livre, dans la première des 57 notes, que le titre Vrouz a été forgé par Jacques Bonnaffé, et elle ajoute : « ça vrouze quand même autrement mieux que “autoportraits sonnés avec ou sans moi” » (p. 163). Sans doute, et pour ces poèmes — des sonnets (“sonnés” — “sonnet” se rattache, indirectement, à “sonner”) —, le titre Vrouz, contenant l’initiale du prénom (V) et la première syllabe du patronyme (Rouz), est providentiel, il permet d’établir une distance par rapport à l’autoportrait.
Le choix du sonnet tel qu’il est pratiqué est une autre manière de s’éloigner d’un lyrisme facile autour du “je” — « je est un hôte d’on ne sait qui ni quoi » (p. 140). Quel sonnet ? La forme du sonnet classique français de Ronsard ou de Malherbe, ou du sonnet anglais, a été revisitée depuis longtemps, et Valérie Rouzeau s’inscrit dans cette tradition de refonte : dans Vrouz, 14 vers d’un bloc, comme ils étaient d’ailleurs présentés à la Renaissance, ce qui n’empêche pas de délimiter souvent dans Vrouz deux quatrains et deux tercets. Avec l’élision, ou non, du [e] devant consonne, on compte l’hexasyllabe, l’octosyllabe, etc., l’alexandrin, et parfois le compte déborde jusqu’à 15, parfois les vers de dimension différente se mêlent. Ici (p. 44), le premier et le dernier vers se terminent par “poisson” et les vers 5 à 8 riment en -on (nourrisson / vont / irritation / chanson) ; la question de la rime apporte une rime : « [...] Au moins plus le pétiole / Qui rime avec parole » (p. 127). Un poème s’attarde sur ce que sont les rimes avec un développement parallèle entre les 14 vers du sonnet et « quatorze kilos à perdre » : après 6 rimes en -ant (ou -ent), une septième clôt le sonnet : « Ma complainte par trop pondérale / Avec ses sept moches rimes en ã » (p. 102). Le lecteur découvrira à foison des rimes internes dans ces 151 sonnets.
On repère assez vite des liens thématiques entre deux ou trois sonnets successifs, signe d’une volonté de construction. L’un commence par « Dire façon marabout sans rien prédire du tout » (p. 112), renvoi au sonnet précédent où le(s) dernier(s) mot(s) d’un vers commence(nt) le suivant ; un autre se termine par la mention d’une possible pendaison, le suivant s’ouvre sur une pendaison réelle (pp. 85 et 86). De même au vers 14 du sonnet 108 (p. 118) : des « vitesses à passer » et, poème suivant, sur la mort du père : « Le temps ne passait plus ni la blanquette de veau / Lorsque mon père a quitté des vaches le plancher » ; cet usage polysémique d’un mot pour lier les sonnets est régulièrement mis en œuvre : “craché / cracher” (pp. 144-145), “patate / patates” (pp. 146 et 147), etc., ou la liaison s’effectue par un lien sémantique clair : “pompe à vélo” / “pédale” (pp. 138 et 139).
À la forte unité formelle s’ajoute le jeu avec les mots dans ses multiples aspects, toujours inventif, souvent inattendu, révélant malicieusement ce qui est tu ou non vu ; au hasard : “Jeune €urope” (p. 35), “club merde et cetera” à la Gainsbarre (p. 27), etc. C’est un réjouissant ensemble, avec l’à-peu-près (“violon dingue”), l’homophonie (« Please please enter votre pin votre pine s’il vous plaît / Votre épine [...] », p. 39, “tentatives de tante hâtive”, p. 82), l’approximation (« Signes d’humilité peut-être / D’humidité assurément », p. 46, “érections présidentielles”, p. 75), le mot-valise (“évapeurée”, p. 18), la répétition, l’onomatopée, le recours à des désignations obsolètes (“sent-bon”, en pincer pour quelqu’un).
Mais que faire sonner, comme on disait à la Renaissance ? Valérie Rouzeau est dans le monde yeux ouverts et les jeux du langage ne sont pas là pour se moquer de ceux qu’elle rencontre dans la vie de tous les jours, mais plutôt pour exprimer une tendresse un peu désabusée. Ce qu’elle refuse, ce sont les portables et la prétendue communication, la consommation sans frein de cet « âge d’enfer » (p. 147), les hommes d’affaires toujours sûrs d’eux, avec « le bouquet’s / L’enfer du gratiné / On nous a pas sonnés / Temps compté rolex bling » (p. 37) ; bref : elle est « moderne sans fil et non / Actuelle plutôt crever » (p. 41). À noter les thèmes abordés, on s’aperçoit que la réalité de chacun est là, les petits boulots — Valérie Rouzeau a vendu des encyclopédies en faisant du porte à porte, par exemple —, ce que l’on voit dans la rue (la vieille avec sa canne, l’enfant qui boîte), le repas à préparer, le Malien qui n’a pas assez d’argent pour s’acheter une mangue, l’essayage d’un chapeau, la neige... Bribes d’une vie aussi, avec les souvenirs d’enfance, le médiocre logement et son matelas à punaises, l’examen au labo, la difficulté croissante à animer des ateliers dans les écoles (« Ces heures dedans les classes / Me pompent mon énergie / Mon désir et ma sève », p. 127).
Il y a dans ces évocations, à côté d’un ton amusé ou critique, une émotion lisible, notamment dans les deux poèmes à propos d’Arlette [Albert-Birot] ou dans celui à propos du cher “Ténébros” (Christian Bachelin), à qui est dédié Vrouz. La mélancolie, Valérie Rouzeau l’exprime toujours discrètement, par exemple quand elle écrit sa relation au lecteur (« Et je vous chanterai une chanson mince / À l’intérieur tout noir de moi », p. 90). Ces moments de retour sur soi sont plutôt rares — « Ma vie j’en parle à peine ou je la brode » (p. 75) — et, puisque lyrisme il y a, celui-ci passe par le jeu avec les mots, par le bousculement de la syntaxe, par « la poétique fonction du langage », par un art du retournement constant.
Les notes en fin de volume, dans le même ton que les sonnets, rappellent au lecteur que le poème s’inscrit dans une tradition. Un sonnet à propos d’un crayon arrivé à sa fin — on lui met pour cela « Le beau Requiem de Mozart » — est remplacé et donc, pour ce nouveau, « Commence son exercitation » (p. 71) : une note donne le sens du mot et renvoie aux Essais de Montaigne. Les autres notes énumèrent avec verve des références : noms d’écrivains (Desnos, Bachelin, Tardieu, Rimbaud, Sylvia Plath — qu’elle a traduit —, etc.), de chanteurs, de personnages de théâtre, titres de films, formulaires de santé, slogans sur des camions. Cela foisonne et le lecteur curieux repèrera d’autres allusions, comme ces carrolliens « Lapins sans leur montre à gousset ».
Valérie Rouzeau prend, transforme, intègre dans son écriture, faisant sien ce qu’elle lit, voit, écoute. Ce livre bouillonnant de vie s’achève par une parodie des adresses au lecteur : le voyage est terminé, « Avant de descendre assurez-vous / de ne rien t’oublier [...] / Nous vous remercions de votre incompréhension » (p. 161). On sait que le chef de train ajoute à l’arrivée : “nous espérons vous revoir”, etc. Sans doute, et il suffit de lire le vers d’ouverture du premier poème, portrait à charge de son auteur, pour s’en convaincre, « Bonne qu’à ça ou rien ».
Valérie Rouzeau, Vrouz, La Table Ronde, 2012, 176 p., 16 €.
Cette recension a d'abord été publiée dans Terres de femmes, la revue numérique d'Angèle Paoli.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie rouzeau, vrouz, humour et mélancolie | ![]() Facebook |
Facebook |
22/05/2012
Isabelle Garron, Corps fut

variation I
tu entres dans la chambre .le linge est épars
étendu pour la fraîcheur .les
pièces sèchent
sur le rebord .c'est la première fois
*
l'argile .chamottée en masse sur la table d'école
afin de décider de l'usage
du peu d'invention de toi .mais
voilà je ne vois plus
les mains avancent .dans la préparation
— surgissent la nature morte
le corps né l'afférence .le
la du sort
*
la forme glisse citron contre socle
et peur du reste se fixe .pincée
entre le tour et l'assiette
*
des silhouettes dansent parmi les vieilles chiffes
l'eau sale des bassines où la fiction va
opère . ou la forme de la terre
flotte contre les parois
dans la matrice l'acidité de l'agrume
*
la paix vibrée venait d'ailleurs dans le désordre étale
par touches .pinceaux .rubans
papiers fous
ou d'autres outils à lames
un rayon atteint parfois la femme
qui ici respire encore
sans ses bijoux
[...]
Isabelle Garron, Corps fut, Suites & leurs variations (2006-2009), Poésie / Flammarion, 2011, p. 45-49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : isabelle garron, corps fut, variation | ![]() Facebook |
Facebook |
21/05/2012
Alain Andreucci, "Le poème de l'adieu", dans À seul

Le poème de l'adieu
D'une neige sans pitié.
Et du cœur effroyable.
Et de toute chose de toujours.
Avec toi ce bois sanglant.
Ou la beauté des choses vient-elle, avec ses parements rouges.
Et aussi le sein des prostituées. Lièvre de langue.
Dans la terre noire pure est du vin.
La couleur rouge, et comme fardée.
Pure demeure, où on pourrit et chaste.
Comme est l'image de l'animal.
À genoux portant sans réserve.
Le ventre vers la bouche ce qui est loin.
Dans la tremblante proximité faisant route.
Toute la neige assise dans le sein jamais lassée.
De tirer ce boulet de chair vive l'ancre légère du corps.
Limpides sont les montagnes que l'humain fléchisse.
Ou que vers la petitesse soient tirés.
Tant de feux infirmes sur la brute.
Ou grandissons-nous puisque sonnent et rosissent.
Dans le ciel de nos pas l'ange déjà rouge et le dieu.
Qui a la forme du temps : mille brèches dans ce qui est.
La forme imparfaite d'un faim jamais reprise.
Pour former la gravitation du puits.
Parce que proche mourir porte.
Ses arbres et ses prairies, que dans l'aggravement est.
Comme flamme noir neige amour. Duretés semblables.
Qui tantôt sont l'écorce et tantôt.
Et tantôt encore ce baiser de chair vraie affolée.
Une bouillie du sang parlerait-elle.
Dans la bouche pour dire.
Une pensée te voilà de retour la guerre a fleuri.
Et la devanture des bouchers sonne le feu intérieur.
Et cette pyrotechnie de la neige nous aimons qu'elle blesse.
D'amoureuse blessure nous aimons.
Que nous secoue ce sang infirme où nous bûmes inconscients.
Car peser jusqu'alors fut invisible.
Et telle fut l'amante sut tes lèvres les mêmes.
Frayeur et chaleur s'accouplant, désordre et mesure jetés là.
Comme des linges impossibles — à hâter le tourment.
Dans la bouche de toute beauté comme en un puits.
Alain Andreucci, À seul, précédé de Une lecture par Yves Bonnefoy,
éditions Obsidiane, 2000, p. 61-62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain andreucci, poème de l'adieu, À seul | ![]() Facebook |
Facebook |
20/05/2012
Henri Michaux, Façons d'endormi, façons d'éveillé

Le lac près de l'Opéra
En promenade. À partir de la place de l'Opéra, où quelque autobus a dû me transporter, faisant quelques pas dans une rue médiocre, qui en traverse une plus large, je me détache progressivement des grandes artères et des boulevards dont j'entends encore faiblement la rumeur s'amenuisant... Soudain je débouche sur une vaste étendue d'eau, dont je ne fais qu'entr'apercevoir l'autre rive dans le lointain, avec ses baies, ses plages, ses criques, ses villas éparses ou groupées.
Comment ! Un lac ! Si près de l'Opéra ! Je n'en reviens pas.
Il est vrai que je prends souvent les mêmes autobus, sur les mêmes trajets, un peu en maniaque, qui n'accepte pas d'être longtemps détourné de sa vie propre. Tout de même ! À ce point ! C'est impardonnable ! Depuis des dizaines d'années que je vis à Paris... Enfin, je l'ai trouvé. Et cet horizon ! Justement ce qui manquait à ce cette capitale un peu usée... et sans chercher détails ni explications, je me laisse envahit et gonfler de la joie inespérée. Quel avenir ! Une existence nouvelle va commencer.
L'impression a tellement pénétré en moi que, réveillé, je ne m'en réveille pas tout à fait, et sans doute je n'y tiens pas, j'aurais trop peur de retrouver une ville où, à nouveau, un lac manquerait. Je reste sans bouger, méfiant, sachant que malgré la certitude encore persistante d'un lac proche et presque à ma porte, il est préférable que je ne lève pas le petit doigt, que je ne me livre (mot si juste) à aucun acte, le plus petit geste en ces heures matinales étant parfois capable d'entamer et de recouvrir en un rien de temps les plus grandes découvertes de la nuit et de vous reconduire illico au strict quotidien.
Henri Michaux, Façons d'endormi, façons d'éveillé, [1969] dans Œuvres complètes, III, édition établie par Raymond Bellour avec Ysé Tran, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2004, p. 482.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, façons d'endormi, façons d'éveillé, rêve, opéra | ![]() Facebook |
Facebook |
19/05/2012
Marcel Jouhandeau, Correspondance avec Jean Paulhan

Depuis trois mois, une chatte mendiante se terrait à notre porte du côté du jardin du matin au soir. Sans doute, une abandonnée. Après les repas, ma mère lui apportait nos restes, mais je sentais que pour la pauvre bête, c'était moins de nos restes qu'elle avait faim que de notre intimité. Chaque fois qu'on entrouvrait la porte en effet, elle regardait l'avenue de cette cuisine où il devait y avoir du feu et une bonne odeur avec un geste si naïf et si éloquent d'envie et d'impatience, mais ma mère ne sachant pas d'où la bête venait, ne voulait pas la laisser pénétrer chez elle. Hier, j'ai obtenu qu'on l'adoptât et elle s'est précipitée à l'intérieur de son rêve comme d'un Paradis et elle s'y pavane maintenant, ivre de bonheur. Sans bassesse, elle est en admiration devant toute chose et ne cesse de nous remercier en se serrant tour à tour contre les jambes de ma mère et contre les miennes. Je la prends sur mes genoux, quand elle n'ose même pas monter sur une chaise. Son humilité et sa discrétion me ravissent. Je me plais à la combler et je ne saurais dire ce que cette présence du « bonheur » me fait du bien. C'est une chatte de l'espèce la plus commune, mais distinguée, à la robe blanche et manteau de deuil ; son petit museau plus blanc que le reste, sous deux bandeaux noirs très réguliers où s'enchâssent les yeux verts. J'aime surtout quand à demi assise elle vire sur elle-même comme aidée par une aile invisible sur deux pattes de devant longtemps levées, telles deux menottes, sans qu'elle paraisse avoir besoin de les reposer sur le plancher pour garder l'équilibre, avec des grâces de kangourou. On dirait qu'elle sait beaucoup plus qu'une autre, qu'elle sait beaucoup mieux le prix de la moindre joie. La misère et la souffrance lui ont donné une âme et cette science.
Marcel Jouhandeau, dans Marcel Jouhandeau, Jean Paulhan, Correspondance, 1921-1968, édition établie, annotée et préfacée par Jacques Roussillat, Gallimard, 2012, 11 février 1931, p. 114-115.
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marcel jouhandeau, jean paulhan, correspondance, chat | ![]() Facebook |
Facebook |
18/05/2012
Pierre Alferi, Sentimentale journée

UN NU
La chose
La toucher
Bousculer
La forme
Pour s'assurer qu'existe
La chose là
Chose — capitale —
Vue tous les jours
Toujours dans un délire
Conscience du temps réduite
À la pointe de flèche
Espace réduit
À l'angle
Cul d'un sac très froncé
La toucher
Prudemment peur
D'aviver sa
Nudité douloureuse de la
Froisser de la
Défroisser mais tellement
Excitable mollusque
Aveugle quand
Se rétracte s'étale
Qu'on veut aussi bousculer
La forme
Extraordinairement profuse
Petite
D'une crête
Qui s'efface passe
Dans une autre et lui passe
L'énergie de pliure
Par ondes
Rouges holà oh
Mon Dieu embrasser
Le visage sans yeux l'œil
Sans visage ?
Pierre Alferi, Sentimentale journée, P. O. L., 1997, p. 45-46.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre alferi, un nu, sentimentale journée | ![]() Facebook |
Facebook |
17/05/2012
Antonin Artaud, Héliogabale ou l'anarchiste couronné

L'anarchiste dit :
Ni Dieu ni maître, moi tout seul
Héliogabale, une fois sur le trône, n'accepte aucune loi ; et il est le maître. Sa propre loi personnelle sera donc la loi de tous. Il impose sa tyrannie. Tout tyran n'est au fond qu'un anarchiste qui a pris la couronne et qui met le monde à son pas.
Il y a pourtant une autre idée dans l'anarchie d'Héliogabale. Sr croyant dieu, s'identifiant avec son dieu, il ne commet jamais l'erreur d'inventer une loi humaine, une absurde et saugrenue loi humaine, par laquelle, lui, dieu, parlerait. Il se conforme à la loi divine, à laquelle il a été initié, et il faut reconnaître qu'à part quelques excès çà et là, quelques plaisanteries sans importance, Héliogabale n'a jamais abandonné le point de vue mystique d'un dieu incarné, mais qui se conforme au rite millénaire de dieu.
Héliogabale, arrivé à Rome, chasse les hommes du Sénat et il met à leur place des femmes. Pour les Romains, c'est de l'anarchie, mais pour la religion des menstrues, qui a fondé la pourpre tyrienne, et pour Héliogabale qui l'applique, il n'y a là qu'un simple rétablissement d'équilibre, un retour raisonné à la loi, puisque c'est à la femme, la première née, la première venue dans l'ordre cosmique qu'il revient de faire des lois.
*
Héliogabale a pu arriver à Rome au printemps de 218, après une étrange marche du sexe, un déchaînement fulgurant de fêtes à travers tous les Balkans. Tantôt courant à fond de train avec son char, recouvert de bâches, et derrière lui le Phallus de dix tonnes qui suit le train, dans une sorte de cage monumentale faite, semble-t-il, pour une baleine ou un mammouth. Tantôt s'arrêtant, montrant ses richesses, révélant tout ce qu'il peut faire en guise de somptuosités, de largesses, et aussi de parades étranges devant des populations stupides et apeurées. Trainé par trois cent taureaux que l'on enrage en les harcelant avec des meutes de hyènes hurlantes, mais enchaînées, le Phallus sur une immense charrette surbaissée, aux roues larges comme des cuisses d'éléphant, traverse la Turquie d'Europe, la Macédoine, les Grèce, les Balkans, l'Autriche actuelle, à la vitesse d'un zèbre qui court.
Antonin Artaud, Héliogabale ou l'anarchiste couronné, dans Œuvres complètes, VII, nouvelle édition revue et augmentée, Gallimard, 1982, p. 95-96.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, héliogabale ou l'anarchiste couronné | ![]() Facebook |
Facebook |





