31/07/2022
Ana Toi, Traités et vanités

Rhétorique
de longtemps le corps
le geste de l’homme
ne fait que mimer
le rite rimé
sans foi ni raison
l’essence est diluée
technique bien huilée
pour le pire simulacre
le forfait est parfait
le parfait est le vide
le pur geste ne se fait pas plus rare
de toujours le geste pur est rare
croire et faire
se scindent sans cesser
on croit faire
sans réellement faire
on fait croire
sans soi-même y croire
Ana Tot, Traités et vanités,
Le grand os, 2009, p. 57.
Littérature de partout rouvrira le
1er septembre
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana ton, traités et vanités, rhétorique, jeux de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
09/10/2016
Ana Tot, Méca
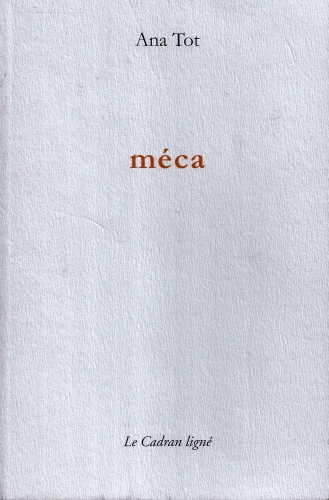
Méca : ce titre pourrait être une abréviation de mécano et, alors, évoquer un jeu de construction ; ici, une grande partie des 69 textes se construit à partir d’un procédé simple : mots de sens opposés (vide / plein, accepter / refuser, différent / pareil, etc.), expressions courantes qui ouvrent un texte (il faut tenir le coup, ça va aller, ça n’a aucune importance, etc.), exploration de ce qui peut être dit d’une ‘’entrée’’ comme « si j’étais », « je suis bien épaisse », répétitions, énumération de ce qui peut suivre un pronom : « elle est bonne. Elle voit. [etc.] », passage d’un mot (matière) à un autre (histoires), etc. On aurait donc de cette manière des jeux avec les ressources de la langue, des exercices de style qui aboutissent d’ailleurs parfois à des énoncés cocasses : la proposition d’ouverture « tout a une fin », après des considérations sur le rapport entre la fin et le commencement, entraîne : « Tout a une fin, sauf le saucisson ». Mais ce n’est pas si simple.
Dans la page titre, différente de ce qu’on lit sur la couverture, sous méca vient camées ; ce renvoi à un travail minutieux de mise en relief ne contredit pas le sentiment premier de jeu. L’anagramme phonique [mé-ca /ca-mé] oriente cependant dans une autre direction : la lecture ne peut s’arrêter à une signification, ce qui est explicite dans un texte où l’on passe d’un sens à l’autre du mot « langue » ; si « je te mets ma langue dans la bouche. Ce n’est pas la langue du plaisir, ce n’est pas une présence. C’est mécanique. C’est la langue. », d’où : « Alors tu sors de toi. C’est désagréable. Ce n’est pas mécanique. C’est enfin la création de ta langue grâce à la langue mécanique. » Ce qui permet de conclure : « C’est enfin la réaction qui te fait réagir. Tu dis, tu réagis, tu jouis, non [dans la bouche] ». Le jeu existe, certes, mais pour dire une expérience.
Les mots en gras (qui s’accordent ici avec le double sens de « langue »), sont séparés de l’ensemble ; simples ou multiples, ils forment une sorte de synthèse à l’issue de chaque texte : à partir de leur réunion dans une table des matières, on esquisse sans trop de peine une vision peu avenante des choses du monde. Sont en effet récurrents des mots reçus avec un sens négatif à des degrés variables : « tout allait rien, rumination, ça-n’a-aucune-importance est, n’arrive pas, rien, basta, choquer, lasse, tout ce sang », le beckettien « pour en finir avec » et le dernier mot du livre, l’impératif « crève ».
Cette invitation à crever dans le texte final est faite non seulement à tous ceux qui, socialement, ont un rôle particulier (les artistes, les poètes), mais à l’humanité bien portante dans son ensemble et aux animaux qui l’accompagnent (chiens, chats) ; toujours dans le jeu des oppositions, à « crever » répond « vivre », qui inclut les rejetés de notre société où tout doit être propre, transparent, sans aspérités : « les vieillards inutiles, les hommes sans génie, les beautés sans Beauté, les choses sans Vérité, les vérités sans Machin-Chose, les fourmis, les microbes, les imbéciles et les incultes. [etc.] ». Opposition exprimée avec humour — il faudrait tout citer —, mais facile, qu’on peut estimer simpliste, et Ana Tot ne l’ignore pas : si la double proposition (crever /vivre) apparaît être un programme, somme toute assez commun, que ce programme lui-même disparaisse ! Que reste-t-il ? « [crève] ». Et peut-être que ce dernier mot du livre sur l’inanité des choses de la vie, renvoie au premier texte.
La phrase d’ouverture, « les choses ne sont pas comme elles sont », prend à rebours la proposition d’Aristote, si souvent commentée : « Le commencement de toutes les sciences, c’est l’étonnement de ce que les choses sont comme elles sont. ». Ana Tot laisse de côté le premier membre de la phrase et, de manière virtuose, semble démonter la proposition en jouant sur « comme elles sont » et en introduisant deux termes (cravates, chaussettes) et non un (choses), ce qui donne à l’issue du raisonnement : « si je te dis justement que tes cravates sont comme des chaussettes c’est que tes cravates sont [comme elles ne sont pas]. Ce n’est pas tant la réflexion philosophique qui est mise à l’épreuve que la lecture sans réflexion.
Par ailleurs, Ana Tot avance à différents endroits de Méca des propositions qui, réunies, interrogent une vision du monde. Ainsi, du statut du ‘’je’’, donc de l’humaine condition : partant de « nous ne créons rien », elle aboutit à « Nous sommes le poids d’un passé qui contient présent et avenir. […] Tout est passé, joué, donné, produit. » S’interrogeant sur ce qui peut être cherché par chacun de nous, qui manquerait, la narratrice affirme « personne, moi pas davantage qu’un autre, ne manque à quoi que ce soit » — ce qui ne peut en effet être discuté et conduit à conclure que « c’est rien qui manque », donc on ne peut que chercher rien… Etc.
Ces considérations importent, mais ne sont pas ce qui retient d’abord. Le lecteur est plus immédiatement sensible au fait d’être emporté dans un labyrinthe de mots et d’être contraint de relire pour saisir le fonctionnement d’une rhétorique souvent subtile. Emporté aussi dans la jubilation d’une écriture qui joue sans cesse avec la syntaxe ou, parfois, avec des consonances en série : « Breloques, bibelots, babioles ! mes bibles, mes bribes, mes billes ! Mes mots, mes mottes, mes montres… » Et séduit par un lyrisme discret, quand la narratrice, à plusieurs endroits, se dédouble, alors « L’une repose sur le lit de mes jours. L’autre s’enflamme / [sur le bord de mes nuits] ».On relit plusieurs fois ce petit livre foisonnant de vie et l’on remercie Le Cadran ligné de l’avoir publié.
Ana Tot, Méca, Le Cadran ligné, 2016, 72 p., 13 €.
Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 21 septembre 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana tot, mica, anagramme, rhétorique, jeu de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
27/07/2015
Jacques Moulin, Journal de campagne : recension
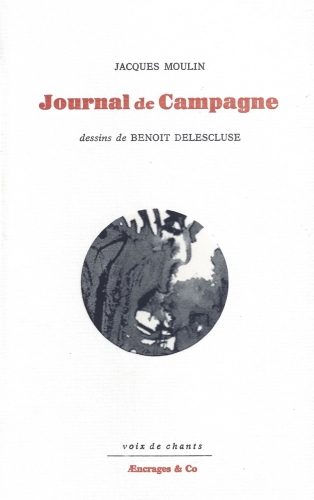
Un journal de campagne, on sait bien que cela évoque les opérations militaires plus que la nature, même si elle est présente : la guerre, quand elle est évoquée, c’est la Grande, celle de 14-18, et sont précisément rappelés des lieux bien champêtres qui furent des lieux de mort, tel le Hartmannswillerkopf, souvent désigné par ses initiales HWK (conservées ici pour titrer 4 poèmes) ou nommé "la montagne de la mort" : éperon rocheux au-dessus de la plaine d’Alsace — « Hécatombe et massacre / Double V pas de veine est ma vie ». Cependant, à travers les souvenirs discrets des combats, l’évocation de paysages de vignobles et de réunions autour d’un verre de Sylvaner, le lecteur est surtout attentif au motif lyrique de la mémoire et, comme à la lecture des recueils précédents, à la manière qu’a Jacques Moulin d’exploiter les ambiguïtés de la langue — c’est-à-dire les ressources avec lesquelles on peut écrire.
Tout d’abord la construction du livre est rigoureuse, ce que l’on ne comprend qu’après la lecture du premier ensemble titré "Cheminement" qui réunit deux poèmes ("Avancée" et "Abri") : le second ensemble, titré "Approches", s’ouvre avec "Place forte" où sont rassemblés une série de termes utilisés pour décrire une forteresse dont quelques-uns, en caractères gras, sont retenus comme titres des poèmes du livre, par exemple ceux que j’ai cités. La variation autour de quelques mots est signalée dans les vers d’un rondel — « On tombe sur des mots qu’on peut envisager / L’alexandrin revient pour chacun les nommer / Canon bastion redoute archère et contrefort / Barbacane bonnette [...] — et, à nouveau, avec humour, dans un « Lexique des titres fortifiés » qui clôt le livre.
On pourrait craindre que des poèmes écrits à partir d’un vocabulaire militaire soient bien peu séduisants, suite de poèmes en vers libres prenant pour prétexte des mots dont le sens, pour la plupart d’entre eux, n’est plus compréhensible à cause de leur technicité, comme "réduit" ou "banquette", mais on voit bien que l’on peut jouer sur leur polysémie. Quand il est difficile d’emprunter des voies de traverse avec un mot, il est toujours possible de s’attacher à la forme même ; ainsi du nom commun "fort" : « F.O.R.T. avec un T qui ne se lie pas. T en tourelle on dit gabion et c’est du guet. Que veut-il prendre aux rets des langues ? », etc. ; « lie » ici se prendra en même temps pour « lit ». Et "fort" appelle évidemment "for", mais Jacques Moulin dans le poème titré "For intérieur" multiplie l’emploi de termes relatifs à la forteresse (fort, fossé, barbelés, ronde, courtines, etc.), y compris à la fin du poème dans la synthèse de ce qu’est ce jugement de la conscience : « Tout est fragile. Vigilance encore mais en fort détaché. »
Dans la série se glisse un rondel, signalé comme tel (« Le rondel bat la brèche et se joue des rebords / Sur le chemin de ronde au plus près des fossés ») ; construit en alexandrins et sur deux rimes selon la règle, son refrain ne comporte cependant qu’un vers et n’est répété qu’une fois. On relève que la reprise d’un vers, dans le livre, est un des moyens de lier les poèmes entre eux — par exemple on notera le retour dans plusieurs poèmes de « On entend la poussière ». Il en est d’autres propres à la poésie de Jacques Moulin. Je pense à son usage des phrases nominales, fréquentes, en cascade, qui donnent mouvement, nervosité(1). Je pense aussi aux jeux phoniques qui consistent à rapprocher des mots qui ne se distinguent que par un son : vestige / vertige ; calvaire /calcaire ; résider / résidu ; pans / pas, ou que l’on rapproche comme enceintes / empreinte ; cisaille /zigzague. Il y a parfois dans ce reprise de cellules sonores un souvenir des Grands Rhétoriqueurs du xve siècle, quand on lit : « Sous l’aile de l’abri bris de mur à coups sûrs . Et s’écoulent les fleuves dans le mugir des plaines » (souligné par moi), ou si l’on prononce : « Si ça te dit ça me dit aussi / Stammtisch ici ».
On pourrait penser à Ponge dans la manière qu’a Jacques Moulin de s’attacher à la lettre du mot, qui ne désigne pas une chose de façon arbitraire, comme tout autre mot, mais parce que sa forme évoquerait cette chose ; ainsi pour "redoute" : « R.E.D.O.U.T.E. comme une redite destinée à souligner un chemin de retrait [...] », ou pour "fort" : « On ne voit guère plus loin que le bout de son T ». Mais un seul poète est nommé, Jaccottet, dont un fragment de prose (d’ailleurs entre parenthèses dans Éléments d’un songe) devient un vers dans le dernier poème : « Tout étoilé d’obscure ignorance / Signé Jaccottet ». Il faut ajouter, en note, François de Sales, à qui est emprunté la graphie "abril" pour "avril", retour au xvie siècle et au jeu des sons avec « Être à l’abri jusqu’à l’avril / L’abril d’avril ». Voilà un livre dans la continuité des livres publiés par Jacques Moulin, avec en ouverture de chacune des quatre séquences un fort suggestif dessin de Benoît Delescluse. Une réussite.
________________________
1. Phrases nominales très nombreuses par exemple dans À vol d’oiseaux, L’Atelier contemporain, 2013.
Jacques Moulin, Journal de campagne, dessins de Benoît Delescluse, Æncrages, 2015, non paginé, 18 €. Cette recension a été publiée en juillet 2015 dans Les Carnets d'eucharis.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques moulin, journal de campagne, guerre, ambiguïté, rondel, rhétorique | ![]() Facebook |
Facebook |
12/08/2014
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955

André du Bouchet par Giacometti
Rhétorique : dépouillés de la rhétorique, on ne se bat plus que les poings nus. (Ferblanterie des mythologies, armurerie comique et naturelle, etc.) On finissait par ne plus entendre que le choc des armures. Nous sommes aujourd’hui au point si intéressant, si vif, de nous reconstituer une coquille.
Dire : pourquoi est-ce que j’écris, ou veux écrire — pas exactement pour le plaisir, ou combler les trous du temps — ou précisément pour cela — l’oisiveté finit par se contre dire et donner un pouce à des forces. Si elle est appuyée par quelques inconvénients solides sur lesquels on peut compter — en dehors : travail, gymnastique, bonté, etc.
Aujourd’hui, comme chaque jour : il faut que la « poésie » devienne plus (autre chose) qu’un constat ou bien se démette. (Moralité, règle de vie, rythme impératif, non-impérieux — mais le mot est détestable.)
Rhétorique. Le « sonnet » devait être une sorte de garde-fou. Écrits par centaines. Des bonheurs relatifs — et de détail — assez pour rendre heureux dans une certaine mesure — mais dans l’ensemble, une fois bouclé le sonnet, rien de bien moderne, ni qui valait qu’on s’y attache ou s’y abîme. Il n’y avait plus qu’à recommencer. Mallarmé essaie d’en faire un absolu, un gouffre. Il s’y abîme. Tout près, justement, de forcer le langage : il n’écrit qu’une poignée de sonnets , au lieu de la multitude que le genre comporte.
De mon côté écrire des poèmes résolument enracinés dans l’effort de l’homme : il sera parfumé des idées du monde ambiant, choyé par le vent. L’eau lui lavera sa sueur. Mais d’abord lui-même —
(Reverdy. C’est ça la réalité telle que je la sens et la respire : mais il faut tout redécouvrir pour soi, comme si vous n’aviez jamais écrit, jamais rien dit. Mais cela je ne l’aurais jamais aussi bien su si je ne vous avais pas lu.)
ART : perpétuel.
Il n’y aura jamais de terme à cette surprise, à cet étonnement sans précédent que nous donnent un poème, une œuvre d’art, pour aussitôt (à condition de nous avoir donné cette surprise, cet étonnement) rentrer dans tout ce qu’il y a de plus familier. L’homme familier (« miracle dont la ponctualité émousse le mystère », Baudelaire) ne cessera jamais de s’émerveiller de lui-même, de se voir reflété dans les yeux de ses semblables.
André du Bouchet, Une lampe dans la lumière aride, Carnets 1949-1955, édition établie et préfacée par Clément Layet, éditions Le Bruit du Temps, 2011, p. 30, 31, 33, 34, 44, 58, 62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bouchet André du, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré du bouchet, une lampe dans la lumière aride, carnets 1949-1955, giacometti, rhétorique, poème, écrire, art | ![]() Facebook |
Facebook |





