31/07/2020
Volker Braun, Poèmes choisis

Eh bien donc je suis content
Eh bien donc je suis content
J’aspire l’air dans mes veines
Et j’ai encore mes cinq sens —
Dans ce monde insensé ? —
J’habite au ras de la terre
Qui n’appartient à personne et à moi.
Je vois encore l’arbre et le poisson
Et les mers qui nagent — C’est leur mort
Que tu vois — Des États
De béton horrible. Et même
Le plus libre, un serviteur
Plaie d’action est encore mortelle.
Je redoute la guerre. —
Et c’est ça qui te réjouit ? —
Vivre au plus grand péril
Du présent, le dernier
Ou le premier homme.
Volker Braun, Poèmes choisis, traduction
Jean-Paul Barbe et Alain Lance, Poésie/
Gallimard, 2018, p. 55.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : volker braun, poèmes choisis, monde insensé | ![]() Facebook |
Facebook |
30/07/2020
Sharon Olds, Odes : recension
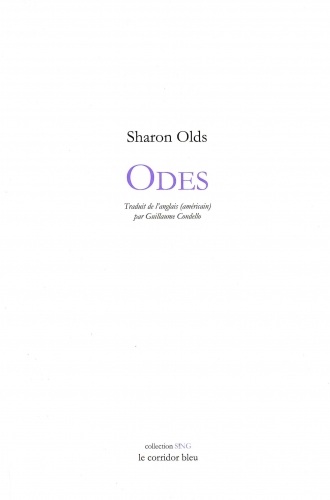
Ce livre d’odes semblerait reprendre la tradition ancienne du blason, qui louait diverses parties du corps féminin (moins souvent du corps masculin), née au XVIe siècle avec Clément Marot et le Blason du beau tétin (et celui du laid tétin) en octosyllabes ; le genre est adopté par quelques-uns de ses contemporains, par exemple, Maurice Scève pour les blasons du sourcil, de l’œil, de la gorge, du soupir, de la larme. On écrit aussi des blasons moins conventionnels, notamment à propos du sexe féminin, celui-ci en décasyllabes de Guillaume Bochetel : « O con gentil, con mignon, con joly, / Con rondelet, con net, con bien poly, / Con ombragé d’un petit poil follet, / Con où n’y a rien difforme ou de laid / (etc.) » Les blasons ne se maintiennent pas au-delà du milieu du XVIIe siècle et diffèrent des poèmes de Sharon Olds sur plusieurs points.
Écrits par des hommes, presque toujours sur des parties du corps féminin, ce sont avant tout des jeux littéraires, chacun rivalisant d’esprit dans la description*. Les odes de Sharon Olds, à propos de l’anatomie des hommes et, plus souvent, des femmes, prennent aussi pour sujet un rêve de victuailles ou la Terre, les amis encore en vie ou l’aube sur la baie de San Francisco. On comprend vite que l’objectif n’est pas seulement de célébrer le corps, et souvent de manière à choquer le lecteur qui attendrait de l’ode quelque chose de lyrique (définition minimale aujourd’hui du genre), mais de placer les descriptions dans la société contemporaine.
Préambule aux sept ensembles de poèmes, la première ode est consacrée à l’hymen, d’abord décrit : « Cher mur, / chère porte, cher échalier, chère porte coupée, tu n’es pas / une chatière ou une porte tambour / mais une piñata à usage unique. » C’est introduire à la position de l’auteure, clairement exprimée vis-à-vis du statut de la femme : pour ce qui est de la rupture de l’hymen, il y a eu choix, « quand, avec qui, où et pourquoi ». Une seconde ode à l’hymen précise ce statut ; à qui s’étonnerait qu’une femme âgée (Olds a alors plus de 70 ans) écrive à propos de son hymen, l’auteure répond, « Mais ce n’est pas que mon hymen » et, plus précisément,
N’est-il pas temps de louer la musique
pourpre qu’elle ne joue qu’une fois, la petite
mort qui marque le début d’une vie
intérieure, et la perpétuation de l’espèce ?
On peut voir dans les odes à différentes parties du corps féminin (clitoris, vagin, vulve, etc.), masculin (pénis, gland) et à des pratiques sexuelles (fellation) une forme de provocation, mais vis-à-vis de quoi ? Faut-il penser que certaines parties du corps et leurs mouvements devraient être exclus de la poésie ? Olds, à propos du mot vagin, écrit que nous « semblons / faire une pause avant de le dire, comme si ce mot / était dangereux ». Il s’agit toujours dans ces odes de refuser la vision lisse d’un corps sans organes, de ses fonctions, qui sont intégrées dans l’ensemble de la vie. C’est pourquoi on lira aussi une "ode sauvage", ode aux pets féminins commentée de manière humoristique, « Suis-je allée aussi loin que / possible, avec ces vers que je me tire du cul ? ». C’est pourquoi aussi on lira un poème autour des toilettes sèches et des merdes devenant engrais ; de toute provenance elles sont égales comme veut le prouver leur énumération. Rien de scatologique ni de vulgaire dans les poèmes sur ces moments et choses de la vie, qui sont restitués comme d’autres.
Il s’agit toujours d’écrire à propos de l’expérience humaine. Celle du corps est première, elle fait prendre conscience qu’il est source de plaisirs s’ils sont choisis et partagés ; Olds commente ainsi sa sortie avec un homme pour qui l’amour ne comptait pas, « j’ai cru mourir, mon cœur / c’est mon corps, le prix d’un baiser, c’est ta vie ». Ce corps vieillit et il est nécessaire de vivre ses changements, ses déformations, d’où une "Ode à ma graisse", une "Ode à mon cou de vieille", en louant « ce qui disparaît et qu’on ne peut jamais rattraper », en acceptant « l’excitante absence de charme » parce que, « face au temps », ce qui importe ce ne sont pas seulement les « doubles mentons flétris » mais « mes muses, ma vérité qui n’est pas la beauté ». Ce corps est aussi dans la société, et les odes à la sœur, à la mère, aux amis, aux amants l’expriment sans ambiguïté ; dans une ode à Evie Shokley, poète afro-américaine, l’auteure rappelle son « aveuglement » de n’avoir pas compris immédiatement que sa peau blanche la faisait différente dans une société toujours ségrégationniste. Son premier acte politique a été justement, en sortant de chez l’orthodontiste, d’entrer dans une chaîne de personnes qui empêchait l’accès à une vente pour protester contre la ségrégation — « Premier pas hors du silence ».
Le silence, c’est dans l’enfance celui des repas, de l’absence d’échange avec les parents ; ce qui est constant dans ces années familiales, hors la présence bienfaisante de la sœur, ce sont les coups de la mère avec qui elle rompt par le seul fait de s’enfuir pour ne pas être battue. Rupture mais non pas abandon du lien maternel : elle se souvient dans "Ode de l’harmonie" de la « voix de soprano de [s]a mère » et de son « regard déchirant, enfantin » quand elle l’a veillée. Ses cendres étant dispersées, elle est heureuse qu’elle soit « disséminée — qu’elle soit partout / et nulle part ». Cette relation à la nature, au "grand tout", est constante dans le livre et ne se manifeste pas seulement dans les odes au vent ou au pin ; à propos des arbres dans la ville, le lien de l’humain à tout ce qui est vivant est affirmé nettement, « ce que font les arbres, surtout, / c’est respirer avec nous, nous offrir une respiration / artificielle naturelle ».
Dans les Odes, Sharon Olds renoue avec la poésie whitmanienne que la traduction de Guillaume Condello, quand on se reporte au texte anglais, restitue avec bonheur : certaines odes semblent être écrites directement en français. Ce livre, l’un des derniers de l’auteure, est sans doute une bonne entrée dans l’œuvre mais il faut souhaiter qu’il ne restera pas le seul à être proposé aux lecteurs.
*Le premier recueil de blasons est publié vers 1568-1573, Les blasons du corps masculin et féminin, Composez par plusieurs poètes avec les figures au plus près du naturel, Paris, Veuve Bonfons (Gallica).
Sharon Olds, Odes, traduction Guillaume Condello, Le corridor bleu, coll. SING, 136 p., 15 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 3 juillet 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sharon olds, odes : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
29/07/2020
Julien Bosc, Le coucou chante contre mon cœur

Attendre
Ouvert
Ne pas fléchir
Tout silencer
Voir
Se replier au point de n’être plus
La pensée se dilue
Les nerfs fondent
La chair reprend ses droits
Le corps chavire une vague l’emporte les fonds l’accueillent
Que m’arrive-t-il
Je ne sens plus rien
Mes oreilles saignent
Un voile froisse mes paupières
Mon ventre fait sous moi
Des mains ou je ne sais me tirent
La bougie s’éteint
Le vent tombe
Avec les pétales du pavot
Le feu l’arc-en-ciel Orion le soleil : pleurerais-je ?
Julien Bosc, Le coucou chante conte mon cœur,
Le Réalgar, 2020, p. 25.
© Photo Chantal Tanet
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bosc Julien | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julien bosc, le coucou chante conte mon cœur, angoisse | ![]() Facebook |
Facebook |
28/07/2020
Laurent Albarracin, L'herbier lunatique

Retirant la pierre de l’eau
elle luit vivante et morte
On aurait donc arraché
un cœur à ses battements.
Mouille un caillou
assombris-le
et son éclat sèche aussitôt
comme un peu de brume lui venant
Souffle sur la pierre
pour attendrir
ton souffle
En soupesant une pierre
sentir la pierre faire bloc avec son poids
faire pierre avec la pierre
On ne sépare pas le chacun
du tout
Tout l’opaque de la pierre
est le durcissement d’une clarté
tout le dur de la pierre
l’éclat de sa durée
Laurent Albarracin, L’herbier lunatique
Rougerie, 2020, p. 8, 9, 10, 11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent albarracin, l’herbier lunatique, pierre, souffle, éclat | ![]() Facebook |
Facebook |
27/07/2020
Serguei Essenine, Journal d'un poète

Première neige
En route. Silence blanc.
Sous les sabots sonne un galop.
Dans les prés seuls batifolent
des volées de corbeaux gris.
Envoûtée par quelque fée
la forêt somnole en rêvant.
Ne dirait-on pas le sapin
natté de tresse blanche.
Courbé comme une petite vieille
appuyée sur un bâton.
À la cime du houppier
un pivert martèle le tronc.
Le cheval caracole — vaste, l'espace !
La neige étale son châle de flocons.
Sans fin, la route fuit
comme un ruban à l'infini.
(1914)
Sergueï Essenine, Journal d'un poète, traduit
du russe, présenté et annoté par Christiane
Pighetti, éditions de la Différence, 2014, p. 49.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sergueï essenine, journal d'un poète, première neige | ![]() Facebook |
Facebook |
26/07/2020
André Frénaud, HÆRES
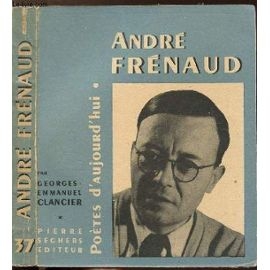
Mais qui a peur ?
Les arbres mouillés,
les armes rouillées,
l’astre dérobé,
le cœur engourdi,
chevaux encerclés,
château disparu,
forêt amoindrie,
accès délaissé,
lisière éperdue,
source dessaisie,
— La neige sourit.
André Frénaud, HÆRES,
Poésie/Gallimard, 2006, p. 147.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, hÆres, mais qui a peur, neige | ![]() Facebook |
Facebook |
25/07/2020
André Frénaud, La Sainte Face

Comptine à la moustache
La virgule qui s’en, qui s’en va
clopin-clopant, c’est la moustache, adieu papa.
C’est la moustache au rat qui s’en va. C’est la moustache,
c’est la moustache.
Oh ! S’en reviendra-t-il, s’en ressouviendra-t-il
en tronçons de... Ahah, le gros rat, le gros roi ?
C’est la question... La question, c’est la moustache.
André Frénaud, La Sainte Face, Poésie/ Gallimard,
1985, p. 195.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, la sainte face, comptine à la moustache | ![]() Facebook |
Facebook |
24/07/2020
André Frénaud, Il n'y a pas de paradis

Un par deux
J’ai maintenant deux corps,
le mien et le tien,
miroir où se fait beau
celui que je n’aimais pas.
Qui ne me portait pas chance
Des succès qui ne m’accordaient rien.
L’amour que nous nous rendons
nous a délivrés des rencontres,
aussi des vertus inutiles.
André Frénaud, Il n’y a pas de paradis,
Poésie/Gallimard, 1967, p. 50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Frénaud André | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré frénaud, il n’y a pas de paradis, un par deux, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
23/07/2020
Antoine Emaz, Carnets

Carnets
Le moi n’a aucune importance — c’est ce qui le traverse, ou ce dont il est le lieu, qui peut amener à écrire.
Le moi est une page, il attend.
Art poétique
ne dire que du vrai
payé comptant
quel que soit l’angle
quelle que soit la débâcle de mots
et travailler ensuite
même le dégoût du vrai
même sa laideur
son insignifiance
Ce que je fabrique ne correspond à rien d’écrit, même si je peux entendre résonner dans mon travail d’autres travaux.
Définissons donc comme poème ce qui, écrit, ne correspond à rien... et cessons d’envier les définitions, fausses également parce que tyranniques, d’autres formes — je pense à la note, au roman, au récit.
Antoine Emaz, Carnets, dans Rehauts n° 45 juin 2020, p. 6, 16, 16.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, carnets, dans rehauts n° 45 juin 2020, art poétique | ![]() Facebook |
Facebook |
22/07/2020
Bernard Noël, Le Mal de l'espèce

Le Mal de l’espèce
......Elle envoya des recommandations : il s’agissait de les suivre avec ponctualité. Elle exigeait que le désir soit préservé à l’extrême et outré autant que possible. Elle comptait sur ta volonté pour qu’ainsi soit ouverte dans la limite une brèche qui, certes, ne la romprait pas mais la repousserait encore et encore jusqu’à l’illusion de l’avoir dépassée. Elle aimait, tu l’as tout de suite compris, l’au-delà, c’est-à-dire cette région que nous portons à fleur de peau et que, pourtant, nous ne savons pas envahir pour nous abandonner simplement à la floraison du bonheur. Elle écrivit donc avec précision qu’elle attendait beaucoup de réserve le premier jour — une réserve passionnément tendue et qui, sûrement, aurait pour effet de créer un appétit beaucoup plus vif que la précipitation vers le plaisir.
Bernard Noël, Le Mal de l’espèce, dans La Comédie intime, Œuvres IV, 2015, p. 289.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, le mal de l’espèce, dans la comédie intime, désir, volonté, plaisir | ![]() Facebook |
Facebook |
21/07/2020
Bernard Noël, Qu'est-ce qu'écrire

Qu’est-ce qu’écrire ? III
Il y a ce mouvement que je n’arrive pas à fixer.
Dans la vie courante, ce serait un élan qu’un geste traduirait. Il n’est pas moins présent dans le corps, et cependant il y demeure insaisissable, comme toujours en train de fuir devant. Devant quoi ? Devant ce qu’il ouvre ou attire ou entraîne. Il laisse le goût de sa trajectoire sans laisser une trace : un goût que j’essaie sur un sens puis l’autre sans réussir à le percevoir clairement. C’est... me dis-je en décidant de mettre un nom dessus pour en finir, mais le nom glisse et se dérobe. Il s’agit d’une germination instantanée qui précède une activité si mince, si rapide qu’elle a tout juste eu lieu pour s’effacer. En vérité, je devrais ne pas l’avoir même remarquée.
Bernard Noël, Qu’est-ce qu’écrire ? III, dans La Place de l’autre, Œuvres III, P.O.L, 2013, p. 213.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, qu’est-ce qu’écrire ? iii, dans la place de l’autre, mouvement, élan | ![]() Facebook |
Facebook |
20/07/2020
Bernard Noël, De Gauche, autrement

De gauche, autrement
Depuis toujours, la pensée politique est orientée vers la prise du pouvoir, et par conséquent vers sa conservation. Cela s’exprimait autrefois par l’hérédité du pouvoir absolu. La succession démocratique a introduit la relativité — jusqu’à quel point ? Et l’instauration du pouvoir économique ne rétablit-elle pas le pouvoir absolu, mais masqué ?
Le comble du génie politique est de faire admettre à l’opprimé la nécessité de son oppression. Le chômage remplit très bien cette fonction. Rien n’est plus terrible dans l’Histoire que d’y observer la permanence d’un complexe de servilité, qui a toujours permis l’exploitation consentante de la majorité. La logique de cette permanence aboutit à ce pouvoir économique intelligent, brutal et universel.
Bernard Noël, De gauche, autrement, dans L’Outrage aux mots, Œuvres, II, P.O.L, 2011, p. 387.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, de gauche, autrement, dans l’outrage aux mots, pensée politique, histoire | ![]() Facebook |
Facebook |
19/07/2020
Bernard Noël, Des formes d'elle

Des formes d’elle
I
vivre dis-tu
c’est la venue
d’un mystère il s’empare
de nous tu vois cette ombre
sur le corps
tu vois
ce fantôme en dessous
la matière a besoin
de matière
ce besoin
est notre infini
ma langue
touche en toi une serrure
intime
tu fais de moi
un moi par-dessus les morts
par-delà les vivants
Bernard Noël, Des formes d’elle, dans
Les Plumes d’Éros, Œuvres I, P. O. L,
2009, p. 279.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Noël Bernard | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard noël, des formes d’elle, dans les plumes d’Éros | ![]() Facebook |
Facebook |
18/07/2020
Paul Claudel, Connaissance de l'Est

La pluie
Par les deux fenêtres qui sont en face de moi, deux fenêtres qui sont à ma gauche, et les deux fenêtres qui sont à ma droite, je vois, j’entends d’une oreille et de l’autre tomber intensément la pluie. Je pense qu’il est un quart d’heure après midi ; autour de moi, tout est lumière et eau. Je porte ma plume à l’encrier, et, jouissant de la sécurité de mon emprisonnement intérieur, aquatique, tel qu’un insecte dans le milieu d’une bulle d’air, j’écris ce poème.
Ce n’est point de la bruine qi tombe, ce n’est point une pluie languissante et douteuse. La nue attrape de près la terre et descend sur elle serré et bourru, d’une attaque puissante et profonde. Qu’il fait frais, grenouilles, à oublier, dans l’épaisseur de l’herbe mouillée, la mare ! Il n’est point à craindre que la pluie cesse ; cela est copieux, cela est satisfaisant.
Paul Claudel, Connaissance de l’Est (1929), Poésie / Gallimard, 1974, p. 82.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l’est, pluie, grenouille | ![]() Facebook |
Facebook |
17/07/2020
Alexandre Castant, Mort d'Athanase Shurail : recension
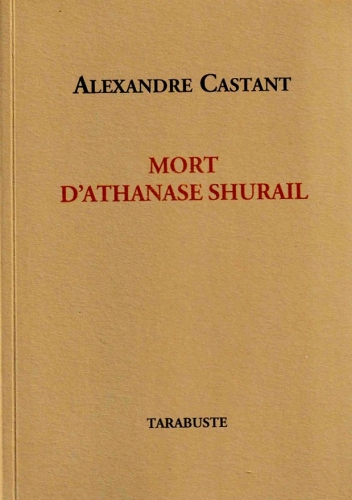
Un premier ensemble, "L’écritoire", compte trois textes numérotés en italique, très brefs, qu’un narrateur commente aussitôt et attribue (quatrième et cinquième séquences) à un certain Damien dans les deux séquences suivantes. Ce Damien n’écrirait dans un cahier que des « amorces » de récits qu’il accompagnerait de dessins de marque-pages ; il construirait ainsi une « bibliothèque invisible » puisque le tout ne quitterait pas son « écritoire ». Du narrateur (un "je"), on ne saura rien ; il a lu dix-sept projets, qu’il a réunis sous le titre "Vie et mort d’Athanase Shurail", et les fait suivre d’une coda, "Après Athanase", dans laquelle il réapparaît, avec un autre (d’autres ?) personnage ("nous"). Le lecteur reconnaît ici la longue tradition de l’enchâssement narratif, intéressant en ceci que certains des textes brefs enchâssent eux-mêmes un embryon de récit et, par ailleurs, que la partie préliminaire annonce l’essentiel des motifs présents dans les textes enchâssés.
À la fin de "La main noire", le personnage qui porte un gant de cuir noir, se coupe un doigt de la main intacte, ce qui constitue la chute de cette première nouvelle. Le lecteur est surpris par son nom, Jean de Gray, qui semble sorti d’un roman du XIXe siècle — c’était le nom d’un évêque anglais (fin XIIe-débute s.) et dont l’une des activités est de dresser des listes de prénoms et de les commenter. En accord avec cette pratique, les prénoms que l’on relève dans les textes pourraient bien appartenir à la fiction. Le lecteur s’arrête à celui de Léonie, qui évoque la tante Léonie de Combray et, de là, cherche dans les romans l’origine d’autres prénoms ; il trouve assez rapidement (et peut-être sans fondement) une source pour une large partie d’entre eux dans l’immense répertoire des personnages de Balzac : « Augusta » rappelle Augusta de Nucingen, « Diane » Diane de Maufrigneuse, « Madeleine » Madeleine de Morsauf, et la liste n’est pas close. Mais "Madeleine", dans la même nouvelle que "Ava" (variante de "Ève") peut en même temps évoquer la pécheresse du Nouveau Testament, elle qui souhaite ici découvrir le cinéma érotique. Tout se passe comme si la « bibliothèque invisible » se nourrissait de l’immense réservoir des noms déjà employés dans la fiction pour mieux s’y intégrer : les personnages de fiction ne meurent jamais et c’est pourquoi "Athanase" figure dans le titre de l’ensemble, étymologiquement le mot signifie « l’éternel », a-thanatos, "celui qui ne meut pas", et que "Lazare", nom du ressuscité du Nouveau Testament, et "Anastasia" signifiant « résurrection » sont également présents. En outre, si ces prénoms ont déjà été employés, ils apparaissent donc comme des doubles et le motif du double est récurrent de différentes façons tout au long du livre.
Dans la première séquence de "Vie et mort", Jean de Gray s’imagine être un autre lui-même, « contemple dans ses propres yeux sa peau, son corps », ce que commente le narrateur,
La fin d’un monde, ou sa révélation, sera une affaire de doubles,
reproduction, duplicata, calque, miroir, télévision.
Le même Jean de Gray, prenant un taxi, s’aperçoit que le chauffeur lui ressemble et s’interroge, « Tous les personnages sont-ils interchangeables ? ». Jusqu’à un certain point, sans aucun doute. Reviennent constamment les miroirs, les reflets, les illusions d’optique, les rétroviseurs, les caméras, les écrans ; à voir deux femmes qui se ressemblent mais d’âge différent, comment être sûr qu’il s’agit d’une mère et de sa fille ou de la même femme à des âges différents ? Cet aspect à la limite du fantastique apparaît dans d’autres séquences ; tel personnage ne dessine que des dessins de planches anatomiques, fasciné non par le corps humain mais par son imitation, par les « images d’images » ; tel autre semblerait manquer d’un double et se demande, « Que se passe-t-il dans mon studio quand je n’y suis pas ? » La réalité souvent saisie par sa reproduction, par ce que l’on voit dans le cadre que forme la fenêtre ou par le biais de tableaux : de tableaux, ceux de Géricault ou de Delacroix — pour ce dernier, il s’agit de La mort de Sardanapale, tableau de morts violentes présentes aussi dans le livre.
Une photographie d’une pie décomposée, de Gisèle Freund, décide un homme à se suicider, « parce qu’en finir avec soi-même est aussi raisonnable ou déraisonnable que de ne pas le faire » et, poursuit le narrateur, « rien dans la vie n’est décidable ni indécidable ni visible ni invisible ». Une femme se noie avec ses enfants, un homme se suicide, des corps « se décomposent » ou, chez un peintre, « se métamorphosent en charognes », comme si après la hantise du double il y avait un mouvement inverse vers la disparition. Ce peintre travaille les « bords : de la mort et de la folie » et un écrivain entend se mettre « en retrait » et « écrire depuis les bords du monde ». L’espace dans lequel évoluent plusieurs personnages a souvent l’aspect d’un décor, toujours le même : parc ou jardin et, surtout, « échiquier de dalles », « damier noir et blanc du carrelage » (le damier de Damien) — deux couleurs récurrentes, comme dans les films N&B — et, en même temps, grande abondance des couleurs, ce que souligne une scène où, dans l’étreinte, une femme sort de sa bouche « un monde virtuel fait de couleurs vives, de monstres et de livres ».
Le "je" qui rapporte les récits de Damien souhaite le retour d’Athanase, que le lecteur n’a pas rencontré dans les « ténèbres d’un labyrinthe en fragments ». Chaque nouvelle lecture de cette Vie d’Athanase Shurail conduit à de nouvelles découvertes et questions : on ne sait si le narrateur, qui a rassemblé l’ensemble, s’efface devant Alexandre Castant quand, à la fin du livre, on lit les dates « 1996-1999, 2019 » — Alexandre Castant a publié plusieurs livres sur l’image et la photographie.
Alexandre Castant, Mort d’Athanase Shurail, Tarabuste, collection Brèves rencontres, 114 p., 11 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 9 juin 2020.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre castant, mort d’athanase shurail : recension | ![]() Facebook |
Facebook |





