25/05/2017
Fabienne Raphoz, Blanche baleine : recension
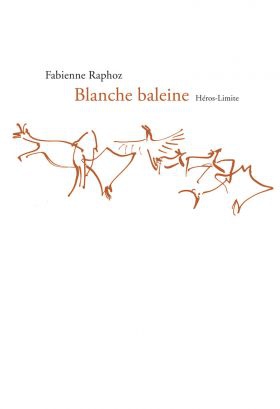
Blanche Baleine peut être rapproché du précédent recueil de Fabienne Raphoz, Terre sentinelle, pour sa thématique, annoncée par deux citations en exergue (George Oppen, David D. Thoreau) : tout est à connaître de la Terre — donc terre et eaux — et tout ce qui existe est à découvrir. On lira le livre comme une exaltation du vivant, de tout le visible, pierres, plantes et animaux dans des espaces variés : le livre s’ouvre sur la péninsule du Yucatán, mais l’on sera aussi proche du Mont Blanc. Il faut cependant, en même temps que ce voyage lyrique, ajouter d’autres parcours, le premier dans les langues avec l’introduction de l’anglais, de l’allemand, du latin scientifique et, pour le français, de néologismes, le deuxième dans le temps avec la présence de l’antiquité et les allusions à des ères géologiques, le troisième dans la littérature avec des citations de poètes contemporains (à l’exception de Byron), que des notes reprennent et attribuent.
Ces éléments variés, distingués ici, se fondent dans une composition rigoureuse. Si l’on commence par un ailleurs (le Mexique), on rejoint dans la troisième séquence, la plus développée, la région natale de la narratrice, la Haute-Savoie, et il faut lire dans son titre, "mon-t Fuji", le possessif « mon ». Les deuxième et quatrième séquences, de dimensions égales, portent des titres qui marquent leur parallélisme, "Buisson premier" et "Buisson sonore" ; le livre s’achève par une séquence d’un vers, titrée "Tell de terre", détournement donc d’un terme d’archéologie puisque "tell" évoque habituellement un amas de ruines de constructions humaines.
Le lyrisme de Baleine blanche se manifeste d’abord dans le plaisir d’écrire les noms, « il importe de nommer » écrit Fabienne Raphoz ; et à côté de noms familiers (baleine, singe, criquet, tortue, fouine, etc.), d’autres renvoient à un ailleurs, et peut-être à ce paradis que chacun porte en lui où le nom de l’animal semble dire ce qu’il est, comme toupaye, chrysomèle, lepture ou sirli — et ajoutons hors du domaine animal des mots dont le lecteur cherchera le sens, comme ololuga, cénote ou pachyte. On découvre à d’autres endroits du texte l’image d’un lien étroit avec la plante et l’insecte, avec la pierre et l’oiseau. Le passereau vu un matin (un accenteur alpin) est décrit à touches rapides, croquis pris sur le vif, ce qui s’équilibre avec le plaisir de « la ritournelle aimée de la liste », celle des différentes variétés de traquets — motteux, pâtre, des prés, tractrac, brun, commandeur, etc., liste qui conduit à nommer les pays où vit chaque variété… Sont également donnés les noms d’espèces de pommes cultivées par le père, noms qui, par leur sonorité, sont aussi liés à un ailleurs, celui de l’enfance, et ils sont isolés pour que chacun forme un vers : « Idared / Metsu / Melrose ».
L’enfance mais aussi d’autres moments de la vie de la narratrice sont présents. Les premiers vers, sibyllins, font allusion à un épisode douloureux (« me suis / écrasée jeune / sur l’asphalte / (vers Manhattan) », écarté (« ai survécu / passons ») : l’expérience intime n’a pas à être motif de poème, ce qui peut être écrit et partagé est autre. Ainsi, les moments vécus dans la région natale qui, bien qu’autour de ce qu’est le "je", sont pour l’essentiel rattachés au motif général du livre ; par exemple, dans une forte ellipse, la narratrice se définit à la fois par rapport à un lieu, un élément, la couleur d’un oiseau :
Je suis faite de la
pierre de mon pays
la rousseur du
gypaète aussi
De même, quand un membre de la famille Raphoz paraît dans les poèmes, c’est pour mettre en relation ce qu’il fait avec la vie animale ; un grand-oncle avait été cocher de fiacre à Paris : cette « migration » s’apparente à « Migration » des oiseaux, et les deux mouvements suivis d’un retour se répondent, page de gauche-page de droite.
Les mouvements sont incessants dans Blanche baleine, à commencer par ceux de la transhumance ; les vers alors deviennent quasiment un calligramme, dessinant un chemin. Quant à la baleine on peut suivre ses déplacements dans le temps, puisque qu’on la découvre fossilisée dans le désert (« voici les bêtes / revenues de loin ») et qu’elle est présente chez Homère et dans la Bible. Mais elle avance aussi sur terre, imaginée avoir donné forme à la grotte, et l’on se souvient qu’elle-même fut pour Jonas ce lieu accueillant qu’est la grotte dans l’imaginaire ; accueillante et bienveillante, qui rejeta le prophète sur la côte. L’image de l’ouverture dans la roche ou le sol (donc horizontale ou verticale) est récurrente dans le livre, favorable ou non selon qu’il s’agit du « trou », de la « balme » (« baume » en Provence, pour « grotte ») ou du cénote (sorte de gouffre). La dernière séquence, titrée "Tell de terre", fait disparaître tout caractère dangereux : elle ne comprend qu’un vers, où revient la grotte, associée à un symbole de renaissance (faon) et de liberté (oiseau) : « le faon des grottes se retourne sur l’oiseau » — ce symbole d’ouverture a été retenu par Ianna Andréadis pour illustrer la couverture.
Fabienne Raphoz, Blanche baleine, Héros-Limite, 2017, 96 p., 16 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 18 mars 2017
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, blanche baleine, recension | ![]() Facebook |
Facebook |






Les commentaires sont fermés.