16/04/2020
Pierre Alferi, chaos : recension

divers chaos réunit des poèmes écrits ou publiés au cours des années 2000 (un seul ensemble date de 1993), sous une autre forme ou dans un autre contexte pour des poèmes isolés — par exemple, un hommage à Jude Stéfan édité isolément (ink, 2011) est intégré dans la sirène de satan. Le titre — chaoss’emploie rarement au pluriel(1) — insiste aussi bien sur la diversité des ensembles que sur la mise en question de normes formelles admises et, par ailleurs, sur l’état de la société, image du désordre.
Le premier chaos, c’est celui que retiennent les poèmes d’ouverture ; et la rue(2018) présente une vue de la ville — Paris — aujourd’hui et questionne la difficulté à restituer la réalité : comment le mot "violence" peut-il suffire à dire ce que sont les opérations de police ? La violence de l’État prend des formes diverses, visibles, abandonnant les plus pauvres, les migrants dans la rue ; aussi
la honte nous survivra
nos descendants diront
enjambaient des corps
longeaient des familles à terre
pour faire leurs courses
Alferi brise la syntaxe, ici et dans d’autres poèmes, pour que la violence dans la réalité quotidienne soit inscrite dans la langue. Le désordre s’impose à d’autres niveaux, les changements affectent la manière d’habiter la ville et rejettent à l’extérieur une partie de la population (« on va / vivre plus loin »). En même temps c’est « la laideur sans frontières », l’importance des "jeux du cirque" avec des « projecteurs / plus haut que les flèches / de leur dame », la transformation de la nourriture (« les churros les burgers »), la surveillance permanente (« souriez / vous êtes filmés »), les pratiques à la mode et leur vocabulaire (« phyto chéro déco bio »), l’omni-présence des médias (« les nouvelles nouvelles »). La « métaphore du vide » est prolongée par l’existence des parcs dits de loisir, celui de Disney et « son univers impitoyable- / ment fluide ». Monde du leurre et de la suffisance dans lequel les assis « mangent des huîtres sous faux modigliani ».
Rien d’heureux dans ce tableau, encore assombri dans rue des deux-gares. Le premier poème donne le nom de quelques médicaments antidépresseurs et, progressivement, s’impose l’image d’un monde sans assise ; on voit « une vieille qui pisse / un allemand fou aux urgences / qui hurle je suce je suce ». Dans la sirène de satan (2019) c’est encore un monde de semblant qui est présenté, où « chacun trouve un équilibre / sans se soucier des autres » : « vivre sépare ». La violence n’a rien de symbolique — on peut compter « le nombre d’éborgnés chez les manifestants » — et il faut (et l’on peut) écrire à propos de la réalité de la société, « un poème qui touche / la crasse ». Poésie non pas "engagée", mais contre le chaos pour que chacun « lève / les yeux vers le / dégagement / qui rend la ville / propre à de nouveaux / usages d’utopie ». L’écriture permet de construire un cadre pour saisir quelque chose de la réalité, dire le chaos pour imaginer ce qui pourrait être autre.
En se souvenant cependant que le sens, des mots comme des choses, échappe souvent, comme tel graffiti sur un mur : une injonction peut être claire (« rappelle-toi beryllos »), mais ni le destinateur, ni le destinataire, ni le contenu de ce qui est à se remémorer. Cette question du sens est une de celles abordées dans un livre de Jacques Derrida (La Carte postale, 1980), cité par Alferi (« chez nous tous les messages / dépassent leur cible / je n’oublie pas la carte / postale de mon père »). On peut orienter le sens de la lecture d’un énoncé grâce notamment à l’emploi de paronomases (« l’arrêt alité », « des gafa gaffe à », « l’intime mité », etc.), ou par le rejet (« la rentrée des classes / sociales »). On s’arrêtera aussi à la manière dont est travaillée une forme traditionnelle, le sonnet.
Écrire l’histoire du sonnet, ce serait sans doute retracer les transformations du modèle pétrarquiste et du modèle français jusqu’aux sonnets en prose de Roubaud. Pierre Alferi, lui, abandonne la langue et propose un sonnet en 14 dessins, sonnet que l’on peut reconnaître de forme shakespearienne : (ABBA) x 2 CDCDEE — cette forme est aussi celle de quelques pièces (dont la première) des Holy sonnets de John Donne (2). Des personnages en noir au premier plan dans la première image sont en grisé dans l’image, vue comme dans un miroir, qui "rime" avec elle, et ceux au départ en grisé viennent alors au premier plan ; ils sont en mouvement dans les "quatrains", plutôt immobiles dans les "tercets". Une simple description du dispositif montre donc que les règles sont respectées si l’on accepte l’équivalence une image = un vers. Cependant, on est loin du projet des poètes du XVIe siècle pour qui le sonnet visait à illustrer les ressources de la langue ; ici, le lecteur peut commenter l’attitude des personnages (coureur, lutteurs de sumo, femme aux seins nus sur un piédestal, équilibriste, etc.) sans qu’il soit possible d’introduire une continuité propre au genre : c’est le contenu même du mot "sonnet" qui vacille.
D’autres ensembles mêlent texte et dessin. Algologie est écrit à partir de dessins d’algues empruntés au livre d’une botaniste ; sous le titre beryllos des lettres en désordre de l’alphabet grec annoncent le graffiti au centre du poème. La première page de gauche de propre à rien (où "propre" est aussi à entendre pour « bien lavé ») évoque dans une chambre les odeurs du corps (cou, seins, sexe), évocation qui s’ouvre par une homophonie, « chair amie », et se ferme par une paronomase, propriété-propreté, en accord avec la relation suggérée ; la chambre est dessinée page de droite, réduite à un lit et à un téléviseur. La plupart des poèmes suivants sont liés aux odeurs avec une répartition texte-dessin analogue ; la dernière image présente un homme fort concentré pour lâcher des vents, image du refus de la bienséance, « — tout plutôt que / l’arrogance du neutre / du littéral déodorant / réputé libre ».
Le dessin n’est pas une simple illustration de ce que les mots suggèrent, et d’ailleurs les mots ne suggèrent parfois que des stéréotypes — une des formes du chaos ? C’est le cas, sous le titre "serial", dans des poèmes en français avec leur traduction en anglais (ou l’inverse), qui énumèrent des situations souvent propres aux films de série B ; ainsi ce résumé de scénario qui ouvre l’ensemble, « une pièce brisée / une boîte noire / une balle de cuivre / sept perles / qu’est-il arrivé à marie ? / avec qui se marie marie ? ». On notera que dans le second scénario, également concis, sont accumulés des mots suggérant l’absence, le manque : perdu, caché, fantôme, sans clé, j’aimais, attachée, bâillonnée.
Il est un autre regard vers l’anglais avec le souvenir des poètes américain John Asbery et anglais Tom Raworth, annoncé dans le premier vers d’un poème par « j’ai deux amours ». Cette allusion transparente à une chanson de Joséphine Baker est peut-être à intégrer dans la pratique d’Alferi qui introduit dans les poèmes, parfois très brefs, quantité d’homophonies, paronomases, allitérations, assonances et allusions, de « cèdre crayon craquant copeau » à patchouli-pâte jolie et au « j’y suis » de Rimbaud. Alferi essaie des formes en prenant son bien partout, y compris avec une forme proche du haïku (dans été passé) ou une mise en page de poèmes chinois. Ce qui reste constant, c’est le choix du vers bref, le plus souvent de 4, 5 et 6 syllabes, vers qui exclut le récit — d’ailleurs un poème s’achève par « l’histoire manque ». L’unité de ces chaos n’est pas que formelle, ce qui domine à la lecture, c’est le rejet du convenu.
- Un exemple dans La Légende des siècles("Le Satyre"), « Au-dessus de l’Olympe éclatant, (...) Plus loin que les chaos, prodigieux décombres ».
2. Pierre Alferi a traduit John Donne (Paradoxe et problèmes, Allia, 2011).
Pierre Alferi, Divers chaos, P. O. L, 2020, 270 p., 18 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 9 mars 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre alferi, chaos, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
15/04/2020
Pierre de Marbeuf, Le Miracle d'amour
Sonnet
Et la mer et l’amour ont l’amer en partage,
Et la mer est amère, et l’amour est amer,
On s’abîme en l’amour aussi bien qu’en la mer ;
Car la mer et l’amour ne sont point sans orage.
Celui qui craint les eaux, qu’il demeure au rivage,
Celui qui craint les maux qu’on souffre pour aimer
Qu’il ne se laisse pas à l’amour enflammer,
Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage.
La mère de l’amour eut la mer pour berceau,
Le feu sort de l’amour, sa mère sort de l’eau,
Mas l’eau contre ce feu ne peut fournir des armes.
Si l’on pouvait éteindre un brasier amoureux,
Ton amour qui me brûle est si fort douloureux,
Que j’eusse éteint son feu de la mer de mes larmes.
Pierre de Marbeuf, Le Miracle d’amour, Obsidiane,
1983, p. 130.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre de marbeuf, le miracle d’amour, amertume, naufrage, brasier | ![]() Facebook |
Facebook |
14/04/2020
Louise Labé, Œuvres, Sonnets

Sonnet VII
On voit mourir toute chose animée,
Lors que du corps l'âme futile part :
Je suis le corps, toi la meilleure part ;
Ou es tu donc, dame vie aimée ?
Ne délaissez pas si longtemps pamée
Pour me sauver après viendrais trop tard,
Las, ne mets point ton corps en ce hazard ;
Rens lui sa part & moitié estimée.
Mais fais, Ami, que ne sois dangereuse
Cette rencontre & revue amoureuse,
L'accompagnant, non de severite,
Non de rigueur : mais de grâce amiable,
Qui doucement me rende sa beauté,
Jadis cruelle, a present favorable.
Louise Labé, Œuvres, Slatkine, 1981, p. 114.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louise labé, Œuvres, sonnet, âme, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
13/04/2020
Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène
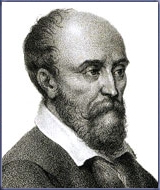
Bonjour, ma douce vie, autant remply de joye,
Que triste je vous dis au departir adieu :
En vostre bonne grace, hé, dites moy quel lieu
Tient mon cœur, que captif devers vous je r’envoye ?
Ou bien si la longueur du temps & de la voye
Et l’absence des lieux ont amorty le feu
Qui commençoit en vous à se monstrer un peu :
Au moins, s’il n’est ainsi, trompé je le pensoye.
Par espreuve je sens que les amoureux traits
Blessent plus fort de loing qu’à l’heure qu’ils sont pres,
Et que l’absence engendre au double le servage.
Je suis content de vivre en l’estat où je suis,
De passer plus avant je ne dois ny ne puis :
Je deviendrois tout fol, où je veux estre sage.
Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène, dans Les
Amours, Garnier, 1963, p. 429.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre de ronsard, sonnets pour hélène, adieu, temps, épreuve | ![]() Facebook |
Facebook |
12/04/2020
Philippe Desportes, Contre une nuit trop claire

Quand quelquefois je pense au vol de cette vie,
Et que nos plus beaux jours plus vitement s’en vont,
Comme neige au soleil mes esprits se défont,
Et de mon cœur troublé toute joie est ravie.
Ô désirs qi teniez ma jeunesse asservie,
Semant devant le temps des rides sur mon front,
Ma nef par vos fureurs ne sera mise à fond ;
Je vois la rive proche où le Ciel me convie.
Mais pourquoi, las ! plus tôt ne me suis-je avisé
Que le bien de ce monde et l’honneur plus prisé
N’est qu’un songe, un fantôme, une ombre, un vain nuage ?
Telle erreur si longtemps ne m’eût pas arrêté,
Comme une second Narcisse, amoureux de l’ombrage,
Au lieu du bien parfait et de la vérité.
(Œuvres chrétiennes, Sonnets spirituels)
Philippe Desportes, Contre une nuit trop claire, Orphée/La Différence,
1989, p. 97.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe desportes, contre une nuit trop claire, vanité, honneur, vérité | ![]() Facebook |
Facebook |
11/04/2020
Jean de Sponde, Les Amours

XI
Tous mes propos jadis ne vous faisoient instance
Que de l’ardent amour dont j’estois embrazé :
Mais depuis que vostre œil sur moy s’est appaisé
Je ne vous puis parler rien que de ma constance.
L’Amour mesme de qui j’esprouve l’assistance,
Qui sçait combien l’esprit de l’homme est fort aisé
D’aller aux changements, se tient comme abusé
Voyant qu’en vous aimant j’aime sans repentance.
Il s’en remonstre assez qui bruslent vivement,
Mais la fin de leur feu, qui va se consommant,
N’est qu’un brin de fumée et qu’un morceau de cendre.
Je laisse ces amans croupir en leurs humeurs
Et me tient pour content, s’il vous plaist de comprendre
Que mon feu ne sçaurait mourir si je meurs.
Jean de Sponde, Les Amours, dans Œuvres littéraires,
Droz, 1978, p. 59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Tardieu Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean de sponde, les amours, constance, feu, ardeur | ![]() Facebook |
Facebook |
10/04/2020
Pierre Silvain, Le Jardin des retours

Tout commence donc par un contretemps. Un train passait et je suivais sa progression ralentie, entre les touffes de tamaris qui bordaient la voie ferrée, à l’approche de la petite gare. Le sifflement de la locomotive m’avait alerté. Je levais la tête au-dessus du papier, mais la diversion que je partageais avec les autres élèves ne me distrayait pas de mon désir contrarié par le silence d’une carte de géographie et la disparition dans les sables du fleuve reptilien sorti de la zone brun clair figurant, avant de se dégrader en tons plus clairs jusqu’au jaune pâle du désert, la haute montagne. Le retard a été une des obsessions de mon enfance, le retard des choses de ce monde à répondre à mon appel. Si exigeant et angoissé qu’il a pu être — qu’il demeure. Contrastant avec la lenteur, l’hébétude proche de l’engourdissement que le climat entretenait dans les corps et les têtes.
Pierre Silvain, Le Jardin des retours, Verdier, 2002, p. 32.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre silvain, le jardin des retours, géographie, retard, obsession | ![]() Facebook |
Facebook |
09/04/2020
la revue de belles-lettres, 2019, 2 : recension

La revue de belles-lettres, plus que centenaire — 143ème année ! —, surprend toujours le lecteur, à la fois au plus près de la poésie d’aujourd’hui et ouverte à des zones peu explorées. Cette livraison propose cette fois un dossier de plus de cent pages autour de la poésie russe d’aujourd’hui, "Polyphonie russe", qui rassemble des poètes tous inconnus en France. Mais la revue donne aussi sa place à une poétesse russe de la génération précédente, Elena Schwarz et, comme chaque fois, à des voix de langue française.
Le numéro s’ouvre avec Pierre Voélin et ses Douze poèmes trop courts, plus deux ; poèmes de quatre ou cinq vers inégaux, le dernier plus court, modestie des motifs et simplicité du vocabulaire : les oiseaux du jour et de la nuit, les arbres, les plantes, le bord des chemins et la figure ancienne du cantonnier qui les entretient, la poule, et
La courtilière sur le sentier,
la huppe dans les vignes,
où je passe — là
est mon chemin.
On lira aussi Sylviane Dupuis ("Muta eloquentia"), Jacques Roman ("Qui instruira le livre du calme") et quatre poèmes de Muriel Pic, extraits d’un ensemble à paraître. Autour de la mer Égée, les corps des migrants sur les plages, « La nuit, les noyés s’y baladent / en traînant des pieds » ; les îles ne sont pas que des paradis pour touristes. « Tu voulais toucher le soleil ? / D’autres veulent toucher la terre. ». Le dernier poème est un hommage, en particulier par son dépouillement, au poète américain Robert Lax (1915-2000) qui passa plus de trente ans de sa vie sur l’île de Patmos avant de revenir dans son village natal en 2000.
C’est avec un court récit de Bruno Pellegrino, "L’appartement", que se clôt le numéro. Le narrateur rapporte un travail qu’il a accepté lorsqu’il était étudiant : à la mort d’une écrivaine, il a été chargé de « classer les papiers et établir l’inventaire de ce qui deviendrait un fonds d’archives ». Il a passé de longues semaines à vider des cartons et à entrer dans l’intimité de la disparue mais, en même temps, sa vie « se poursuivait à l’extérieur de l’appartement » et, par ailleurs, c’est au cours de cet été qu’il corrige les épreuves de son premier livre.
Hélène Henry présente la poétesse russe Elena Schwarz (1948-2010) et propose huit poèmes datés de 1988 à 2007, un long poème écrit à la suite de l’incendie de son appartement en 2004, quelques pages en prose dont Trois caractéristiques de ma poésie où elle dit construire « un petit modèle du monde », inventer des thèmes nouveaux (« Les amoureux aux funérailles »), être attachée, comme Ovide, aux métamorphoses. Très tôt « créatrice de l’ombre », « son refus des compromis, son travail poétique nocturne et obstiné, l’inscrivent naturellement dans la dissidence littéraire ». Rappelons que Joseph Brodsky après son procès en 1964 est contraint à l’exil, et ce n’est qu’après 1981que l’étau officiel se desserre : Elena Schwarz peut alors lire ses poèmes et les éditer ; surtout, elle voyage à l’étranger, notamment en Italie, « son pays d’élection ». Les pages d’Hélène Henry sur les contenus et la métrique, font regretter l’absence de traduction de l’œuvre en français, seuls 31 poèmes (1948-2010) ont été publiés en français (La Vierge chevauchant Venise et moi sur son épaule (traduction H. Henry, éditions Alidades, 2004). Le poème d’Elena Schwarz est « à la fois discours à la première personne, négligent, accidenté, bariolé, lexicalement cahotant, et ces confuses paroles que laissait échapper la pythie delphique dans ses moments d’"enthousiasme" ». Un exemple autour de « l’infini de la mémoire » :
Quand je regarde au fond du gouffre de ma vie —
J’y trouve tout un tas de choses
On dirait à mes pieds un entonnoir béant —
Ce qui fut autrefois, ce qui nous arriva,
Et m’arriva à moi et ne reviendra pas.
(...)
L’ivresse, dira-t-on, de lire Khlebnikov,
Le vieux 6x6 de ma jeunesse, et le souhait
De souffrir pour tous, pour tous et plus que tous,
Et cette écolière qui s’appelait Vovk Kourelekh,
Ce passé si pareil à un dépotoir
Il gronde, il griffe, et je suis sans regret.
Le dossier autour de la nouvelle poésie russe est présenté par le poète russe Alexander Markin (qui vit en Suisse) et rassemble neuf poètes nés après la dernière guerre, surtout à la fin des années 1970 ou après 1980. Leurs poèmes prouvent que, malgré le peu de souci du pouvoir de promouvoir une culture vivante, il y a aujourd’hui un « extraordinaire épanouissement » de la poésie, comparable à ce qui s’est passé au début du XXe siècle, avec « expérimentation formelle, thématiques inédites ». Ces nouvelles générations de poètes sont nées dans la foulée de la littérature clandestine d’avant la chute de l’URSS — la littérature libre dans un pays sans liberté diffusée sous forme de polycopiés (les samizdats). Elles ont aussi découvert la poésie européenne et américaine du XXe siècle, ce qui a facilité la rupture avec les formes traditionnelles de la poésie russe. Les poètes retenus ici, parmi d’autres possibles, « thématisent l’expérience traumatique des catastrophes historiques du XXe siècle, les guerres, les répressions, l’effondrement d’un pays immense ».
Plusieurs ensembles de poèmes (tous en bilingue, sauf un) sont suivis d’un entretien avec le traducteur ou de ses réflexions (Yvan Mignot, traducteur par ailleurs de Daniil Harms, les donne sous la forme d’un poème), à propos de ce qui est nouveau par rapport à la poésie russe connue. L’un des poètes, Alexander Averbukh, commente lui-même son travail ; évoquant ici la vie en URSS en 1932, il a écrit à partir de documents et de récits, pour « absorber une diversité de voix ». Cet exilé a tenté d’écrire une « sorte de requiem » et cherché, en s’appuyant sur des témoignages, à faire que toutes les paroles oubliées, enfouies « continu[ent] à résonner (...) avec les incorrections, les dialectes, les accents ». De nationalité israélienne et vivant au Canada, il sait ce que signifie « l’absence de langue ».
Beaucoup de poèmes tournent autour du motif de la mémoire ; Lida Ioussoupova, par exemple, écrit ce qu’a été une enfance sous le régime soviétique, les scènes évoquées glissant progressivement dans le fantastique. La méditation sur le temps d’une autre poétesse, Maria Stepanova, prend un autre chemin : comme l’analyse sa traductrice, il s’agit pour elle de refonder « la mémoire du corps féminin, absent des grands récits », et elle puise dans les mythologies, les littératures, l’histoire. Un passé plus proche de nous, celui des guerres de Tchétchénie et d’Afghanistan, est évoqué par Elena Falaïnova à partir, comme elle le rapporte, de ce qu’elle a entendu raconter par un ancien soldat ; à la lire, on regrette que seul un poème ait été traduit, dont voici la première strophe :
...Les voici repartis sur leur Afghanistan,
Grosny aux grosses roses noires épanouies,
Quand sur la place, ils se sont mis en rang
En carré pour être réduits en bouillie.
Quand a eu lieu le jour de fête du serment
Elle est venue pour se donner à lui,
Elle était la nouvelle Iseut de son Tristan
(Attention, attention, tous à l’écoute !)
[...]
Il faudrait citer d’autres poèmes de cet ensemble foisonnant qui, en effet, rappelle la richesse des années 1920 en URSS, quand le stalinisme n’avait pas encore détruit toute créativité.
La revue de belles-lettres, « polyphonie russe », 2019, 2, 216 p., 30 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 3 mars 2020.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la revue de belles-lettres, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
08/04/2020
Bashô, Le Faucon impatient

Un éclair soudain
dans les ténèbres s’en va
le cri du héron
Champignons des pins
des feuilles d’arbres inconnus
sont restées collées
Automne s’en va
quand elle a ouvert le main
bogue de châtaigne
Dans sa robe de plumes
emmitouflées bien au chaud
pattes du canard
Ah le feu de braise
du visiteur sur le mur
l’ombre se profile
Bashô, Le Faucon impatient, traduction
René Sieffert, POF, 1994, p. 203, 207,
215, 241, 245.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bashô | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bashô, le faucon impatient, héron, automne, feu | ![]() Facebook |
Facebook |
07/04/2020
Images de Saint-Savin-sur-Gartempe
Photos Chantal Tanet
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : images de saint-savin-sur-gartempe, art roman | ![]() Facebook |
Facebook |
06/04/2020
Pïerre de Ronsard, Folastries

Folastrie III
Et cependant que la jeunesse,
D’une tremoussante souplesse,
Et de maniments fretillars
Agitait les rougnons paillars
De Catin à gauche et à destre ;
Moine, chanoine ou cordelier,
N’a refusé son hatelier (= ratelier].
Car le mestier de l’un sus l’autre
Où l’un dessus l’autre se veautre,
Luy plaisoit tant qu’en remuant,
En haletant, et en suant,
Tel bouc sortoit de ses aisselles,
Et tel parfum de ses mamelles,
Qu’au mont Liban ensafrané
En eust esté bien embrené.
Ceste Catin, en sa jeunesse,
Fut si nayve de simplesse,
Qu’autant le pauvre luy plaisoit
Comme le riche, et ne faisoit
Le soubresaut pour l’avarice,
Mais elle disoit que c’estoit vice
De prendre chaîne ou diamant
Du pauvre ny de riche amant,
Pourveu qu’il servist bien en chambre
Et qu’il n’eust plus d’un pied de membre ;
Autant le beau comme le laid,
Et le maistre que le valet,
Estoient repus de la doucette
A la luitte [= lutte] de la fossette,
Et si bien les resecouoit,
Les repoussoit et remouvoit
De mainte paillarde venue,
Qu’après la fievre continue
Ne falloit point de les saisir
Pour payment d’avoir fait plaisir
A Catin, sans jamais soulée,
De tuer, pour estre foulée,
Et qui de tourdions [= contorsions] a mis
Au tombeau ses plus grands amis.
[...]
Pierre de Ronsard, Livret de folastries, édition
Van Bever, Mercure de France, 1919, p. 60-62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre de ronsard, livret de folastries, catin, satisfaction | ![]() Facebook |
Facebook |
05/04/2020
Paul Claudel, Ægri Somnia

Ægri Somnia
Depuis que je suis malade et ne puis plus bouger de mon lit, attentif entre mes quatre murs au progrès et à la dégradation d’une certaine clarté intérieure et hagarde qui est cette journée pareille aux autres journées, je reçois beaucoup de visiteurs. Le malade est toujours là. Il est comme un triste piquet au milieu d’un fleuve qui attire et recueille toutes les flottaisons du courant. [...]
Paul Claudel, Œuvres en prose, Pléiade /Gallimard, 1965, p. 886.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, Œuvres en prose, maladie, visiteur | ![]() Facebook |
Facebook |
04/04/2020
Étienne Faure, Tête en bas

De la perte il me reste une enveloppe, pelure
de ton amour naguère qui me souriait — que faire,
respirer, humer le désert, se souvenir du
va-et-vient de l’air dans ton corps qui sortait,
rentrait dans la cage, interdit de quitter
le territoire du torse
pendant tout l’hiver quand légèrement blanchi
Paris givrait de l’intérieur au contact de nos souffles,
cette espèce de candeur où tes lèvres
et la chaleur des corps mue en chaleur humaine
m’avaient assigné — maintenant me voici
face aux arbres, nouvelle fenêtre
d’où l’avenir allègrement raté s’aperçoit,
qui exonère de tout devoir de survie
— le ciel n’est pas trop moche par rapport à hier,
si je mourais maintenant ça ne serait
pas bien grave, il est quelle heure ?
Et pense à respirer mon amour.
le pire est expiré
Étienne Faure, Tête en bas, Gallimard, 2018, p. 91.
On peut lire un texte en prose récent d’Étienne Faure sur remue.net :
https://remue.net/silence-on-reve-etienne-faure
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Faure Étienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Étienne faure, tête en bas, la pire est expiré | ![]() Facebook |
Facebook |
03/04/2020
Paul Valéry, Carnets, II
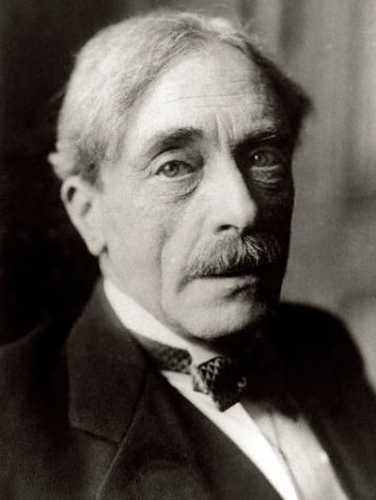
Éros
La passion de l’amour est la plus absurde. C’est une fabrication littéraire et ridicule.
De quoi un antique auteur pouvait-il parler ? après la guerre et les champs _ il tombait dans le vin et l’amour.
Mais si l’on sépare les choses indépendantes — on trouve bien un sentiment singulier devant l’être vivant, devant l’autre — mais ce n’est pas l’amour — quoique cela puisse finir dans certaines expériences de physique.
Paul Valéry, Carnets, II, Pléiade/Gallimard, 1974, p. 396.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, carnets, ii, passion, amour, assurée | ![]() Facebook |
Facebook |
02/04/2020
Giorgio Caproni, La mur de la terre

Moi aussi
Moi aussi j’ai essayé
Ce fut toute une guerre
d’ongles. Mais maintenant je le sais
Nul ne pourra jamais trouer
le mur de la terre.
Giogio Caproni, Le mur de la terre, traduction
Philippe di Meo, Atelier La Feugraie, 2992, p. 85.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giogio caproni, le mur de la terre, essai, échec | ![]() Facebook |
Facebook |










