14/06/2016
Emil Cioran, Syllogismes de l'amertume
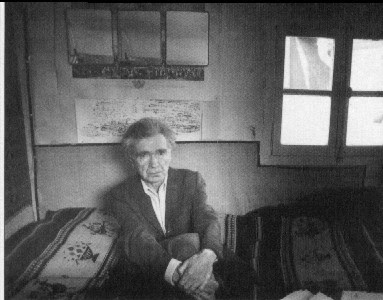
Le public se précipite sur les auteurs dits « humains » ; il sait qu’il n’a rien à en craindre : arrêtés, comme lui, à mi-chemin, ils lui proposeront un arrangement avec l’Impossible, une vision cohérente du Chaos.
Point de salut, sinon dans l’imitation du silence. Mais notre loquacité est prénatale. Race de phraseurs, de spermatozoïdes verbeux, nous sommes chimiquement liés au Mot.
Il est incroyable que la perspective d’avoir un biographe n’ait fait renoncer personne à avoir une vie.
Presque toutes les œuvres sont faites avec des éclairs d’imitation, avec des frissons appris et des extases pillées.
Cette espèce de malaise lorsqu’on essaie d’imaginer la vie quotidienne des grands esprits… Vers deux heures de l’après-midi, que pouvait bien faire Socrate ?
Emil Cioran, Syllogismes de l’amertume, Idées/Gallimard, 1976, p. 19, 21, 23, 25, 30.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cioran, syllogismes de l’amertume, chaos, impossible, silence, malaise | ![]() Facebook |
Facebook |
13/06/2016
E. E. Cummings, No Thanks

à l’amour sois (un peu)
Plus attentif
Qu’à tout
tiens-le seulement peut-être
À peine moins
(étant au-delà d’ô combien)
serré que
Rie, souviens t’en par de fréquentes
Angoisses (imagine
Son moindre jamais avec ta meilleure
mémoire) donne entière à chaque
Toujours en liberté
(Ose jusqu’à une fleur,
comprenant outre mesure le soleil
Ouvre quel millième pourquoi et
découvre le rire)
E. E. Cummings, No Thanks, traduit et
présenté par Jacques Demarcq, NOUS,
2011, p. 68.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Cummings, Edward Estlin | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e.e. cummings, no thanks, jacques demarcq, amour, mémoire | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2016
Laurent Fourcaut, Alcools de Guillaume Apollinaire : recension
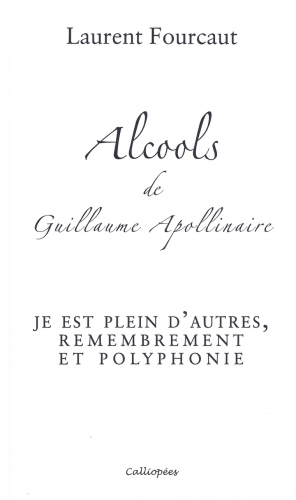
Il est bon aujourd’hui de relire Wilhelm Apollinaris de Kostrowistky, naturalisé français, né en Italie de père inconnu et d’une mère polonaise, elle-même née en Lituanie province russe ; aujourd’hui, c’est-à-dire à un moment où les migrants, plus largement l’ « autre » (Rrom, Syrien, Irakien, Éthiopien— liste qui ne peut se clore), est ‘’invité’’ à repartir chez lui. Cela a à voir avec les années 1900, où le rejet de qui n’était pas français de souche ( ?) existait : Apollinaire eut à en souffrir et ce n’est pas hasard si les exilés ont une grande place dans son œuvre.
Plusieurs pages sont consacrées à rappeler ce qu’était Paris au début du xxe siècle, au moment de la publication d’Alcools en 1913, tant du point littéraire que musical — Du côté de chez Swann sort la même année, comme Le Sacre du Printemps — et pictural : toutes les avant-gardes sont dans la capitale. Il n’est pas non plus indifférent de se souvenir qu’Apollinaire vit au moment où toute une série d’innovations voient le jour : l’automobile, l’avion, le métro, le cinéma…, où l’empire colonial s’étend. À côté de ce contexte large, Laurent Fourcaut appelle que l’œuvre d’Apollinaire se caractérise par sa diversité (poésie, contes, romans, théâtre, chroniques d’art), précise ce qu’a été la formation du poète, détaille la genèse et la composition d’Alcools, commente la versification et l’emploi d’un vocabulaire rare (un lexique est donné en annexe), étudie le rythme fondé sur la marche et le chant, « dans les pulsions mêmes du corps. »
Mais que pouvons-nous donc encore apprendre à propos d’Alcools, recueil qui a suscité de nombreux essais ? Laurent Fourcaut, qui connaît fort bien la poésie contemporaine et anime la revue Place de la Sorbonne, poète lui-même, a lu toutes les études dont il donne une liste commentée. Son but est de lire Alcools à partir d’un fil rouge : sans père, sans nom, sans patrie, sans langue, Apollinaire représente une « espèce de forme pure de l’abandon et du manque », et l’on peut suivre dans son œuvre sa quête d’une identité. Non pas pour recouvrer un ‘’je’’ entier, sans faille : l’unicité n’existe pas et « la poésie [d’Apollinaire] consiste à donner forme — donc mille formes changeantes, mille tons divers, mille sens éclatés — à ce mouvant et polyglotte gisement du moi que Freud au même moment appelle inconscient ». C’est donc un ‘’moi’’ éclaté qui apparaît, et cette dispersion se manifeste par le biais de la multiplication des références : Apollinaire mêle les époques et les lieux, l’histoire et les mythologies, emprunte aux religions et aux littératures. Mais s’il s’empare de l’héritage culturel qu’il a assimilé, c’est pour le secouer, y prendre son bien : l’héritage est une assise, mais aussi ce qui contraint, et même asservit, et dont il faut s’affranchir ; on y apprend des formes nouvelles et la multiplicité des figures que l’on y rencontre permet de forger sa voie / voix.
C’est dire que le ‘’je’’ n’a pas « d’autre réalité […] que celle que lui [confère] le défilement indéfini, sur la page, des mots, des motifs, des images, des formes », et Laurent Fourcaut suggère de lire Alcools comme « un théâtre où le poète met en scène la tragédie […] de son identité problématique, insaisissable, égarée. » Cette lecture, il la propose en s’appuyant sans cesse sur le texte, en analysant les motifs qui se chevauchent dans le recueil, ceux du temps qui passe, de l’ombre — de l’inconstance, du dédoublement —, de la folie, du rêve, de la « bouche-sexe » de la mère, de « la femme impossible », de l’amour enfui, de l’exilé.
Dans un dernier chapitre passionnant, Laurent Fourcaut met en parallèle la vision de la ville dans Alcools, un tableau de Chagall et trois autres perceptions (Rimbaud, Verhaeren, Aragon) ; la ville est objet poétique, image de l’ère nouvelle pour Apollinaire, par excellence pour tous l’espace des métamorphoses, une « métaphore de la poésie ». Ce n’est peut-être pas ce que les lecteurs du xxie siècle lisent dans Apollinaire, plus séduits dans Alcools par la tradition élégiaque — il faut rappeler que ses contemporains étaient très sensibles à la diversité des thèmes et des tons, au caractère baroque de l’œuvre.
Laurent Fourcaut, Alcools de Guillaume Apollinaire, Calliopées, 2015, 144 p., 15, 60 €.
Cette recension a été publiée sur Sitaudis le 19 mai 2016.
Publié dans Apollinaire Guillaume, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, alcools de guillaume apollinaire | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2016
Ana Tot, méca
je suis dupe. Mon regard a beau pivoter à cent quatre-vingt degrés de gauche à droite de bas en haut je suis dupe. Je ne sens pas que je suis dupe. Si je pouvais sentir la duperie dont je suis l’objet je ne serais pas dupe. Je ne sais pas que je suis dupe. Si je pouvais savoir la duperie dont je suis l’objet je ne serais pas dupe. Non seulement j’ignore ce qui me dupe mais j’ignore même si je le suis. Dupe. Je suis dupe. Simplement je suis dupe. Si je pouvais savoir, savoir simplement que je suis dupe sans pour autant évidemment savoir d’où vient la duperie ni ce qu’elle est, il va sans dire, sous peine d’y mettre un terme, et sans pour autant cesser d’être dupe, ah, si seulement ! je pourrais jouir alors d’être dupe. Mais je suis dupe et c’est à peine si une vague et vaine caresse de satisfaction
(m’effleure)
Ana Tot, méca, Le Cadran ligné, 2016, p. 11.
Le Cadran ligné, éditions fondées par Laurent Albarracin :
Le Mayne, 19700, Saint-Clément
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ana tot, méta, dupe, questions, doute, le cadran ligné | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2016
Jean Genet, La Parade
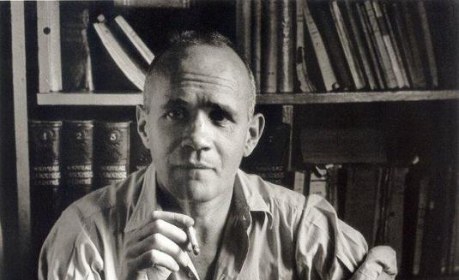
La Parade
Silence, il faut veiller ce soir
Chacun prendre à ses meutes garde,
Et ne s’allonger ni s’asseoir
De la mort la noire cocarde
Piquer son cœur et l'en fleurir
D’un baiser que le sang colore,
Il faut veiller se retenir
Aux cordages clairs de l’aurore.
Enfant charmant haut est la tour
Où d’un pied de neige tu montes.
Dans la ronce de tes atours
Penchant les roses de la honte.
On chante dans la cour de l’Est
Le silence éveille les hommes.
Silence coupé d’ombre et c’est
De fiers enculés que nous sommes.
Silence encor il faut veiller
Le Bourreau ignore la fête
Quand le ciel sur ton oreiller
Par les cheveux prendra ta tête.
Jean Genet, La Parade, dans Le condamné
à mort, L’enfant criminel, L’Arbalète,
1966, p. 69-70.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean genet, la parade, silence, veille, rose, bourreau | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2016
Claude Dourguin, Points de feu
Mars sur sa fin : l’orge est sorti de terre, la grande parcelle a changé de couleur imperceptiblement (je l’ai sous les yeux, au sens propre puisqu’elle s’étend à quelques mètres en contrebas, chaque jour), brun roux puis strié à peine, irrégulièrement selon le sol, de vert pâle, puis quadrillé de franches bandes vertes. Les tiges ont à peine quelques centimètres mais cela suffit : désormais chaque matin une bande de chevreuils — deux adultes et trois jeunes — prennent leur petit déjeuner en même temps que moi. Souvent ils renouvellent l’opération le soir, tôt vers six heures, six heures et demie. Ils broutent en tranquillité, nonchalants comme s’ils savouraient les jeunes pousses succulentes, tendres à coup sûr, et, sans doute, le font-ils — quelle raison de les croire dénués de goût ?
Claude Dourguin, Points de feu, Corti, 2016, p. 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : printemps, claude dourguin, points de feu, orge, chevreuil, goût | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2016
Bashô, Seigneur ermite

Espérant le chant du coucou,
j’entends les cris
du marchand de légumes verts
L’automne est venu —
sur l’oreiller
le vent me salue
Sous une couverture de gelée,
un enfant abandonné
sur un matelas de vent
Ah ! le printemps, le printemps,
que le printemps est grand !
et ainsi de suite
Les pierres semblent fanées
et même l’eau s’est tarie —
l’hiver à son comble
Bashô, Seigneur ermite, édition bilingue
par Makoto Kemmoku et Dominique
Chipot, La Table ronde, 2012, p. 64,
66, 69, 77, 82.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : basha, seigneur ermite, saisons, printemps, hiver, automne, vent | ![]() Facebook |
Facebook |
07/06/2016
Henri Thomas, Nul désordre

L’interrogé
— Où, tes poèmes futurs ?
— Derrière le mur.
— Où le vois-tu ce rempart ?
— Partout. Nulle part.
— Et toi-même, où donc tu perches ?
— C’est ce que je cherche.
Henri Thomas, Nul désordre, dans
Poésies, Poésie/Gallimard, 1970, p. 208.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri thomas, nul désordre, question, absence | ![]() Facebook |
Facebook |
06/06/2016
Ghérasim Luca La Paupière philosophale : recension
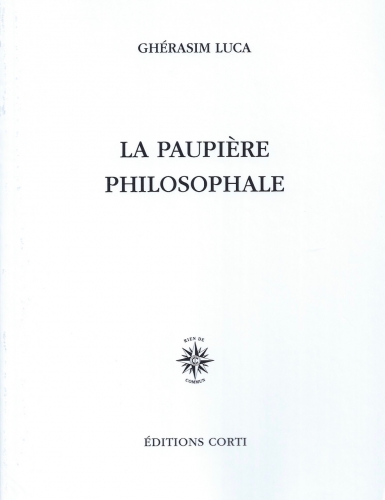
Un numéro de la revue Europe consacré en grande partie à Ghérasim Luca paraît en même temps que La paupière philosophale : c’est une somme sur ce poète trop méconnu et nous y reviendrons. La prière d’insérer précise que le recueil de courts poèmes publié par les éditions Corti a été écrit en 1947, la même année que Passionnément, qu’il faut relire — mais peut-on se passer de relire Le chant de la carpe, La proie s’ombre, ou d’écouter Ghérasim Luca dire Comment s’en sortir sans sortir ? Pour l’instant, nous découvrons comment l’on peut écrire à propos de pierres précieuses.
Le livre est partagé en 10 courts ensembles, le premier non pas sur une paupière — il n’y a que des yeux ouverts sur le monde des mots —, mais amorçant la suite consacrée aux pierres, l’opale, l’onyx, le lapis-lazuli, etc. Ghérasim Luca les décrit à sa façon, en considérant que ce sont des mots : il s’agit de décomposer chaque nom et de composer d’autres mots à partir de là. ‘’Opale’’ contient le son ‘’o’’, qui peut donc prendre la forme écrite ‘’eau’’, ‘‘au’’ ; ‘’pale’’ se décompose en ‘’pal’’, ‘’al(e)’’, ‘’pa’’, ‘’p’’, et l’on peut encore ajouter ‘’op’’. Tous ces éléments phoniques ou graphiques, fragments de ‘’opale’’, sont assemblés de diverses manières de sorte que le lecteur puisse reconnaître (entendre ou lire) ‘’opale’’, ou un des éléments du nom. Ainsi dans le second poème pour cette pierre :
L’eau palpe le poulpe
Mais le hâle le pèle
Après la reprise du mot (« L’eau pal[pe] »), Ghérasim Luca introduit une variation de la suite ‘’al’’, et ‘’pal’’ devient ‘’poul’’, puis ‘’pèl’’ — ‘’poulpe’’ apparu dan le premier poème formé d’une série avec des mots de construction ‘’p + voyelle’’. Ces manipulations aboutissent à de mini récits souvent pleins d’humour et toujours évoquant un univers étrange ; la syntaxe étant respectée, on cherche assez spontanément à savoir « ce que ça veut dire ». Ça veut dire que défaire les mots (prononcés, écrits) et en agencer les éléments dans un autre ordre, aboutit à proposer des associations insoupçonnées.
Prenons la turquoise. Avec un principe de décomposition analogue, le mot offre ‘’tu’’, ‘’tur’’, ‘quoi’’, ‘’qu + voyelle’’, ‘’q’’, ‘’oi’’, donc ‘’oua’’, ‘’oa’’. Tous éléments à partir desquels se bâtit un poème nonsensique :
Sur le turf oiseux d’un tutu / Turlututus et turluttes / Sont disposés en quinconce
Trois-quarts en ouate pour les oiseaux / Trousse-queue en quartz pour les oasis
Le lecteur prendra plaisir à suivre les transformations opérées avec les mots onyx, lapis-lazuli, saphir, chrysophrase, améthyste, rubis et émeraude — ce dernier contient ‘’mer’’, donc ‘’mère’’, et ‘’raude’’, d’où avec changement de consonne ‘’raube’’, et Gérasim Luca écrit alors : « Elle [= l’émeraude] est comme la mère d’une robe ». Il prendra plaisir parce que l’on entre aisément dans cet univers qui, certes, se dérobe au sens, mais s’offre généreusement à l’imaginaire de chacun.
Ghérasim Luca, La Paupière philosophale, Corti, 2016, 80 p. ,14 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 20 mai 2016.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ghérasim luca, la paupière philosophale, jeu de mots, non-sens | ![]() Facebook |
Facebook |
05/06/2016
Max Jacob, Le Laboratoire central

Véritable petit orchestre
(Partie descriptive)
Houlettes du Grésivaudan
Sur le sol glacé des prairies
Les souliers mordorés près des fleuves
Rochers ou les barquettes des bergers
(Partie musicale)
Saint sein ! vive le sein !
Vive le vin divin du Rhin
Où Chio ? ou Ténédo ? louez l’Ohio.
Point ! Point ! Point !
L’auto miaule, pioupiou piaule
Marabout l’allume
L’allume à la lune.
Je vais faire la niche
La niche aux péniches
Point ! Point ! Point !
Bout des coussins des marsouins.
Point ! Point ! Point !
Pape ! papal ! pape alors à l’or.
Point ! Point ! Point !
Élie ! Allah ! Alain !
Tiens ! il neige ! zut.
Le rat pose beaucoup de plumes.
(Partie philosophique)
Unanime j’aime et rode
Nature sous la neige imperturbable
L’habitude du danger rend les hommes prudents
Et le femmes téméraires.
Max Jacob, Le Laboratoire central, dans Œuvres,
édition Antonio Rodriguez, préface Guy Goffette,
Quarto/Gallimard, 2012, p. 606.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Jacob Max | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max jacob, le laboratoire central, petit orchestre, description, philosophie, calembour | ![]() Facebook |
Facebook |
04/06/2016
Georges Bataille, Minibus date lilia plenis, dans L'Expérience intérieure

Qui suis-je
pas « moi » non non
mais le désert la nuit l’immensité
que je suis
qu’est-ce
désert immensité nuit bête
vite néant sans retour
et sans rien avoir su
Mort
réponse
éponge ruisselante de songe
solaire
enfonce-moi
que je ne sache plus
que ces larmes
*
Poèmes
pas courageux
mais douceur
oreille de délice
une voix de brebis hurle
au delà va au delà
torche éteinte
Georges Bataille, Manibus date lilia
plenis, dans L’Expérience intérieure,
Gallimard, 1954, p. 205 et 207.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, manibus date lilia plenis, dans l’expérience intérieure, identité | ![]() Facebook |
Facebook |
03/06/2016
Étienne de la Boétie, Sonnet XXII, dans Œuvres complètes

Quand tes yeux conquerans estonné je regarde,
J’y veois dedans à clair tout mon espoir escript ;
J’y veois dedans Amour luy mesme qui me rit,
Et m’y mostre, mignard, le bon heur qu’il me garde.
Mais, quand de te parler par fois je me hazarde,
C’ets lors que mon espoir desseiché se tarit ;
Et d’avouer jamais ton œil, qui me nourrit,
D’un seul mot de faveur, cruelle, tu n’as garde.
Si tes yeux sont pour moy, or voy ce que je dis :
Ce sont ceux là, sans plus, à qui je me rendis.
Mon Dieu, quelle querelle en toi mesme se dresse,
Si ta bouche & tes yeux se veulent desmentir ?
Mieux vaut, mon doux tourment, mieux vaut les despartir,
Et que je prenne au mot de tes yeux la promesse.
Étienne de la Boétie, Sonnet XXII, dans Œuvres complètes d’Estienne de la Boétie, 2 vol., Introduction, bibliographie et notes par Louis Desgraves, William Blake and C°, 1991, II, p. 154.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étienne de la boite, sonnet xxii, amour, description | ![]() Facebook |
Facebook |
02/06/2016
Albert Camus, Carnets III, mars 1953-décembre 1959

Cahier VII, 1953
Nécessité d’une aristocratie. Dans le présent, on ne peut en imaginer que deux : celle de l’intelligence et celle du travail. Mais l’intelligence à elle seule n’est pas une aristocratie. Ni le travail (les exemples, dans les deux cas, sont évidents). L’aristocratie n’est pas d’abord la jouissance de certains droits, mais d’abord l’acceptation de certains devoirs qui, seuls, légitiment les droits. L’aristocratie c’est à la fois s’affirmer et s’effacer. Pour sortir de soi (définition du devoir) l’intelligence ne peut aller vers les privilèges. Les uns font partie d’elle-même, les autres sont le contraire de l’intelligence. Et le devoir ne consiste ni à s’affirmer ni à se supprimer mais à faire servir ce qu’on affirme. Elle ne peut donc aller que vers le travail qui est son devoir et sa limite. Le travail de son côté ne peut aller vers l’abêtissement, inconscient ou conscient (humiliation généralisée de l’intelligence) qui est ou lui-même, ou son contraire (voir plus haut). Il ne peut donc aller que vers l’intelligence… Finalement l’aristocratie du travail et celle de l’intelligence ne sont possibles, dans le présent, que si elles se reconnaissent l’une l’autre, et commencent à marcher l’une vers l’autre pour consacrer un jour une seule image supérieure de l’homme.
La seule source de l’aristocratie c’est le peuple. Entre les deux, il n’y a rien. Ce rien qui est la bourgeoise, depuis 150 ans, essaie de donner une forme au monde et n’obtient qu’un néant, un chaos qui ne se survit encore qu’à cause de ses anciennes racines.
Albert Camus, Carnet III, mars 1953-décembre 1959, Folio / Gallimard, 2013 (1989), p. 122-123, 123.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, carnets iii, aristocratie, intelligence, travail, bourgeoisie, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
01/06/2016
Guennadi Aïgui, Hors-commerce Aïgui

Sommeil : formes de Arp
mais tressaillit
la blancheur du sommeil — d’un mouvement
de forces qui sans nom ni apparence
— mais quelque part croissaient et bruissaient
la pomme le soleil et la colombe
et puis le matin infini
dans le champ sans la-ville-et-la-forêt
brûlait de figures intérieures —
de forces — qui se prolongeaient
dans la lueur du jour
Guennadi Aïgui, Hors-commerce Aïgui, poèmes
traduits par A. Markowicz, Le Nouveau
Commerce, 1993, p. 112.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guennadi aïgui, hors-commerce aïgui, poèmes traduits par a. markowitz, arp, formes | ![]() Facebook |
Facebook |





