14/11/2019
Reinhard Priessnitz, 44 poèmes

Large au séant
Et pourquoi qu’tu trompaytes ?
j. van hoddis
moins de fesses, d’yeux, cerveaux,
ça suffirait. moins de mains.
bien. moins de texte. ôter l’image ;
moins de mots. nuls relais,
rejets, nulle vapeur ! sans pin-pon
écrire encore moins de vagues.
plus de papier, moins de trombones
à cul lisse aussi dégonflé. nul présent !
Reinhard Priessnitz, 44 poèmes, traduction
Alain Jadot, préface Christian Prigent,
NOUS, 2015, p. 147.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reinhard priessnitz, 44 poèmes, large au séant, image, christian prigent | ![]() Facebook |
Facebook |
13/11/2019
Étienne Paulin, Là : recension
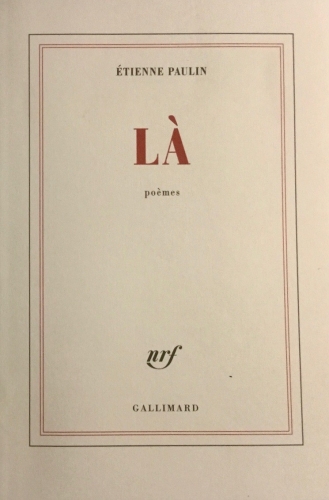
Là compte 43 poèmes en vers libres, dont les 9 derniers, très courts, sont réunis sous le titre "Séquelles" au sens de séries, et s’ajoute un poème en prose. La variété des titres ("Sans réponse", "Roulis", "Allons", "Pesée", "Un carillon", etc.), pour le début, comme la brièveté des textes, laisseraient penser à un regroupement un peu désordonné, mais des motifs récurrents et des constantes dans l’écriture apparaissent vite au lecteur et assurent une forte unité au livre. Ainsi, même la citation de Jean Tortel en épigraphe, « Mais ces noirs graffitis / Sont les restes d’un feu », a un écho dans des vers où la musique « dans le désordre et l’amour absolus /(...) arrive à voir le feu ». Aussi les souvenirs, l’enfance ont-ils une grande place tout comme ce que peut être une poésie qui s’en préoccupe — qu’est le réel ?
Dans le premier poème est évoqué un souvenir qui peut sembler insignifiant, celui de « tommettes / dans les masures », et son peu d’importance est souligné, « nul ne remue / nul ne revoit ce genre / de souvenirs » ; pourtant, plus avant dans le livre, on lit « je me souviens des carrelages ». Ce sont ces riens qui font l’essentiel des vies de chacun, « des riens qu’on a laissés », souvenirs qui surgissent ici de l’enfance. L’irruption du passé dans le présent n’est pas toujours choisie et ce n’est la plupart du temps que sous forme de bribes plus ou moins liées, dans le plus grand désordre, et parfois indistinctes, parfois non nommables précisément, mais qui se sont cependant maintenues un peu hors du temps et d’un lieu, : « enfant il y avait / des lumières et des lumières ».
Ce qui charpente l’ensemble du livre, ce sont toutes les notations à propos des petites choses de la vie, de ce qui échappe la plupart du temps au regard, de ce que l’on oublie parce que sans importance, et qui revient pourtant à la mémoire, et c’est d’ailleurs l’attention de Rimbaud à des moments minuscules que retient Étienne Paulin : il se souvient d’un poème, "Au cabaret Vert", en écrivant « un jour de tartine de beurre / et de plat colorié comme au Cabaret Vert*. Ce qui importe, ce ne sont pas les "grandes" actions ou prétendues telles, mais « les deux v du mot vivre », et vivre c’est accepter de connaître un mélange d’éléments de nature diverse, « des fêlures et des fées », certainement pas la stabilité.
Il y a dans cette poésie un refus de se payer de mots, la vie n’est ni réussie ni un échec : « on essaie on fréquente / on va vers on croit voir », et l’on réagit à ce qui se passe. "Là", c’est devant moi, devant vous, ce qui survient, inattendu : un accident, c’est « là soudain », « là malgré », « c’est là / c’est là que ça », et le passant renversé, la sirène de l’ambulance, c’est ce qui rompt l’ordre des jours, un « accident soudain qui nous rassemble », qui fait craindre pour l’aimée/l’aimé. La vie est composée de désordres à accueillir comme tels, d’émotions venues de l’art, ici de la musique, avec l’écoute de l’avant dernière sonate de Schubert "D 959" (titre d’un poème) : « c’est un frisson immense parmi les choses tristes ». Cependant, ce qui est vécu, et plus encore les souvenirs, sont plus ou moins voués à l’oubli, « on ne peut pas revoir / à moins d’un poème / qui serait pour toi le seul ».
Que reste-t-il des jours si rien n’en est écrit, qui puisse être transmis ? Le poème, « son rêve est de tendre vers toi » : les mots ne sont que « feuilles mortes » s’ils ne sont pas lus, entendus par l’Autre. L’écriture peut être comparée à ce qui se passe quand le carillon de la mercerie se fait entendre, alors « j’entends son timbre / voilà j’arrive » ; il y a cependant une différence : « parfois le chant est là / mais rien pour le savoir ». Et comment fixer quelque chose du chaos qu’est toute vie ? Étienne Paulin écrit « je me souviens des carrelages / et de l’odeur », et ajoute aussitôt « — ah non / déjà j’invente ». La difficulté consiste à restituer quelque chose du vécu, le réel étant fuyant, souvent inatteignable par les mots — sans (trop) d’invention superflue, "L’art du réel" (titre d’un poème) ne pouvant aboutir à écrire « les crocodiles s’embrasseront ». Cette difficulté est abordée dans le poème en prose : « oui, j’ai peur de la phrase, de la pensée, de l’ordre. »
Pour que le chant "tienne", pour reprendre Étienne Paulin, il ne faut pas seulement la récurrence des motifs mais aussi des formes en accord avec ces motifs. Ils sont nombreux dans Là. Le lecteur relèvera au long du livre l’emploi de paronomases (pesée / pensée — les deux mots ayant le même étymon latin —, arrive / arrime) et de mots en écho (pend / pende, fêlures / fées, fragments / sarments, bondir / rebondi), des allitérations (« mille matins du monde / moulés »). Le vocabulaire est d’une grande simplicité et les mots d’usage plus restreint sont d’autant mieux aisément repérés, comme rai de jour, méfaire, ponceau ; on fait la même remarque pour la syntaxe, très régulière, ce qui met en valeur les ellipses, comme dans « deux colibris / ont tout vu // et pépient comme si rien ».
Une voix singulière qui, dans Là comme dans les livres précédents, explore les riens qui font la vie, son déséquilibre et sa plénitude.
* Voir : Rimbaud, "Au cabaret Vert" : « la fille aux tétons énormes [...] Rieuse, m’apporta des tartines de beurre, / Du jambon tiède, dans un plat colorié ».
Étienne Paulin, Là, Gallimard, 72 p., 10, 50 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 18 octobre 2019.
.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
12/11/2019
Pascale Alejandra, L'œil et l'instant
La nécessité sauvage
Comment confier la tristesse ?
Il reste les recoins
Les replis
L’effacement
L’évasion
Les châteaux de l’enfance
S’arracher les yeux
Se modeler monstre
L’Apparition
Ne regarde plus
Le tournoiement
Il n’annonce pas la fin
Ne sois pas triste
Nous ne pourrons jamais nous rencontrer
Pascale Alejandra, L’œil et l’instant, le phare
du cousseix, 2019, p. 5 et 8.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascale alejandra, l’œil et l’instant, nécessité, apparition, tristesse, rencontre | ![]() Facebook |
Facebook |
11/11/2019
Henri Michaux, Façons d'endormi, façons d'éveillé

Les rêves vigiles
Le contraire du rêve qui, n’importe où il vous porte, vous y mène attaché et sans que vous puissiez rien, la rêverie, dispose de liberté. Elle demande à en avoir. Elle en fait sa puissance.
Plutôt de surabondance de liberté, viendra l’embarras.
C’est errer qui convient avec la rêverie, errer d’abord, errer négligemment, approcher, s’éloigner, tâtonner, écarter les clichés de bonheur triomphal qui se présentent, qui sans doute répondent à des désirs et des envies énormes, communes à presque tous les hommes, mais pas spécialement aux vôtres, errer jusqu’à ce que vous rencontriez enfin, petit ou grand ou infime, ce dont vous avez réellement le désir, spectacle, atmosphère et monde qui ne peut se produire sans nonchalance d’abord.
Henri Michaux, Façons d’endormi, façons d’éveillé, dans Œuvres complètes, III, Pléiade/Gallimard, 2004, p. 519.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Michaux Henri | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henri michaux, façons d’endormi, façons d’éveillé, rêve vigile, nonchalance | ![]() Facebook |
Facebook |
10/11/2019
Georges Perec, W ou le Souvenir d'enfance

Un jeudi après-midi du printemps ou de l’été 1944, nous allâmes en promenade dans la forêt, emportant nos goûters, ou plutôt, sans doute, ce que l’on nous avait dit être nos goûters, dans des musettes. Nous arrivâmes dans une clairière, où nous attendait un groupe de maquisards. Nous leur donnâmes nos musettes, Je me souviens que je fus très fier de comprendre que cette rencontre n’était pas du tout le fait du hasard et que la promenade habituelle du jeudi n’avait été cette fois que le prétexte choisi pour aller ravitailler les Résistants. Je crois qu’ils étaient une douzaine : nous, les enfants, devions bien être trente. Pour moi, évidemment, c’étaient des adultes, mais je pense maintenant qu’ils ne devaient pas avoir beaucoup plus de vingt ans. La plupart portaient la barbe. Quelques-uns seulement avaient des armes ; l’un d’eux en particulier portait des grenades qui pendaient à ses bretelles et c’est ce détail qui me frappa le plus. Je sais aujourd’hui que c’était des grenades défensives, que l’on jette pour se protéger en se repliant et dont l’enveloppe d’acier galoché explose en centaines de fragments meurtriers, et non des grenades offensives que l’on jette devant soi avant d’aller à l’assaut et qui font plus de peur et de bruit que de mal.
Georges Perec, W ou le Souvenir d’enfance, dans Œuvres, I, Pléiade/Gallimard, 2017, p. 741.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges perec, w ou le souvenir d'enfance, goûter, maquisard, résistant | ![]() Facebook |
Facebook |
09/11/2019
Maurice Blanchot, Le pas au-delà

Seul à nouveau, offert au multiple, dans la pluralité de l’angoisse, au-dehors de lui-même, faisant signe sans appel, l’un dissuadé pour l’autre. La solitude, c’est évidemment l’espace sans lieu, lorsque présence se nomme non-présence, où rien n’est un — défi sans défiance à l’unique. La solitude me cache à la solitude, parfois.
Seul à nouveau, défi à l’unique, l’un perdu pour l’autre.
Maurice Blanchot, Le pas au-delà, Gallimard, 1973, p. 94.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice blanchot, le pas au-delà, solitude, espace | ![]() Facebook |
Facebook |
08/11/2019
James Joyce, Poèmes

Bahnofstrasse
Les yeux qui rient de moi signalisent la rue
Où je m’engage seul à l’approche du soir,
Cette rue grise dont les signaux violets
Sont l’étoile du rendez-vous et de l’adieu.
O astre du péché ! Astre de la souffrance !
Elle ne revient pas, la jeunesse au cœur fou
Et l’âge n’est pas là qui verrait d’un cœur simple
Ces deux signaux railleurs cligner à mon passage.
James Joyce, Poèmes, traduction Jacques Borel,
Gallimard, 1967, p. 113.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Joyce James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james joyce, poèmes, jacques borel, adieu, jeunesse, âge | ![]() Facebook |
Facebook |
07/11/2019
Claude Dourguin, Paysages avec figure

(Naples)
Le passant se faufile entre des façades hautes noircies par les années, percements irréguliers, entablements brisés, étages dissemblables indemnes de toute fureur réhabilisatrice ; des porches vastes introduisent à des vestibules superbes à colonnes, les marches déboîtées d’une église servent à l’étalage d’une quincaillerie d’occasion, des arrière-cours où s’entasse un capharnaüm hétéroclite d’ustensiles, de vieilles motos et de plantes, livrent leurs loggias d’altitude à la gaieté des lessives ; des palais s’accoudent à la vie populaire, leurs façades aux larges fenêtres à frontons posent, noblesse oblige, leur belle architecture à peine visible en l’absence de recul. La rue affirme la plus vivante des royautés — on y fait son marché, on y discute, travaille, conclut toutes sortes d’ententes, d’échanges, on y vent et y achète à peu près tout, on peut venir à y dormir, on y joue, on s’y affronte parfois ; on s’y repose, à terre, accroupi contre un mur à deux pas du chantier pour manger sa pizza pliée a libretto sans rien manquer du spectacle.
Claude Dourguin, Paysages avec figure, éditions Conférence, 2019, p. 134.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude dourguin, paysages avec figure, naples, rue, diversité | ![]() Facebook |
Facebook |
06/11/2019
La revue de belles-lettres : recension
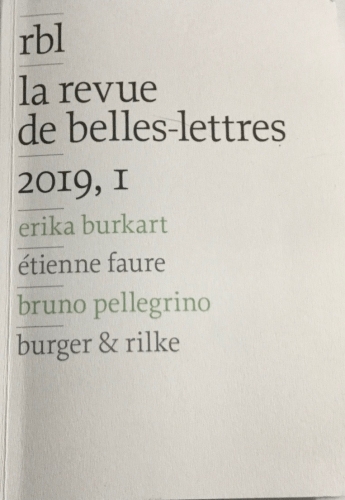
Le lecteur de cette livraison ne se plaindra pas de l’abondance des traductions de l’allemand : la connaissance des poètes de langue allemande reste faible en France, limitée à quelques noms pour la plupart des lecteurs*. Erika Burkart (1922-2010), poétesse alémanique dont quelques poèmes ouvrent le numéro, a été traduite, mais en Suisse (Minute de silence, 1991, Mouvement lent, 2005). Ici sont donnés, traduits par Marion Graf, des poèmes des jours et des saisons, de l’écoute de l’autre, du regard attentif dans la nature, « Dans les chemins où verdit aujourd’hui la semence d’hiver, / je vois, je vais / par des sentiers creusés sous la terre, / je suis les nuages, je me souviens des pierres, / je perds des mots, je trouve un mot. » Konrad Bayer (1932-1964), membre du Wiener Gruppe, n’est malheureusement pas encore disponible en français — il l’est en anglais ; Lucie Taieb donne à lire quatre proses, chaque fois récit d’une étrange vie en raccourci. Catherine Fagnot a traduit récemment — Délai de grâce, 2018 — des histoires brèves d’Adelheid Duvanel (1936-1966) qui, comme ici, présentent des personnages pas du tout adaptés au chaos du monde. On lira aussi Martin Bieri (né en 1977 ; traduction Marina Skolova) et ses poèmes autour des nuages, ceux des peintres, ceux des photographes, les « nuages de guerre » à Berlin où vivait Schönberg, les nuages de toute l’industrie, ceux sur la scène du théâtre créés par les machinistes — et autour de la transformation rêvée du "je", personnage devenu « trace » et circulant partout mais, dit-il, « jamais je ne me vis / ainsi : en nuage ».
Rut Plouda (née en 1948) écrit dans une langue minoritaire, le vallader, langue romanche parlée dans le canton des Grisons. Traduits par Walter Rosselli, ses poèmes explorent des couleurs, comme celle des coquelicots, « mots rouges, offerts plus tard dans une enveloppe orange, des mots qui s’en vont avec le vent, s’en vont, restent suspendus, disparaissent ». À ce qui est vu dans la nature s’ajoutent dans la revue ce qui est regardé avec des poèmes d’Étienne Faure (né en 1960) autour de quelques tableaux et gravures, d’oies qui migrent, d’oies qui reviennent un jour ensoleillé où l’on pique-nique au Père-Lachaise avec les fleurs printanières, autour aussi d’un concert où l’on observe « le corps enserrant / le bois qui résonne en chair et en os », où l’on entend « dans le brouhaha des chaises / la foule [qui] applaudit debout les musiciens mutiques / qui saluent ». Les cinq poèmes de Cécile A. Holdban (née en 1974) restent dans le domaine musical, écrits à l’écoute de deux des cinq Metamorphosis de Philip Glass, de son concerto pour violon et d’autres pièces ; quelque chose de la musique minimaliste est retrouvé avec l’usage de l’anaphore (« Le silence existe, pas en ce monde, pas en ce monde, / même les fourmis crient dans leurs galeries de tourbe, / même les fougères, / même les océans (...) ») et la recherche d’unités rythmiques de base : « glissement du gris / temps ensablé / baiser sans trace / boue séchée / logique élémentaire / de l’amas ».
Toujours dans cette première partie de la revue, on découvre dans un court texte d’Avril Bénard quelques aspects de la vie d’un Touareg qui, brusquement, est « en haut de la colline et puis d’un coup plus rien. Son absence l’a remplacé, c’est comme s’il n’avait jamais existé ». Et Trieste ? Tout a changé et il reste de Joyce une statue, de Saba le souvenir vif de qui voulait « être un homme parmi les hommes ». mais la présence toujours de Duino « sur ce rocher face à la mer » et les vers de Rilke. Pierre-Alain Tâche comprend qu’on peut y rester « sans avoir pour autant appris ou deviné / (...) ce qui se trame sous [s]on nom ».
Rilke occupe une autre partie de la revue par le biais d’une nouvelle, "L’édition cuir", de l’écrivain allemand Hermann Burger (1942-1989), qui met en scène la rencontre d’un jeune étudiant et d’une femme d’âge mûr dans le val Bregaglia, à Soglio, c’est-à-dire dans un lieu où Rilke a séjourné. La conversation d’Eduard n’est nourrie que de l’œuvre du poète et il ne voit en Rita, qui l’écoute, qu’une femme un peu âgée ; quand il la découvre autrement, elle refuse ses avances. Quatre brèves études mettent en évidence la forte relation à Rilke, l’ironie et la cruauté de la nouvelle (Isabelle Baladine Howald), sa construction basée sur « l’opposition du dedans et du dehors, du visible, des formes, et de ce qui échappe à la saisie. » (Alexander Markin) Le lecteur quitte Rilke pour une nouvelle de Bruno Pellegrino à propos de la « hantise de perdre » d’un enfant et, pour cette raison, de la nécessité de conserver le moins possible d’objets, de faire l’inventaire de ses possessions et de jeter... Le poète Pierre Chappuis propose à la lecture un livre de poèmes de José-Flore Tappy dont on connaît ses traductions d’Anna Akhmatova, trop peu l’œuvre poétique.
Chaque année, dans ses deux livraisons, La revue de belles-lettres , outre un éclairage sur un écrivain ou ce qu’il a inspiré — ici, Rilke —, donne notamment à lire des traductions d’écrivains très peu connus ou ignorés en français, fenêtre ouverte nécessaire.
La revue de belles-lettres, Société de Belles-Lettres, Lausanne, 2019, 174 p., 30 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 9 octobre 2019.
* Une anthologie bilingue comprend 29 poètes d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse, préparée par Kurt Drawert, La poésie allemande contemporaine, les années 90, Seghers-Goethe Institut, 2001.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la revue de belles-lettres, littérature allemande, Étienne faure, cécile a. holdban, rilke | ![]() Facebook |
Facebook |
05/11/2019
Eugène Savitzkaya, Saperlotte ! Jérôme Bosch

Je suis la plume qui cherche sa place et le pinceau fouillant l’humide obscurité de la couleur. Je bouge par déclics nerveux, je me meus par secousses afin de me débarrasser des peaux mortes et de diverses squames ancestrales. J’ai appris à m’ébrouer segment par segment comme un chien ou une fouine et quand je m’ébroue, je fais lâcher prise aux divers crabes accrochés à la racine de mes poils et me détruisant le dos à coups de rostre et de mandibules. Troué en mille points, peut-être déjà désossé, je peux qu’’avancer par secousses et par bonds. Et me voilà projeté vers l’image inconnue à travers un ciel bleu et gris comme une bonne cendre de bois variés et, à toute force, jusqu’à extinction, je tente de recomposer l’animal bicéphale et je jette mes deux jambes et mes deux bras dans un grand moulin d’huile fine où je perds mon nombril, où je confonds mes yeux avec ceux d’un chat, où je disparais avec mes outils et mes biens.
Eugène Savitzkaya, Saperlotte !, Jérôme Bosch, Flohic, 1997, p. 55 et 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Savitzkaya Eugène | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugène savitzkaya, saperlotte !, jérôme bosch, métamorphose, crabe, fantastique | ![]() Facebook |
Facebook |
04/11/2019
Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle

Les nuits sans celui qu’on aime
Avec celui qu’on n’aime pas , et les grandes étoiles
Au-dessus de la tête en feu et les mains
Qui se tendent vers Celui —
Qui n’est pas — qui ne sera jamais,
Qui ne peut être — et celui qui le doit...
Et l’enfant qui pleure le héros
Et le héros qui pleure l’enfant,
Et les grandes montagnes de pierre
Sur la poitrine de celui qui doit — en bas.
Je sais tout ce qui fut, tout ce qui sera,
Je connais ce mystère sourd-muet
Que dans la langue menteuse et noire
Des humains — on appelle la vie.
Marina Tsvétaïéva, Le ciel brûle, traduction
Pierre Léon et Ève Malleret, Poésie/Gallimard,
1999, p. 79.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marina tsvétaïéva, le ciel brûle, enfant, héros, vie | ![]() Facebook |
Facebook |
03/11/2019
Thomas Bernhard, Sur la terre comme en enfer
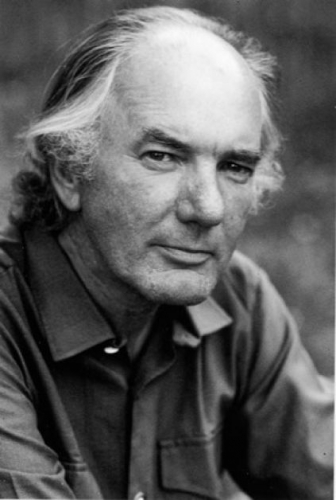
Où me pousse
le vent,
mon cœur,
mon cerveau,
en bas
dans la ville,
là-bas
dans la verdure
des collines délavées,
vers des femmes étrangères
vers
la lune,
mêlant
blanc
et rouge
sur un mur nu
de cimetière,
dans la forêt
qui, noire,
étend les jambes
et dans l’étang
rit,
s’envolent
sauvagement
les oiseaux oubliés
d’un coup,
où
mon vent,
mon cœur,
mon cerveau,
mes larmes ?
Thomas Bernhard, Sur
la terre comme en enfer, traduction
Susanne Hommel, Orphée/La Différence,
2012, p. 93 et 95.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas bernhard, sur la terre comme en enfer, cœur, cerveau, vent | ![]() Facebook |
Facebook |
02/11/2019
Juan Gelman, Vers le sud, précédé de Notes
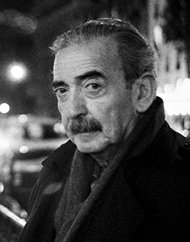
Note XIX
homme / la vie est une chose
misérable / immortelle / ouvreuse
de blessures et douleurs / mais homme véritable /
regarde-la défaire
les tourments comme un bœuf humain
qui labourerait de l’autre côté de l’ombre /
ou qui te m’aimerait la transparence
pour souffrir pareillement
à jorge cedron
Juan Gelman, Vers le sud, précédé de Notes, traduction
de l’espagnol (Argentine) Jacques Ancet, Poésie /
Gallimard, 2014, p. 57.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : juan gelman, vers le sud, précédé de notes, jacques ancet, vie, transparence | ![]() Facebook |
Facebook |
01/11/2019
Jean-Baptiste Chassignet (1571-1635), Le Mespris de la vie et Consolation contre la mort

Nostre vie est semblable à la lampe enfumée,
Aus uns le vent la fait couler soudainement,
Aus autres il l’esteint d’une subit soufflement
Quand elle est seulement à demi allumee,
Aus autres elle luit jusqu’au bout consumée
Mais, en fin, sa clarté cause son bruslement :
Plus longuement elle art, plus se va consumant
Et sa foible lueur ressemble à sa fumee :
Mesme son dernier feu est son dernier cotton
Et sa dernier humeur que le trespas glouton
Par divers intervalle ou tost ou tard consume.
Ainsi naistre et mourir aux hommes ce n’est qu’un
Et le flambeau vital qui tout le monde allume,
Ou plustost ou plus tard, s’eslougne d’un chacun.
Jean-Baptiste Chassignet (1571-1635), Le Mespris
de la vie et Consolation contre la mort, Droz, 1967, p. 61.





