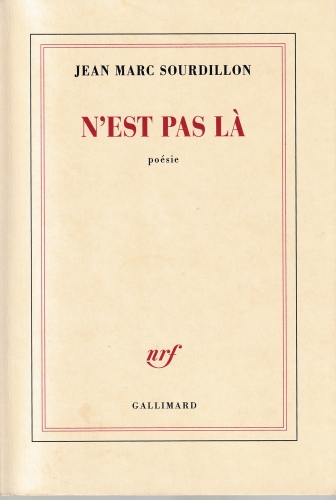17/02/2026
Collectif, Chantal Montellier l'irréductible
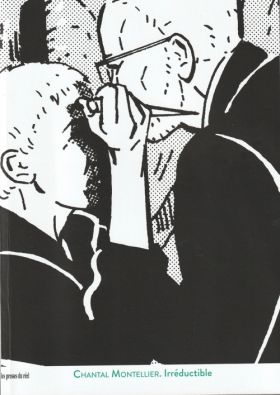
Il n’est pas nécessaire d’être un passionné de bandes dessinées pour connaître au moins un album de Chantal Montellier (née en 1947). Scénariste et dessinatrice, elle est une des rares parmi les artistes (bédéistes ou non, hommes et femmes) à considérer que la société n’est pas un havre paisible. D’où son écriture et son dessin contre l’exclusion sociale, contre l’enfermement asilaire et contre les "fous" qui dirigent le monde, contre le racisme, contre le sexisme, contre Big Brother déjà présent … Une série de dessins de Wonder City (1983) est un bon résumé de sa pratique : sur une affiche, dans un cœur en noir et blanc, les bustes d’un couple bcbg, lui : « we’re in love », elle : « we love Wonder City » ; ce symbole d’un prétendu réel est recouvert d’une affiche jaune dont le texte appelle à une autre société, « Contre la pauvreté / le contrôle abusif / la sélection / le racisme / Grand rassemblement [etc.] ». On comprend que le milieu de la bande dessinée n’ait pas accueilli avec enthousiasme cette personnalité dérangeante — qui plus est une femme ! On se réjouit qu’une exposition de son œuvre ait été organisée à La Villa Arson, à Nice, en 2024 (dont Vanina Géré était une des commissaires) et qu’un livre paru le dernier trimestre de 2025 lui rende un juste hommage.
Ce qui caractérise d’abord ce livre autour d’une autrice de bandes dessinées, qui dessine, a écrit la plupart de ses textes, a choisi le noir et blanc bien avant la couleur, c’est l’abondance des œuvres reproduites. Les études sont d’autant plus lisibles que les matériaux commentés sont présents, qu’il suffit de tourner les pages pour retrouver des exemples de ce qui est commenté, les reproductions étant de bonne qualité. En outre, les responsables de l’ouvrage reprennent entièrement une bande dessinée de Chantal Montellier, La Mare rouge, sortie seulement dans une revue du parti communiste, Révolution, en 1984-1985. Travail de commande : il s’agissait d’illustrer le texte du reportage d’un sociologue et, ainsi, de valoriser la vie sociale d’un quartier du Havre, de restituer le quotidien et la vie réelle de ses habitants.
L’engagement politique de Chantal Montellier est une composante essentielle de son activité. Élève à l’école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, elle s’installe ensuite à Paris, met son désir d’être peintre entre parenthèses et entreprend une vie de dessinatrice avec le dessin de presse ; il y aura ses débuts dans la BD avec, en 1974, la collaboration à Charlie, devenu mensuel, puis à Métal hurlant (1975) et aux éditions Les Humanoïdes associés, qui lancent en 1978 Ah ! Nana, majoritairement nourri par des femmes bédéistes — Chantal Montellier s’y trouve dès le premier numéro. Elle y installe notamment le policier peu sympathique Andy Gang (personnage ensuite d’albums) et y évoque la Commune dans Thiers-état *. Plus tard, elle adaptera en bande dessinée non pas Céline mais Jean Genet et Virginia Woolf.
Elle commence son activité au moment où le mouvement féministe se développe en France, en laissant la bande dessinée hors de son champ alors que la représentation de la femme "libérée" sexuellement est dominante et satisfait le voyeurisme masculin — la Barbarella de Jean-Claude Forest (1964 en album) en est le prototype. Chantal Montellier, au travers de récits simples, met en cause le pouvoir patriarcal, le rôle de la psychiatrie comme un des moyens de la domination sociale. Tout concourt à ôter son humanité à l’individu, par exemple en dénudant la femme. Les livres se succèdent avec toujours le même objectif, mettre en évidence la déshumanisation progressive de la société, le développement de la violence et, précisément pour ce qui concerne les femmes, le travail gratuit à la maison, la prostitution, les féminicides, le viol, auquel est consacrée la BD Odile et les crocodiles en 1983.
Les femmes, dans l’espace public, deviennent des proies et les albums des années 60-70 les présentaient le plus souvent comme des "objets sexuels", ce qui satisfaisait les fantasmes masculins. Les violeurs, ici trois fils de bonne famille, représentent l’institution qu’il faudrait détruire pour construire une autre société. À Odile, qui tue le violeur, un personnage, l’écrivain, propose d’inverser les positions : elle deviendrait une mangeuse d’hommes, hypersexualisée ; la solution correspond bien à la vision des dominants qui ne savent penser que la prédation.
On apprend beaucoup dans les nombreuses études et pas seulement à propos de la bande dessinée. Comment sont construits des récits, par exemple, est l’un des objets d’une étude consacrée aux albums qui rapportent les aventures de Julie Bristol ; les réflexions sur les liens entre l’usage du noir et du blanc, du gris et de la couleur selon le but recherché débordent largement le domaine de la bande dessinée.
Il fallait une équipe pour aborder une œuvre qui s’est développée pendant plus d’un demi-siècle et a été diffusée dans une partie du domaine francophone, la Belgique, la Suisse et le Canada. Des chercheurs de ces pays sont présents aux côtés des Français : historiens de l’art, théoriciens et critiques d’art, enseignants aux Beaux-Arts, sémioticiens, romancier responsable d’une collection — et bédéiste. La plupart des questions que l’on peut poser à la lecture d’une œuvre le sont, générales (orientations et évolution de l’ensemble, les transformations du dessin), et spécifiques (analyse d’un album, emploi de la couleur). Les articles de spécialistes pèchent souvent par l’entre-soi, ce n’est pas le cas ici, il y a une volonté claire de faire partager un plaisir de lire. On peut seulement regretter quelques redites d’un article à l’autre et l’absence de données à propos de la réception de l’œuvre, mais la qualité de l’ensemble donne au lecteur qui ignorait les albums de Chantal Montellier l’envie d’en ouvrir un.
* Thiers par allusion au dirigeant Adolphe Thiers qui commanda l’écrasement des Communards dans le sang.
Vanina Géré, Camille Debrabant, Camille de Singly (sous la directon de), , Chantal Montellier l’irréductible, Les Presses du réel, 2025, 378 p., 28 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 23 janver 2026.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
10/02/2026
André Breton, Julien Gracq, Correspondance 1939-1966
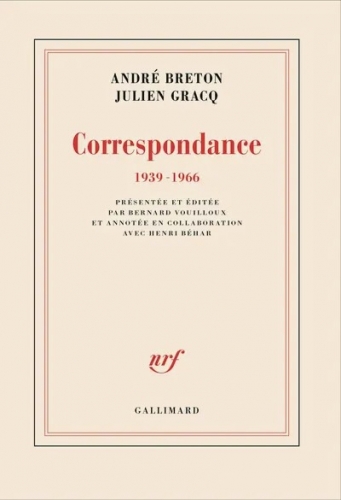
Julien Gracq envoie Au Château d’Argol à André Breton qui s’enthousiasme : il a découvert dans le roman une proximité avec ses recherches, « [votre livre] m’a placé pour la première fois au cœur de mes propres préoccupations, de mes propres désirs ». Message de reconnaissance que Julien Gracq accueille avec émotion, « Votre jugement m’importait, plus que tout autre » et, plus loin, « Votre lettre me donne du courage ». C’est ainsi que commencent, en mai 1939, des échanges nombreux jusqu’à la mobilisation des deux hommes, interrompus de 1941 à mai 1946 par l’exil d’André Breton aux États-Unis, repris jusqu’à sa mort en septembre 1966. La correspondance contient très peu de développements sur la littérature, il s’agit plutôt d’affirmer une communauté d’esprit à partir des activités et préoccupations de chacun ; ce qui apparaît notamment avec le passage de « Monsieur » à « cher ami », « très cher ami », « cher Julien », « très cher Julien » pour l’un, de « Monsieur », à « cher André Breton », pour l’autre une légère distance, qu’explique peut-être l’importance littéraire qu’il accordait à son aîné : il avait commencé à le lire au début des années 1930, avec les Manifeste du surréalisme, Les Pas perdus et Poisson soluble (1924), Nadja (1928).
L’admiration réciproque n’implique pas un accord sur tout et les points de désaccord entre celui considéré comme le "chef" du surréalisme et Julien Gracq, sans être nombreux, auraient pu entraîner une séparation ; André Breton ne s’embarrassait pas de précautions pour exclure de son entourage quiconque s’opposait frontalement aux choix défendus dans les Manifestes du surréalisme. En 1951, quand il est attaqué pour sa manière d’être dans le mouvement, il demande à Julien Gracq son avis : pourquoi, écrit-il, sont « conjurés contre moi des gens avec qui j’ai entretenu de si longs rapports d’amitié. » La longue réponse se veut conciliatrice ; prenant acte des « longs rapports d’amitié », il écarte l’idée de conjuration et insiste sur une « querelle d’amoureux » née d’une différence d’appréciation : l'André Breton des manifestes n’est plus l’André Breton de l’après-guerre. Explications données et refus d’approuver la condamnation, Julien Gracq conclut : « Je souhaite que vous pensiez moins à cette affaire. Peut-être qu’elle ne vaut pas vraiment qu’on s’y arrête très longtemps. (…) Je vous l’avoue, (…) je n’y ai pas pris un intérêt si pressant. » Il se refusera encore à prendre parti pour les surréalistes qui, en novembre 1962, avaient frappé Georges Hugnet dans son appartement au prétexte qu’il avait insulté la mémoire de Benjamin Péret. Il a d’ailleurs écrit plus tard : André Breton avait pris soin d’« écarter entre nous tous les sujets scabreux. »*
André Breton n’ignorait pas la distance de Julien Gracq vis-à-vis du surréalisme (« il ne m’est que très extérieurement et très imparfaitement connu »), cela ne l’a pas empêché de lui faire part, en 1939, d’un projet de revue, de lui assurer qu’il voyait en lui « le collaborateur idéal » et de lui demander son avis détaillé quant au contenu d’une revue du point de vue du lecteur. Les propositions détaillées de Julien Gracq, dans une lettre du 22 août 1939, auraient abouti, si elles avaient été mises en œuvre, à une Nouvelle Revue Française"améliorée". Il la voulait à l’écart de toute « doctrine politique » et donc sans le noyau surréaliste pour la diriger ; de là, l’introduction de collaborateurs sans lien avec les surréalistes. Cet éloignement de l’engagement a pour corollaire le refus de mettre en avant des œuvres violentes qui ont perdu leur sens — celles de Sade, de Lautréamont — au bénéfice d’œuvres contemporaines. Parallèlement, il faut se passer de « poèmes ahurissants qui dégoûtent le public » ; on pense par exemple à l’écriture automatique. Selon Julien Gracq, une revue devrait inclure une critique argumentée des livres nouveaux, destinée à dissocier ce qui est à lire de ce qui est à rejeter. La guerre emporta le projet.
Une revue d’obédience surréaliste créée en juin 1942 aux États-Unis a eu 4 numéros (2-3 en 1943, 4 en 1944) ; dirigée par le peintre David Hare, à ses côtés André Breton, Marcel Duchamp et Max Ernst ; le sens du nom choisi n’aurait pas tout à fait convenu à Julien Gracq, VVV, « La victoire sur les forces de la régression, la vue autour de nous, la vue en nous [...], le mythe dans le processus de formation sous le voile de ce qui se passe. » En France, en 1944, domine selon lui dans les « "milieux littéraire" un vent d’imbécillité » ; les années suivantes, rien ne change, les lieux de publication soumis à la doxa des communistes.
Une introduction développée était nécessaire pour le lecteur d’aujourd’hui, peu au fait des détails de l’histoire littéraire. Les querelles liées au surréalisme, le rôle d’André Breton dans ce mouvement, les conditions difficiles pour être édité dans l’après-guerre, ces faits et bien d’autres sont replacés dans leur contexte. Des notes précises et légères accompagnent les lettres pour la même raison. Les curieux reprendront la lecture de la correspondance à partir de l’index des personnes citées, tous consulteront la table des illustrations, pour Breton et Gracq posant en tenue de ville dans la forêt de Meudon, pour reconnaître écrivains et peintres présents au Café de la place Blanche en 1953, ou pour découvrir Julien Gracq et sa compagne, Nora Mitrani, à Venise en compagnie d’André Pieyre de Mandiargues. Dans la correspondance d’André Breton, déjà riche de plusieurs volumes (Paulhan, Éluard, Péret, Tzara et Picabia, etc.), l’auteur de Nadja ne surprend pas, curieux, enthousiaste et attentif, et l’on apprend beaucoup sur cet écrivain un peu secret qu’était Julien Gracq.
* Julien Gracq, Carnets du grand chemin, Œuvres II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1995, p. 1055.
André Breton, Julien Gracq, Correspondance, 1939-1966, Édition Bernard Vouilloux, collaboration d’Henri Béhar pour les notes, Gallimard, 2025, 240, p.21 €? Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 janvier 2026.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré breton, julien gracq, correspondance | ![]() Facebook |
Facebook |
09/02/2026
L'Ours Blanc, automne 2025
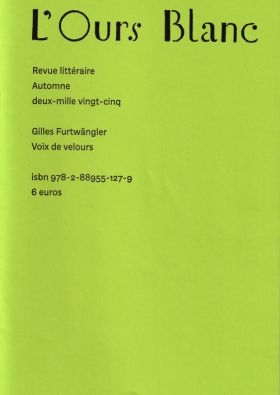
Georges Perec, installé au café de la Marie, place Saint-Sulpice à Paris, relève « ce que l’on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n’a pas d’importance : ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages », ce qui aboutit à Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (1975). Gilles Furtwängler procède de façon analogue, principalement avec des énoncés oraux de nature très diverse, de langue française ou anglaise, et ajoute quelques énoncés écrits. On peut soupçonner des inventions de l’auteur, l’ensemble réunit cependant des énoncés que chacun a pu ou aurait pu entendre ; sans en faire une étude que proposerait un sociologue, le lecteur reconnaîtra quelques traces de comportements qui ne donnent pas une image enthousiasmante de la société contemporaine — parfois, mieux vaut en rire.
Plusieurs groupements recueillent des énoncés très disparates, on sait que ce que l’on écoute dans une journée n’a évidemment aucune cohérence, que l’on se déplace ou non dans plusieurs lieux ; le vide de la plupart des notations hors contexte provoque le rire ou (et) laisse penser que les préoccupations des humains sont d’une grande futilité. Par exemple :
(…) Ma couille*, dans une autre vie, j’étais une bouteille en plastique. Dans la prochaine vie, je ne sais pas, une fausse dent ou un fer à béton. Petits sauts. Graines de tournesol dans la poche. Cheveux coupés sur la place. Dédicace. 6.8 pouces. 6.1 pouces. Ergonomie. Dream big. Dignité, non.
Certains énoncés ne peuvent être interprétés que comme une critique de la société contemporaine où les valeurs classiques sont abandonnées : le travail ne viserait pas à l’utile mais à produire n’importe quoi, le seul but étant de vendre ce n’importe quoi. La langue elle-même se plie aux exigences de la simplification, et il y a une exaltation du « propre », rien ne doit dépasser, se distinguer d’une norme jamais énoncée :
J’aimais que tout soit propre comme nos verrines, notre famille et la rue. Réduire. Actif. Asap [= as soon as possible]. Passif. S’adapter. S’affoler. Win-win [= gagnant-gagnant]. Zéro défaut. Produire du néant pour vendre du néant. Atout plus plus. Future is an attitude.
Une série de questions sans lien entre elles suscite le besoin de construire un texte homogène ; La continuité est absente, mais l’alternance du singulier et du pluriel (il, ils) facilite l’essai de mettre en place un récit, alors même que les phrases ont pu être notées des jours différents — ce qui peut entraîner des réflexions à propos de ce que nécessite un récit.
(…) Est-ce qu’ils avaient l’air jeune ? Est-ce qu’il avait un linge sur la tête ? Est-ce qu’ils ont dit Peace ou au moins merci ? Est-ce qu’ils roulaient lentement ? Est-ce qu’ils ont provoqué tes chiens ? Est-ce qu’il avait l’air d’être sobre ? (etc.)
Une autre série, qui rassemble plutôt des textes écrits, rend compte longuement de ce qui est un inquiétant fait de société, l’assassinat de femmes par leur conjoint ou ex-conjoint ; on sait que le nombre de féminicides ne décroît quasiment pas d’une année à l’autre et il est bon que les relevés de conversations ou d’articles de journaux soient nombreux.
(…) Tuée à coups de barre de fer par son mari. Volontairement percutée par le véhicule conduit par son conjoint. Découverte dans une mare de sang. Décapitée. 22 ans. Frappée à mort à l’aide d’une chaise par son compagnon, il est avéré que sa fille de 7 ans a assisté au meurtre. Violée avant d’être assassinée. (etc.)
Chacun tirera une leçon de l’amas de banalités qui font l’essentiel des conversations, celles que l’on saisit au vol et les nôtres. Le petit livre de Gilles Furtwängler peut faire comprendre que l’on énonce souvent des sottises, sans pour autant être un "beauf" ; il peut aussi suggérer de poursuivre les relevés dans notre environnement pour de nouvelles « voix de velours ».
* Appellation familière en s’adressant à un homme ou une femme.
L’Ours Blanc, Héros-Limite, automne 2025
n° 45, 32 p., 6 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 15 décembre 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'ours blanc, automne 2025, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
30/01/2026
Anne Malaprade, Épuiser le viol : recension

Une première lecture de épuiser le viol m’a déconcerté par tout ce qu’il me fallait, littéralement, redécouvrir, à commencer par les lettres de Mme de Sévigné (mais on ne se lasse jamais de les lire), dont en avant texte deux citées avec deux personnages, le loup et le loup-garou, ce qui introduit le jeu entre Loup, figure du violeur (on reconnaîtra ici et là des allusions au Petit Chaperon Rouge, version Perrault) et Louve, son épouse. « Animal » se transforme, loup et louve prennent forme, visage et pratiques des humains, « Louve (…) entre dans la tanière (…) Sur le bureau une boîte de thon ». Un second texte, de l’autrice cette fois, explicite le titre et ce faisant définit les enjeux du livre, en suggère des éléments ; extrait :
Violer jusqu’à épuisement des ressources exacerbe des incompétences métriques (oublier des distances entre soi et l’autre, les avaler, les dissoudre en déchets), des incompétences scalaires (confondre la grande dans le petit, l’enfant tellement adulte, le féminin sur le masculin, le neutre par l’indéfini), des incompétences d’emplacement (se perdre dans le tissu-peau des petites filles et ce en pleine lumière familiale) (…)
Huit chapitres suivent, tous doublement titrés, chaque titre comme un sommaire du texte. Le premier annonce des éléments tragiques, « Le saut de la mort / Lune nous regarde » ; le troisième est une allusion à une série colombienne, « L’esclave blanche / Lune en son royaume », le sixième « Le procès de Louve / Lune décharnée » renvoie à un livre pour enfants, variation sur l’histoire du Chaperon rouge, Le procès du Loup, de Zarko Patan ; tous les autres sont des titres de films de Carl Th. Dreyer, du premier « Pages arrachées au livre de Satan / Lune perd son propre cadavre » au dernier du livre, « Ordet / Allumer les soleils ».
Au chaos du monde correspond le chaos dans la vie d’une femme, son refus du viol dans tous les sens du mot, sa perte de repères quand son couple est brisé — « Un matin, les époux font l’amour pour la dernière fois (…) elle sait que c’est fini ». À la perte répond la construction du livre ; pas de récit, la discontinuité : chaque ensemble formé de groupements de dimension très variable séparés par une barre (/), le lecteur pouvant s’égarer d’ailleurs dans la distribution des noms qui ne sont pas toujours attribués au même personnage ; ainsi "Violette" — est-il besoin de souligner le rapport à "viol" ? —, dont même un homme dans un roman1 d’Emily Brontë, Heathcliff, surgi au détour d’une phrase, aurait un instant l’apparence. Ainsi encore Louve, dont il faut lire le nom sans le "u", « Louve dérive de Love en Love : elle est parfois son père, parfois la petite fille. Elle est très rarement Louve », alors que Loup est toujours l’Envioleur, homme et père, comme "Petits" ou "Violettes" sont les enfants. Il « fréquente Barbe-Bleue et (…) fait peur aux Ogres », cependant il « aurait aimé se déguiser en Violette ».
Comment écrire le désastre en écartant le pseudo-réalisme de la plupart des romans ? La discontinuité ne suffit pas et le livre est nourri, toujours en lien étroit avec le propos, par la littérature dans toute sa variété, dès son ouverture, et par le cinéma, la musique même (Steve Reich) et la peinture avec un hommage à Marcel Duchamp et mention d’une toile qui pourrait être placée « sur un petit pan de mur jaune »2. Relever tous les extraits et toutes les allusions, leur rôle dans l’histoire de Louve est exclu ici, on retiendra quelques exemples. Quand Louve « ne respire que de disparaître demain auprès des renards bleus(Mandelstam) », il est bon de relire le poème évoqué, il résonne par image avec la situation de Louve qui vit une violence réelle et souhaiterait retrouver quelque chose de la « beauté primitive » des « renards bleus »3, très loin, dans un autre monde, l’Arctique.
Cette violence est suggérée par une allusion, « Il la tue, il ne lui fait pas de bien. Il n’a pas vu le film de Resnais » ; on lit peut-être une ironie de la part de la narratrice ; dans Hiroshima mon amour (1959), les mots de "Elle" à "Lui", repris plusieurs fois dans une scène amoureuse, étant « Tu me tues, tu me fais du bien ». D’une manière positive sont évoquées plus loin les « répliques lancinantes de Hiroshima mon amour », cette fois, semble-t-il, pour une union entre une Violette et Louve. La rupture a été d’autant plus difficile à vivre que Louve aurait voulu « que l’amour ne s’éloigne pas dans la séparation », mais rien ne peut se substituer à l’éloignement des corps qui implique la fin d’une histoire, sauf à nier la réalité, ce qui est souligné : « Elle a tort, tout le vivant est soumis à la fin et au détachement. »
« Le retour au réel précède sa solitude intégrale. Cela s’appelle l’aurore. » Plus qu’au film de Bunuel, le titre renvoie à la fin de la pièce de Giraudoux, Électre, conclusion amère de la fin d’une histoire, « Comment cela s'appelle-t-il, quand le jour se lève, comme aujourd'hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l'air pourtant se respire, et qu'on a tout perdu (…) — Cela a un très beau nom (…). Cela s'appelle l'aurore. » Que reste-t-il ? Ce qui s’est achevé laisse, au moins un temps, Louve sans défense avec le sentiment de n’avoir plus d’identité, ce qui s’exprime par « Mon nom est Personne », proposition non référencée, l’épisode du Cyclope dans l’Odyssée étant devenue commune. Ce que pense Louve de son sort est traduit dans les dernières pages avec un emprunt à une réplique d’une femme, Bébé Donge, « On ne recommence pas deux fois l’amour. »4
La tentation de disparaître est là, surtout quand dans la vie quotidienne, dans la rue même rien n’entraîne vers la vie, « beaucoup portent une barbe bleue ». C’est, progressivement, par la disparition des « incompétences » que Louve pourrait retrouver ce qu’elle est, en écrivant son histoire, la douleur et la violence, mais une fois écrit « Ce livre fait mal aux Louves. Elles sentent bien que le style est dans le ventre, et qu’il a toute l’importance d’une aventure. » Le livre peut aider à revenir à la vie, tout comme dans le film Ordet = (la) parole, les mots de Johannes redonnent vie à Inger, morte au moment de son accouchement. Mais la conclusion du livre est amère, empruntée à une lettre de Flaubert :
« (…) quand les intérêts de la chair et de l’esprit, comme les loups, se retirent les uns des autres et hurlent à l’écart, il faut donc comme tout le monde se faire un égoïsme (plus beau seulement) et vivre dans sa tanière ».
On reconnaît d’un livre à l’autre l’écriture d’Anne Malaprade, une langue qui n’hésite pas à recourir aux mots justes, dire telle réalité (merde, couille, putain) et à un emploi ancien : un moustique a dévisagé le visage de Louve, soit "défiguré" — d’où la suite pleine d’humour : elle ressemble alors à La Joconde L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp. Il y a parfois le plaisir de la paronomase (« Les mots, quels mots. Les mets, quels mets. »), et du jeu des significations (« elle aussi balance, se balance, s’en balance ».) On multiplierait les exemples. Ce qui est un fait d’écriture propre à l’autrice est la virtuosité des énumérations qui associent des éléments hétérogènes et l'on ne peut oublier l'art difficile de la répétition.
Anne Malaprade, Épuiser le viol, éditions isabelle sauvage, 2025, 144 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 10 décembre 2025.
1 Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent.
2 allusion à Proust, La Prisonnière.
3 Pour la gloire grondante des temps futurs, dans Ossip Mandelstam, Œuvres poétiques, traduction Jean-Claude Schneider, Le Bruit du temps/La Dogana, 2018, p. 364.
4 dans le film d’Henri Decoin, La Vérité sur Bébé Donge. (1952)
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne malaprade, épuiser le viol | ![]() Facebook |
Facebook |
28/01/2026
Audre Lorde, Une merveilleuse arithmétique de la distance : recension
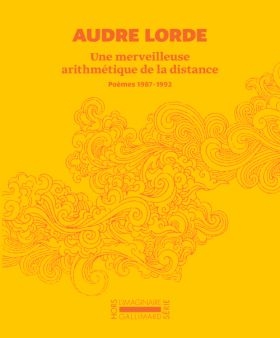
Au début du XXe siècle, des femmes que leur statut social protégeait n’ont pas hésité à écrire à propos de leur homosexualité ; on pense toujours à Renée Vivien et à Nathalie Clifford Barney et il faut relire aussi Lucie Delarue-Mardrus, se souvenir de l’exaltation du corps chez Joyce Mansour, etc. Le militantisme LGBT aux États-Unis, le "mariage pour tous" (2013 en France), le mouvement #MeToo, entre autres, ont favorisé depuis une vingtaine d’années la publication d’une poésie longtemps ignorée. L’œuvre poétique d’Audre Lorde (1934-1992 ; elle avait ôté l’y de son prénom) a commencé à être traduite tardivement en français (La Licorne noire, 2021), d’autres publications ont suivi grâce aux traductions du collectif Cételle (Charbon et Contrechant, 2023). Aujourd’hui, la collection de poche L’Imaginaire, dans un format et une présentation inhabituels, propose un ensemble posthume (1993) de poèmes ; quatre brèves préfaces d’Alice Diop, Fatou S., Kiyémis et Mélissa Lavaux rappellent l’importance d’Audre Lorde aux États-Unis : auteure noire, féministe lesbienne, elle fut jusqu’à sa disparition militante des droits civiques et de la liberté des femmes.
Les traductrices précisent dans une note, qu’elles ont choisi pour se « rapprocher le plus possible du propos d’Audre Lorde », de s’appuyer « ponctuellement sur des stratégies de démasculinisation de la langue française ».
Le titre porte une leçon ; il faut toujours aller de l’avant, partir au moins métaphoriquement, « Pas de place pour régler les comptes / sauf dans une merveilleuse arithmétique de la distance ». Aller de l’avant implique de s’opposer à ce qui est, opprime, empêche d’être soi, nie jusqu’à l’existence : Audre Lorde dénonce le racisme ordinaire qui tue, par exemple en 1984 une femme noire pauvre, Eleanor Bumpurs, refusant son expulsion : la porte de son logement enfoncée, elle est abattue par un policier. Le refus de l’autre parce que noir est chose commune partout, jusqu’à instaurer l’apartheid, comme en Afrique du Sud, où l’on tuait quotidiennement à Soweto. Le racisme ne disparaît pas aisément, toujours présent des deux côtés de l’Atlantique.
Audre Lorde prend l’exemple de son père, né de père inconnu, qui a travaillé toute sa vie pour que ses filles ne connaissent pas le même sort que lui ; il achetait de « vieux livres », rapporte-t-elle, « pour mon univers sans langage », et elle est devenue bibliothécaire. Que pouvait faire son père ? « Noir et sans le sou / sur cette terre où seuls les hommes blancs / règnent par l’argent. » Comment ne pas désespérer de la persistance de la ségrégation ? Audre Lorde, d’abord surprise du visage haineux de sa nouvelle voisine blanche, entend l’enfant qui l’accompagne, « Je ne t’aime pas, braille-t-il, / Tu viens pour me garder ? ».
La vie quotidienne dans une ville américaine des années 1980 était difficile pour l’ensemble des ouvriers, la crise économique de 1975 avait laissé des traces, mais elle l’était encore plus pour la population noire plus vite atteinte par le chômage, « la misère me hurle / dans les rues voisines », écrit-elle, aggravée par les ravages de la drogue et ceux de la prostitution qui conduit des femmes « du trottoir au néant ». La situation est d’autant plus mal vécue par la communauté noire que les "Blancs" ne représentent sur terre qu’une minorité, ce que souligne avec humour Audre Lorde :
La plupart des habitants de cette planète
sont (…) Asiates, Noires, Brunes, Pauvres, Femmes, non Chrétiennes
et ne parlent pas anglais.
Vers qui se tourner pour continuer à se tenir debout ? D’abord vers les femmes qui n’ont pas renoncé à changer leur vie, celle de leur famille. Audre Lorde s’est nourrie des paroles de sa mère, modèle comparable à « une eau libérée », qui l’ont incitée à toujours se battre. Elle évoque aussi un militant noir des droits civiques, Marcus Garvey 1887-1940) qui, à l’origine de la culture rasta, avait une position radicale : il prônait le retour des anciens esclaves en Afrique.
Mais elle exalte surtout dans ses poèmes de la ville le rôle des sens, attentive au timbre de la voix, aux regards, aux odeurs ; elle n’oublie jamais l’importance des rêves et des désirs : elle écrit ce qu’était l’amie disparue avec qui elle passait parfois la nuit à lire des poèmes — « Je n’arrive pas à croire que tu sois sortie / de ma vie. / Alors tu ne l’es pas. » Elle-même succombera à une récidive d’un cancer du sein, active jusqu’aux derniers jours (« comme il est dur de dormir / au milieu de la vie ») et toujours exemple de militante pour la liberté complète des femmes : libres socialement et libres de leur corps.
Audre Lorde, Une magnifique arithmétique de la distance, Poèmes 1987-1992, édition bilingue, traduction Providence Garçon et Noémie Grunewald, collection L’imaginaire/Hors-série, Gallimard, 2025, 148 p., 25 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 26 novembre 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : audre lorde, une magnifique arithmétique de la distance : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
22/01/2026
Dominique Quélen, Matière : recension

Certaines contraintes d’écriture (le sonnet, le dizain par exemple), d’abord propres à telle époque, ont été et restent des cadres commodes et qui les a adoptées en a fait usage à son gré, les sonnets de Baudelaire sont éloignés de ceux de Nerval. On sait qu’il est toujours possible de proposer d’autres contraintes que celles existantes ; Georges Perec, par exemple, s’est passé de la lettre /e/ dans La disparition, ce qui entraînait une cascade de modifications : le lecteur a affaire alors à une autre langue que celle qu’il pratique. Dominique Quélen, dans Matière comme dans plusieurs de ses livres, lui aussi invente des règles et, ce faisant, construit une langue à l’intérieur de la langue commune.
Le livre compte 8 ensembles de proses titrés ; le premier, "Écrire petit", ouvre une boucle qui se referme avec "Le langeage" : titres en miroir, chacun ayant un double sens : double sens de « petit » dans le premier titre, le second marquant que le corps, dès le début (dans les langes) ne peut être séparé du langage. La construction est rigoureuse : on lit deux séries de 24 poèmes avec deux poèmes par page de longueur sensiblement égale (peut-être faudrait-il s’assurer du nombre de signes…) et séparés par un blanc de dimension à peu près équivalente ; elles sont suivies, titrés "Bancals et malaisants", de 24 poèmes imprimés en continu, chacun avec un titre apparemment descriptif. Suivent deux ensembles construits comme les deux premiers, avant "Deux fois douze douzains de dodécasyllabes, mis en prose", donc encore 24 poèmes différents des premières séries mais liés à la troisième dont le titre de chaque poème est un dodécasyllabe, comme "Qui perd un frère ou une sœur n’a pas de nom" ; on retrouve ensuite la première configuration, deux fois 24 poèmes. On obtient ainsi la forme AABAABAA.
Cette enquête autour de la forme pourrait être poursuivie ; on note par exemple que dans un poème, certains nombres sont liés au nombre 24 et un mot à un terme de poésie ; ainsi, à propos d’un mort, « tu es rangé dans un cube. Une boîte. Un mètre douze de côté » ; on lit aussi un renvoi au jeu des nombres à propos d’une « course parfaite » : « deux séries de douze foulées chacune ». L’une des caractéristiques de Matière est justement de mettre en évidence l’« équilibre instable » (p. 72, 89) des choses du monde, instabilité d’autant plus visible qu’elle s’oppose à la fermeté de la forme. La matière elle-même fuit sous les pas ; l’eau plus ou moins stagnante est présente jusqu’à la fin du livre (« un pied s’enfonçait dans la vase », 116). Le langage lui-même, malgré l’apprentissage (« Parler, l’habitude une fois prise en demeure »), peut perdre à tout moment son équilibre ; il suffit d’une lettre, d’un son pour que les choses basculent, que l’on passe d’une matière à l’autre, que plus rien ne soit reconnaissable, « se confondent l’orge et l’orange, l’orage ». Il suffit alors de se demander comment épeler un mot pour saisir la relation étroite avec « peler » (une orange) », soit engager une destruction. Les mots semblent même interchangeables, au moins quand la construction du corps n’est pas achevée, « le vocabulaire enfantin […] colle et remplace les plaies par de la peau ».
Cependant, ce qui ressemble à un jeu formel est lié à ce qu’est le poème :
De mélose tirant mélope, tu inventes mélopement / qui se met à vivre. Une fois les règles de la langue et / du vivant définitivement enfreintes, tu n’as plus à les / inventer, de mélopée te vient mélope avec naturel. / Tu es là-dessous où les vers se font / naturellement / langue, poème à l’intérieur de la langue, chant / mêlant invention et opérations de langage.
Invention : le poème met en mots et fait donc exister ce qui n’est pas, créant avec la langue et ajoutant à ce qui est, « on franchit d’un bond ce ruisseau qui n’y était pas hier ». La langue autorise la transformation du monde en y introduisant chaque fois que nécessaire « la chose manquante », bien que non visible puisque seulement de mots. Chacun ayant un usage particulier de la langue commune, a sa « propre langue », chacun pourrait faire « d’une phrase un vers, d’un vers un poème ». Une quasi définition de ce qu’est un poème insiste sur cette particularité irréductible, « Poème = un entre-deux de langue = un écart = un langage et non un extrait seulement du langage » ; il s’agit bien d’un "espace" créé dans la langue, qui implique que l’on se retire des règles communes, que par exemple « le corps de la phrase » exprime « par sa torsion comme un linge enveloppe un bras ». C’est dire que la syntaxe normative n’est pas de mise, qu’on use de répétitions, des sens multiples d’un mot, etc., et la confusion des sons révèle parfois l’essentiel : dans ces vers « Quand l’œuvre que ceci cela, / l’œuvre de ta vie, on entend l’œuf c’est comme ça » — l’œuf, image de l’origine d’une vie, et l’œuvre aboutissement.
C’est là encore une image du double, ou plutôt d’une figure et de son reflet, qui court d’un bout à l’autre de Matière quand il s’agit du corps, de la symétrie des membres notamment. Mais aussi des pronoms, je/tuinterchangeables, ou des frères dont l’un disparaît, « Tout le monde perd un frère, ou / soi-même on est le frère perdu. C’est très commun. » L’identité elle-même, ou plutôt ce qui socialement donne à chacun sa place, n’est pas entière, « Cette chose. Mon nom, dis-tu. Cette chose trouée au milieu. » L’unité est impossible dans le réel : chaque fois que l’on s’avance c’est pour être devant un trou ; cette image insistante envahit le livre et, pour commencer, elle est attachée à ce qui permet justement de la parler : « Voici ce qui tombe une première fois de la bouche en / accompagnant la parole encore informulée : un trou. » Bouche aussi comme trou, « trou du poème », phrase comme un corps, corps comme un sac et auparavant dans un « pochon ventral » où l’on se trouve « noué, absorbé dans la tâche obscure d’en sortir ». Parmi d’autres motifs, la mort s’impose dès les premières pages avec un noyé et un chien crevé et l’on apprendra que « C’est sain, c’est simple, c’est normal d’être mort ».
À la suite des poèmes, une note indique au lecteur qu’un autre volume complètera un triptyque commencé avec Une quantité discrète (Rehauts, 2022) — le projet relancerait ce qui semblait achevé avec le dernier poème : c’est la fin du double devenu un, de l’image et de son reflet, et tout se ferme avec le mot « rien ».
Dominique Quélen, Matière, Flammarion/poésie, 2025, 134 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 17 novembre 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique quélen, matière : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
14/12/2025
Christian Prigent, Zapp & zipp : recension

Un portrait avec pleins et déliés
Bien des écrivains n’ont pas rédigé de journal, de Flaubert à Beckett et Modiano, ou n’ont jamais eu l’intention de le publier, comme Jules Renard, Kafka ou Virginia Woolf ; d’autres l’ont donné à lire (Gide) et en ont même fait une partie importante de leur œuvre (Paul Léautaud, Charles Juliet). Les contenus sont extrêmement variés et différents d’un journal à l’autre ; celui de Prigent exclut à peu près complètement le récit de faits quotidiens — il note cependant qu’il regardera l’arrivée d’une course cycliste, mais on ne saura pas si c’est lui qui s’occupe du lave-linge. Le journal est divisé en groupes mensuels, abandonnant la mention de dates retenue dans la publication sur Sitaudis. Le lecteur aura beaucoup à réfléchir en le suivant mais il s’y est habitué s’il a lu sur le site des éditions P.O.L ses « textes libres », titrés SILO : ils « abordent les rapports poésie/peinture, poésie/prose, théorie/fiction, littérature/politique, lyrisme/carnavalesque, phrase/phrasé ». C’est là une partie du programme du journal à l’occasion de lectures, de notes pour un colloque, d’un article ou d’un entretien ; s’y ajoutent des observations à propos de l’actualité, des poèmes ici et là, des réflexions sur la/sa vieillesse, des souvenirs d’où de rares mentions sur la famille. Bref : un vrai journal comme le définissent les dictionnaires. Une annexe propose des extraits de Chino Rabelais (paru en 2020) et un index à la manière de l’auteur (La vie civique, La vie des lettres, etc., qui s’achève par Le Cabinet des Muses).
Le titre est dans la manière de Prigent, qui apprécie les onomatopées. Outre la répétition Z…P, on imagine un couple dans un scénario du genre « Zapp & Zipp sont sur un bateau » — ce qui rappelle le centenaire Zig et Puce de Saint-Ogan. Zap(p) implique par ailleurs le changement, le passage d’une idée à une autre et Zip(p) désigne un format de fichier pour archivage, donc on peut « zipper les sujets entre eux » (exergue du livre) : voilà pour un journal. Ne pas oublier que Prigent, (longtemps) cycliste et connaisseur des courses, a sans doute pensé à la célèbre marque américaine de roues de vélo, Zipp. On voudrait restituer l’unité du « disparate » de ces 736 pages : on la trouverait dans ce qui guide les lectures (de Follain à Guyotat) et les préparations d’articles ou de conférences — ce qui renvoie le lecteur aux livres de l’essayiste qu’est Prigent ; on tentera plus simplement d’en regrouper quelques éléments dans ce qu’il note à propos de son écriture et de sa propre vie.
Écrire, qui a occupé et occupe encore une partie importante de son temps, a pour point de départ des lectures : écrire, cela a été « tenter de comprendre pourquoi et comment ceux-là (Ducasse, Rimbaud) m’avaient fait écrire — et pourquoi eux et fort peu d’autres (sinon plus tard, quelques étrangers : Maïakovski, Khlebnikov, Hölderlin, Pound, Cummings… — mais une fois les choses déjà jouées) ». Ce qui vaut pour l’ensemble de l’œuvre justifie-t-il la tenue d’un journal et sa publication régulière ? Peu de diaristes d’ailleurs expliquent le pourquoi de leurs notations à intervalles réguliers ; Prigent consacre à la question quelques lignes en avril 2024 sous le titre « Vider les lieux ». Il s’agirait « de tenir fermement la posture amère, sarcastique et furieuse, se mettre tout le monde à dos, user les amis, vider le plus possible les lieux autour de soi (…) avant de n’avoir plus qu’à vider à son tour les lieux ». La rédaction d’un journal viserait à se retrouver seul, comme si ce qui était écrit avait pour « Seul but, peut-être » de chasser les lecteurs, amis ou non ? La vieillesse (80 ans en 2025) peut expliquer le retrait : « on est seul, et davantage à mesure qu’on a moins de force pour faire comme si on était et vivait "comme tout le monde " », ou aussi : « Je suis vieux. Mes amis sont vieux. L’échéance approche ».
La plupart des textes du livre n’ont rien qui puisse corroborer l’affirmation d’un retrait, qu’il s’agisse des nombreux développements autour d’un écrivain, d’un film ou d’un livre. Quand paraît le nouveau TXT (2019), Prigent ne souhaite pas apparaître comme tel dans ce « lieu quasi pour [lui] natal » mais, avec des publications anonymes « se retirer sans abandonner ». Certains textes donnent à reconnaître un Prigent observateur attentif de la nature quand, par exemple, un Martin-pêcheur vient visiter les bassins à poissons rouges du jardin ; émotion encore quand il se trouve à un "bout du monde" ; lyrisme sans doute, soit « l’obsession de l’immensité innommable » du réel. Alors « écrire tente de noter cette démesure, d’en restituer l’effet, le tact ». On relit aussi la page où il observe avec émotion Beckett et Pinget silencieux dans un café (souvenir « pauvre, furtif, même pas volé, incompréhensiblement poignant ») et, à un autre moment, croise Beckett portant un cabas d’où dépasse un poireau. Ces notations renforcent pour le lecteur le vif des très nombreux mini- essais à propos de films et d’écrivains, de ce qu’est pour lui l’écriture et la poésie.
Prigent est-il présent dans ses livres, par exemple dans la série des Chino ? certainement, sans qu’il soit question d’autobiographie, genre majeur aujourd’hui : « ils disent une vérité de ma vie (ce serait peu) et (c’est beaucoup plus) rappellent que la sorte d’énergie joyeuse des fictions s’en est arrachée — comme écriture : victoire sur la mélancolie. » C’est cette énergie qui donne son allant, et son unité, à l’ensemble du journal et elle écarte chaque fois la tentation du repli. Elle éloigne du « verbiage » des réseaux, de leur inculture, permet de refuser fermement l’idée que vouloir diffuser les "grandes œuvres" serait élitiste. Ce qui n’empêche pas de savoir qu’« écrire ne sauve de rien, ne sauve rien » et, en même temps, qu’« on apprend le monde en écrivant ».
La publication de l’ensemble du journal fait apparaître, avec un retour régulier de quelques interrogations et de quelques motifs, une unité d’écriture moins visible dans la publication mensuelle. On repèrera quelques éléments récurrents, les séries d’adjectifs comme « C’est compliqué, tordu, lacunaire, opaque », « C’est toujours une chance — d’être moins morne, moche méchant, con », etc., la fréquence des parenthèses, des italiques pour marquer l’importance d’une notion, l’usage très régulier de surjouer, surjoué et de moche — jusqu’à « ce soi moche ». Etc. Tous éléments qui facilitent la lecture, traces fortes d’une volonté de partage.
Christian Prigent, Zapp et zipp, 2019-2024, P.O.L, 736 p., 29 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis Le 9 novembre 2025.
Publié dans Prigent Christian, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian prigent, zapp & zipp : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
26/11/2025
Laura Tirandaz, J'étais dans la foule : recension
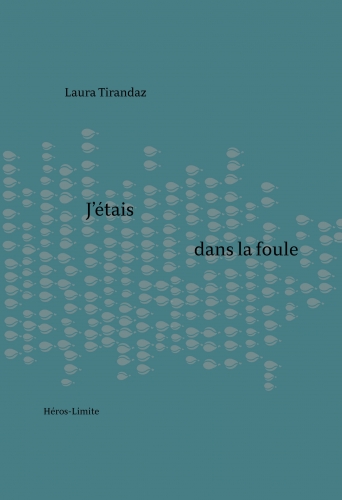
Être dans la foule — « J’étais dans la foule » revient trois fois dans le livre — c’est à la fois être au plus près des "autres" et, en même temps, vivre la solitude, « Solitude aiguisée de qui passe à portée de main ». La narratrice se trouve dans ce lieu provisoire par nature, qui apparaît à la fois « Dédale piège refuge » ; La foule réunit ici des hommes et des femmes qui semblent manifester contre un pouvoir violent ; la narratrice rapporte : « Je passe / un homme glisse une insulte, insulte répétée plus avant, et la mort est présente, « on continue on continue / on s’est mis à ramper / à jeter des poignées de sable pour cacher le sang ». Images de répression collective qui s’exaspèrent quand les femmes sont objet de violence :
Je marchais et me souvenais
des femmes traînées par les cheveux jusqu’au cœur de la ville
l’été écrasé sous les bottes
Le pouvoir tue pour terroriser, choisissant ses victimes, « ce matin deux exécutions », et presque aussitôt « ce matin — une exécution », et les notations ne laissent aucun doute sur la volonté de faire taire toute opposition (« le sang ouvrier », « Quelqu’un à qui on a enlevé la peau et les verbes », etc.). Une des plus tragiques restitutions de la violence mêle les gestes quotidiens à ceux d’une exécution, dont la banalité est ainsi mise en valeur : « Ce que je me suis forcée à finir / la phrase / l’assiette / et sa tombe — je devrais y aller / Il a tourné le dos face au mur ». Cependant, « Plus il y a d’ennemis / plus il y a d’amis » et, dans l’avant-dernier poème, « J’attends la foule / Derrière le paravent / les ombres respirent toujours la même fleur ».
Les citations précédentes pourraient laisser croire que le long poème qu’est J’étais dans la foule est un récit concernant ce qui se passe en Iran, le nom de l’auteure étant transparent ; elles sont relevées et rassemblées parce qu’il y a bien une visée politique dans ces poèmes que l’on met en exergue. Mais autre chose, qui déborde la terrible actualité. Et d’abord une perception de la foule en même temps restituée et devenant objet d’imagination : « (…) Des phrases, des coups de rame / Les corps glissent / Les visages se superposent / Il pleut » ; on lira plusieurs fois ce genre de passage où le réel semble, mais semble seulement, mis à distance et perçu alors avec plus de force. Le dernier vers du poème s’achève d’ailleurs sur une de ces notations qui introduisent un effet de réel, « Des mouches sur mon rouge à lèvres ».
Écrire ce qu’est la foule n’implique pas une description comme on peut en lire chez Zola ou Hugo (la foule comme une mer, une marée). La narratrice regarde et le texte se divise, les éléments vus tous différents, juxtaposés, sans que le chaos du monde soit organisé : tout le contraire d’une description, ce qui donne au lecteur le sentiment d’être aussi devant un désordre impossible à réduire. D’autres séries sont limitées à une suite de mots et tout se mêle, choses vues, bruits, textes lus, toujours pour donner du réel une perception différente : « Les insectes les rumeurs les alarmes / les comptines où l’animal trouve refuge ». La foule est aussi un lieu sonore, dans l’immense confusion des bruits se détache parfois brusquement, la nuit, une voix qui dit, pense-t-on, sa souffrance, « Une femme criait / Qu’on m’emporte / Qu’on m’emporte ». Quand la narratrice écoute une personne, ici un adolescent, dont les mots sont tout autant inorganisés que les paroles saisies dans la foule, « (il) te parle des nuits d’alcool en famille / du silence dans la cuisine / de l’épaisseur de l’air et du velours des voix âpres, rares », ce qui est plus réel qu’une restitution d’une prétendue oralité.
La narratrice n’est pas seule, sans que les personnages introduits soient mieux définis qu’elle. La double injonction qui ouvre le livre — « Abandonne la route », puis « Reviens vite » — peut s’adresser à un lecteur imaginé comme au "vous" de ce début ou au "tu" qui entre dans l’histoire à différents moments ; d’autres pronoms apparaissent, un « nous » et un « ils », qui peuvent renvoyer à des figures diverses : il y a assez régulièrement dans J’étais dans la foule des traces d’un ailleurs, d’un dehors qu’on peut bien appeler le réel. Le seul pronom récurrent, "tu" ("te") joue avec le "je", mais il n’est pas certain, et le lecteur ne le saura pas avec certitude (heureusement !), que le couple formé par le je-tu soit toujours le même. Il y a l’idée d’une fusion totale, mais qui ne peut être qu’imaginée, « qui envahissait le rêve de l’autre ? / Nous avons la même insomnie / la même honte ». Il est fait état une brève conversation entre je et tu et, plus longuement, de la fin d’une relation, mais avec un passage brutal de je à elle : le poème commence par « j’écrirai un jour le récit d’un amour qui s’achève » et se poursuit par « (…) Elle lui tient la main, penche la tête / Lentement elle le massacre ».
On voudrait relever tous les entrelacs d’un poème qui, rappelant régulièrement le contexte, des moments de vie en Iran aujourd’hui, s’échappe des circonstances et, constamment, offre une lecture passionnée du réel, en refusant de présenter une image ordonnée de la violence, du chaos où chacun, qu’il le veuille ou non, vit sa vie, même éloigné des tueries contemporaines ou de la crainte de « tomber dans le vide » — ce sont les derniers mots de ce très beau poème.
Laura Tirandaz, J’étais dans la foule, Héros-Limite, 2025, 72 p., 16 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 28 octobre 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laura tirandaz, j'étais dans la foule, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
15/11/2025
Verlaine, Maurice Denis, Sagesse (Fac-similé) : recension
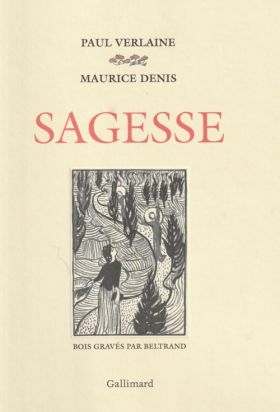
Sagesse n’est peut-être pas le recueil le plus lu de Verlaine, mais quelques poèmes en sont très connus comme, dans la troisième partie, "Le ciel est par-dessus le toit ", plusieurs fois mis en musique (notamment par Déodat de Séverac, Gabriel Fauré et Reynaldo Hahn) et des versions folk, pop l’ont popularisé. Il est intéressant de relire aujourd’hui l’ensemble illustré qui, publié en 1880 à compte d’auteur et repris en 1889 chez Léon Vanier, est accompagné en 1911 de bois gravés de Maurice Denis, édité par le marchand de tableaux Ambroise Vollard. On passe d’un éditeur de livres de religion, la Société générale de librairie catholique à l’éditeur des écrivains dits "décadents" et des symbolistes. L’intérêt de ce fac-similé, qui précède une nouvelle édition des œuvres de Verlaine dans la Pléiade, tient au fait qu’il met sous les yeux des lecteurs un exemple remarquable de livre nabi.
Verlaine a écrit Sagesse après sa conversion, à partir d’août 1873, dans la prison de Mons, en Belgique où il purge une peine de deux ans pour avoir tiré sur Rimbaud en juillet. Publié en 1880, le livre suscite peu de critiques, toutes négatives ; cependant, Huysmans fait lire Sagesse à Jean des Esseintes, personnage principal de À rebours, publié en 1884. En effet, il reconnaît que Sagesse « caractérise (…) la sensibilité fin de siècle, mêlant ferveur religieuse inquiète et sensualité ardente et trouble ». Maurice Denis (1879-1943), lui, découvre très jeune les poèmes, en 1889 ; il s’y retrouve, séduit par le ton religieux, et pense rapidement à l’illustrer. Ses recherches graphiques aboutissent à un album qu’il offre à Lugné-Poe (né en 1869), co-créateur du Théâtre de l’œuvre, qui le fait circuler dans les salons et les ateliers. Parallèlement des expositions, des publications de ses dessins dans des revues donnent à Maurice Denis une assise dans le monde artistique où ses bois sont bien accueillis.
Cependant, quand Maurice Denis rencontre Verlaine en 1890, ils ne se comprennent pas ; l’écrivain reconnaît dans certaines illustrations des échos vifs de la vie alors que le peintre a donné à toutes une valeur symbolique. Par ailleurs, l’un et l’autre conçoivent de manière différente la sacralité ; Verlaine est venu, lentement, à la religion, c’est un converti qui n’a pas totalement abandonné ce qu’il était, alors que pour Maurice Denis la croyance en Dieu est de l’ordre de l’évidence, native. La rencontre, pourtant, est remarquable du point de vue esthétique ; il est visible que le « mélange de naïveté et de réflexivité en art est également un trait de la poésie de Verlaine, oscillant entre ingénuité feinte et extrême conscience du jeu littéraire ». L’accueil est positif dès 1892, notamment du côté des catholiques, où l’on note « l’orthodoxe mysticité » des gravures opposée au « dilettantisme religieux » qui règnerait alors.
Tout au long des années 1890 des gravures de Maurice Denis sont publiées et, en 1895, sept xylographies, en même temps qu’un appel à souscription pour une édition illustrée de Sagesse. Après la mort de Verlaine, le 8 janvier 1896, les choses se précipitent et plusieurs éditeurs sont sollicités, que le projet retient mais qui ne s’engagent pas. Il s’écoulera plus de quinze ans entre le début des négociations entre Maurice Denis et Ambroise Vollard et la publication, en 1911. Le galeriste voit l’intérêt des gravures et des estampes de peintres, il en expose en 1896, préparation à l’édition de livres d’artistes : le premier, Pierre Bonnard, illustre Parallèlement de Verlaine. Pour Sagesse, il fallait se libérer des droits détenus par les héritiers de Léon Vanier, le premier éditeur ; il fallait aussi modifier les dimensions des dessins de Maurice Denis. Le livre paraît au début de 1911 (achevé d’imprimer : août 1910) et il vient peut-être trop tard, à un moment où commence à se mettre en place « l’esprit nouveau » que défend superbement Apollinaire peu après. Il est certain que « D’une époque à l’autre, [le mouvement nabi] prolonge, comme en pointillé, la ligne d’une autre modernité possible, maintenant en partie refoulée ».
La restitution du fac-similé, outre qu’elle est une édition d’art, donne à lire Verlaine autrement. Pour "Le ciel est par-dessus le toit", par exemple, Maurice Denis a privilégié les connotations religieuses qui ne sont pas du tout dominantes dans ce poème : on retient « la cloche (…) tinte » (2ème strophe), comme élément de paysage (une église) — « Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là » (premier vers de la 3ème strophe) n’appelle pas d’illustration — ; il multiplie les croix et le paysage représenté est un cimetière. Qu’il interprète ou transforme le texte ne remet pas en cause la qualité esthétique des gravures et dessins de dimensions variées qui accompagnent les poèmes, placés en ouverture, embrassant le texte ou en cul-de-lampe. On appréciera les très nombreuses illustrations (dessins préparatoires, parfois tirés de carnets, lithographies et xylographies, détails) réunies dans les études qui suivent le fac-similé. On appréciera aussi la clarté de l’essai de deux responsables de l’édition qui complètent leur étude avec des notes lisibles, une bibliographie à propos de Sagesse, de Maurice Denis et sur le livre nabi.
Verlaine, fac-similé de Sagesse, illustrations de Maurice Denis, suivi de « L’invention du livre nabie », par Jean-Nicolas Illouz et Clémence Gaboriau.Gallimard, collection « livre d’Art », 2025, 104 p. et LVI p.. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 27/10/2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verlaine, maurice denis, sagesse | ![]() Facebook |
Facebook |
09/11/2025
Bruno Fern, des tours, suivi de Lignes : recension
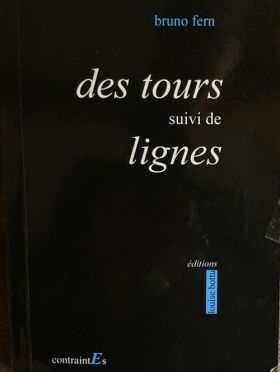
On peut écrire en « vers libres » pour faire part de ses amours ou de son désespoir de vivre, plus prosaïquement de ce qui se passe dans sa vie, et cela finit par devenir un livre de "poèmes" ; chacun en trouvera chez son libraire un grand choix. Autre chose est d’écrire en prenant la langue comme matériau, en s’imposant des contraintes formelles ou en les réinventant — le sonnet, par exemple, est toujours vivant sans être toujours selon les règles du sonnet de Ronsard. À l’intérieur du cadre que l’on a choisi, ou construit, d’autres contraintes s’imposeront. Bruno Fern invente une contrainte, très littéraire, dans chaque partie du recueil, à partir de laquelle d’autres jeux rhétoriques se développent.
La règle dans des tours, qu’on lit aussi immédiatement "détours", titrée heureusement « Fabrique », est énoncée avant le premier poème et reprise en quatrième de couverture :
Chaque poème est issu d’un texte dont l’origine est indiquée. Un extrait y a été prélevé puis scindé en deux parties : la première est placée à la fin du poème et la seconde au début. Entre ces extrémités figure un écho plus ou moins lointain au texte original, comme les images dans les glaces déformantes d’une fête foraine.
L’allusion à la fête foraine n’est pas de hasard ; populaire par excellence, elle est une parenthèse dans le quotidien — même évidemment si elle appartient à la vie sociale ; ce qu’on y fait n‘a pas de conséquences : on tire sur des leurres, on tamponne des autos qui repartent, etc., donc tout est vrai (on a une carabine) et tout est faux (personne ne meurt).
Le premier poème part du début de la première des Élégies de Duino, dans les traductions les plus courantes, « Qui donc, si je criais ». La "fabrique" retient d’abord le cri dans sa matérialité (des sons), puis comme manifestation d’un trouble (« plainte »), écho au poème de Rilke, mais aussitôt « plainte » est entendu comme terme de droit ("plainte contre X"), ce qui autorise l’introduction de l’emprunt :
donc si je criais il en sortirait quoi d’arti
culé — au minimum un son, ça
c’est sûr, mais pas forcément une plainte
déposée par les voisins
ou l’on ne sait trop qui
La fabrique, ici, joue sur la polysémie et, avec le rejet du vers 2 (« culé »), introduit un vocabulaire familier, une des constantes ensuite dans le recueil.
Dans un poème construit à partir du treizième vers (« De rudesse envers moi, je veux tes mains baiser »), d’un sonnet d’Étienne Jodelle, des mots sont repris (« endurer », « meilleur ») ou légèrement transformés (« tendrelette » devient « tendre »), mais les gestes de l’amour ne sont plus ceux policés du poème, à ce qui n’est que suggéré dans le vers 14, « Si un baiser meilleur au moins ne te vient plaire », correspond crument ce que la Renaissance ne publiait que sous le manteau : « je veux tes mains baiser ta fente et ton anneau ». Bruno Fern introduit aussi des paronymes, en les liant avec « & », plutôt courant au XVIe siècle même si absent de ce sonnet, et en signalant leur présence : « avant que tous deux liés en corsage & en cor / dage — c’est le jeu qui veut ça ». Le jeu sur « corps », « sage » et « [d’] age » s’accorde avec les sonnets de Jodelle.
On appréciera ces "détours" parfois complexes, joués à partir de poèmes d’Apollinaire, Baudelaire, Villon, Zanzotto, Saint-Amant, etc., avant de suivre l’exercice d’une autre règle. Elle est énoncée dans une note à font 5 de E. E. Cummings : « Comment obtenir le mouvement en divisant les mots, c-à-d en composant par syllabe ? » (traduction Jacques Demarcq). Les phrases de départ sont, là encore, choisis dans des textes littéraires — on pouvait prendre des modes d’emploi ou des publicités, etc. — d’Apollinaire encore, de Christian Prigent, Malherbe, etc. Certaines « lignes », commencent à partir d’un fragment (Tristan Tzara, « Et si je m’égare c’est que je ») :
ET
si étêté je pique encore excusez-moi un sprint
et intègrent en cours de route une autre citation, ici, vers 2, la partie en italique vient d’Andrea Zanzotto.
SI
si en as des cascades qui saute de strates en strates
Ce n’est plus la relation au texte de départ qui importe, plutôt la construction de brefs récits en jouant sur la prononciation, par exemple, pour défaire l’attente du lecteur (qui s’arrête) ainsi, dans « je m’égare », la syllabe « m’é » devient « mes » et cette transformation est commentée : (…) je suis / M’É /propre pas, je m’épate moi-même mais / GARE / à ne pas se gargariser de haut langage.
La « ligne » prise dans le Sonnet en X de Mallarmé, « Aboli bibelot d’inanité sonore » suscite de multiples transformations analogues (« LI / tes râlements », au / BE / au milieu », etc.) et la répétition de la syllabe initiale : pLIés, Lisant, Lit, pâLIr, L’Identité, Lisible, Livide, reLIer, Lie.
On ne boudera pas le plaisir de retrouver un vers de Villon ou de Queneau (autre travailleur expert de la langue) point de départ des modifications que lui impose Bruno Fern. Ajoutons qu’au "détour" d’un jeu sur une syllabe il multiplie des allusions littéraires ; toujours avec le vers de Mallarmé, on reconnaîtra un (presque) fragment de vers de Nerval, « TÉ / nébreux consolable ».
Bruno Fern, Des tours suivi de lignes, Louisse Bottu, 2025, 96 p., 10 €.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bruno fern, des tours, suivi de lignes, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2025
Jean Tortel, Limites du regad

Transparent. C’est merveille
Immobile ici. Le seuil
Étonnant de jour dense.
(Exulter que cela
Soit tel. Et toute profondeur
Calmée.)
J’ai dit : dehors
Je subis une intensité.
Lame étalée d’argent ou langue
Aérienne et solide,
C’est à présent et pour m’y retrouver.
Lavé. Soleil.
Dire belles
Visible.
La verdure encore massive.
Le corps est là
Évidemment,
Luire ou lumière
Sur le gravier gris-bleu.
Cela doit se dire
Si proche que.
Jean Tortel, Limites du regard,
Gallimard, 1971, p. 88-89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean tortel, limites du regard | ![]() Facebook |
Facebook |
26/10/2025
Jacques Lèbbre, Les carrefours ou les regrets : recension
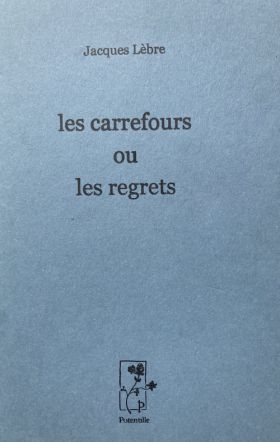
« Que sont-elles devenues ? »
L’autobiographie aujourd’hui prend les formes les plus diverses, du Journal, qui le plus souvent conserve ce que l’auteur(e) juge publiable, au roman où le "je" se donne plus ou moins clairement pour un double de l’auteur(e). Jacques Lèbre a choisi de revenir, dans douze poèmes en vers libres, sur quelques rencontres — non datées — avec des femmes, aimées parfois fugitivement ou simplement croisées. Il pourrait sans doute citer Apollinaire, « Les souvenirs sont cors de chasse / dont le bruit meurt parmi le vent » : quand le temps a effacé le vécu, il se souvient et relate avec des imprécisions, des erreurs quelques moments de ces "carrefours" qui, parfois, ont changé pour longtemps ses jours. Il retient aussi des "regrets", ces moments d’hésitation qui font disparaître ce qui était possible, ces empêchements de la vie aussi où l’on pourrait changer de voie.
L’ensemble touche à ce qui est intime, cependant la pose lyrique est éloignée en écartant des poèmes le "je", comme si un narrateur extérieur s’adressait à un personnage, avec un "tu", et auquel il rappellerait quelques épisodes de la vie passée. À côté de ce procédé, Jacques Lèbre accroît la distance en rapportant une rencontre sans aucun pronom personnel, mais en en notant les lieux, du premier où quelque chose va se passer (« l’escalier gravi », qui aboutit donc à un appartement) au dernier, le plus anonyme qui soit (« l’aire déserte d’une route »), en accord avec le ciel nocturne qui semble illustrer la fin d’une liaison :
une étoile filante comme la traîne d’un amour
qui déjà disparaissait tout au fond de l’horizon
Les autres lieux du poème connotent la nécessité de dissimuler la liaison : « Une traversée matinale du Jardin des Plantes », une gare, « une autre ville, à l’abri sous un pont ». « Discrétion » de la liaison interdite, mais désir de continuer à la faire vivre par la parole quand les amants se séparent, provisoirement ou non, ce qu’indiquent le premier et le dernier vers semblables, « Un numéro de téléphone longtemps su par cœur ».
Il n’est pas indispensable de suivre les récits dans le détail : certaines rencontres sont seulement souhaitées, pour respecter une éthique (on ne trompe pas l’amie avec qui l’on vit) mais qu’une femme trompe, elle, son compagnon pour vivre quelque temps une vie parallèle, est accepté. Une liaison n’a été vécue qu’« en pointillé durant vingt ans », alors que cette autre est délimitée dans le temps, restreinte à « quelques rencontres épisodiques ». Plus intéressant peut-être pour le lecteur et la lectrice, le lien entre ces récits et des modèles littéraires. L’un d’entre eux se situe précisément dans la ligne de l’amour, de la rencontre amoureuse selon les surréalistes ; une femme, présentée comme belle, monte dans un bus et, rapidement, sort de son sac une revue de poésie, face à celui qui écrit des poèmes, ce qui semblait rendre obligée une rencontre — qui a lieu. On reconnaît là le "hasard objectif" à l’œuvre par exemple dans la Nadja d’André Breton, d’autant plus nettement qu’ici l’acteur du récit, « un peu déprimé », était « sorti pour qu’il se passe quelque chose ». Une dimension tragique, inattendue, qui accroît le caractère littéraire, clôt le récit ; s’il est noté qu’il n’y eut que quelques « rencontres épisodiques », le sort de la femme est souligné, « maintenant : sa tombe dans un cimetière parisien / et quelques pauvres cailloux sur le marbre noir ».
D’autres poèmes rapportent cet imprévisible des mouvements de la vie, le chaos dans lequel chacun vit, dans les rencontres amoureuses ou non, et Jacques Lèbre ne met pas de côté des "regrets". Le désir d’une relation peut être partagé à un moment et plus tard le sens s’en est perdu pour l’un ou pour les deux. Une liaison ancienne et depuis longtemps terminée pourrait « recommencer » mais les gestes ou les paroles attendus ne viennent pas, une autre fois les mots ne manquaient pas mais il fallait sortir de ce lieu mal commode qu’est une poste et « Plus jamais, plus jamais tu ne l’as revue ».
Les souvenirs sont toujours une reconstruction du passé, souvent erronée, pour les carrefours comme pour les regrets, et Jacques Lèbre en est conscient. Il en donne au moins un exemple ; s’adressant à une femme autrefois aimée, il lui rappelle qu’elle avait porté une jupe jaune, « Non, (…) elle n’avait jamais porté de jupe jaune ». C’est presque toujours le hasard, encore une fois, qui appelle le souvenir — une rue, une phrase — et ne ressurgissent des « limbes » que des « bouffées ». Ce qui domine, c’est la perte et chacun ne sauve que des fragments de ce qui peu à peu s’efface.
Jacques Lèbre, Les carrefours ou les regrets, Potentille, 2025, 20 p., 10 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 4 septembre 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, les carrefours ou les regrets | ![]() Facebook |
Facebook |
05/10/2025
Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein ? : recension
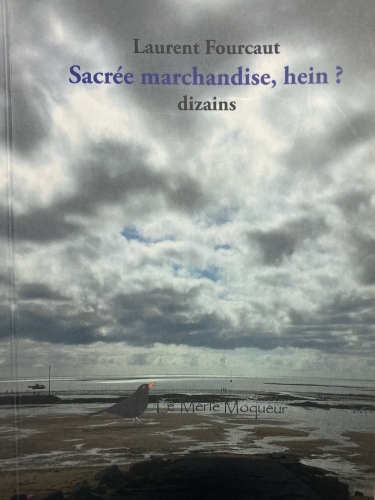
Comme le titre l’indique, Laurent Fourcaut a réuni des dizains (137), tous de dix syllabes et rimés. Renouant avec la tradition de la poésie française, il est aujourd’hui un des grands artisans du sonnet en alexandrins dont il a publié de nombreux recueils ; comme quelques écrivains du XXe (Valéry, Aragon) et du XXIe siècles (Cliff, Roubaud), il visite une autre tradition, celle du dizain ; il justifie avec humour cette infidélité à son vers favori dans le poème d’ouverture, "Palinodie" : « voici qu’un plus court amour vous hèle ». Presque tous ses poèmes sont de mini récits, parfois autobiographiques, régulièrement à propos de la nature, mais aussi autour des choses du monde — la langue, les mœurs, les inégalités sociales et autres malheurs dus au capitalisme triomphant.
L’un des plaisirs de la lecture des dizains de Laurent Fourcaut naît de sa maîtrise de la forme et de son jeu avec les contraintes qui y sont liées. L’organisation classique des rimes (ABABBCCDCD) est respectée et très peu sont fautives, comme « médecine-décime-mesquine » ou « étouffe-touffes-soufre ». Quand besoin est, un mot est coupé à la rime pour satisfaire la règle, parfois avec humour : « pas » rime avec « pa/rent » et « pac/se » ; pour la même raison, la finale -ique devient -ic (music, logic, etc.). On ne trouvera pas de fantaisie dans l’ordre des mots, est exceptionnelle cette construction : « où le monde des cartes que nous fûmes / rebat indifférent », manière d’écrire que l’auteur n’adopte pas. À l’inverse, une transformation morphologique patoisante comme : « seule chose à faire : qu’on se bougions / », s’accorde avec le choix de mêler les "niveaux de langue", on trouvera donc des élisions (v’là, c’te castration, vit’fait,, etc.) et un vocabulaire familier ou argotique (seulabre, cézigue, chibre, etc.).
Cette forme évoque ces bazars qui contenaient tout ce qui permettait les petits bricolages de la vie quotidienne, unité du fourre-tout propre à ces dizains. On y rencontre des figures de la mythologie (Vénus, Apollon, les Vestales, Pan, etc.) qui voisinent avec les noms de musiciens et d’interprètes appréciés de Fourcaut (Bach et Glenn Gould, Couperin et Monk, Erroll Garner, etc.), ceux de peintres (Chardin, de Staël, etc.) et d’écrivains (Ponge, Prigent). Un dizain peut être consacré à un musicien (Monk) ou à un écrivain (William C [Cliff]) ; le nom de Proust appelle une précision (« il narra la fin d’un monde qui croule »). De nombreux titres de dizains évoquent des œuvres variées, des pratiques (Art poétique ou catabase), des manières de parler (Vas-tu foutre ton camp), un standard de jazz (In the mood chanson de Glenn Miller), etc. Si « Qu’on voit danser » renvoie — plus ou moins facilement — à une chanson de Charles Trenet, la source de « mon sang se coagule » (Cyrano de Bergerac de Rostand) est moins évidente et les titres en latin, comme Et in Arcadia ego, requièrent une certaine complicité. C’est encore le cas pour Rosebud, nom de la luge qui symbolise l’enfance de Kane et ses jeux dans la neige, dans le film d’Orson Welles, Citizen Kane. Jeux culturels, certes, mais la littérature est partage d’un patrimoine et le lecteur y prend ce qui lui convient.
La neige est présente dans les dizains, comme ce qui est propre à chaque saison. Laurent Fourcaut est attentif aux changements de temps, il note la venue d’un orage, les variations de la lumière, les effets du vent, enthousiaste devant le ciel de l’aube et de ses couleurs le soir. Plusieurs poèmes commencent par une observation météorologique qui, souvent, donne sa forme à la journée (« vent pluie violente contre les vitres / », « Par dix degrés mais au soleil c’est sûr/ »). Une attention analogue est portée aux animaux, chassés, voués aux abattoirs alors qu’ils sont « en plein accord muet avec le monde ». Restent encore dans la campagne du Cotentin les oiseaux que l’auteur observe (mésange, bouvreuil, chardonneret), la plupart familiers — « un merle tout noir va sur la pelouse ». La ville, elle, a progressivement éliminé l’essentiel de la vie sauvage, « le vrai monde elle l’a réduit / ce qui fut libre et nu est cuit ». Il n’a pas pour autant un refus de la vie urbaine, Laurent Fourcaut vit en partie dans le XXe arrondissement de Paris et y apprécie les cafés, la bière (la Leffe), la vue des jeunes femmes, éléments de sa vie récurrents dans ses livres. Il évoque aussi bien de petits incidents (une chute après une marche ratée, la carte bancaire avalée) que les souvenirs d’enfance à Alger (« l’esplanade / où nous jouions au foot années cinquan / te »), l’achat d’un fauteuil et sa remise en état ou la commémoration de la Commune au Père Lachaise. Il revient plusieurs fois sur la longue durée du Covid qu’il analyse comme « premier symptôme majeur / du grave dérèglement planétaire / dû au capitalisme ravageur ». Ce sont ces ravages dans tous les domaines que les dizains explorent, fustigeant régulièrement « les gens du CAC ». Tous les aspects de la vie sont atteints, la consommation avec les "Grandes surfaces", « prédateurs voraces », le rêve des gens d’avoir « à domicile /leur bassin à eux à eux dans leur coin », la fiction des "réseaux sociaux" et des "amis", les divers « fesse bouc », lieux de l’égo avec leurs « accablantes niaiseries », le productivisme généralisé d’où les produits chimiques sur tout ce qui est consommé, l’illusion de la maîtrise de son petit domaine avec la prolifération des mots de passe… Le vocabulaire est aussi atteint avec l’introduction par les médias de mots dont l’air savant séduit, comme résilience, employés à tort dans les contextes les plus divers. Laurent Fourcaut rassemble une bonne partie des dégâts provoqués dans la société par le fait que l’argent est devenu à peu près la seule "valeur" ; l’immigré, par exemple, représente l’envers inacceptable d’une société repue et il n’y a pas de place possible pour lui — « les tentes des migrants sont découpées par les flics
Les dizains de Laurent Fourcaut présentent une société malade, incapable de voir, par exemple, quand elles sont là ces « feuilles neuves d’inespéré printemps » ; quand tout semble aller à vau-l’eau il faut cependant avec lui garder ses « propres mythes » : « il faut qu’ils tiennent (…) face (…) à l’informe du réel » et, refusant le désastre, répéter « à toi de jouer merle moqueur ».
Laurent Fourcaut, Sacrée marchandise, hein, Le Merle moqueur, 2025, 156 p., 12 €. Cette revendion a été publiée par Sitaudis le 15 juillet 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent fourcaut, sacrée marchandise, hein ? : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
06/09/2025
Jean-Marc Sourdillon, N'est pas là, : recension
« mords dans le citron vert »
L’absence la plus douloureuse à vivre est sans doute celle d’un proche — compagne ou compagnon, mère ou père, enfant — disparu : le manque de ce qui était vécu dans la vie quotidienne rappelle constamment une présence. Jean-Marc Sourdillon écrit à propos de deux vides de nature différente : d’abord, le départ d’un fils qui n’a plus de raison de rester dans le foyer familial, fils auquel on s’est efforcé de transmettre ce qui pouvait l’aider à être lui-même, conscient de ce qu’il était, qui disparaît brutalement ; ensuite, la mort d’une mère avec qui s’étaient construits un regard sur les choses du monde, peut-être une conception de l’amour, et certainement une partie de ce qu’il était. Le dernier ensemble, plus général et qui donne son titre au livre, s’attache à cerner ce qu’est le manque de repères lié à l’absence.
Un poème prologue, "Nos années-lumière" — 4 strophes de trois vers non comptés — s’écarte de ce qui suit : y est mis en avant le couple qui s’est construit avec, toujours, « Toutes les fenêtres ouvertes sur la terre (…) dans l’immense nuit stellaire sans fin ni commencement (…) et notre œil bien vivant, bien ouvert ». C’est à partir de ce socle, celui de la présence, que sont estimés les vides et d’abord le départ du fils. La rupture est d’autant plus sensible qu’elle a lieu à l’aube, en avion, éléments contraignants pour ceux qui restent puisque le temps de la séparation est compté, sans recours possible. En même temps, cette rupture est dite positive, la vie du fils ne sera plus celle d’un enfant mais d’un adulte autonome et elle est pensée comme telle lors du parcours vers l’aéroport ; le transport est vécu comme une « naissance dans la lumière », la voiture est comme « lavée par la lumière », et pour finir « Nous décollions tous les trois, lui, elle, moi, vers le ciel, cet avenir, cette lumière. La lumière de septembre. »
La disparition met en cause l’existence même de celui qui reste en ce qu’il ne peut penser l’Autre, le fils, comme Autre, mais comme une partie de lui-même, « de tu à l’intérieur ». Le narrateur transforme les rôles, le fils représentant pour lui au plein sens du mot « La fin de [s]a naissance », « comme si c’était lui [le fils] le père ». Ce qui est répété sous différentes formes comme « Je suis né avec lui », « il m’a donné mon nouveau moi ». L’insistance du père à mettre en avant une relation caractérisée par l’idée que le fils est à la source de sa re-naissance explique la violence des effets de la rupture, restituée par le vocabulaire : il devient « coque vide abandonnée », il est « brisé », « explosé », « effondré ». Cette destruction provoquée par le manque s’oppose à la relation heureuse où se vivait la transparence, traduite par une série d’anaphores (« Avoir + partagé, logé, habité, senti », etc.), l’une marquant sans ambiguïté le désir du père — ou sa certitude — d’avoir été "lisible" pour le fils : « Avoir avec lui, devant lui, déposé les armes, les masques, les postures, et surtout celles du langage qui sont les plus dures et qui font mal ». Il est certain que la douleur provoquée par ce vide change tous les aspects de la vie, d’autant plus vivement que rien ne le laissait prévoir, « Avion en plein vol désintégré ». Comment vivre après ?
Là où il n’y avait eu rien, l’absence de tous et de quelqu’un, il y avait de nouveau quelque chose. Quelque chose d’intensément lumineux, mais de révolu, de lointain, d’oublié. Pas pour autant perdu, pas encore perdu. Rappel à l’ordre, à la vie, à la naissance sous la forme d’un deuil, d’un presque deuil.
La lumière du début revient, parce que « l’amour continue. en mémoire ». Il est toujours là aussi pour la mère, « même morte, une mère ne s’efface pas ». Le narrateur a vu sa mère malade, épuisée, acceptant sa solitude et, jusqu’au bout, avec « la faim de vivre » ; il a vu aussi le corps maternel mort, « Du vide sous la forme du plein, une absence de pierre gelée ». Comme son fils, il était parti parce que la rupture était nécessaire, « parce qu’il le fallait, parce que c’est ça, vivre ». Le fils permettait de re-naître, la mère disparue il faut « réapprendre à marcher, c’est-à-dire à faire ressurgir l’origine », reconnue dans une petite photographie — comme si le nouveau-né ne pouvait-être que sur une image à sa taille — où l’enfant et la mère semblent se "reconnaître" comme unité. Une paronomase exprime clairement ce lien, « Tout part de là, tout parle de là ». Aussi forts que l’image témoin, le lien est traduit par la voix, le cri de la naissance et, tout au long de la vie, la voix de la mère, la voix de l’aimée, la voix du père, et encore par la voix de ceux /celles qui font regarder autrement le monde — ici Philippe Jaccottet, Maria Zembrano* — qui, chacune à leur manière, apportent la lumière. L’anaphore, comme dans la première partie, met en valeur cette fonction de la voix, voix « par quoi je se fait et se défait quand il dit qu’il aime ou qu’il le voudrait », une voix « pour sortir de soi ».
La prose du dernier ensemble devient verset, avec la reprise continue de « n’est pas là » : celui, celle qui, comme la mère, a disparu mais reste à tous les moments de la vie présent en soi, donnant toujours sa "lumière", sa voix toujours entendue. C’est pourquoi cette méditation sur l’absence est du côté des vivants. Pour Jean-Marc Sourdillon, la vie demande à sans cesse renaître, à dire « mords dans le citron vert ».
- Jean-Marc Sourdillon a écrit sur l’œuvre de Jaccottet et de Maria Zembrano, qu’il a traduite.
Jean-Marc Sourdillon, N'est pas là, Gallimard, 92 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 18 juin 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-marc sourdillon, n'est pas là : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
13/07/2025
Hélène Sanguinetti, Jadis, Poïena, une poème : recension
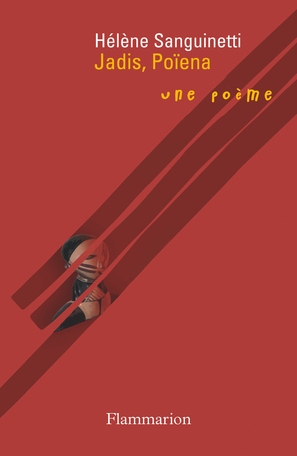
Un livre a souvent une histoire, Hélène Sanguinetti raconte dans un Avant-propos la genèse de Jadis, Poïena (une poème), qui réunit un texte récent (il donne son titre au livre) et Fille de Jeanne-Félicie, que le responsable de la collection, Yves di Manno, tenait à reprendre. L’autrice était à ce moment « certaine d’avoir écrit un premier livre, méritant ce nom » et elle en déposa en novembre 1986 le manuscrit chez René Char qui l’apprécia beaucoup. Se relisant, elle distingue deux sortes de "jadis" d’un livre à l’autre : le jadis étroit du destin particulier et le grand jadis du mythe et de l’histoire universelle. La continuité entre l’un et l’autre, entre ces poèmes éloignés dans le temps est dite autrement, l’individu est inséré dans l’ensemble du vivant : « Même si fleur fichue / une autre arrive / pour fleurir / c’est pareil chez /petits, grands animaux / et autres espèces / innombrables ».
Le titre appelle plusieurs remarques. Le français poème est emprunté au latin poema alors que Poïena l’est au grec poïena (de poïen, « fabriquer ; créer ; composer des poèmes ») ; « Le "e" final de "poème" est / le reste du "a" finalement avalé / par les flots autrefois ». "Une poème" se justifie par le caractère féminin de Poïena et par la volonté de féminiser des mots qui semblaient ne renvoyer qu’à une activité masculine. Poïena est un personnage du livre dont on trouve la trace sur les couvertures : la quatrième porte l’image d’une « terre cuite polychrome de l’auteure (2013) » et la première une silhouette — l’une et l’autre peu identifiables. Il est présent avec la narratrice dans le récit fragmenté qu’est le livre, sa "vie" n’étant guère séparable de celle de la femme qui, parfois, ne s’en sépare pas, « Dans les bois, je marchais, / Poïena, / sous mon bras, et dans mon cœur, ». Le plus ancien Fille de Jeanne-Félicie, est composé de courts poèmes en prose.
À travers les poèmes des deux ensembles, le récit d’une vie se construit, labyrinthique parce que le plus souvent allusif. Il s’agit de moments de la vie vécue et non d’un temps inventé, d’inspiration, et l’on constate qu’aux voix qui scandent ce qui est en rapport avec Poïena, donc avec une sculpture, d’autres rejettent violemment ces évocations avec un vigoureux « ON S’EN FOUT ». En dehors de la référence à la Grèce antique, avec les Furies et les Muses (qui sont d’ailleurs écartées), et au monde médiéval avec l’adresse « Douce enfant, beau neveu », les renvois à la littérature sont peu nombreux. Un poème, par exemple, commence avec le souvenir d’Apollinaire : « Cors de chasse et / bruit du vent » fait allusion aux vers de Cors de chasse : « Les souvenirs sont cors de chasse /Dont meurt le bruit parmi le vent » ; un autre évoque Le dormeur du val de Rimbaud (« un soldat tête nue / couché au fond /etc. »). Les lieux sont précisément notés, essentiellement à Marseille et à proximité de la ville — rue Bernex, BouBel-Air, la Maronaise, etc.
Dans Jadis, Poïena (une poème), deux ensembles de courtes proses, titrées "Fille de", s’éloignent du ton des poèmes, entièrement pour le premier centré autour de la vie de la narratrice dans la famille : courts récits à propos du décor, de ceux qui y vivent et de ce qui s’y passe, la chambre, les remarques d’une voisine, la mère, la cuisine, un amour d’enfant, le père et sa nudité dans l’ivresse — d’où la découverte du sexe masculin. Le second ensemble ("Fille de 2") est consacré à ce qui est extérieur au cercle familial, la nuit, la rue, la campagne, la mer, etc., à la nécessité aussi de se défendre contre les attouchements des garçons un terme exprime la violence des gestes : le verbe furer, (de même origine que forer), ici « toucher de manière indiscrète » (« ses doigts dessous entre tes cuisses, j’aime furer les blondes »).
Si le lecteur hésite quelquefois à interpréter, c’est qu’Hélène Sanguinetti se garde de la pseudo transparence des sentiments ; ainsi, sans qu’une liaison ait été dite clairement intervient la rupture, restituée sans phrases, « Après/ la porte de la rue a claqué / C’est fini, répète, c’est fini, / encore / répète, FINI ». Peut-être y a-t-il peu à dire dans la plupart des événements de la vie, à côté de quelques questions sans cesse posées et reposées :
Qui suis-je d’où
viens ? où
vais ?
et personne jamais
pour répondre
La seule chose certaine, c’est le mouvement du monde et qu’il est vain de chercher une réponse à sa propre présence : mieux vaut laisser en soi « un peu d’ombre ».
On sera attentif aux formes choisies et d’abord l’économie de la ponctuation essentiellement limitée à la virgule, souvent « finales » qui, alors, « accélèrent l’écriture », la suppression souvent de l’article défini. On ne comptera pas les jeux entre romain et italique, majuscules et minuscules, avec les interlignes, les polices, etc. ; il faut ajouter l’usage d’onomatopées et, surtout, de petits points en lignes variées. Ces caractéristiques (absentes du second ensemble) suggèrent de lire l’ensemble des poèmes à haute voix, comme y incitent également les sous-titres « Scène », « Voix », et ce beaucoup plus que les brefs énoncés familiers (« Je saute mais / putain / regarde-moi ! »). À lire Hélène Sanguinetti, qui publie aussi une anthologie de ses textes (Lanskine, 2025), on se dit avec elle, « Hue les mots ! ».
Hélène Sanguinetti, Jadis, Poïena, une poème, Poésie/Flammarion, 2025, 156 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 27 mai 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |