31/01/2024
Jean-Louis Giovannoni, Le grand vivier, Journal 2020-2021 : recension
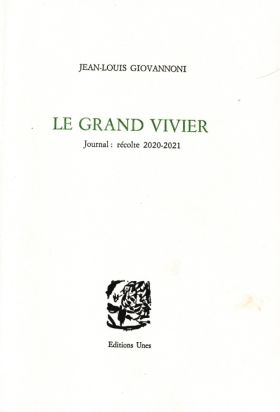
« Rien ne nous attend en dehors de nos inventions »
Le journal — "journal intime" est un pléonasme — n’est en principe pas destiné à la publication ; que l’on pense aux écrits de Joubert (1754-1824), dont des extraits ont été édités sous le titre de Recueil de pensées de M. Joubert, par Chateaubriand, intégralement en 1939 avec le titre Carnets. Depuis la seconde moitié du XIXe, d’abord avec les Goncourt, puis Léon Bloy, le journal devient un genre à part entière : une partie d’une œuvre est constituée par un journal publié à intervalles réguliers (Julien Green, Charles Juliet) et certains écrivains donnent à lire leur journal peu après sa rédaction (Christian Prigent, Pierre Bergounioux). Le grand vivier répond aux règles générales du journal, avec la mention des dates, de ce qui préoccupe le narrateur ; pourtant, l’un des extraits mis en exergue, « Je sais ce qui est autour de moi » (Wallace Stevens) pourrait donner une idée erronée de son contenu.
Le journal s’ouvre avec la date du premier confinement, le 17 mars 2020, et son effet visible, « Rien ne bouge. Personne dans les rues ». Cela paraît peu vraisemblable mais annonce la perception particulière des choses du quotidien ; une partie de ce qui entoure Giovannoni est constamment transformée et ce dès la note du 18 mars : il constate que les objets restent muets et qu’avec eux la relation affective est médiocre, maladroite. Ils peuvent d’ailleurs sembler prendre vie, sans le manifester clairement ; ainsi les vêtements sur leur support, note le narrateur, « n’attendent qu’une chose : mon corps » et souvent semblent bouger ; le savon fendillé sur le lavabo rêve visiblement de l’eau. Les meubles restent dans un silence « inentamable » mais leur rôle n’est pas négligeable, il est indispensable de les heurter pour « continuer à se sentir vivant ».
C’est qu’en effet le corps même du narrateur n’a pas d’assise suffisante pour se reconnaître comme tel ; à intervalles réguliers, il perd sa réalité jusqu’à rencontrer son autre lui-même : « Je ralentis toujours avant de franchir une porte. Peur de me croiser au détour d’un couloir ». Comment « se sentir fidèle à soi-même » devant le miroir quand on a le sentiment d’y voir chaque fois un inconnu. En outre, ce que font les personnes observées depuis le balcon n’est pas interprétable — des gens à leur fenêtre applaudissent, sans que l’on en ait la raison —, une dame se promène une laisse à la main — le chien, peut-être devant ou derrière elle, n'apparaît pas ; etc. L’hallucination n’est pas loin quand, dans une file d’attente le narrateur imagine sentir qu’on le pousse dans le dos alors que personne n’est derrière lui, la répétition de cette sensation l’inquiète et le fait partir.
L’espace même perd sa stabilité. Le balcon devient pont de navire et « appuyé au bastingage », « on a coupé les amarres ! » et l’on voit les immeubles s’éloigner ; d’autres demeurent à quai, le sable dans les rues s’accumule et pourrait devenir dune. Au paysage urbain se substitue la mer, l’absence de repères et la fin des relations sociales. Avec un scénario analogue le narrateur quitte la ville rêve avec le désir de s’envoler depuis le balcon, il verrait aussi volontiers des morceaux de son corps partir dans le vent. Une autre forme de disparition imaginée est fondée sur la réduction du corps : il rétrécit et « se glisse dans une boîte hermétique placée au fond d’un tiroir » ; on pense aux sculptures que Giacometti gardait dans une boîte d’allumettes. Ici, le narrateur souhaite que la boîte soit oubliée, du même coup sa propre existence.
Ce n’est que très rarement qu’un autre personnage — un "tu" — apparaît dans le livre. La nuit, le narrateur touche un visage (« ton visage ») ; plus avant, une scène est probablement rêvée, liée à la "vie" des pierres ; il jette au loin, note-t-il, « la pierre que tu m’avais offerte ». Restent le chat, les joggeurs du matin, quelques voitures, un voisin à sa fenêtre avec des jumelles. Pas de rupture dans les notations. Ce qui est extérieur au corps n’acquiert une existence que si des phrases ont été écrites, « Ces corps ne frémissent que si des phrases, des sonorités de mots bougent en moi, en lieu et place de cet arbre, de ce mur, de cette maison… à jamais dehors et moi à jamais dedans. » Les choses, les personnes ont perdu leur réalité et la fin du confinement, pour l’essentiel, ne change pas la vision du narrateur. Cependant, il faut continuer à vivre et puisque tout est désormais à nouveau en ordre, « on peut sortir ».
Jean-Louis Govannoni, Le grand vivier, Journal 2020-2021, éditions Unes, 2023, 176 p., 23 €. Cette recenion a été publiée par Sitaudis le 24 décembre 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
28/01/2024
Patrick Kéchichian, L'écrivain comme personne : recension
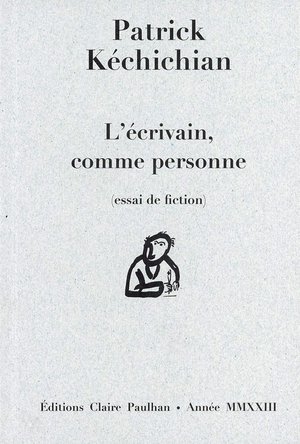
« Un récit ? Non, pas de récit, plus jamais », ce refus de Maurice Blanchot, dans La Folie du jour, est un des quatre textes mis en épigraphe et repris dans l’un des trente chapitres de quelques pages du livre. Au cours de la lecture, on relève encore « on ne réécrit pas l’histoire, et pas davantage sa propre histoire ». De quoi donc s’agit-il ? non d’une autobiographie — on y reviendra — mais du parcours complexe qui aboutit à cet "Autre" qu’est l’écrivain. Pour autant que l’on puisse se dire « écrivain » : dans sa préface, Didier Cahen souligne l’ambiguïté du titre, comme si Patrick Kéchichian « jouait des mots pour dire deux choses en une ».
Le livre, l’écrit sont vécus comme fondateurs depuis l’enfance, comme si pour Patrick Kéchichian les premiers contacts avec l’extérieur étaient passés, d’abord, par les mots, ceux reçus, entendus et lus, tout autant ceux écrits pour essayer de transcrire — non de décrire quelque chose de ce qui s’éprouvait et, de cette manière, « découvrant le monde en se découvrant lui-même au bout de son crayon ». Expérience particulière de construction du "Je", cette certitude, ou illusion, que l’écriture, les mots ont faculté d’atteindre le vrai des choses, de soi. Ce qui conduit pendant un long temps à accumuler les pages, cahiers, feuilles volantes et, sans doute dès les premiers essais, à multiplier les énumérations pour cerner au plus près ce qui (sa propre vie, le monde) resterait sinon opaque, obscur. Tout ce qui fait les jours devrait donc être noté, les mots sur la page conférant aux instants les plus divers du vécu un supplément de réalité. Une citation, amputée de son début et de sa fin, éclaire sur la diversité des « fragments d’existence » que conservait Patrick Kéchichian :
(…) souvenirs dépareillés, rêves éveillés, ensommeillement et/ou insomnies, obsession du recensement de soi, drames et anecdotes, additions minutieuses ou multiplication de vétilles, inventaires dûment consignés des nostalgies et des regrets, troubles de l’esprit encourageant ceux du comportement, deuil prolongé, rires couverts de pleurs et inversement (…)
Cette liste partielle fait comprendre le caractère anarchique de ce qui est retenu et l’impossible approche du livre désiré, dont les mots auraient un peu restitué des « images de l’invisible et [des] figures, même approximatives, de l’existence ». Livre qui donnerait à lire la vie de quelqu’un, mais « étoffée et dramatisée par l’auguste geste d’écrire ». Feuilletant les nombreux "récits de vie", journaux, carnets édités ces dernières années, le lecteur sait bien qu’ils relèvent d’une imposture — Jude Stéfan avait très justement publié des bribes d’un journal (plus ou moins inventées) sous le titre Faux journal. C’est cette imposture qui arrête Patrick Kéchichian, « tout ce qui pouvait être narré, (…) rapporté, encensé, pensé, analysé, catalogué, comptabilisé trouvait, en marge du livre à venir (…) une possible expression ». "Livre à venir"1 donc, qui ne peut être écrit qu’en sortant de l’imposture, du désordre pour lui « opposer l’idée, la volonté, le projet, la recherche d’un ordre. »
Abandonner les facilités des notes d’un journal, "intime" ou non, ne peut se décider qu’après une prise de conscience de « l’ampleur de [son] ignorance, de la hauteur et de la profondeur de [son] désarroi » ; la conscience est la « porte du discernement », ce qui donne la possibilité d’une certaine cohérence à « des fragments, des bribes, des lambeaux de cette histoire invisible » qu’est une vie. Non pour écrire sa vie comme exemplaire, mais l’écrire « hors de tout titre de propriété » — et devenir écrivain. En sachant alors qu’écrire n’est pas « une fonction, un métier, un statut, sauf à accepter de porter sa vie durant un masque (…). L’être de l’écrivain est vide, disponible (…) » et « Ce vide, cette absence (…) sont habités par l’acte présent d’écrire ». L’une des lectures du titre du livre est en relation avec cette affirmation et est explicitée dans ce parcours à propos de ce qu’est écrire, « Je suis quelqu’un pour la seule raison que je ne suis personne ». C’est cela qui autorise Patrick Kéchichian à projeter un « livre de vie et de vérité, de nudité et de lumière », qui l’a guidé également dans son activité de critique : il lui fallait toujours, écoutant « la voix de l’autre », non pas disparaître, effacer ce qu’il était, mais « la restituer à elle-même, (…) lui faire écho » ; c’est bien le même qui écrit un « essai de fiction » et à propos d’un livre.
On reconnaît dans cette méditation sur « l’étrangeté de la parole littéraire »2), sur la difficulté à en rendre compte, au-delà d’une certaine proximité avec Maurice Blanchot, les traces d’un lent cheminement, d’une volonté de comprendre. Comme si Patrick Kéchichian avait eu à cœur d’éclaircir ce qui était resté très longtemps obscur, « Il y avait en moi, depuis l’enfance, sans que j’en prisse l’exacte conscience, encore moins la mesure, une attente, une mystérieuse alerte, une gestation secrète du cœur ».
Patrick Kéchichian, L'écrivain comme personne, éditions Claire Paulhan, 2023, 160 p., 18 €. Cette recension a étépubliée par Sitaudis le
1 Le livre à venir est le titre d’un livre de Maurice Blanchot, repris à nouveau au début de l’avant dernier chapitre de L’écrivain comme personne.
2 Maurice Blanchot, op. cité, p. 39.
Patrick Kéchichian, L'écrivain comme personne, éditions Claire Paulhan, 2023, 160 p., 18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick kéchichian, l'écrivain comme personne, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
22/01/2024
James Sacré, Les animaux sont avec toi, depuis toujours : recension
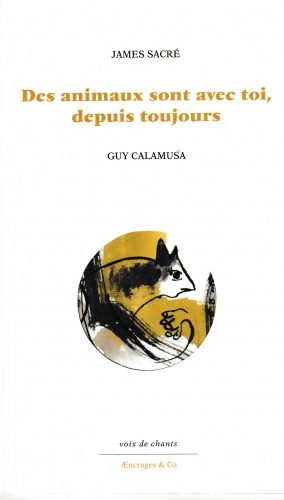
« Les animaux sont avec toi, n’y sont pas »
Les animaux sont présents depuis fort longtemps dans les poèmes de James Sacré et apparaissent même dans des titres, sans précision (Un oiseau dessiné sans titre et des mots, 1988) ou avec le nom d’un animal, Le taureau, la rose, un poème (1990). Un des titres, Des animaux plus ou moins familiers (1998) est devenu un vers de ce nouvel ensemble de cinq poèmes et pose la question de la familiarité, de la relation entre l’animal et les humains.
Les poèmes ont partiellement la forme de récits où, notamment, est évoquée l’enfance du narrateur — une figure de James Sacré ; elle s’est passée dans une ferme de Vendée et les animaux du quotidien étaient liés au travail agricole, la vache, la jument, le chien (qui fait revenir les soir les vaches à l’étable et accompagne à la chasse), la perdrix que l’on chasse ; ailleurs, au Maroc que connaît bien le narrateur, l’âne est aussi un auxiliaire précieux pour le travail et le transport. Écrire à propos des animaux si longuement fréquentés, c’est revenir vers des images de l’enfance qu’il faut rappeler régulièrement à la mémoire mais qui, cependant, s’effacent, comme les paysages que les remembrements successifs ont détruits. Le passé se réduit à des mots, le temps a fait son œuvre.
Que dire alors de cette présence familière des animaux, autrefois à la ferme, aujourd’hui dans la maison ou l’appartement pour beaucoup de nos contemporains ?
Quels liens se créent entre les animaux et celui qui les côtoie, utilise leurs aptitudes ou se limite à leur compagnie ? La familiarité instaurée conduit à leur donner un nom (pas un nom et un prénom), dans la ferme : « le chien Bob », « Les vaches / Chacune avec son caractère / La tranquille Blanchette, la Charmante / L’insupportable Muscadine / (…) Ardente la jument ». Cette tentative de rapprocher l’animal de l’humain rencontre vite ses limites. Que voit-on dans les yeux de l’animal ? interroge James Sacré. La peur, la méfiance — au moins échappe-t-il à la folie qui n’est qu’humaine. Combien de fois entend-on « il ne lui manque que la parole », à propos d’un chien ou de tout autre animal familier. C’est ainsi, involontairement, souligner l’impossibilité d’un échange par manque d’une langue commune, les gestes ne suppléant pas à tout : « Tu sais peut-être comment ton chien ou ton cheval / Vont répondre aux gestes que tu as/ Mais tu ne sais pas / Ce qu’ils pensent ».
Il n’y aurait rien d’autre à partager que le silence, la solitude. On sait bien que le mot « cheval », le mot « chien » ne sont que des mots. Ils suscitent pourtant des images venues des livres, des contes de l’enfance. Mais comme les souvenirs, ce sont des images qui « S’enfuient, charpie de quelques mots / Au fond des brumes du temps ». Dans le poème, les mots semblent prendre vie par la « musique et [le] rythme, mais est-ce bien un bison que l’on voit dans ces vers rimés ?
Le dessin d’un bison bourru
Ou le mot bison (désir éperdu)
Serait quelle vraie bête accourue
Sur de la pierre ou du papier nus ?
Dessin ou mots restent à jamais silencieux dans le poème, ils ne se mêleront pas aux bruits de la nature et les nombreux mots recopiés qui caractérisent les bruits émis par les animaux ne sont toujours que des mots, « c’est rien qui rugit ou qui couine ».
Écrivant à propos des animaux, James Sacré n’abandonne pas des thèmes qui charpentent ses livres, comme l’extrême difficulté de l’échange avec l’Autre, ici l’impossibilité humaine de sortir du silence face à l’animal. C’est aussi le temps de l’enfance, temps perdu de la proximité des bêtes totalement coupé du présent, que les mots ne feront pas revivre. « Si des animaux parlés, dessinés / Sont le vide et l’ailleurs / Du poème qu’on vient d’écrire ? »
James Sacré,Les animaux sont avec toi, Peintures de Guy Calamusa, Æncrages & Co, 2023, 40 p., 18 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis, le 21 novembre 2023.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, les animaux sont avec toi, depuis toujours | ![]() Facebook |
Facebook |
11/01/2024
Liliane Giraudon, La jument de Troie : recension

Dans un "livre d’artiste" contemporain, dessins ou peintures accompagnent des poèmes, accompagnement dont les écrits peuvent souvent se passer. Tout autres sont les livres dans lesquels poèmes et dessins sont étroitement liés, hier par exemple avec Les Mains libres, "Dessins de Man Ray illustrés par les poèmes de Paul Éluard", aujourd’hui Pierre Alferi écrivain et dessinateur dans divers chaos. Le dessin ou la calligraphie est parfois le poème lui-même ; souvenons-nous qu’Apollinaire avait eu le projet de réunir ses calligrammes sous le titre Et moi aussi je suis peintre.
Liliane Giraudon propose un titre, par exemple "Poème intervalle", calligraphié en vert, et ce qui pourrait être la représentation en couleurs, mauve et vert, de ce qui est alors interprété comme un intervalle. Le lien entre titre et dessin stylisé semble clair la plupart du temps ; par exemple encore, sous "poème casserole" le dessin d’une casserole que l’on reconnaît comme telle sans le secours du titre. Dans bien des cas pourtant, le dessin pourrait représenter tout à fait autre chose que ce qu’annonce le titre ; la relation entre un ovale rouge et le titre "poème vaginal" n’existe que par leur proximité, de même, cet ovale rouge traversé par une ligne ne sera pas toujours reconnu, sans son titre, pour être une vulve. Les critères en œuvre sont très variés — c’est un des plaisirs de la lecture que de chercher les liens entre l’écrit, qui est une annonce et le dessin : « poème toasté » laisserait penser qu’un poème pourrait être (sur) un toast…, le dessin donne à voir deux toasts qui portent quelques traits (6 et 8) à interpréter comme étant de l’écriture (donc le poème écrit), ou le dessin lui-même est le poème.
On échoue parfois à lire une relation qui devait être évidente pour l’auteure. Le titre "Poème maman" précède une série de lignes, de couleurs différentes, qui se croisent, chacune ayant une entrée en bas de page mais aucune de sortie ; on peut imaginer bien des connotations, pas vraiment positives ici, attachées au rapport à la mère. Il est plus difficile, semble-t-il, d’interpréter la relation entre le titre "Poème papa" et le dessin qui le suit, sorte d’intestin en trois parties, rouge, verte, bleue : c’est un des cas où la sagacité du lecteur est nécessaire. Pour l’ensemble, on peut apprécier l’humour (parfois potache) de l’auteure. Le "Poème singe" surmonte un buste, le visage seulement figuré par le tracé de la tête et une forme orangée à l’intérieur ; l’ensemble est en rapport avec le texte, paginé, qui précède les dessins titrés et est annoncé par « Guenon, je singe ».
Le passage du singe à la guenon est analogue à la substitution de la jument au cheval dans le titre du livre ; Liliane Giraudon précise qu’ici « Pénélope répond à Ulysse. / Ithaque c’est terminé. Elle ne brode plus mais dessine… ». Elle rapporte aussi dans les quelques pages liminaires son parcours d’écrivaine, transformée par la lecture de Reznikoff, la maladie (« Arrivée du crabe ») qui l’a conduite au dessin, « Dans une pratique de substitution ». Elle évoque le Bauhaus et la Black Mountain, deux lieux d’expériences et de formation qu’elle aurait souhaité connaître, et Anni Albers artiste textile qui y fut présente. À partir de la « séquestration imposée à tous », en 2020, elle entreprend chaque jour ces « Poèmes)(Dessins », devenus aujourd’hui, ajoute-t-elle, une « Sorte d’acte de survivance. Traçant les lignes de ma propre survie comme celles de l’objet du poème ».
Pour le lecteur, qui passe du "Poème aphasique" au "Poème casselangue", outre le plaisir de découvrir cette accumulation de poèmes-dessins, il ne manquera pas de s’interroger à propos de ce qui est « poésie » (voir Les Mains libres). Au moins lira-t-il la fin de l’introduction de la guenon : « La quasi-manie d’une « qui ne sait pas dessiner » devient un virus dans la Forteresse du Monument-Poésie ».
Liliane Giraudon, La jument de Troie, P.O.L, 2023, np, 18 €. Cette recension été publiée dans Sitaudis le 17 novembre 2023.
P.O.L, 2023
np
18 €
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liliane giraudon, la jument de troie, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
28/12/2023
Ludovic Degroote, La début des pieds : recension

Si l’on se fiait seulement au titre, saurait-on que La Sorcière de Rome(André Frénaud) ou La pluralité des mondes de Lewis (Jacques Roubaud) sont des livres de poèmes ? Ceux qui annoncent leur contenu ne sont pas les plus nombreux, loin de là, tels Ode pour hâter la venue du printemps (Jean Ristat) ou Poésie ininterrompue (Paul Éluard). Sauf à connaître l’auteur, la plupart des titres n’orientent pas le lecteur vers un genre plutôt qu’un autre. Le début des pieds est un exemple de titre qui surprend ; les nombreux blasons du corps, depuis Marot et son Beau tétin, n’ont retenu que des parties du corps communément érotisées, de du Bellay à André Breton. De quoi s’agit-il chez Ludovic Degroote ? Le titre apparaît dans la première partie "un peu de monde" : « avec la bière le vin la quiche le fromage le pain et le dessert je ne suis plus qu’un ventre chaque jour / je ne vois plus que le début de mes pieds » — c’est aussi le titre de la troisième partie, après "un peu plus au bord".
Des poèmes autour du corps, de la place du sujet dans le monde, de la solitude, de la disparition se construisent à partir de ce type de notation. On ne quitte pas le lyrisme, mais il s’accompagne d’un certain détachement, et d’un humour, qui ne sont pas sans évoquer les grands moralistes classiques. La forme même du texte, proses brèves et rythmées réunies en courts ensembles, renforce le rapprochement. Les motifs sont agencés de manière complexe, on retient celui, récurrent, de la solitude et de la difficulté de vivre dans le monde, déclaré dès l’entrée : « il y a des jours où j’embrasse le monde à pleine bouche, j’y mets toute ma langue, et je ne sens rien ».
Il est inutile d’essayer de trouver une place dans ce monde, où l’on est et dont pourtant on se sent séparé (« c’est comme si le monde se dérobait à force que je sois dedans »), puisque ce n’est pas le monde qui exclut, mais ce que nous sommes, vides, sans regard pour autrui : « nous voyons cet effondrement du monde comme s’il était séparé de nous alors qu’il ne s’agit que de notre propre effondrement — nous sommes séparés du monde ». Vertige de l’inquiétude, de l’incertitude, de savoir que chacun vit la « faille du présent [...] sans cesse recommencée », la chute vers « le manque » — la mort —, mais que rien n’est dit, que tous vivent dans le silence. Solitude irrémédiable : chacun tombe /de son côté / sans heurter les vides / qui nous relient ».
Que faire de sa peur ? La supporter, puisque rien ni personne ne peut réduire ce qui est ruine en soi et l’« on ne se débarrasse pas si bien de soi ». S’enfermer pour ne plus vivre, au moins provisoirement, l’instabilité du dehors. Le monde n’est alors "visible" que par le biais des images : il est alors suffisamment à distance, et donc sans danger : le "je" oublie alors quelle place il y occupe et ce qu’il est lui-même : « et par instants je ne sais pas d’où je viens, j’aime bien la télécommande, le monde je le choisis tant pis si ça n’est pas vrai à l’instant qu’il défile sous mes yeux […] quel bonheur à la télé tout coule ». Ce retrait, qui s’exprime souvent, permet à bon compte d’être « constamment ailleurs » et de ne retenir du dehors que tout ce qui ne peut blesser et parfois même ce que tous s’accordent à estimer "poétique" : « je regarde la télé / la fenêtre est ouverte / on entend les oiseaux ».
Il y a chez Ludovic Degroote une manière tranquille de reprendre les motifs du lyrisme et d’aller à côté, du côté du politique, « j’essaie de m’en sortir / nous n’avons pas la chance de vivre au darfour » ; manière affirmée dans une esquisse d’"art poétique" sans concession. Parce que la poésie n’a pas à se limiter à la seule évidente subjectivité (Ah Frappe-toi le cœur, c’est là qu’est le génie), qu’elle n’a pas de thèmes privilégiés. Pourquoi pas les pieds plutôt que la douleur amoureuse ou les petits oiseaux ?
j’ai envie d’une bière
voilà de la poésie prise au vif
58% de français se plaignent de la poésie contemporaine leurs attentes ne sont pas satisfaites, ils pensaient que ce serait autre chose, ils ont déjà tant de mal, c’est inutile d’en rajouter, ils croient qu’on le fait exprès
Voilà bien une autre façon d’en rajouter… Rien de plus immédiatement lisible et bien éloigné de ce qui est rangé, classé, étiqueté dans la case "poésie". Ce qui est écrit repose bien sur une expérience du monde sans emprunter les formes répertoriées, mais avance « par petits bouts sans suivi de rien ». L’écriture n’est pas moyen de guérir de la difficulté d’être là, et évacuer la poésie-pansement, comme la poésie-décorative, est travail de salubrité publique, revigorant pour le lecteur.
j’aimerais bien pouvoir écrire que le petit pansement c’est l’écriture ou que l’écriture en ôtant le pansement met le monde à nu plaie du monde plaie de soi écrire quelque chose active son petit symbole et apporte sa grandeur au poème j’aimerais bien écrire une petite obscurité populaire en achevant le torrent oh raim du peuple libre incendie le froid chambranle des montagnes
mais j’en reste à la vie qui nous ronge
Le début des pieds est suivi d’un ensemble de poèmes titré Ventre. Les poèmes sont composés cette fois de vers très courts, avec parfois jeux d’assonances et allitérations (« langue gavée gangue », « rien rot mot air mort », « mots hachés hachis ») et une syntaxe brisée, les éléments de la phrase juxtaposés ou la phrase inachevée. On pense parfois aux derniers textes de Samuel Beckett ; par exemple : « durer pour durer / encore un peu même si / peu qui quand même /avant drap ongles et chapelet blancs / », etc. Comme s’il était difficile, voire impossible de dire ce qui importe, le manque, la solitude, la perte, la fin, comme s’il fallait le ressassement pour que le vide de toute vie soit perçu — « et partout des mots / qui cherchent leur silence ».
Ludovic Degroote, Le début des pieds, suivi de Ventre, éditions Unes, 2023, 128 p., 21 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 14 octobre 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degrootd, le début des pieds : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
22/12/2023
Ludovic Degroote, Le début des pieds : recension

Si l’on se fiait seulement au titre, saurait-on que La Sorcière de Rome(André Frénaud) ou La pluralité des mondes de Lewis (Jacques Roubaud) sont des livres de poèmes ? Ceux qui annoncent leur contenu ne sont pas les plus nombreux, loin de là, tels Ode pour hâter la venue du printemps (Jean Ristat) ou Poésie ininterrompue (Paul Éluard). Sauf à connaître l’auteur, la plupart des titres n’orientent pas le lecteur vers un genre plutôt qu’un autre. Le début des pieds est un exemple de titre qui surprend ; les nombreux blasons du corps, depuis Marot et son Beau tétin, n’ont retenu que des parties du corps communément érotisées, de du Bellay à André Breton. De quoi s’agit-il chez Ludovic Degroote ? Le titre apparaît dans la première partie "un peu de monde" : « avec la bière le vin la quiche le fromage le pain et le dessert je ne suis plus qu’un ventre chaque jour / je ne vois plus que le début de mes pieds » — c’est aussi le titre de la troisième partie, après "un peu plus au bord".
Des poèmes autour du corps, de la place du sujet dans le monde, de la solitude, de la disparition se construisent à partir de ce type de notation. On ne quitte pas le lyrisme, mais il s’accompagne d’un certain détachement, et d’un humour, qui ne sont pas sans évoquer les grands moralistes classiques. La forme même du texte, proses brèves et rythmées réunies en courts ensembles, renforce le rapprochement. Les motifs sont agencés de manière complexe, on retient celui, récurrent, de la solitude et de la difficulté de vivre dans le monde, déclaré dès l’entrée : « il y a des jours où j’embrasse le monde à pleine bouche, j’y mets toute ma langue, et je ne sens rien ».
Il est inutile d’essayer de trouver une place dans ce monde, où l’on est et dont pourtant on se sent séparé (« c’est comme si le monde se dérobait à force que je sois dedans »), puisque ce n’est pas le monde qui exclut, mais ce que nous sommes, vides, sans regard pour autrui : « nous voyons cet effondrement du monde comme s’il était séparé de nous alors qu’il ne s’agit que de notre propre effondrement — nous sommes séparés du monde ». Vertige de l’inquiétude, de l’incertitude, de savoir que chacun vit la « faille du présent [...] sans cesse recommencée », la chute vers « le manque » — la mort —, mais que rien n’est dit, que tous vivent dans le silence. Solitude irrémédiable : chacun tombe /de son côté / sans heurter les vides / qui nous relient ».
Que faire de sa peur ? La supporter, puisque rien ni personne ne peut réduire ce qui est ruine en soi et l’« on ne se débarrasse pas si bien de soi ». S’enfermer pour ne plus vivre, au moins provisoirement, l’instabilité du dehors. Le monde n’est alors "visible" que par le biais des images : il est alors suffisamment à distance, et donc sans danger : le "je" oublie alors quelle place il y occupe et ce qu’il est lui-même : « et par instants je ne sais pas d’où je viens, j’aime bien la télécommande, le monde je le choisis tant pis si ça n’est pas vrai à l’instant qu’il défile sous mes yeux […] quel bonheur à la télé tout coule ». Ce retrait, qui s’exprime souvent, permet à bon compte d’être « constamment ailleurs » et de ne retenir du dehors que tout ce qui ne peut blesser et parfois même ce que tous s’accordent à estimer "poétique" : « je regarde la télé / la fenêtre est ouverte / on entend les oiseaux ».
Il y a chez Ludovic Degroote une manière tranquille de reprendre les motifs du lyrisme et d’aller à côté, du côté du politique, « j’essaie de m’en sortir / nous n’avons pas la chance de vivre au darfour » ; manière affirmée dans une esquisse d’"art poétique" sans concession. Parce que la poésie n’a pas à se limiter à la seule évidente subjectivité (Ah Frappe-toi le cœur, c’est là qu’est le génie), qu’elle n’a pas de thèmes privilégiés. Pourquoi pas les pieds plutôt que la douleur amoureuse ou les petits oiseaux ?
j’ai envie d’une bière
voilà de la poésie prise au vif
58% de français se plaignent de la poésie contemporaine leurs attentes ne sont pas satisfaites, ils pensaient que ce serait autre chose, ils ont déjà tant de mal, c’est inutile d’en rajouter, ils croient qu’on le fait exprès
Voilà bien une autre façon d’en rajouter… Rien de plus immédiatement lisible et bien éloigné de ce qui est rangé, classé, étiqueté dans la case "poésie". Ce qui est écrit repose bien sur une expérience du monde sans emprunter les formes répertoriées, mais avance « par petits bouts sans suivi de rien ». L’écriture n’est pas moyen de guérir de la difficulté d’être là, et évacuer la poésie-pansement, comme la poésie-décorative, est travail de salubrité publique, revigorant pour le lecteur.
j’aimerais bien pouvoir écrire que le petit pansement c’est l’écriture ou que l’écriture en ôtant le pansement met le monde à nu plaie du monde plaie de soi écrire quelque chose active son petit symbole et apporte sa grandeur au poème j’aimerais bien écrire une petite obscurité populaire en achevant le torrent oh raim du peuple libre incendie le froid chambranle des montagnes
mais j’en reste à la vie qui nous ronge
Le début des pieds est suivi d’un ensemble de poèmes titré Ventre. Les poèmes sont composés cette fois de vers très courts, avec parfois jeux d’assonances et allitérations (« langue gavée gangue », « rien rot mot air mort », « mots hachés hachis ») et une syntaxe brisée, les éléments de la phrase juxtaposés ou la phrase inachevée. On pense parfois aux derniers textes de Samuel Beckett ; par exemple : « durer pour durer / encore un peu même si / peu qui quand même /avant drap ongles et chapelet blancs / », etc. Comme s’il était difficile, voire impossible de dire ce qui importe, le manque, la solitude, la perte, la fin, comme s’il fallait le ressassement pour que le vide de toute vie soit perçu — « et partout des mots / qui cherchent leur silence ».
Ludovic Degroote, Le début des pieds, suivi de Ventre, éditions Unes, 2023, 128 p., 21 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 14 novembre 1023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ludovic degrootd, le début des pieds, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
09/12/2023
Les linguistes atterréEs, Le français va très bien, merci : recension
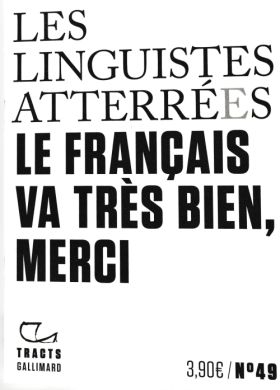
Faut-il "protéger" le français ?
Depuis plus de cent cinquante ans, toutes les tentatives entreprises pour faire comprendre que le français n’était pas une langue homogène, parlée (et écrite) de la même manière dans tout l’hexagone, ont échoué. En dehors de l’Académie française, tous les cercles, sociétés, associations, de « protection » de notre belle langue (sic) (et des fourmis volantes, peut-être) se sont levés, prêts à en découdre pour empêcher toute modification et défendre, par exemple, l’accord-du-participe-passé-avec-avoir -si-le-complément-est-placé-devant (j’ai oublié devant quoi). Littré, resté une référence même pour les tenants du statut quo, était convaincu de la nécessité de changements dans l’orthographe et écrivait : « L’orthographe ancienne fournira de bonnes indications pour la réformation de notre orthographe moderne, qui offre tant de surcharges, d’inconséquences et de pratiques vicieuses ». C’est en effet sur l’orthographe que les "batailles" se livraient dès la dernière partie du XIXe siècle. Les plus grands noms de la philologie, de la grammaire, de la grammaire comparée, de la phonétique, professeurs d’Université, au Collège de France, membres de l’Institut ont porté une pétition à l’Académie Française, sans succès, et certains d’entre eux n’ont pas attendu que l’institution bouge et ils ont choisi d’écrire (et de publier) avec une orthographe et une syntaxe réformées. Toute cette histoire a été écrite.
Ce que démontent les auteurs de ce livre, ce sont toutes les contrevérités largement diffusées, les pseudo-arguments qu’aucune étude n’étaie mais qui sont acceptés. Ce qu’ils proposent, c’est de débattre à partir de faits. Le premier, implicitement nié, c’est l’évolution de la langue ; personne ne parle plus comme à l’époque de Molière, pas plus d’ailleurs que dans les années 1850 — ou 1900… Les très nombreuses transformations de la vie, quotidienne ou non, ont modifié en profondeur le vocabulaire ; un agriculteur d’aujourd’hui, par exemple, n’a que très peu de lexique à partager avec un paysan des années 1920. Etc.
Autre plan. Un Français/une Française de Marseille ne prononce pas les mots de la même manière qu’un Français/une Française d’Île-de-France (ils n’ont d’ailleurs pas exactement le même lexique), le lexique et la syntaxe d’un ouvrier/d’un « employé de surface » ou d’une aide-soignante, ne sont pas les mêmes que ceux d’un énarque ou d’un polytechnicien. Voilà des évidences, dira-t-on ; certes, mais il faut en conclure qu’ils parlent tous le français, ou plutôt, comme le rappellent les auteurs, qu’il y a plusieurs français, ce que s’obstinent à ignorer les "défenseurs" de la langue. Par ignorance souvent, par mépris aussi souvent pour ceux qui ne parlent pas comme eux — mais beaucoup ne se rendent pas compte qu’ils multiplient en parlant les « fautes » qu’ils condamnent allègrement — il suffit de les écouter à la radio pour s’en convaincre si c’était nécessaire. Pour plus de clarté : il y a des français comme il y a des classes sociales.
Contre les idées toutes faites. Non, l’anglais (langue dominante aujourd’hui) n’envahit pas le français ; non, l’Académie française ne règlemente pas le français (ce n’est pas son rôle — et le voudrait-on que cela ne servirait à rien) ; non, il n’existe pas d’orthographe logique, parfaite, etc., et ce n’est pas en faisant une dictée par jour que les élèves l’apprendront — sa place dans la sélection serait peut-être à revoir ? ou bien il faudra licencier une partie des journalistes du Monde, de Libé, etc., dont une partie n’a pas dû faire assez de dictées ; non, le français des sms n’est pas une horreur : c’est une autre manière de l’écrire, et ceux/celles qui le pratiquent ne parlent pas comme ils écrivent — il faudrait, comme le suggèrent les auteurs, comparer au collège et au lycée « écrit réel et oral réel ». Pour l’écriture inclusive et les innovations comme iel, ellui, celleux, « ce ne sont qu’un tout petit bout de l’iceberg du genre grammatical ».
Les linguistes ne se demandent pas « si les anglicismes, les parlers jeunes, le rap, les tics de langage [en fait, au final], l’orthographe rectifiée, l’écriture inclusive…, c’est bien ou mal. On observe les faits linguistiques ». Cette observation permet de comprendre, et d’accepter, qu’il y ait des usages différents du français et qu’aucun n’a de prééminence : « les variantes coexistent », Il faut lire et faire lire ce livre de spécialistes qui savent de quoi ils parlent, toujours fortement argumenté. Il devrait être donné à tous ceux qui enseignent la langue, aux professeurs des écoles, de collège, de lycée, ne serait-ce que pour faire réfléchir sur les pratiques d’enseignement
Les linguistes atterrées, Le français a très bien, merci. Tracts/Gallimard, n° 49, 2023, 62 p., 3, 90 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 1er novembre 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les linguistes atterrées, le français va très bien, merci | ![]() Facebook |
Facebook |
07/12/2023
Jean-René Lassalle, Ondes des lingos-poèmes : recension
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-rené lassalle, ondes des lingos-poèmes, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
02/12/2023
Esther Tellermann, Ciel sans prise : recension
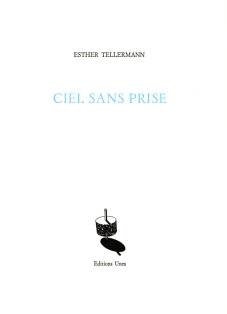
« Voilà / tout finit / et commence »
Il suffit d’ouvrir Ciel sans prise pour reconnaître l’écriture d’Esther Tellerman : poèmes entre dix et quinze vers, lesquels comptent rarement plus de trois syllabes, très peu ponctués mais parfois un blanc introduit une légère pause ; aucune rupture d’une page à l’autre, comme si s’écrivaient par touches les moments d’une histoire, celle peut-être d’un jeet d’un tu/vous très vite présents. L’ouverture du livre donne l’impression que se poursuit un autre livre par la rupture dans une durée :
Soudain nous avions / fermé / les persiennes
Le début rapporte un avant, un passé, où s’est vécu un acte de retrait, le « nous » s’isolant de son entourage et le livre s’achève avec une ouverture, par deux mots détachés, « Qui noue / les chemins et les cercles / toujours arrache / la couleur // fait face ». Ouverture sur l’avenir, vers un autre livre, non pour répéter ce qui a été écrit, mais pour continuer à dire ce qui ne peut être un fois pour toutes énoncé. Parce que rien, ou très peu, de ce qui est écrit ne peut être lu comme "réel", seulement pour une trace possible d’un moment, plus ou moins lisible, plus ou moins transformée : l’un des derniers textes, repris en quatrième de couverture, renvoie ainsi au début du livre, « Qui / soudain / ferme les persiennes », après un autre qui reprend la première scène, « Soudain / nos persiennes étaient closes ».
Comment décider de ce qui est réel, de ce qu’est le réel dans le livre. Dans le premier poème quand le "je " revient au présent après un temps dans le passé (plus-que-parfait, « avions fermé »), cela se passe dans un mouvement où l’univers semble se défaire (« Tout près / les continents / me traversent), est-ce l’image d’un ailleurs que l’on retrouve plus loin (« avant l’incandescence / d’une unique fièvre / où s’engouffrent / les continents ») ? d’une confusion où l’espace s’étire jusqu’à déborder toute limite ? Parallèlement, les divisions temporelles s’effacent pour laisser place à une durée continue, sans présent ni passé, et à la proposition : « un lendemain n’est-il / un jadis suspendu à l’aurore », une réponse : « l’absence de lendemains » d’où naissent l’obscurité, la « ténèbre ». L’écriture ouvre à « un absolu », à « l’infini » (« Nous humions l’infini »), l’absence de verbe parfois ne situant plus rien dans la durée, « l’encre psalmodiant / l’exactitude / des naufrages / le dessin / des univers / tus ». Il suffit d’un mot, « soudain », pour qu’il y ait rupture, l’univers semble se défaire, perd tout contour et sa raison d’être, « Soudain / ne respirent / les vieux mondes / trébuchent / sur les constellations » et plus avant, « les vieux mondes dérivent ». Tout pouvant devenir mots, ce qui était achevé peut recommencer, comme si un changement d’ordre météorologique suffisait à provoquer une métamorphose, « Puis reviendra / l’orage /(…) et notre chemin / sera visible » — futur d’un "nous" dont les composants sont insaisissables.
S’agit-il d’un "nous" amoureux comme le laisseraient supposer, par exemple, les allusions à la chambre close, au mouvement des reins ? Un "nous" complice au regard commun pour observer ce qui est en dehors de lui : « nous écartions / les persiennes pour / deviner / un monde / qui palpite » ? Mais de ce monde bien peu est dit, le lecteur découvre — ou invente en partie — des allusions à l’Histoire passée à partir des « rafales de souvenirs ». Les éléments propres à un récit sont évidemment absents et si l’on cherche des paysages, on ne trouve que des « horizons » ; les noms variés de fleurs et d’arbres participent au rythme des poèmes, non à une description de lieux — dans l’ordre d’apparition : amandier, jasmin, sauge, saule, hibiscus, gardénia, hysope, églantier, myrtille, châtaignier, cyprès, aubépine, lilas, saule, laurier, pavot, orme, hyacinthe. Quant aux noms généraux (terre, ciel, mer, continent), ils ne renvoient à rien de concret et la relation au visible est même explicitement effacée ; ainsi, l’ombre surgit, fabrique d’obscurité (« Tout à coup / une ombre / tourmente le bleu / dépose un peu de nuit »), mais plus souvent l’ombre, et donc l’obscurité, apparaissent comme des éléments intérieurs : « sans ombre que celle du dedans », et il est inutile de chercher à « tresser des chimères / apprivoiser l’ombre ». La mer, présente dans les poèmes, a un statut analogue à celui de l’ombre, ce qui est répété : « sans / mer // que celle du dedans », puis « sans mer / que celle du / dedans ».
Cette présence absence semble définir ce qu’est le "tu / vous", de là toute fondation d’un "nous". L’interlocuteur est lié à une odeur, proche par sa salive, il partage une chambre avec la narratrice et, également, des rêves (« nous inventions des sommeils ») s’avère être une création verbale, « je cherche encore / la langue / où / vous dire ». Construit peu à peu il s’évanouit brusquement (« Puis soudain je vous perds »), comme si les mots manquaient pour maintenir sa consistance. Ils sont bien là, les mots, mais pour exprimer nettement qu’ils sont la seule existence du "tu / vous" ; c’est « celui qui ne fut / à qui je parle », « Vous avez été / serez / (…)/ un dieu absent / ouvrant les paumes / frère / d’un ailleurs ». "Tu" comme suite de mots, seulement une forme nécessaire pour explorer ce que pourrait être un échange, « Je serai / vous / celui qui fut / à qui je parle / ou / qui ne fut pas / mais demeure ». Peut-être qu’une relation entre un "je" et un "tu" n’existe qu’avec les mots — Car / rien n’est / que / l’au-delà de / la forme » —, la présence du "tu" étant plusieurs fois affirmée comme suspendue au désir du "je" ; l’un et l’autre comme des formes à investir — c’est leur statut dans la langue. C’est une condition suffisante pour que les souvenirs, les temps de l’enfance, le passé donc, renaissent dans le présent, souvent avec leur charge émotive qu’on lit proche d’un Verlaine : « Dans les vieux parcs / viennent les chagrins / au souvenir / des pavots et des / musiques ».
On voit là que Ciel sans prise n’a rien d’un livre de poésie abstrait. Parfois énigmatique, qui suggère plus qu’il ne dit, qui demande à être relu, et la forme choisie est un élément important dans le plaisir de la lecture. Esther Tellermann use rarement de la paronomase (jaspe / gypse) et des répétitions de sons (« des paupières et des paumes ») ; outre les ellipses de verbes, elle introduit régulièrement des constructions syntaxiques qui exigent une (re)lecture attentive (compléments multiples ou éloignés du verbe, cascade de relatives) ou dont l’ambiguïté n’est pas immédiatement levée — un exemple : « (…) peut-être / secret / que le / corps porte / et soudain / irradie / la brûlure », où « secret » peut être lu comme sujet de « irradie ».. Livre que l’on peut lire sans rien connaître des ensembles précédents, auxquels on peut le rattacher tant l’œuvre est homogène.
Esther Tellermann, Ciel sans prise, éditions Unes, 2023, 220 p., 20 €.
Cette recension a été publiée par Sitaudis le 12 octobre 2023.
Publié dans RECENSIONS, Tellermann Esther | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esther tellermann, ciel sans prise, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
21/11/2023
Antoinette Deshoulières, De rose alors ne reste que l'épine : recension
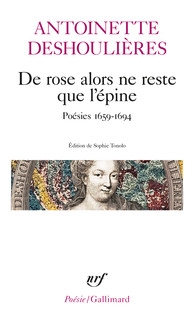
On ne lit plus beaucoup les "classiques" dans les lieux qui ont vocation à les faire connaître et aimer, l’école, le lycée, l’université. Sauf à y être encore obligé pour un concours, parfois un examen ; au fil du temps, ils sont devenus illisibles pour la plupart des lecteurs. Ouvrir La Fontaine ou Racine (n’évoquons pas Ronsard ou Rabelais, qu’il faut « traduire ») implique de comprendre que la langue, comme tout ce qui fait la vie, a changé. Le comprendre devrait / pourrait entraîner le choix de l’effort — comme en demande la lecture d’un écrivain contemporain, Pierre-Yves Soucy ou Esther Tellermann — sachant que toute édition d’un écrivain du passé est aujourd’hui (quand elle est bien faite) assortie de notes. La publication d’un large choix de poésies d’Antoinette Deshoulières (1638-1694) est un modèle du genre ; l’éditrice, Sophie Tonolo, connaît fort bien l’ensemble de la poésie du XVIIe siècle et aplanit toutes les difficultés de lecture : elle a modernisé la graphie, éclairci dans des notes simples le sens de mots disparus (hoirie) ou dont l’usage est autre (cabinet), expliqué ce qu’est un madrigal ou une élégie, remis en mémoire des données historiques (qui était Charles Quint ?), etc. Bref, on ne se plaindra pas de l’abondance des notes, même si quelques esprits chagrins, qui ne voient midi qu’à leur porte, trouveront inutile d’indiquer que « les trois fatales Sœurs » (p. 42) désignent les Moires ou Parques, Clotho, Lachésis et Atropos. Tout cet appareil, que l’on n’a pas à consulter systématiquement, facilite la lecture d’« une grande voix de la poésie française du XVIIe siècle injustement et inexplicablement oubliée. », comme la présente, justement, le site des éditions Gallimard.
On n’approuve pas l’idée que l’oubli de telle ou telle poète est inexplicable, mais il faudrait, il faudra écrire autrement l’histoire de la littérature, expliquer pourquoi tant d’écrits de femmes n’ont pas été publiés, et ceux qui l’ont été souvent "oubliés" aujourd’hui. Nous n’en sommes heureusement pas là et l’on se réjouit de l’abondance des noms de femmes au rayon "poésie" — l’anthologie personnelle de poètes femmes qu’a proposée Marie de Quatrebarbes, Madame tout le monde (Le corridor bleu, 2022) n’aurait pas été possible en 1980, par exemple. Antoinette Deshoulières, elle, a écrit pendant plus de trente ans et maîtrisé les genres poétiques de l’époque, du simple rondeau à l’élégie. Dans les cinq ensembles de cette anthologie, seul un groupement s’attache à des formes (2. Chansons, ballades, rondeaux), les autres sont thématiques (1. Être femme, 3. La plume à la patte, 4. Dans le monde, 5. Penser et combattre).
Contrairement à des idées reçues, le féminisme n’est pas né avec les Pussy Riot ou avec #metoo ; même si la voix d’Antoinette Deshoulières n’a pas fait bouger les pratiques masculines de son époque, elle a dû être entendue, au moins par d’autres femmes. L’ensemble "Être femme" est sans doute le plus surprenant pour le lecteur, qui a ri sans se poser de questions à la lecture des Femmes savantes de Molière — les femmes (celles qui avaient étudié et avaient des loisirs) étaient donc de vilaines pédantes ! Dans une Épître chagrine à Mademoiselle ***, Antoinette Deshoulières fait entendre un autre point de vue ; une femme veut-elle « devenir savante » ? Elle s’expose à toutes les moqueries dans une société où « Personne ne lit pour apprendre, / On ne lit que pour critiquer » :
Pourrez-vous supporter qu’un fat de qualité
Qui sait à peine lire, et qu’un caprice guide,
De tous vos ouvrages décide ?
Si vous allez à la Cour, vous saurez vite que « l’air qu’on y respire / Est mortel pour les Gens qui se mêlent d’écrire ». L’auteure accumule les arguments pour décourager la jeune femme, terminant en livrant son expérience malheureuse,
J’ai su faire des vers avant que de connaître
Les chagrins attachés à ce maudit talent.
Antoinette Deshoulières parlait d’expérience puisque, sans être fortunée, elle a publié ses œuvres et a, en partie, subvenu à ses besoins de cette manière. Si elle n’a pas hésité à tourner le compliment pour obtenir des faveurs, en l’occurrence des subsides, elle a aussi attaqué dans ses vers le comportement des hommes vis-à-vis des femmes ; et l’on constate (sans joie) que peu de choses ont changé. Comment les jeunes gens regardent-ils les femmes ? « Quand ils ne nous font pas une incivilité, / Il semble qu’ils nous fassent une grâce. » Dès qu’il a obtenu les faveurs d’une femme, un homme en cherche une autre, « inconstant / comme tous les autres hommes », et il se comporte selon une règle commune, répétée dans chaque strophe et dans l’envoi d’une ballade, « Tous les hommes sont trompeurs. » Nous ne sommes plus dans la Carte du Tendre, pense-t-elle, nous vivons « Dans un siècle où l’Amour n’est que dans les chansons. »
On accumulerait les citations qui prouvent la lucidité d’Antoinette Deshoulières qui a su analyser ses observations. Parfois elle paraît naïve au lecteur de 2023 dans ses vers de moraliste proches de La Rochefoucauld : nous savons bien qu’il n’y a pas lieu de « s’applaudir d’être belle » puisqu’on « a peu de temps à l’être / Et longtemps à ne l’être plus » ; mais qui sait aujourd’hui regarder la mort « sans changer de visage » ? D’autres poèmes, relatifs à la vie « dans le monde », disent beaucoup à propos des mœurs des puissants de l’époque, des comportements d’une classe qui s’est longtemps imaginée au-dessus de tout ; l’auteure ne relève évidemment pas de front leur nuisance et flatte le roi ou Madame de Maintenon, comme d’autres l’ont fait. Elle prouve dans d’autres poèmes une fantaisie acide qui n’a pas trop vieilli : elle donne la parole à plusieurs chats — comme les hommes le feraient — qui tentent de séduire sa chatte Grisette, mais celle-ci semble suivre les conseils de sa maîtresse et ne s’en laisse pas conter, proposant dans le meilleur des cas son amitié.
Reste à souhaiter que d’autres écrivaines (en vers ou en prose) soient sorties des bibliothèques ou des éditions savantes souvent coûteuses, où elles sont aujourd’hui reléguées. Il est certain qu’elles trouveront des lecteurs : la misogynie n’a certes pas disparu, mais la manière d’accueillir les œuvres des femmes a changé et un retour en arrière peu probable (croisons les doigts !).
Antoinette Deshoulières, De rose alors ne reste que l'épine, édition SophieTonolo, Poésie/Gallimard, 2023, 220 p, 10, 10. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 2 octobre 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoinette deshoulières, de rose alors ne reste que l'épine : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
13/10/2023
Lorine Niedecker, Cette condenserie : recension
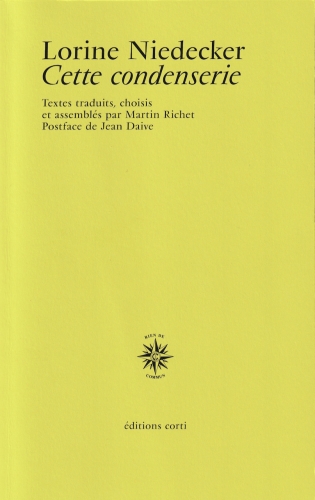
Martin Richet, traducteur de l’anglais américain, a choisi pour ce volume des lettres de Lorine Niedecker envoyées, pour la plus grande partie, à Louis Zukofsky (pas toutes conservées et parfois censurées) et à Cid Corman. La correspondance est suivie de deux essais à propos de ces deux poètes — le second, aussi éditeur, publiait la revue Origin —, puis d’un récit de voyage, précédé de notes. Par ces choix, Martin Richet a voulu mettre en lumière « plusieurs mouvements de condensation : « comment la vie devenue lettre se fait matériau d’un poème ; comment la lecture se densifie en poétique ; comment le document et le savoir informent l’expérience et l’écriture. » Le livre se termine par une brève étude de Jean Daive, ouverture à la lecture de Lorine Niedecker.
Lorine Niedecker et Louis Zukofsky furent très proches et le mariage de l’écrivain n’interrompit pas, pendant longtemps, leur correspondance. Dans ses lettres, Lorine Niedecker décrit souvent avec beaucoup de détails l’espace dans lequel elle vit, la faune et la flore qu’elle ne se lasse pas d’observer ; par exemple, pour les oiseaux, le grand héron, l’engoulevent, le nid de kildirs, et elle parcourt trente kilomètres « pour voir des nids d’hirondelles comme des bouteilles ou des gourdes de boue sur les flancs d’une grange ». C’est là la matière de ses poèmes. Elle se sent si proche du milieu humide qui l’entoure — les marais, le lac Koshkonong proche — qu’elle a le sentiment d’en être un élément (« je pourrais presque me croire de l’eau de mer dans les veines ») ; vivant dans ce milieu, elle imagine qu’elle peut contribuer à son développement, en y créant elle-même : ainsi elle arrache de très jeunes saules, les emporte jusqu’à la maison pour [s]a propre création du monde ». Cette image de monde premier est régulière, jusqu’à écrire, quand elle doit se mêler aux occupations de ses contemporains, « j’ai surgi de ma boue primordiale ». C’est dans une cabane, au confort des plus sommaires (sans eau ni électricité), près du bord d’une rivière, qu’elle a vécu longtemps avec sa mère et qu’elle abandonnera dans la dernière partie de sa vie : « Comme j’aimerais être libre de cette sinistre affaire qu’est la propriété », écrira-t-elle. C’est là aussi qu’elle écrivait et lisait.
Elle lisait beaucoup, dans plusieurs domaines, et elle énumérait parfois dans une lettre un achat de livres (par exemple : D. H. Lawrence, Goethe, Edith Hamilton, Rilke, Henri James, Conrad, une étude concernant Emily Dickinson) ou précisait ce qu’elle appréciait (« J’aime les poèmes de Robert Creeley », « Ce livre [de Cid Corman]) rentre dans mon armoire spéciale ». Elle n’hésitait pas à noter ses réticences et ses mises à l’écart ; estimant encore un peu Ginsberg, elle regrettait son comportement, « pourquoi faut-il que ces manifestations de vitalité passent par la misère, la crasse, le sexe. ». Elle donnait son sentiment à ses correspondants à propos de telle ou telle œuvre, tout en ne se jugeant pas capable de lecture critique, « j’apprécie, je ne critique pas et je cite comme [Marianne Moore] mais sans sa perspicacité ». L’étude sur la poésie de Zukofsky est en effet pour l’essentiel un montage de citations du poète.
Lorine Niedecker ne mettait jamais en avant ce qu’elle écrivait, ce qu’elle était ; elle a gagné son pain en faisant des ménages et ne tenait pas à ce que l’on sache qu’elle publiait des poèmes, mais elle n’avait aucun doute sur la nécessité pour elle d’écrire, « Il n’y a rien de plus important dans ma vie que la poésie », écrivait-elle à Jonathan Williams. C’est cette nécessité qui la conduisait à toujours reprendre ses poèmes, rarement satisfaite. L’écriture avait toujours pour elle comme point de départ ce qu’elle avait vu, entendu, vécu ; pour garder une de ses images, la phrase lui venait comme une crue de printemps mais, ensuite, acceptant le conseil de Zukofsky, le « sentiment suivant a toujours été de « condenser, condenser ». » Commentant une lettre de Cid Corman, qui pensait ses poèmes trop « écrits », elle se donnait cette tâche de condenser, « il faut que je travaille à me faire plus dense, plus nette et pourtant plus distante, comme dans l’imagination pure ». Cette volonté l’a éloignée de l’enregistrement de ses poèmes ou de leur lecture en public. Cette solitaire pensait que les poèmes s’adressaient au lecteur et devaient être « lus en silence », ce qui n’empêchait pas pour elle d’être constamment attentive aux sons, « Quand on a l’oreille affutée on fait sonner ses poèmes dans le silence ». Tout se résumait à s’éloigner de la prose, c’est-à-dire à l’abondance de mots dans un poème qui aurait abouti à « perdre une poésie parfaite, serrée ».
.
Ses notes de voyage sont faites d’observations, mais aussi de lectures sur l’histoire de la venue des Français dans la région du Lac Supérieur. Elle a écrit sa passion pour les pierres, et dans son compte rendu de voyage elle a noté : « Le panneau de la Boutique à Agates je ne l’ai pas raté » : elle y a acheté, en plus d’une agate, « une pierre bleue, une sodalite et une cornaline ». On lit cette importance de la pierre dans un poème, Voyageurs, qui précédant la postface de Jean Daive, s’ouvre ainsi : « Dans la moindre partie du moindre être vivant / est une matière qui a un jour été pierre / devenu terreau. »
Jean Daive est allé jusqu’à la cabane où vivait Lorine Niedecker — elle appréciait beaucoup sa poésie — et la revue qu’il dirige, K.O.S.H.K.O.N.O.N.G., nom du lac proche de la cabane, témoigne d’une proximité avec une manière de penser la poésie. Sa brève étude demanderait à être largement commentée, retenons-en un passage sur la complexité de l’œuvre : « En lisant textes, journaux, lettres et poèmes, je pense souvent aux fresques de Giotto à Assise où les récits de rêves et les changements d’échelle culbutent notre regard et ses logiques parce que la narration surdimensionnée s’en trouve malmenée. »
Lorine Niedecker, Cette condenserie, Textes traduits, choisis et assemblés par Martin Richet, Postface de Jean Daive, éditions Corti, série américaine, 2023, 274 p., 21 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 22 septembre 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lorine niedecker, cette condenseriez : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
08/10/2023
Lucie Taïeb, L'art de panser les plaies : recension
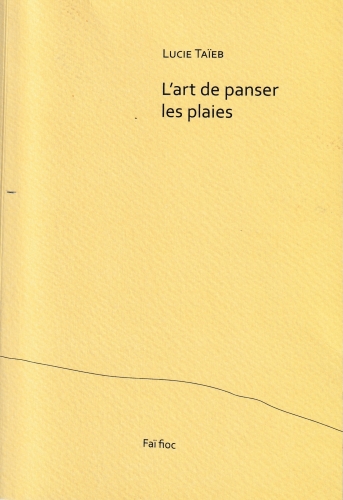
L’art de panser les plaies est aussi le titre du premier poème, suivi de "Est-ce une prière", "Nos corps nos pierres", "Où sont les cerfs ?", "Parmi les gravats" et "Thomas". Quand on a lu le Nouveau Testament, on lit immédiatement la relation entre le poème d’ouverture et le dernier, mais c’est l’ensemble du livre qui est construit autour du motif du corps blessé, du monde blessé, de la violence. On relie aussi le texte à Ambroise Paré (1509 ?-1590), cité justement dans le poème liminaire, chirurgien qui avait mis au point une "manière de panser les plaies" provoquées par les arquebuses pour éviter l’amputation.
On ne sait à qui s’adresse, dans le poème liminaire, un "je", féminin, qui, sur le ton de la confidence, rapporte avoir « arraché de [s]es dents l’oreille d’un amant », oreille aussitôt avalée. À ce début de destruction du corps répond, rapportée par le même "je", ou un autre, la mention de morsures, reçues sans que le lecteur sache qui en est l’auteur. Le récit prend alors une autre voie, celle des règles morales — religieuses : « on m’a appris qu’il fallait réparer ses fautes / ou tenter de le faire » ; ces règles sont accompagnées de ce qui définit le savoir-vivre pour une femme selon certains usages sociaux : une tenue et un maquillage corrects, se tenir droit, ne pas pleurer en parlant, etc. Le retour à la violence dans un second temps du poème est directement lié au Christ.
La (une) narratrice rêve qu’un homme lui ouvre le flanc d’un coup de lame de rasoir, blessure qu’elle lui inflige à son tour : « cet homme est mon frère et moi » ; étrange figure du double, et les sangs se mêlent pour atteindre l’unité, comme auparavant une partie du corps était absorbée. Cette tentative fantasmée de l’Un retrouvé est suivie d’un récit de démembrement construit à partir de l’intrigue de La confrérie des mutilés, roman de Brian Evenson : un détective ne peut progresser dans son enquête, et connaître la vérité, qu’en acceptant des mutilations successives, le chef de la confrérie étant un « homme tronc / ne reste que la tête / plus de langue ». Chaque fois on peut lire une initiation cependant impossible à vivre, ce que, semble-t-il, la forme pour le rapporter donne à lire.
Le premier poème commence par introduire une narratrice, « Je ne vous cacherai pas que mon chagrin est grand », et il est question ensuite de la fureur qui l’habite et la conduit à la violence physique. La phrase est d’abord reprise partagée en deux vers, puis seul le premier membre est maintenu dans une des parties du poème, les différentes affirmations niées (« ne pas te blesser / ne pas te panser (…) cette fureur n’en est plus une ») la blessure christique (« la seule qui m’émeuve ») est évoquée. Une proposition (« je ne sais plus ce que je dis ») remet en cause ce qui précède ou s’applique à l’amorce de récit qui suit : image d’une décollation qui ne serait dans la joute amoureuse que « les doigts enserrant la nuque ». Dans la clôture du poème, reste « Je ne vous cache pas » qui embraye sur des phrases verbales où le lecteur retrouve des mots phares (sang, chagrin), la désorganisation de la syntaxe, mime de celle du corps (« ne vous / non / mon chagrin ») et la fin exclut l’idée d’une pause, « trembler trancher chuter / ce monde mon chagrin ».
Comment relancer le poème quand tout semble détruit ? La narratrice souhaiterait une relation au monde apaisée, où l’écoute, donc l’échange, serait possible, souhait qui suscite une cascade de questions, la venue d’un "nous" et le constat d’une immense faiblesse, « Nous serons désarmés, nous n’aurons plus rien à défendre, nous serons nus, exposés à la morsure, à la blessure, et seuls, » — seuls avec de multiples questions sans réponses. La solitude acceptée, soit le retrait du monde, entraîne la perte de ce qu’implique l’échange : le nom, la conscience de son corps. De là, après tant de questions qui ne résolvent rien, la référence à Hölderlin : sa leçon conduit à clore avec une question-réponse qui rompt avec le retrait : « ne crois-tu pas qu’à craindre la blessure notre corps dépérisse, rabougri, desséché, car plus rien ne lui vient de l’extérieur ? »
C’est encore la relation à l’Autre, la solitude et la violence qui sont au cœur de "Nos corps nos pierres" ; avec la pierre qui blesse l’œil de la narratrice et, d’emblée, avec le retour de la parole empêchée : dans le premier poème, la narratrice souhaitait « pouvoir parler sans qu’on [lui] coupe la parole », maintenant « c’est tout ce qu’on ne peut pas dire » qui est difficile à vivre, l’empêchement, d’ordre social, concernant le corps, l’intime, la sexualité. Mais que la narratrice indique à l’Autre — existe-t-il ? — ce besoin de dire, ne changera rien à la solitude de chacun : tout se passe comme si les conventions interdisaient une rencontre des corps ; elle ne pourrait se produire qu’en renonçant à l’identité sociale que donne le nom ou en acceptant tout de l’autre, « je prends ton corps non pas dans la réalisation de sa puissance mais lorsqu’il se décharge, s’altère, déraille, je prends tout ce qui vient de toi ». Mais est-il possible d’échapper au chaos ?
Le poème "Où sont les cerfs" est fondé sur une comptine de ce titre ; à la question qui ferme les deux strophes, « Faut-il les tuer ? », est répondu NON, puis OUI, mais reprise deux fois à la fin du poème elle reste sans réponse. On pense au mythe d’Actéon et Artémis quand dans l’évocation d’une fuite un homme devient cerf et une femme chasseresse ; on pense aussi à la symbolique du cerf dans la chrétienté, où il représente la résurrection. D’un côté la mort, de l’autre la renaissance, ce qui s’accorde avec l’attente de la narratrice, "qu’un rêve advienne où tu parais, peu importe le nom et le visage ». Rêve bien éloigné dans "Parmi les gravats…" où s’impose la violence d’État, « une entreprise de destruction du monde tel que nous l’avions connu », où une main coupée est présente. Cependant, « une main est toujours en attente d’une autre main » contre la violence.
Le lien est visible avec le dernier poème, "Thomas". C’est l’apôtre qui rapporte sa rencontre avec le Christ, répétant son invite — « approche-toi, donne-moi ta main » et la commentant. Il reste en retrait (« Tu es revenu, je le vois, je n’ai pas besoin de te toucher »), malgré l’insistance du Christ.
Comme si rien n’était à attendre puisque, pense Thomas, « comme tu dois être seul parmi nous désormais, blessé, intact, vivant et mort ». Le Christ ne peut sauver personne, pas plus que l’Autre, quel qu’il soit, ne peut sauver la narratrice. Le monde semble n’être qu’un chaos où l’instance qui pourrait proposer des règles pour une vie sociale paisible, n’est qu’une source de violence. Que faire ? Peut-être « Désarticuler toute logique de domination et de soumission, en commençant par soi. » Vision tragique de la société contemporaine et de l’individu.
Lucie Taïeb, L'art de panser les plaies, Faï fioc, 2022, 64 p., 12 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 12 août 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucie taïeb, l'art de panser les plaies | ![]() Facebook |
Facebook |
03/10/2023
Natalie Barney, Je me souviens : recension

La possibilité du mariage entre personnes du même sexe - le ‘’mariage pour tous’’ -, grâce à la loi votée le 13 avril 2013, aurait sans doute réjoui Natalie Clifford Barney (1876-1972), qui aurait peut-être épousé Pauline Mary Tarn, Britannique écrivant sous le nom de Renée Vivien (1877-1909). Américaine installée à Paris, elle était suffisamment riche pour ne pas se soucier des jugements de la « bonne » société : son salon littéraire rue Jacob a reçu bien des écrivains, de Colette à Marguerite Yourcenar. Amoureuse de Renée Vivien, elle était cependant volage et son amie finit par la quitter. Elle ne se résigna pas à cet abandon et chercha, sans succès, à reconstruire leur relation. Je me souviens en est la trace, écrite en 1904 et publiée anonymement en 1910, un an après la mort de Renée Vivien, dont le nom est aisément lisible dans la dédicace qui précède le poème en prose, « À l’auteur de « cendres et poussières », ces cendres et ces poussières ». Lyrisme amoureux que certains aujourd’hui jugeront trop classique, il s’agit d’une variation autour d’un thème rebattu, et pourtant neuf si on le veut, illustré par Lamartine dans ce vers de "L’isolement", « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ».
Je me souviens..., ce que laisse entendre le titre, est un récit : quatre volets, "La rencontre", "Absence" (suivi d’un "Interlude, trois songes à travers la fièvre"), "Le retour", qui n’a pas lieu, "Nocturnes", qui conclut au renoncement : le dernier poème est encore une adresse à l’aimée pour qu’elle soit peut-être une dernière fois présente, mais le lieu où elle pourrait accompagner Natalie Barney est un « jardin triste et solitaire » avec un « palais désert » devant une « eau morte » et des « feuilles (...) fanées », des « cygnes hostiles » ; le tout en automne, donc rien qui puisse susciter un retour de la passion, le souhait d’une nouvelle rencontre, ne serait-ce que pour se tourner vers le passé, « ce lieu n’a de vie autre que le reflet des choses passées ».
Tout, au moment de l’écriture, est éloigné de ce que fut la naissance de l’amour, premier souvenir rapporté. La séduction est immédiate, évoquée par trois mouvements : « elle vient vers moi » / « à moi » / « près de moi » ; chaque stade correspond à une approche du corps de l’Autre avec le passage du sourire aux yeux, puis à la voix, et à une perception : de la « saveur des fruits » à celle de « l’ombre du soleil » et au « mystère de la nuit ». L’aboutissement est le don de soi, de son corps devenu un jardin : image du paradis. L’une et l’autre, « corps semblables », sont comme des fleurs ; l’auteure insiste sur le caractère naturel de la relation amoureuse, de ce « virginal amour » qui vivait toutes les « audaces » de l’amour. Elle l’oppose aux « visions passagères » de son inconstance et à son résultat : « J’ai perdu le bonheur ».
La suite ne peut être que le rappel de ce que fut l’amour partagé. Après « Je me souviens », Nathalie Barney passe à « Je me rappelle », enfin à « Sais-tu ». À l’envoi de poèmes de la part de Renée Vivien, elle ne peut que se refuser d’être ce qu’elle est, infidèle, et même, écrit-elle à celle dont elle sait qu’elle ne la lira pas, « je me déteste de survivre à ton amour ». Ce lien entre amour et mort, elle l’a vécu avec son amie et elle écrit magnifiquement ce qu’est cet élan amoureux si fort qu’il déborde toute limite, « Je me rappelle les soirs violets, où notre désir ne désirait que l’anéantissement et nous avions la faim et la soif de la mort ».
Que reste-t-il quand ce lien entre Éros et Thanatos a été rompu ? Remâcher les souvenirs, vivre l’attente en sachant qu’elle sera toujours une attente et rien d’autre ne donne du sens aux jours. Les fenêtres restent noires, le printemps n’est plus une saison de la renaissance, les poèmes qui lui sont dédiés par des admirateurs/trices importent peu puisque « l’amour meurt », etc. C’est peut-être dans les songes de l’interlude, où l’auteure rencontre des figures de désolation — et longuement une femme laide et cruelle, la Vie — que la conséquence d’un amour achevé apparaît, sans apprêt : il n’y a plus que l’oubli, qui est peut-être la seule vraie solitude ».
On lira avec intérêt les courts textes de deux lectrices, de génération différence, Suzette Robichon et Félicia Viti, qui rapportent leur découverte de Natalie Barney.
Natalie Barney, Je me souviens, Avant-propos de Suzette Robichon et Félicia Viti, Gallimard, L’Imaginaire, 2023, 120 p., 8 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 20 juin 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : natalie barney, je me souviens : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
27/07/2023
Cécile A. Holdban, Osselets : recension
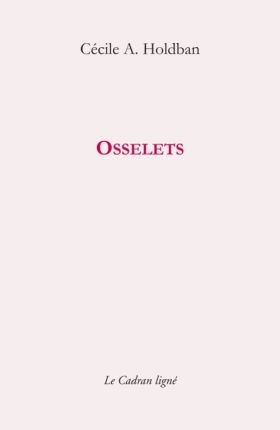
On ne joue plus guère aux osselets, utilisation de certains os (tarses) du mouton, ensuite faits en plastique. Ce jeu d’adresse demandait une certaine dextérité pour former des figures, les osselets sont ici des mots qu’il faut associer pour créer des arrangements harmonieux.
Osselets réunit en dix courts ensembles des poèmes d’un à cinq vers. L’exergue d’Antonio Porcha pour l’un d’eux ("Nuagier)" aurait pu être retenu pour l’ensemble, « Quand je ne suis pas dans les nuages, je suis comme perdu ». La rêverie et les départs dans l’imaginaire sont en effet au cœur du livre et ce dès l’ouverture, titrée "Minos" : le mythe du labyrinthe devient une création dans le présent d’un "je" (« celui qui le crée / et celui qui s’y perd »), le thème de la perte répété peu après sous plusieurs formes ainsi que celui de la création. Le lecteur partira dans un autre ailleurs avec le dernier ensemble, "Origamis" ; le mot évoque un art minimaliste, celui du pliage du papier dans la tradition japonaise, ici il s’agit de l’association d’un petit nombre de mots pour des parcours parfois complexes, ainsi dans le poème de clôture, « Épitaphe d’un dahlia : / nais, flamboie, tombe ».
On s’arrêtera à d’autres titres qui sont des créations linguistiques ou de sens. Ainsi "Vaguier" et "Nuagier" sont construits sur le modèle de "grenier" ; "Larmier", à côté de son sens en architecture, est aussi en rapport avec l’œil (« angle externe de l’œil d’où les larmes s’écoulent », dans Osselets c’est un « lieu de larmes ». Le lien entre les larmes et la douleur, le chagrin, est restitué par un jeu de mots, « Chaque larme est un lac / où baigne / l’aigu d’une lame ». On relève un autre jeu de mots, « les vagues » / « divaguent » (rencontre homophonique puisque divaguer n’est pas du tout un composé de vague), mais ces jeux sont isolés, Cécile A. Holdban préfère les reprises qui permettent de construire plus aisément l’unité du texte ; par exemple, l’adjectif "bleu" (« S’il n’y avait qu’un seul bleu possible / le sommeil n’existerait pas », p. 18) apparaît à nouveau page suivante dans trois poèmes sur quatre (poèmes 1, 3, 4) et le nom "aile" du poème 2 est repris dans les poèmes 3 et 4. D’autres éléments assurent l’unité du livre comme la récurrence de quelques mots, notamment « arbre » et « mer », celui-ci peut même être dans des propositions opposées : « La mer s’avance jusqu’aux yeux / elle remonte peu à peu / à la source des larmes » bascule en « Les larmes sont salées / pour couler vers la mer ».
Un autre élément d’unité du livre est apparent, c’est la grande fréquence des métamorphoses. Tout ce qui appartient à la Nature est susceptible de prendre des caractères propres à l’humain et l’on ne s’étonne donc pas de lire que « La pluie adoucit / l’humeur sombre des nuages » ou que « Les nuits servent à fleurir / le sourire des pierres », etc. Certains poèmes restent — joyeusement — sans interprétation immédiate, ainsi « Un œil pourpre flotte dans l’amphore du fleuve », et le lecteur les rapproche des pratiques des surréalistes. Sans proposer des liens trop faciles, ces vers d’Éluard, « Les guêpes fleurissent verts / L’aube se passe autour du cou », pris au hasard dans L’Amour la Poésie, pourraient figurer dans Osselets. La métamorphose du végétal, du minéral ou du liquide, etc., s’effectue simplement avec l’emploi du verbe être (« chaque vague est une nef »), souvent grâce à la comparaison avec comme (« Ce qu’on ignore s’apprête à naître / comme la forme de l’eau (...) »), et très couramment en posant l’existence de la transformation (« Les pierres observent, apprennent, / et parfois même, aiment et bondissent »).
Cécile A. Holdban suggère au lecteur de rejoindre un univers où l’imaginaire se substitue à la réalité décevante et dont l’entrée n’est pas sans évoquer Lewis Carroll, « Choisis cette porte, et tu vivras pour toujours / en compagnie de dragons, de fées, de panthères ». L’univers d’Osselets semble, lui, à l’abri des contraintes de la réalité contemporaine, qui n’apparaît jamais. Pourtant, quelques éléments rappellent, discrètement, que le monde des heureuses métamorphoses est d’abord un monde rêvé. Le temps se saisit de tout, « Le temps galope à dos de nuit », et dans un livre où très peu de couleurs apparaissent, c’est le noir qui domine — chant noir, pluie noire, fil noir, eau noire, pain noir... Peut-être faut-il ne retenir que ce qui pourrait venir ?
Le cœur habite la voix
le temps habite le visage
la pierre habite la pierre
tout le reste est encore en chemin
Cécile A. Holdban, Osselets, Le Cadran ligné, 2023, 48 p., 13 €. Cette recesion a été publiée dans Sitaudis le 14 juin 2023.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile.a. holdban, osselets : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
19/07/2023
Marie de Quatrebarbes, Vanités
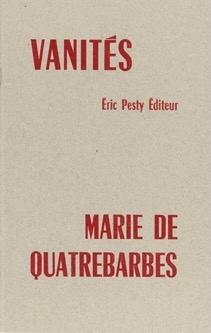
« Plutôt que de prendre racine, nous passons »
Le pluriel Vanités renvoie à une période de l’histoire de la peinture, la première partie du XVIIe siècle, pour l’essentiel à des natures mortes évoquant le caractère éphémère de la vie, parfois avec la présence d’un crâne : on rencontre aussi dans le livre cet objet — « Ce crâne, regardez-le, né de la roche et son greffon de lierre, entremêlé aux bois du cerf » —, mais le thème de la brièveté de l’existence n’a ici rien de religieux : le contexte associe le minéral, le végétal et l’animal. Pas de prière, de méditation pour se préparer à mourir, seulement savoir que le temps défait tout ce qui est et le projet est clair, « nous nous en tiendrons au matérialisme le plus tendre ». Ce qui est immédiatement lisible : la mort est la condition de la vie et s’il est une éternité elle est dans le fait que tout recommence sans cesse.
Le livre s’ouvre avec la reprise du texte en frontispice d’Anatomie de la mélancolie de Robert Burton, présentant Démocrite occupé à disséquer des cadavres pour reconnaître le siège de la mélancolie ; l’annonce en regard se présente comme en relation avec cette activité, mais avec un objet plus large : « Ceci est un livre d’histoire naturelle, décrivant les formes élémentaires par lesquelles commence la nature ». On verra comment se développe ce projet a priori fort ambitieux. Ces deux pages ne sont pas paginées, pas plus que l’ensemble des poèmes qui suivent, numérotés de 1 à 36, toujours de strophes de quatre vers, puis 361/2 pour le dernier de deux vers. On note que d’emblée un récit est annoncé et les premiers poèmes mettent en scène Épicure, « un mathématicien épris de gymnastique » (Thalès de Milet), Platon : l’Antiquité et ses savants inscrivent le livre dans l’histoire longue mais sont laissés au profit « à présent de l’avenir ».
L’avenir, et le présent, ce sont les multiples transformations des êtres vivants, et en particulier de la fleur, métamorphoses (qui lient d’ailleurs le livre à l’Antiquité) dont l’abondance font de Vanités un étrange kaléidoscope dans lequel on verrait les êtres et les choses se défaire et se reconstruire dans un mouvement incessant. S’il est une éternité, ce n’est pas du côté de la religion qu’il faut la chercher : c’est celle du recommencement — même si des mots semblent sortis d’un traité de l’époque classique, « squelette vivant, nudité et ordure ». La vie naît et se développe à partir de la mort, « le genêt pousse dans la ruine », « les corps se dissolvent (…) puis tout recommence », « le tombeau [de la fleur] est le berceau de l’arbre », etc. — on recopierait une partie du livre si l’on relevait toutes les occurrences de ce mouvement. La métamorphose se produit à tous les niveaux, les formes s’emboîtent, vouées à la disparition et, de là, apparaissent d’autres formes ; la fleur devient fruit, puis graines qui se séparent de la plante, se dispersent et d’autres fleurs trouvent leur place. Métamorphose généralisée qui emporte tout, « de toutes parts un mouvement léger fait pirouetter les masses ». La distinction entre l’inerte et le vivant n’est elle-même plus de mise, au moins pour le regard qui confond le minéral et le vivant, on voit « les scarabées pierres mobiles », ailleurs « les rochers pourrissent » et le végétal semble prendre des caractères du vivant mobile (« les yeux tuméfiés du mimosa ») (1).
Mais comment rendre compte de ce qui, presque toujours, échappe au regard ? Marie de Quatrebarbes choisit notamment l’énumération de noms pour restituer le foisonnement des éléments sujets à la métamorphose ; parmi d’autres :
On aperçoit au sol des miniatures, aiguilles, chatons de pins usés, minés, foudroyés, mollusques & huîtres, limaçons gélatineux, élastiques, hannetons, lentilles, moules, mouches du rosier, trente-six fragments de feuilles et demi »
Comment également introduire un semblant d’unité dans ce qui est donné pour échapper à tout ordre ? Dans une partie importante du livre, reviennent dans chaque poème l’adjectif « petit », un de ses dérivés ou un mot connotant la petitesse : « petit », le mieux représenté, seul ou non (« son tombeau était petit » opposé à « esprit large », « petites morsures »), « brève histoire », « insecte », « petitesse, « miniature », « imperceptibles », « microscopes ». Une figure insolite, celle de l’enfant, fréquente dans les livres de Marie de Quatrebarbes, est introduite avant le premier poème numéroté, entrant dans la série des contraires par son jeu : « L’enfant éteint la lumière, il l’allume » ; Il apparaît ensuite régulièrement, lié à la nature (« l’enfant se contemple dans le miroir de la nature »), se transformant (« l’insecte-enfant ») avant d’entrer dans le mouvement du recommencement à la fin du livre : « Parfois s’animent dans le visage du mourant les traits du nouveau-né & réciproquement ». Certains procédés rhétoriques s’ajoutent, comme la répétition de mots, pour unifier les contenus, avec aussi des jeux d’assonances (or dans une strophe : morsure, mort, ornée, sorte) et d’allitérations, ainsi avec la reprise d’un titre de livre de Paul Éluard, « le dur désir de durer ».
Il suffirait peut-être de dire que Vanités est un livre original sur l’idée de recommencement dans la nature. Le livre, cependant, apparaît plus complexe. La citation donnée supra s’achève par « trente-six fragments de feuilles et demi » : comment ne pas y reconnaître le numéro de la dernière page ? Si l’on s’attarde à quelques allusions dispersées, comme « reprendre la phrase encore » et, dans le dernier poème, « La page ne dit pas où elle va », à des allusions littéraires (par exemple à Louis Zukofsky), on relit aussi l’ensemble comme une métaphore de ce qu’est l’écriture et tout peut s’organiser alors autrement, qu’il s’agisse du thème du recommencement, de la répétition, de la mort et de la naissance, du passé et de l’avenir, etc. La fin de l’avant-dernière strophe et celle de la dernière confirment la possibilité de cette lecture, « On n’y voit rien, suivez mon regard » et « il n’est jamais trop tard pour détourner sa fin ». Ajoutons qu’il est d’autres lectures qui ne contredisent pas celles proposées ; ainsi, Vanités est, peut-être, dans le fil de Voguer un livre autour de la mémoire.
- On sait que l’on emploie "œil" pour désigner le bourgeon.
Marie de Quatrebarbes, Vanités, Eric Pesty éditeur, 2023, 38 p., 10 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 30 mai 2023.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Quatrebarbes Marie (de), RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marie sz quatrebarbes, vanités, recension | ![]() Facebook |
Facebook |





