22/06/2025
Silvia Majerska, Blancs-seings : recension
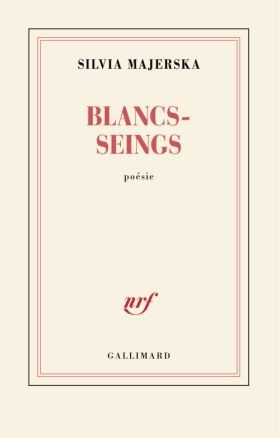
La quatrième de couverture propose une lecture des douze courts poèmes du livre ; chacun, en prose, occupe quelques pages, divisé en séquences précédées de chiffres romains ; aucun ne connaît la majuscule et la ponctuation est réduite au minimum. Chaque poème est consacré à une plante dont le nom en latin est donné en titre. Des éléments nés d’une vision personnelle alternent avec d’autres extérieurs et le tout est éloigné du (triste !) langage des fleurs tout autant que d’un discours sur un herbier. Il s’agit plutôt, comme l’écrit l’auteure, d’une « botanique intérieure » qui mêle constamment l’observation, celle que chacun pourrait faire, et l’imagination, qui transforme telle plante en être qui voit le monde. En exergue, une citation du Bon usage de Grévisse dit que l’astérisque (*) devant un mot signale une forme hypothétique, l’avertissement vaut ici pour le contenu qui suit le nom, pas pour la désignation en latin précédée de ce signe. La rose, fleur par excellence dans le monde occidental, ouvre le recueil.
La rose est reconnue comme le symbole de l’amour, culturellement très présente de la mythologie grecque et à la littérature, en France, du Moyen Âge à Ronsard et à Paul Éluard. C’est pourquoi elle est en ouverture, immédiatement identifiée bien que sous son nom latin, *Rosa. Ce qui n’est pas le cas des autres plantes du livre ; on lit d’ailleurs « il relèverait du miracle d’entrevoir tilia dans tilleul sans connaître un strict minimum de latin ». Le lien entre pinus et pin est encore lisible, comme peut-être celui entre viola et violette, mais l’ignorance de la langue morte ne permet pas de reconnaître dans Castanea, Trifolium, Taraxacum, Papaver, Bellis, Chamaemelum, Vitis et Lilium, respectivement Châtaigne, Trèfle, Pissenlit, Coquelicot, Pâquerette, Camomille, Vigne et Lys. On verra que c’est un motif, celui de la transformation, qui donne une unité particulière au livre : la rose aurait changé, de son passé violent (« sombre », avec ses piquants) au présent (fleur de l’amour), et elle change aussi de couleur hors de la nature.
Ici, la rose, comme vivante, « obéit : à la lumière, à la chaleur », et, avec les sentiments d’un humain, elle se comporte comme tel, douée de la faculté de rêver ; la narratrice comprend que les façons d’être d’un humain — comme la respiration — choquent la rose qui, elle, n’est pas soumise à l’air. La rose peut être transformée par la génétique et la dernière partie du poème rapporte qu’est née une rose bleue (précisément bleu violacé, bleu lavande) dans les laboratoires japonais, transformation destructrice d’un élément de la nature et de sa charge symbolique, de l’imaginaire qui lui est attaché. Toutes les plantes réunies dans Blancs-seings se modifient, chacune à sa manière ; pour les arbres ils grandissent et gardent quelque chose de leur histoire ; la châtaigne, qui semblait dans sa « cuirasse polie » avoir fait « vœu de silence » explose au sol ; le latex du pissenlit est comme du sang ; le pavot ressemble à une marmite, à une jupe et semble lié au feu ; la grappe de la vigne semble un fleur de glycine ; le poème consacré à la violette se termine par un palindrome, attribué parfois à Virgile et choisi comme titre par Guy Debord pour titre d’un de ses films, In girum imus nocte ecce et consumimur igni, « nous tournons dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu ». Pour la camomille,
« et pareil à l’eau chaude que nous versons sur les fleurs desséchées dans le but de ressusciter les cités perdues au fond de nos infusions,
la mémoire insuffle au passé recroquevillé dans le bol de l’esprit ses anciennes courbes et couleurs.
Il s’agit bien sûr d’une construction de l’imagination qui fait penser à la perception d’un bâton dans l’eau : nous ne voyons pas alors la réalité, déformée, ce que développe la fin du poème. On n’oublie pas non plus que le lys par sa blancheur s’apparente à la perle et le poème s’achève avec une explication détaillée à propos de la formation d’une perle dans l’huître, lieu par excellence de la transformation.
Une partie de la page (de chaque poème) reste blanche, comme un blanc-seing, en ce sens que l’on doit combler ce qui n’est pas explicitement donné à la lecture : les mouvements de transformation, de changement qui affectent chaque plante, preuve qu’elle est vivante. Ces douze courts poèmes le disent superbement.
Silvia Majerska, Blancs-seings, Gallimard, 2024, 72 p., 12, 90 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 21 mai 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
17/06/2025
Henri Droguet, Petits arrangements avec les mots : recension
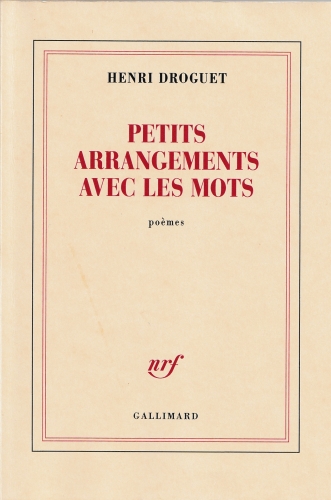
L’arrangement avec les mots commence avec le titre, une note finale indique qu’il est un « écho, et un hommage au beau film de Pascale Ferran, Petits arrangements avec les morts (1994) ». Il se poursuit avec les titres des quatre divisions, à peu près égales, du livre, tous à double sens : "À la lettre" (15 poèmes), "Main courante" (16), "État des lieux" (16), "Veille de nuit" (17), et il est présent du début à la fin. Il ne fait pas oublier les personnages du livre, récurrents dans la poésie d’Henri Droguet, la nature et les manifestations des éléments, la mer, le vent, la pluie, les plantes, les animaux. Cet univers appartient à l’anthropocène, nommé par dérision dans le premier poème « l’antre aux peaux saines » ; pourtant, l’homme, presque toujours anonymisé (un « quidam », un « passant », « quelqu’un »), y tient peu de place et ses actions, sauf celles d’un enfant, sont surtout du côté du chaos. À partir de cet ensemble, est mis en œuvre le programme esquissé en quatrième de couverture, « joie des mots », « fête du langage », soit jeux avec les significations, la morphologie, la syntaxe et la prononciation, qui n’empêchent pas que « la gravité n’est pas absente ».
Le livre débute par ce qui est lu habituellement à la fin d’un écrit, non un post-scriptum mais trois. Le premier exclut temps et espace : « Ni les jours ni les nuits ce n’est / ni soir ni matin c’est la cendre / comme un gouffre et le rien défait » ; la mer et le vent sont dans le désordre et la destruction dans un mouvement qui ne cesse jamais — « sans début / ni fin » — et qui est indéfiniment nourri, du ruisseau vers le fleuve et lui-même vers la mer, tout comme l’aube ne conduit qu’à la nuit. Tout semble se défaire, être voué à la disparition, la belle cétoine peut ravir le regard par ses couleurs mais quand elle « sort du cœur de la rose (…) elle se hâte sans savoir vers sa fin ». La ruine et la mort sont souvent proches, presque toujours liées à une violence ordinaire ; ainsi l’image du corbeau se nourrissant de charogne revient à intervalles réguliers (trois fois) et le bruit même du bec dans la chair morte est restitué, « soc soc soc » ou « toc toc toc » quand il « pioche (…) le désordre d’une entraille bleue », d’« une bidoche désassemblée corrompue ». Seules semblent échapper au désastre les plantes et la faune bien présentes, longuement énumérées : « spergulaire, séneçon, carotte à gomme, vergne, oseille, la belle ombelle, roselière, coudrier, aubépine ; chiens courants, reptile trigonocéphale, lièvre, merle, freux, fauvette » ; ajoutons un oiseau qui « cuicuite quelque part ».
Seul ici le chien courant rappelle un peu l’existence de l’homme dont les travaux et créations sont ignorés ou dépréciés, ainsi un produit tiré de la nature et un outil pour la transformer :
froment pétrifié mauvais pain mauvais
fagot écrasé cabossé
un talus épineux farouche
digère lentement une charrue multisocs
hors d’âge disloquée
Cette nature ne peut que difficilement convenir à l’homme (« l’inouï presque rien ») qui n’agit que pour la changer et parle sans cesse quand il lui faudrait se taire ; il cherche toujours « quelqu’un à qui qui parler ». Il est le « passant » dont les interventions apparaissent inutiles, « viande à Dieu / vautrée /[qui] chante le temps m’enfuit / braille et bée barbouille », qui ne comprend pas qu’il lui faudrait laisser ses fausses œuvres, partir vers la mer « nourricière », « vrai et beau refuge pour aller plus loin / nulle part encore et partout », se diriger vers un ailleurs dont on ne saura rien, sinon qu’« on sera loin / très loin / une fois pour toutes », et délivré au moins provisoirement d’une vie qui n’a pas de but. Les travaux humains n’aboutissent qu’à des constructions provisoires qui se défont plus ou moins rapidement ; pour Henri Droguet, alors qu’il insiste sur la permanence des mouvements et bruits de la nature, toujours semblables, les gestes de l’homme sont à côté de ce qu’il lui faudrait faire : rien n’est dans la durée, y compris les animaux qu’il pensait avoir maîtrisés :
un chemin compliqué se perd (…)
un moulin bat de l’aile (…)
plus bas dans une forge effondrée (…)
des chiens rouges hurlent clabaudent
cherchent qui dévorer
Cependant le lecteur n’est pas dans un univers du désespoir. Certes, « l’infini chaos », « l’informe abîme n’accueille ni / parole ni /rien », et il est bien là ; reste à en sortir autrement que par la fuite au bout du monde, qui ne changera rien. La vraie sortie, c’est l’enfant qui la connaît, il est « l’autre sans trace ni visage / étranger rebelle qui rêvasse encore » ; sans passé, n’étant donc pas devenu le « faramineux déchet » qu’est l’adulte, il rêve, « chante », « poursuit ses romances », « dans l’herbe court après les nuages » ; il « rêve entre deux portes », soit dans une situation des plus instables, et s’il oublie ses rêves il en reprend d’autres très vite. Henri Droguet rappelle que « l’enfance [est] sans parole » — enfant continue le latin infans « qui ne parle pas » —, mais « il ânonne la stupeur l’amour / seul l’amour / et le reste s’est perdu » — il se trouve encore, l’enfance passée, quelques hommes pour vivre « l’amour toujours / inlassablement l’abandon ». Pour ne pas quitter l’enfance, heureuse proximité des prononciations qui permet de parler de « je d’enfant », comme si l’identité était attachée au jeu.
Le jeu, la fête du langage sont en accord avec le chaos : ils sont partout, et d’abord dans la composition ; on l’a vu avec les titres pour les divisions du livre et les poèmes, il faut ajouter dans ce domaine "roman", qui n’en a aucun des caractères, "envoi", "fable", etc. À côté de citations de Victor Hugo, Jean Follain, d’autres non traduites (Coleridge, Dante, Milton) mettent en cause l’ordre du livre, comme l’emploi de l’italique, de capitales et de polices différentes. Il faudrait s’intéresser aux allusions littéraires, sans doute nombreuses ; par exemple, « un grenier où manque la neige » fait penser au passage d’un poème de Reverdy, : « j’écrivais dans un grenier / où la neige en tombant par / les fentes du toit devenait / bleue ». Chaos encore dans ce qui paraît stable dans la langue, les mots pour dire la position dans le temps ; ainsi le tombier — qui creuse les tombes — chantonne « demain / je t’aime hier je t’aimerai encore / toujours et déjà je t’aimais ». Henri Droguet accroît peu le lexique et ses créations sont aisément intégrables comme « grenaillu » ou « tombier », mais il emploie des mots régionaux ou techniques comme « drache », « grouin » ou « mégie » ; beaucoup plus courantes sont les assonances, allitérations, homonymes et paronomases : « Petit petit piètre piéton poieton », « la mer mégère magie mégie », « une averse herse », « orage opéra », « il dément déman / tibule », « qui franchit surgit rugit mugit ; conquis (qu’on dit », etc. Un mot familier voisine avec un énoncé "recherché" : « il lansquine » à côté de « l’indécise beauté / l’argent crispé des saules ». L’emploi au singulier de « entraille » est rarissime, mais on le lit par exemple chez Baudelaire, Giono et Valéry. On n’oubliera pas les nombreuses accumulations d’adjectifs ou/et de verbes qui donnent le sentiment d’un trop plein, comme si le texte débordait :
l’eau cabossée sauvage dévalante merveille
à son bouillon turbulent phosphoreux
sa tambouille ratatouille
chevelu parloir à tout faire et défaire
qui simultanément divague
fauche écorche bronche
vague désosse chuinte rince
happe râpe ponce
berce caresse
prémédite
Cet arrangement foisonnant se relit et le plaisir des jeux dans la langue ne faiblit pas ; on se laisse « prendre au je » et l’on reconnaît plus aisément aussi une dimension plus sombre du texte en suivant « l’homme instable » qui fuit le silence, en retrouvant « le modeste réel ».
Henri Droguet, Petits arrangements avec les mots, Gallimard, 2025, 132 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 12 mai 2025..
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
26/05/2025
Alexis Pelletier, Là où ça veille : recension
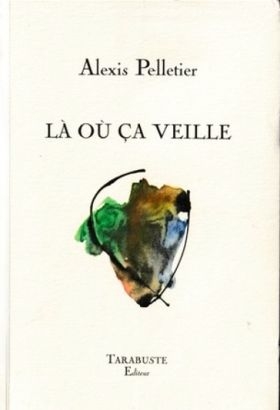
« le rêve d’un écrit sans fin toujours repris »
Qu’écrire quand un proche meurt ? Peut-on échapper à la littérature ? Qu’il s’agisse ou non de l’aimée (« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé »), aucun mot ne peut exprimer ce qui est vécu comme la perte. Littérature encore les vers de consolation quand la fille de l’ami a disparu (« Ta douleur Du Perier, sera donc éternelle (…) »). Le livre d’Alexis Pelletier appartient à cet ensemble singulier de poèmes et proses autour de la mort de l’aimé(e), ici la mère. L’écriture commence presque trente années après le décès, fondée sur des souvenirs, et ce qui fut ne peut réapparaître que par approximations successives et retours si un détail, vrai ou inventé, semble préciser le cours de l’événement. La force du livre tient à cette tentative répétée d’une reconstruction du passé, admise pour finir comme impossible, fiction (le mot est employé) qui questionne autant l’auteur et sa vie que la disparition, et également la relation à l’écriture.
Des trois ensembles du livre, le premier (le plus développé) cherche à reconstruire la scène des derniers moments de vie de la mère, cette circonstance particulière que le narrateur n’a pas vécue, « Je n’ai pas /vu l’instant sans nom le moment/ le passage où/ la vie va jusqu’au bout de la vie et s’en va ». Passage invisible même pour qui est présent — moment dont le caractère indicible a été si justement restitué par Bossuet dans une oraison funèbre, « Madame se meurt, Madame est morte »*. Ensuite avec l’éloignement dans le temps, d’autres souvenirs changent la saisie du passé, d’où dans la dernière partie d’autres réflexions sur le deuil, la relation à la mort et à l’amour. L’unité du livre tient à la place centrale du décès de la mère, à la présence continue du je-narrateur et au fait que la perception de l’espace intérieur se modifie : dans les premiers vers vient au jour « un souvenir / dans une lumière / assez sombre » et cette opacité, régulièrement répétée, dure longtemps, il faut l’achèvement du parcours de l’écriture pour que s’impose « un souvenir dans une lumière assez vive » — c’est le dernier vers. Parallèlement à l’unité des contenus est affirmée une unité formelle ; le livre débute sans majuscule et aucune n’apparaîtra en dehors des citations : la division en trois ensembles n’empêche pas alors le lecteur de penser que le récit avait peut-être déjà commencé auparavant ; l’avant-dernier vers suggère qu’il peut se poursuivre, mais autrement : « je ferme les yeux je te vois je tiens ta main », le "te" renvoyant ici à la femme aimée.
Alexis Pelletier indique qu’il a écrit plusieurs versions pour progressivement s’éloigner de la fiction. Des décennies après le décès de la mère, les souvenirs à la base du récit ne sont plus du tout assurés, rien ne peut aller contre le temps qui a déformé des moments difficiles à vivre, où le narrateur a été immédiatement préoccupé par le passage de la vie à la mort de la mère. Les années ont passé avant le temps de l’écriture et ce réel non vécu, comme d’autres éléments parmi ceux qui l’ont suivi, sont alors inatteignables, confus ou perdus. Comment sortir de cet « étrange combat entre l’oubli et la mémoire » ? seule l’écriture, reprise, peut faire revenir des souvenirs. Cependant tout ce qui est autour de la disparition demeure dans « des lumières assez sombres », alors qu’au cours de la soirée à l’Opéra à laquelle, adolescent, il avait invité sa mère, « les lumières de l’orchestre n’étaient pas sombres » — l’opposition sombre/clair accompagne l’évocation de ce qui a été en bonne partie enfoui dans la mémoire et le retour du souvenir des jours où la mort était éloignée, impossible à imaginer.
La relation à la mère, complexe, a connu des plages heureuses, notamment celles de l’enfance d’où surgissent par exemple les mots entendus au réveil, « tu as trop dormi c’est l’heure », et la vision de la fierté maternelle appréciant le choix de ses achats de livres (Verlaine en poche, pages choisies de Rimbaud en classique Larousse). Le narrateur se souvient aussi des rencontres par la musique, même décevantes. Adolescent, pour inviter sa mère à l’Opéra, il avait passé la fin de la nuit devant Garnier pour prendre des places bon marché dès l’ouverture ; pourtant, au-delà de la joie commune, ce qui demeure de cette soirée, c’est le « désaccord profond » à propos des deux cantatrices dans Jenufa, opéra de Janácek, lui très sensible au contenu et rejetant le sacrifice des femmes, elle d’abord attachée aux voix. Dans les derniers temps de la maladie, une demande a bouleversé le narrateur, « s’il te plaît mon chéri il faut me suicider » : c’était là « un dépassement de la douleur qui fait face /à la mort par l’amour ». Relation vécue mais non exprimée parce qu’absence d’échange entre la mère et le fils. Pourquoi alors écrire ce qui, par la force des choses, ne peut être en partie qu’une « fiction » — « élégie », « tombeau », « récit », « roman » ? « c’est /peut-être que la vie passe dans l’écriture/la nudité de l’amour dans la mort/rien ne/s’épuise/sauf si le désir de mots n’est qu’une/illusion un fantasme ».
Les retours sur les souvenirs, sur ce qui n’a pas été vécu, parfois le début d’analyse de ce vécu (« je m’aperçois que le deuil de Maman renvoie / à une angoisse fondatrice »), les doutes mêmes à propos de ce qui est raconté, donnent une vraie force au livre. Tout cela n’empêche pas que ce n’est pas un document, mais qu’il appartient à la littérature, à un "genre", l’autobiographie. Le lecteur qui n’aurait rien lu de l’auteur apprend d’ailleurs qu’il croyait naïvement que des études de lettres l’aideraient à devenir écrivain et, surtout, qu’il a beaucoup lu — beaucoup de noms, de renvois à des ouvrages, par exemple à Une phrase pour ma mère (de Christian Prigent), aussi qu’il maîtrise le jeu avec la langue (retravaillant l’homophonie morphine/mort fine ou en construisant une : mère morte/mer morte/amère mort). Littérature, oui, et c’est pour cela qu’il déborde complètement ce qui pourrait n’être que la relation d’un deuil.
* Bossuet, "Oraison funèbre de Henriette Anne d’Angleterre, duchesse d’Orléans" (dans Recueil des Oraisons funèbres…, Grégoire Dupuis, 1691)
Alexis Pelletier, Là où ça veille, Tarabuste éditeur, 2024, 132 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis, le 8 avril 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
17/05/2025
Jacques Lèbre, Sonnets de la tristesse :recension
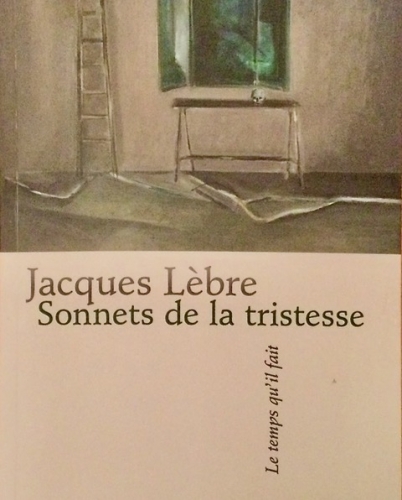
La société paysanne traditionnelle a commencé à disparaître à partir des années 1960 (1) avec la transformation de l’agriculture, précisément avec le développement de la mécanisation, ce qui a peu à peu changé la structure des familles : trois générations vivaient souvent sous le même toit dans la ferme, chacune ayant son rôle. Ce modèle a longtemps perduré dans certaines régions jusque dans les années 1970, il a quasiment disparu au XXIe siècle, les paysans étant devenus des agriculteurs et la plupart d’entre eux s’exilant en ville. Ce qui explique en partie le développement des "maisons de retraite" et de ce que la manie des sigles désigne par EHPAD. Jacques Lèbre a vécu cette période, même si ce n’était pas dans une ferme, et ses sonnets portent sur la fin de vie de sa mère dans une maison de retraite, un de ces établissements qu’il qualifie de « mouroirs ».
À partir d’un certain âge, la vie se retire lentement, devenant « eau morte », sans autre occupation que d’observer « ce qu’il y a d’encore vivant ». La vieillesse n’est un désastre qu’à partir du moment où tout ce qui peut retenir au monde disparaît, les amis, les enfants, les sorties hors de sa maison, les spectacles. Il n’y a alors plus de vues sur le monde, plus d’horizon, seulement un présent définitivement immobile. La mère de Jacques Lèbre le dit et le répète clairement, lucide à propos de ce qu’elle vit dans la maison de retraite : « Les journées sont longues ». On peut bien continuer à lire le journal et résoudre des mots croisés — elle le fait encore à 99 ans —, les jours se ressemblent et il devient difficile de distinguer le mardi du mercredi, comme de se souvenir du jour où le fils reviendra. Les souvenirs qui reviennent, ce sont ceux, très anciens, de l’entrée dans la vie professionnelle, à une époque où l’on se déplaçait surtout à pied, quel que soit le temps.
Il est difficile de parler à cette mère dont le corps s’est transformé, maigre maintenant et fragile, de cette mère à qui l’on ne peut dire que des banalités parce qu’il est impossible de passer outre une « absence de dialogue depuis toujours ». Au fil des années, des visites dans la maison de retraite, le fossé entre le fils et la mère ne se comble pas, le fils souffre de ce qui est un abandon de sa mère dans un lieu où elle n’a rien d’autre à faire qu’attendre la mort, sachant qu’il ne pouvait la prendre en charge. Il reconnaît chaque fois qu’il entre dans la maison de retraite
(…) ces regards éteints
ce silence des vies qui viennent ici finir
et dont on ne soupçonne même pas ce qu’elles furent
ailleurs en leurs lieux et leur temps.
Les sonnets font penser à ceux de Robert Marteau : 14 vers avec la division en strophes (4/4/3/3), mais sans rime ni nombre de syllabes régulier ; c’est la transmission de l’observation et de l’émotion qui compte d’abord, c’est dire en mots simples que "vieillesse" rime le plus souvent avec "tristesse". Jacques Lèbre a fait précéder les sonnets d’un petit ensemble en vers libres, Onze propositions pour un vertige, , qui aborde d’une autre manière la question de la perte de la mémoire. L’ami — le "tu" du poème — oublie l’essentiel de qui constitue les relations avec autrui et tout noter sur un carnet est inopérant : il lui faudrait consulter le carnet. Dans un lieu public, par exemple un café, il ne s’aperçoit pas que l’heure de la fermeture est arrivée, « Sans repère temporel, que devient l’espace ? / Peut-on seulement soupçonner ta désorientation ? ». La perte de mémoire est tragique ici puisqu’elle conduit à l’enfermement.
Le livre se clôt avec quelques poèmes d’une teneur bien différente, titrés L’amour est comme le sol, illustrés en 1998 par Marie Alloy. Jacques Lèbre met en scène la fraîcheur et l’innocence de l’enfance sous la figure d’une petite fille qui, à l’écart des adultes qui passent, parle aux oiseaux : elle représente, au moins pour un temps, ce que l’on se plaît à désigner comme le paradis, sa relation si évidente avec la nature éloigne le désastre de la vieillesse, exclut toute idée de finitude et évoque l’amour :
Où retrouverions-nous un peu de cette innocence
sinon dans l’amour ? L’amour est comme le sol
qui écorchait, lorsqu’on le rencontrait, en tombant.
- sur ce sujet, le livre essentiel d’Henri Mendras, La fin des paysans (1967). Ce qui n’est pas un détail : : 1 200 000 fermes en moins de 1970 à 2020.
- Publié en 2013 par les éditions Le phare du Cousseix, créées par Julien Bosc disparu en 2018.
Jacques Lèbre, Sonnets de la tristesse, Le temps qu'il fait, 2025, 80 p., 15 € . Cette recension a été publiée par Siaudis le 30 mars 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques lèbre, sonnets de la tristesse : recension | ![]() Facebook |
Facebook |
20/04/2025
Philippe Beck, Documentaires : recension

« Chaque prose est un documentaire »
Ce que l’on écrit sur les "réseaux sociaux" n’a pas vocation à être relu, un écrit chasse l’autre et tous sont voués à tomber dans l’oubli. Philippe Beck s’est livré à un « exercice de spéléologie électronique » pour rassembler plus de 180 textes, de dimension variable (de quelques lignes à trois pages) publiés en ligne du 22 mars 2015 au 7 juillet 2024 ; il y a joint, remaniée, une communication à un colloque, titrée Le poème intéressant, et une prose dédiée à Johan Faerber, Musique entre destin et caractèrequi, toutes deux, s’accordent avec l’ensemble des écrits regroupés. Un avertissement donne sans ambiguïté une manière de les lire, « Chaque prose est un documentaire, et non un pur et simple document d’existence et de témoignage à mesure qu’on existe ». Le substantif documentaire reprend, ici et dans le titre, l’usage à propos du cinéma, les proses s’entendent donc comme « des documents (…) sur des secteurs de la vie ou de l’activité humaine ou du monde naturel »*.
On comprend que Documentaires aborde, au gré de l’actualité et des activités, rencontres, lectures de l’auteur dans des domaines variés : vivre dans le monde implique la diversité des échanges sociaux. On peut sans peine établir des listes des sujets documentés qui, de manière à engager la réflexion et le dialogue, peuvent être précédés de « Qu’est-ce que » — un enfant, la clarté, un intellectuel, un esthète, un pianiste, etc. On trouvera aussi aisément des points communs parmi les citations à quoi est parfois consacrée la prose de tel jour, que la citation se suffise à elle-même — sujet de réflexion pour le lecteur — ou soit point de départ d’un commentaire, bref ou étendu : Ashbery, Joubert, Swift, Celan, Tchekhov, Alain, Deleuze, Tom Waits, Imre Kertész, Robert Schumann (lettre à Clara), etc. Ce qui apparaissait lors de la publication de chacun de ces documentaires et qui, évidemment, est impossible de ne pas lire dans leur réunion, c’est une analyse politique des faits sociaux, quels qu’ils soient ; rien de surprenant pour le lecteur de Philippe Beck qui, depuis les premiers livres de poèmes, écrit, pour reprendre son vocabulaire, pour éclairer, clarifier, dialoguer, de là transmettre — ce qui devrait être le but de tout documentaire. On retiendra surtout les proses liées à la poésie, domaine essentiel pour qui réfléchit à la vie sociale, en sachant les limites d’une recension : les documentaires forment désormais un tout où les réflexions autour de la poésie sont liées aux observations à propos de la musique, de la lisibilité, de la publication des écrits, etc.
On peut d’abord lire un documentaire général, à propos de ce qu’est un esthète. L’esthète considère que la sensibilité est un « ordre autonome » et, ce faisant, sépare l’art des conditions matérielles dans lesquelles il existe et se développe, et efface les « décisions éthiques et politiques dont la vie quotidienne est tissée » .Toute œuvre d’art transforme celui qui la regarde, l’écoute, la lit ; c’est dire qu’elle a un rôle dans la cité, qu’elle modifie quelque chose dans une communauté, ce que comprennent bien les régimes totalitaires qui tentent de mettre l’art à leur service ou le bannissent. Par ailleurs, personne ne vit hors d’une société et la création solitaire n’existe pas si l’on entend par là qu’elle serait indifférente au contexte. Le formalisme revendiqué en poésie souffre d’oblitérer le contexte : il voudrait que la forme seule produise du sens « ou rejoigne la signification qu’atteste la communauté » ; or les mots d’un poème devraient aider le lecteur à comprendre des sentiments qu’il vit et qu’il n’a pu lui-même mettre en mots. L’émotion naît de reconnaître et de sentir dans les mots associés selon un rythme quelque chose de la nuit du monde où l’on vit. C’est pourquoi l’activité artificielle qui consiste à écrire un poème, si elle l’atteint, fait bouger, si peu que ce soit, la communauté ; en effet, « Aucun homme n’est une île, un tout complet en soi » (John Donne, traduit et cité par P. B.), ce qui l’atteint touche du même coup le groupe. La poésie aurait ainsi une fonction positive, politique, puisqu’elle est à la source de changements, de là d’échanges, de dialogue, sans pour autant imaginer qu’elle transformerait à elle seule une société : il faut inverser les termes et penser « qu’il faut changer le monde avant d’espérer que la poésie puisse le changer ou le rédimer ».
Un des documentaires consiste, sous le texte original, en la traduction non commentée d’un poème d’Emily Dickinson où la question de l’identité, plusieurs fois abordée par ailleurs, est posée.
Je suis Personne. Qui êtes-vous ?
Êtes-vous – Personne - aussi ?
Alors nous faisons la paire !
Ne le dites pas ! Ils le diraient – vous savez !
C’est si ennuyeux d’être – Quelqu’un !
Si public – comme une Grenouille
Dire son nom – tout le mois de juin
Au Marais qui vous admire !
« Personne » : « je » et « vous » seraient hors du lien social qui suppose un nom, mais leur existence entraîne la possibilité d’un dialogue, fondement d’une communauté, alors que « quelqu’un », ici, ne ferait que « dire son nom » sans attendre de retour, seulement pour être admiré de la foule (le « Marais »). C’est là un exemple du fait que « La poésie est documentaire ou n’est pas ».
L’illustration de John Tenniel pour la couverture est en relation avec le titre, soit avec l’ensemble du livre. Elle figurait dans l’édition de 1889 (1ère édition 1865) d’Alice au Pays des merveilles de Lewis Carroll. Alice est devant le chat de Cheshire qui, souriant, satisfera la demande de la petite fille, disparaîtra lentement en commençant par le bout de la queue et ne laissera de lui en suspens que son sourire. Il y a là l’impossibilité d’une expérience perceptive — un sourire sans chat — pour Alice, « la Citoyenne du Bon sens Étonné ». Leçon peut-être pour apprécier la nécessité du commentaire, ce « sourire doux et cruel s’impose à l’âme bousculée. Il représente une pure façon de déplacer la sagesse, car la sagesse ne sait que faire de ce qui la rend folle ». C’est un des plaisirs de Documentaires que de conduire le lecteur, comme dans Abstraite et plaisantine, poèmes récemment publiés, à réfléchir sur sa pratique de lecture de la poésie.
* Trésor de la langue française informatisé, article "Documentaire"
Philippe Beck, Documentaires,Le Bruit du temps, 2025, 48 p., 22 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 23 mars 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
06/04/2025
K.O.S.H.K.O.N.O.N.G, automne 2024

Dans le poème de la une de couverture, Larry Eigner pose la question « qu’est-ce que l’abstrait ? qu’est-ce que le concret » après une suite de mots écrits verticalement :
carte
peinture
poème
truc
vert
soleil
couleur
La liste peut être dite "concrète", chaque mot évoque un élément du monde et, en outre,peinture et couleur peuvent être associés, ou d’une autre manière peinture et poème — et d’autres relations existent ; elle est abstraite dans la mesure où la signification de la liste n’est construite que par le choix d’un lecteur, sinon la série reste un tas de mots, comme tel tableau de Paul Klee est ou n’est pas un amas de formes et de couleurs.
Un second texte de Larry Eigner appellerait des remarques analogues et cette nécessité d’inventer sa lecture caractérise évidemment une grande partie de la livraison.
On ne s’étonnera pas que l’on ait à le faire pour le long poème, en vers et prose, de Claude Royet-Journoud ; "La pensée n’opère que sur des surfaces ", repris avec d’autres poèmes parus dans K.S.O.N.G. dans Une disposition primitive (P.O.L., 2025). On note des constantes, comme l’absence de continuité d’un vers ou d’un groupe de vers à l’autre ; ainsi pour les premiers vers :
On y dépose de simples éléments
Corps penchés sur les débris
Des yeux se ferment
On repère le jeu des pronoms (on, il, elle), également propre à l’auteur, la présence d’un miroir qui double l’image — « le corps se scinde en deux » —, mais aussi un « corps dénué de visage », « un corps éparpillé », à partir du moment où la maîtrise des mots s’altère. Avec l’idée d’une scène dans le passé, avec le travail de la mémoire d’où surgissent des mots, le lecteur de Royet-Journoud a le sentiment de lire un immense poème commencé avec la publication de son premier livre, Le Renversement (1972) où était interrogée la composition de l’écrit — « alors décroît le nom / à l’avant de chaque parole / de chaque accomplissement / métaphorique » (p. 83). Interrogations analogues ici — « Combien de temps pour que le sens enfin nous parvienne » — et réponse que seule la lecture pourra proposer.
Les fragments d’un récit de Robert Creeley, traduits par Martin Richet proposent des aspects différents de son écriture. Une série d’énoncés avec le mot "dent" juxtapose le réel (« dents de la scie »), la fiction (« dents du dragon ») et l’absurde (« Qui ne s’est pas déjà fait scier une dent en quatre sans s’en souvenir ? ») ; l’unité de cet ensemble est rompue par des éléments sans aucun lien avec la série, comme l’introduction de deux personnages féminins, « Le souvenir de Betty et Marjorie et du voyage à Des Moines est vrai » : l’affirmation met en cause la "vérité", la réalité, de ce qui précède. Ce qui suit semble sans relation avec le développement à propos des dents, mais l’idée de réalité est à nouveau présentée, et répétée, en même temps que la possibilité de la fable, « Quand je me montre telle que je suis, je reviens à la réalité ». La suite introduit des bouts de phrase en espagnol (dont la traduction est présente plus loin dans le texte), la répétition de « Vire au vert, vire au blanc » dans un texte énoncé par un "je" féminin qui affirme plusieurs fois son individualité (« Il faut penser à soi »), pose à nouveau qu’il « revient(t) à la réalité » pour aussitôt annoncer « Retournement. J’aime que mes combinaisons paraissent incongrues ». Les derniers éléments des fragments sont des variations lexicographiques autour du mot « Mother, cette mère (…) », qui se résument dans le mot « source ».
Serge Linarès donne à voir ce qu’a été le travail de l’écrivaine Anne-Marie Albiach sur un poème. Il présente dans son intégralité le premier état du tapuscrit d’un poème, sans ses ratures signalées en note. On aurait souhaité connaître les ratures des deux tapuscrits suivants et que soit joint l’état définitif du poème, "Répétition", publié dans Mezza Voce en 1984 (réédité en 1992) ; tous les lecteurs n’ont pas à portée de main le volume et il est en effet passionnant de découvrir, en y passant beaucoup de temps, comment l’auteur a progressivement transformé et réduit son texte. La lecture préalable de l’essai de Jean Daive, Anne-Marie Albiach, L’exact réel (Éric Pesty éditeur, 2006) aidera, me semble-t-il, à aborder ce tapuscrit
Le titre du poème de Jean Daive, qui clôt le numéro, trappist, est ambigu, renvoyant comme "trappiste" en français au monde cistercien et à une bière fabriquée par des moines, mais il est aussi employé en anglais comme le français "trappeur" et, récemment, c’est le nom donné à une étoile (Trappist-1) située à 40 années-lumière de la Terre. Tous ces usages sont dans le poème qui s’ouvre sur une absence ; à la question « D’où venons-nous du plus loin / que vous et moi et de plus / loin que nous ? », est répondu « « Personne ». / Je ne rien » et, plus avant, sont donnés un temps et un espace non calculables, « Génération après génération / Galaxie et galaxie ». Jean Daive introduit des éléments susceptibles de transformer la lecture qui semblait acquise, les équivalences ciels / eaux, les trois Sœurs — Parques ou Moires —, le jeu du miroir, d’où le double et les paroles dupliquées, etc. On a le sentiment que le poème appartient à un ensemble où ces éléments sont intégrés.
Comme les livraisons précédentes de K.O.S.H.K.O.N.O.N.G., ce numéro exige du lecteur une lecture attentive — et c’est tant mieux : une revue devrait toujours être un lieu d’expériences d’écriture.
K .O.S.H.K.O.N.O.N.G., n° 27, Automne 2024, 32 p., 11 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 février 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
28/03/2025
Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul : recension

Le livre réunit six ensembles, dont plusieurs déjà publiés dans des revues, sous le signe de la musique dès le titre, "partita" impliquant aussi l’idée de variations. Un des groupements de poèmes évoque avec "chaconne" ("Chaconne pour une planète") une danse à trois temps née au XVIIe siècle ; un autre est plus explicite, "Musiques sur quelques départs". Enfin la conclusion du premier texte en exergue consacré à l’emploi par Bach du violon pourrait résumer ce qu’ambitionne Olivier Barbarant dans le recueil, « [à propos du violon chez Bach, instrument double, harmonique et symphonique] Cette dimension porteuse d’opacité, de relief et d’une sorte d’au-delà de lui-même. Cet équilibre aussi d’un cante jondo[chant profond] ne sortira rien qui se contente d’être lisse et beau, mais âpre et réel et vrai ».
"Enfantines" ouvre le livre avec une quadruple référence dans le premier poème : le titre, « Qui je fus », est emprunté à Michaux (1), le port dans l’adolescence du triangle rose (2) est une allusion transparente à l’homosexualité, des noms d’écrivains, un d’une femme politique, sont ceux des modèles à égaler (« devenir Hugo, Gide, Verlaine, ou Louise Michel) », est cité Glenn Gould avec son « jeu très lent construit au bord du gouffre » dans son interprétation des Variations Goldberg de Bach. On peut lire là une manière de programme. Comme Michaux dans Qui je fus Olivier Barbarant s’appuie souvent ensuite sur des éléments biographiques : amours homosexuelles, rappel du lien à Aragon à propos de qui il a publié plusieurs livres (ici, le titre du second ensemble est l’incipit d’un chapitre d’Aurélien), souvenirs de l’enfance, etc. Le dernier groupe de poèmes se présente comme un bilan (« Quelle étrange vie à la fin / (…)/ Aura été la tienne »), avec à nouveau la présence de Paris, des proches qui portent des prénoms (Bérénice, Aurélien) issus d’Aurélien, l’amour au centre de sa vie, les disparitions (« Vivre était donc apprendre à perdre ») et un sentiment de solitude, « Sans doute la plupart ignorent / Que j’ai su si bien les aimer ».
Le recueil est dominé par deux motifs complémentaires : la fin accélérée du monde et la manière dont l’individu peut vivre ce désastre. « Toute la terre est périssable », ce qu’annonce le rappel elliptique de destructions récentes, « Des tours jumelles. Des cathédrales / Une centrale […] ». Ce qui est détaillé, c’est la disparition future des œuvres d’art, « Il ne restera rien de nos musiques mortes », ni de Matisse, Chardin ou Caravage. Mais rien non plus du "nous", des humains comme individus : devenus un « troupeau docile ». Cet avenir n’est pas l’Apocalypse de la religion, seulement une conséquence des actions humaines qui aboutiront au néant, au rien, à « l’ultime chaos ». S’il est à faire une prière — tout à fait inutile cependant — elle ne s’adresse pas à un dieu absent mais aux humains, « Ayons pitié de nous / Ayons pitié de nous ». On note le choix du 12-syllabes ou du décasyllabe, vers "nobles", pour chaque fois conclure des annonces de destruction (« Mais qui entend vraiment la cloche d’incendie », « Pas de grand écran pour notre agonie »). Ce tableau sombre, désespéré, préfigure le sort de l’humanité et il n’est pas difficile de penser qu’il ne s’agit pas d’une fiction, tant se manifeste en effet une indifférence générale, pas seulement celle des gouvernants, devant l’extinction d’espèces animales ou les changements du régime des eaux. Que faire quand tous les signes d’une catastrophe s’accumulent.
La réponse d’Olivier Barbarant n’est pas un sauve-qui-peut, plutôt le choix de retenir ce qui reste pour, chacun, vivre au mieux le présent : « dans cet enfer promis / Passent quelquefoisdes abeilles » (souligné par moi), au béton opposer la glycine et au rien « un autre infini » constitué par la lumière, le vent, les fleurs, les oiseaux, les regards, les échanges, « Un accord entre deux pensées ». Partir du fait que « L’essentiel n’existe qu’à peine » implique que tout ce qui éloigne du désastre est fragile, que l’on ne saisira que des « buées », des « balbutiements », des « instants », des « miettes », « une poudre »,
Pour toute force l’éphémère
la vraie vie parie sur le givre
qu’on regarde aux fenêtres fondre
On se proposera de lire, de regarder, d’écouter, d’écrire peut-être, sachant que toutes les œuvres humaines disparaîtront, comme disparaissent les lieux que l’on a connus et appréciés, et l’on comprendra que l’amour dans tous les sens du mot appartient à la « vraie vie »,
L’art et l’amour ouvrent l’amande
du monde enfin déshabillé
dont ne tombent que les mensonges
L’amour des corps, homosexuel ou non, sauve donc du gouffre par la beauté des corps ou la grâce de l’étreinte, même quand elle a lieu au fond d’un garage. C’est le fait d’être deux qui donne un sens à sa propre existence, ce que reprend Olivier Barbarant sous différentes formes, « L’important n’est pas de savoir qui l’on est / mais ce que d’un corps l’on offre à la vie ».
Les poèmes d’Olivier Barbarant ne cherchent pas à innover en abandonnant toute règle : pas de tentative de faire naître le sens par l’illisible ou en prétendant fonder une autre langue. Comme d’autres contemporains (Ristat ou Paulin, par exemple), il utilise le vers libre compté (surtout l’hexa- et l’octosyllabe), ne néglige pas les images (« une farine de visages », « la neige du sourire », etc., l’anaphore ou l’énumération qui arrête un instant la variété du réel. Il s’agit toujours de saisir ce qui ne dure pas, de dire et redire que ce « monde menacé » peut encore être « l’écho d’être deux ».
- Henri Michaux, Qui je fus, "Une Œuvre un Portrait", Gallimard, 1927.
- Le triangle rose était le symbole porté par les homosexuels masculins dans l’univers concentrationnaire nazi ; les lesbiennes portaient le triangle noir, symbole désignant les asociaux.
Olivier Barbarant, Partitas pour violon seul, Gallimard, 2025, 96 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 11 février 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
17/03/2025
Marc Cholodenko, De très brefs rêve : recension

Si les récits de rêves sont relativement abondants depuis le XIXe siècle — de Nerval (Aurélia et son incipit, « Le rêve est une seconde vie ») à Hugo, d’André Breton à Ionesco et Perec — les recueils sont plus rares. À côté de Michel Butor (Matière de rêves) et Michel Leiris (Nuits sans nuit), certains auteurs ont publié des rêves inventés, comme Queneau (Des récits de rêves à foison) notamment dans un roman (Les Fleurs bleues) où, à quelques siècles de distance, un duc d’Auge rêve d’un Cidrolin qui rêve de ce duc d’Auge. De très brefs rêves se présente en quatrième de couverture comme un ensemble de rêves « brefs » — de quelques lignes à une quinzaine ; après une série de cent rêves, un second ensemble de trente-huit titré "d’une autre sorte", précède un rêve isolé, d’une page, "L’ultime, plus long". Inutile de se demander si ces récits de rêves sont bien la notation de vrais rêves, mieux vaut les aborder comme des récits littéraires en évitant de s’encombrer d’une grille de lecture : chacun appliquera la sienne, s’il le souhaite.
Le narrateur, évidemment, est toujours présent et un "portrait" de lui semble se construire à partir des récits mais, sauf encore à confondre narrateur et auteur, on peut reconnaître dans le "je" sans trop de peine n’importe quel quidam. Le rêveur affirme d’ailleurs d’emblée ne pas avoir d’intégrité assurée, incapable de se reconnaître devant un miroir, incapable justement de coïncider avec un "je". Il n’est de surcroît pas du tout reçu comme individu par ceux qu’il côtoie, se voit « seul et malheureux », « oublié ». Il semble hors de ce monde qui ne le voit pas, s’apercevant un jour qu’il a un voisin dans son immeuble ; il sait, dit-il, « l’indifférence du monde à moi qui y suis indifférent, juste retour des choses ». Mais s’il se refuse à ce qu’on s’adresse à lui avec « Monsieur », (« C’est moi ce Monsieur ? Dieu me préserve de l’être jamais »), il souffre en même temps d’être retranché du monde ; imaginant une présence derrière lui, il se retourne, « ilnyapersonne », ne pouvant plus lacer ses souliers et, alors dans « le royaume des impossibilités », il « appelle à l’aide. » Mais constat : « Il semble bien que personne ne m’y a suivi ». Peut-on sortir de cette balance entre le fait de se sentir seul et le besoin d’exister pour autrui ? L’équilibre est sans doute possible dans un monde qui n’existe pas ; quand le narrateur rapporte avoir raté son train, il comprend que « tout, à commencer par les arbres, se suffit d’être », et il en tire une leçon, « S’il y avait un autre temps, c’est vers là qu’il serait possible de se retourner ».
Les récits du livre ne visent pas cependant dans l’ensemble à énumérer les difficultés à se vivre comme individu, mal à l’aise dans un monde où l’on peine à trouver une place. La recherche d’une apparence qui distingue chacun d’autrui est tournée en dérision avec humour ; le narrateur s’aperçoit qu’un de ses doigts a disparu et cherche la bague qu’il portait ; il se voit avec un pansement sur la tête, à la manière de l’"Autoportrait " de Dürer, et se baptise « Autoportrait au pansement » ; son visage n’est pas simplement visible sur son mouchoir, comme celui du Christ dans la légende du suaire de Turin, mais y est transposé : personne ne s’en aperçoit, ce qui appelle le commentaire « Ça aussi est déjà arrivé ». L’humour repose aussi sur les mots : quand on rêve d’avoir les oreilles décollées, on les a sans doute mises dans sa poche.
Le sommeil favorise-t-il le jeu avec le sens des mots ? On en lira plusieurs dans ces très brefs rêves, par exemple une distinction entre « gravir des degrés » et « monter des escaliers », ou à propos de "claudication" : le narrateur s’imagine être remarqué à cause de sa claudication, mais personne ne peut lui expliquer le sens du mot, donc il faut conclure, « Soit c’est un mot que j’ai inventé. Soit ce ne doit pas être la claudication. » Une partie importante des rêves repose sur une situation absurde relatée sans distance, d’où un humour décapant et, en même temps, une "leçon" sur la manière de vivre, comme dans ce rêve :
Ce coiffeur me rase le crâne. Je ne lui ai pas demandé. Il doit savoir ce qu’il fait. Il faut parfois pouvoir s’abandonner aux trop rares imprévus que nous offre la vie. Mais non il me rase la boîte crânienne. Voilà mon cerveau qui apparaît. C’est rafraîchissant. Avec cette physionomie simplifiée je ressemble plus à n’importe quel homme. Ce qui correspond tout à fait à mon caractère effacé.
Le lecteur relèvera d’autres récits qui aboutissent, discrètement, à une leçon comme dans une fable, leçon qui n’a rien à voir avec une morale. Nombreux aussi dans leur construction sont les rêves qui, construits comme une nouvelle minuscule, s’achèvent avec une chute. Ainsi, le narrateur s’étonne que la statuette tout juste acquise lui sourie : sourire moqueur, le prix sur l’étiquette est plus bas que la somme versée au marchand. La manche du manteau n’essuie pas les larmes du narrateur, il a déjà enfilé le vêtement qui, donc, n’est pas son ami, « C’est moi qui suis mon ami. Mon seul ami. Je n’ai même pas un manteau pour ami. » Etc. D’autres récits sont clairement proches du fantastique ; la femme inconnue devant la porte assure au narrateur qu’il la connaîtra le jour suivant, les fleurs lui disent leur nom, etc., et, comme nous sommes dans la littérature, on entrerait volontiers avec lui dans ce café où le propriétaire donne au consommateur un billet pour visiter le cimetière marin.
Entrer dans ces brefs récits c’est aussi être sollicité par le narrateur, directement (« Si ma réaction ne vous surprend pas… ») et par la variété de l’écriture : phrase très courte, phrase proustienne, vocabulaire familier un peu vieilli (troquet), restitution de formes orales (J’ai qu’à dire, c’est quoi comme marque, etc.), références littéraires. C’est aussi oublier les diverses interprétations que l’on attribue à nos histoires nocturnes ; Proust, dans Le côté de Guermantes, rapportait comme le voulait une certaine psychologie au XIXe siècle une analogie entre les rêves et la prise de drogues et l’aliénation mentale, d’autres théories se sont développées, toutes gêneraient le plaisir de lire ces très brefs rêves.
Marc Cholodenko, De très brefs rêves, P.O.L, 2025, 96 p., 17 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 31 janvier 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
07/03/2025
Julia Peker, Marelle : recension

« démêler les ombres »
Jusqu’à une époque récente les enfants blessés dans leur vie et éprouvant les plus grandes difficultés à se construire, finissaient le plus souvent, devenus adultes, à la dérive ; l’aide extérieure nécessaire pour les aider, relativement récente, en sauve une partie du désespoir de vivre. Julia Peker, psychologue clinicienne, reçoit ces enfants et adolescents, garçons et filles, que la vie a commencé très tôt à détruire. Ses poèmes ne sont pas des comptes rendus de séances, ils ont été écrits à partir de soins faits d’écoute et d’échange, aussi l’expression « poèmes cliniques » de l’auteure pour les définir paraît-elle inadéquate : ils n’ont pas vocation à être lus par ceux et celles qu’elle a accompagnés dans leur détresse, mais par des lecteurs de poésie. Ces poèmes, en strophes de quelques vers brefs, rarement plus de vingt, restituent, en belle page, le "portrait" d’une rencontre qu’un titre, page de gauche, tente de présenter.
Marelle est aussi le titre d’un poème qui met crûment en lumière, la quasi-impossibilité d’un enfant cabossé de s’adapter à certaines pratiques sociales, ici à un jeu qui, en principe, n’est pas solitaire, courant dans les cours de récréation autrefois. Après avoir tracé sur le sol le dessin d’une marelle, l’enfant ne parvient pas à sauter, sans doute par crainte d’échouer ; preuve d’un rapport au monde, difficile ou peut-être impossible, qui apparaît avec force au lecteur. Souvent, les titres des poèmes sont éloquents : le saut, SOS, Noir, le cri, mutique, survivre à la nuit, la langue de personne, etc.
On devine que des drames familiaux, des violences, le décès d’un proche ou (et) l’absence des plus simples sentiments d’affection ont été à l’origine des troubles profonds que la psychologue tente de comprendre pour chercher avec l’enfant à les réduire. Mais il est rare que quoi que ce soit s’exprime à ce sujet. Souvent l’enfant reste muet, se ferme, parle d’autre chose, parfois quitte la pièce en refusant la main tendue, ce que traduit, parmi d’autres, une strophe :
tes mots ont pris le pli
s’avancent sur des lignes parallèles
pour ne jamais croiser
ce qui pourrait remonter du dedans
ne rien déterrer de tes nuits
ne rien voir de ce qui s’écroule
quand tu cherches à tenir
Quelle que soit la qualité de son écoute, l’adulte se retrouve régulièrement devant un enfant qui garde « un secret/défendu par la peur ». "Peur" est un des mots récurrents, marque du malaise d’exister, d’être là : c’est « la peur d’être vu », c’est « la peur [qui] secoue sans bruit [l]es épaules », c’est la peur de dire ce qui provoque la peur. Alors la voix « trébuche » de ne pouvoir dire, de ne pouvoir sortir d’un « labyrinthe à sens unique », et si l’on s’extrait du dédale c’est pour rester devant des « portes closes » : personne n’attend personne à la sortie.
La rencontre avec l’enfant ou l’adolescente(e) s’organise pour l’essentiel à partir de ses gestes, de ce qu’il peut dire et non de questions ; parfois, des mots mal acceptés parce qu’ils viennent de l’adulte — de l’autre —, provoquent le refus, interrompent toute possibilité d’échange, l’enfant s’absente ou se retire de la pièce, « le moindre mot/le moindre geste/et tout explose ». À l’inverse, le refus de la proximité peut se manifester par un flot de mots qui, d’une autre manière que le silence, éloigne la parole amie en face de soi, alors « les mots s’empilent/sans vraiment s’enchaîner ». Ce n’est pas dire que toute tentative d’approche échoue, que la psychologue ne peut rien faire ; même quand l’enfant se vit « seul contre tous », il essaie toujours de ne pas rompre avec ce "tous" et c’est par le regard qu’il accepte une aide, ce que relève l’auteure, « pour ne pas sombrer/ dans un gouffre sans fond/tu te contentes/ de croiser mon regard ». Le regard est, souvent, la voie d’où part une sorte de dialogue et, aussi, celle qui le bloque — on lit , parmi d’autres exemples, « ton regard se retire », « tes yeux sans regard s’enroulent en dedans ».
Même quand les mots s’échangent, ils ne font pas disparaître une tristesse, une douleur, des manques, la hantise de la perte, le sentiment que « les couleurs de la vie / [sont] introuvables ». Comment évacuer « les gravats de l’enfance » ? comment restituer sa plénitude à des « corps en morceaux », à une « unité morcelée » ? comment cette « plage secrète / délivrée des cris et du temps » à laquelle tous ces êtres blessés aspirent ? On sait que toute cette misère, depuis toujours, naît et se développe parce que la société ne se soucie pas, ou très peu, de la difficulté à se vivre, parce que les uns et les autres ignorent cette souffrance. Pourtant, elle est souvent proche et Julia Peker dit justement « mais que verrions-nous/sans tes questions qui font tourner le monde ? »
Le commentaire de sitaudis.fr
Julia Peker, Marelle. Dessins d’Edna Lindenbaur. Préface de Jean-Louis Giovannoni. L’Atelier contemporain. 176 p.. 25 €. Cetterecension a été publiée par Sitaudis le 18 janvier, 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julia peker, marelle, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
26/02/2025
Marie de Quatrebarbes, Les éléments : recension

Les livres de Marie de Quatrebarbes sont d’une certaine manière sans surprise : le lecteur n’y retrouve pas ce qui fait le fonds aujourd’hui de (très) nombreux recueils de poèmes, le récit de vie, l’autobiographie, la relation du quotidien. Les éléments est un livre exigent de questions, y entrer demande au lecteur un peu de patience et il aura en retour un rare plaisir de lecture. Ce qui peut être vite repérable dans le chaos offert, ce sont des constantes formelles et de contenu. Ici : les quatre premiers ensembles de poèmes en prose, Le détail principal, Les actualités reconstituées, Empirique fossile, Assez vivant, ont paru dans des revues, le cinquième est inédit ; ils sont liés de manière évidente, « les éléments », la mer, la terre, l’air sont constamment présents, moins le feu, avec « les films de Méliès brûlés » ; un cinquième poème en prose, Digression sur le dehors, est inédit, et construit à partir d’un des thèmes récurrents de l’œuvre, celui du reflet ou du double. Mais c’est le thème de la répétition qui apparaît dans la strophe d’ouverture.
Il est impossible de ne pas lire la reprise, trois fois, de : « enfance » (le jour de l’enfance, la très petite enfance, dans l’enfance) avec, comme une glose, « la petite fille ». Le mot revient régulièrement, un des ciments de parties assez diverses, plusieurs fois dans un poème avec des emplois différents, comme s’il s’agissait d’insister sur le choix formel de la répétition et la variété des significations :
L’enfant en l’enfant cajole l’enfant (…) Pour se donner du courage il chante quelque chose : je suis cet enfant qui vit à l’intérieur d’une autre enfant
On note la constance de l’enfance dans presque tous les livres, également sous la forme de la « petite fille » (« J’ai été cette petite fille solitaire », La vie moins une minute, 2014) ; elle est aussi présente dans Les éléments sous forme de souvenir (« Lorsque j’étais enfant, je pensais (…) »), également à la base d’une création artistique, « Inlassablement il répète les gestes en une série toujours identique ». D’autres mots réapparaissent au fil des pages, comme la tulipe, mot par ailleurs intégré une fois dans l’une des reprises d’un fragment de phrase [en italique] qui contribue à construire l’unité du livre :
« Comme l’élastique revient à sa position initiale, la tulipe de l’enfance retourne en la main avec la peau des doigts qui se touchent, s’entrelacent, s’entreglosent et nouent ensemble sensation, prémonition et désir »
Quelques variantes (verbes conjugués ou non, sujets différents, ajout de verbes, de compléments) apportent l’idée d’un changement continu dans les choses, dans le monde. Ce chaos est notamment figuré par le procédé de l’énumération, donc par l’impossibilité de contenir dans un texte le visible ; s’ajoute le fait que le nom des choses se crée par contiguïté sémantique (« il pleut (…) sur la mer basse continue ») ou sonore (« la pluie tombe sur (…) les voies toutes voilées de lumière, les voilures, les allures, les haleurs, les chaleurs, (…), les gens, les gendarmes (…), la voirie, la verrerie, les verrières » [etc.]). Sans oublier dans la longue liste des éléments — « la lumière, des éclairs » — ou des expressions — « les masques qui tombent » — que la pluie ne peut atteindre. On imaginerait le peu de réalité de ce monde si, dans l’énumération qui précède immédiatement, toutes les images d’un film sont affirmées être « vraies », mais une partie ne peut être regardé contrairement à ce qui est suggéré, comme « les fantômes de la bibliothèque et le lys dans la vallée ».
La "réalité" du film transporte le lecteur dans la fiction, l’une des constantes de l’œuvre de Marie de Quatrebarbes, fiction revendiquée (1) ou non. Dans Les éléments, l’imaginaire irrigue le texte, des embryons de récits appartiennent au conte, l’un met en scène un homme extrait de l’écorce d’un arbre, un autre des parents qui abandonnent des mois leurs enfants et reviennent nus « avec un œuf dans la bouche », etc. La fiction peut reposer sur l’ignorance ou une observation médiocre, par exemple quand un enfant se souvient qu’il prenait les seiches pour des vaisseaux, ou elle naît par un jeu de langage ; « Si (…) que se serait-il passé ? ». Enfin elle est la raison d’être du cinéma, d’où la brève biographie de Georges Méliès, pionnier des trucages avec ses "actualités reconstituées", et l’allusion à des images de ses films, celle notamment de la jeune femme à cheval sur un croissant de lune. Imaginaire triomphant avec ce que l’on peut découvrir derrière la porte : on pense à Lewis Carroll ou, pour le cinéma , par exemple à L’imaginarium du docteur Parnassus de Terry Gilliam. On en vient à conclure que « Tout ce qui est fiction existe ou existera », ou a existé comme est rappelée l’ouverture de la Mer rouge pour permettre l’exil de Moïse (Exode, 14).
Il s’agit bien d’une rupture d’avec "l’ordre naturel" et l’auteure introduit dans le livre des ruptures analogues en brisant l’ordre donné comme logique dans une suite de phrases, descriptive ou narrative. Un récit, ouvert avec la mention d’une femme couchée sur le sol bifurque complètement quand elle est comparée par son immobilité à une banquise : elle laisse place à des considérations sur la glace, la neige, l’iceberg — saut d’autant plus grand que la scène se passe à Tanger. Le lecteur rencontre d’autres ruptures avec la juxtaposition dans un énoncé, ou entre deux énoncés, de deux propos sans lien entre eux :
Une fois j’ai vu au microscope un morceau de mon doigt et il en va de même avec les gens
La rupture repose aussi sur un interdit culturel propre à notre civilisation et la présenter sans aucun commentaire en accroît la force, l’énoncé restreignant la pratique anthropophagique à une catégorie, « On ne doit pas manger la chair de ceux avec lesquels on dort ».
Ainsi les représentations du monde se modifient sans cesse et l’on se demande comment ce chaos de l’expérience peut se maîtriser. À vrai dire aucune issue n’est avancée. Les suggestions de la narratrice ne sont guère enthousiasmantes : « accrocher ma vie aux noms que j’invente, pas plus humains que moi, non plus que vous ». Pratique qui implique que « l’immobilité devient notre conquête », ce qui est répété ensuite, « Disons que l’immobilité est notre stratégie ». On comprend vite que la solution avancée n’en est pas une, pas celle de Marie de Quatrebarbes, mais que ses mouvements complexes dans la langue (qu’on a seulement esquissés) visent à questionner les représentations de l’expérience (de la langue, du monde), outre le plaisir de lire qu’ils procurent.
- voir par exemple : "on invente des histoires pour les derniers petits", La vie moins une minute, 2014.
Marie de Quatrebarbes, Les éléments, P.O.L, 120 p.,16 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 12 janvier 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
31/01/2025
Gérard Cartier, Le Roman de Mara : recension
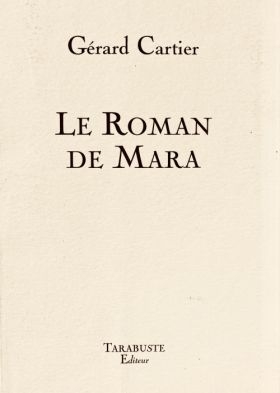
« Tout parle tout fait signe »
Gérard Cartier a choisi d’écrire en vers Le Roman de Mara, comme pour la plupart de ses fictions classées dans le genre "poésie" dans sa bibliographie — il approuve sans doute Rémi de Gourmont affirmant en 1892 que « le roman doit être un poème, car il n’y a qu’un seul genre en littérature : le poème. » (1) Le Roman de Mara est un récit à plusieurs personnages : le narrateur, père de Mara, O***, morte mais souvent évoquée et Mara, au centre d’un livre strictement composé. Il commence par un poème titré "Le carnet" qui annonce quelques éléments du récit et s’achève par « le livre s’ouvre » ; suivent trois chapitres de longueur égale, " L’enfance Mara", "Le Grand Huit" et "La Passion Mara" ; le premier et le troisième titres reprennent la syntaxe du Moyen Âge conservée aujourd’hui, par exemple, dans "Hôtel Dieu" ; un poème séparé, "Le reste du carnet", clôt le livre. Chaque chapitre compte 33 poèmes d’une page, numérotés en chiffres romains mais titrée dans la table des matières. On reprendrait volontiers ce qu’écrit l’auteur qui voudrait « que rien ne dérange les lignes » mais qui apprécie le chaos. De là, parce qu’il garde ces choix opposés, « ce trouble à ajuster mes pages / où s’entassent en vrac l’harmonieux et l’informe ».
Harmonie dans la construction et dans le propos, qui suit Mara dans l’enfance, puis dans la formation avec le traditionnel — dans d’autres temps — voyage en Europe, surtout en Italie, et enfin dans sa séparation d’avec l’éducation paternelle quand elle vit sa « passion » amoureuse. Les noms des personnages eux-mêmes ramènent à l’Italie : Mara (d’origine hébraïque) et Ornella, prénom de l’absente restitué à la fin du livre. Le nom Mara est lui-même image de l’harmonie : à une lettre près anagramme de "amare" (latin et italien aimer) et, dans le titre, /m…r/ suit /r…m/, dans un poème, une quasi paronomase quand il est question du « royaume des enfants / à quoi Mara s’amarie ». L’harmonie est aussi dans les références culturelles. Le lecteur rencontre d’abondants renvois à la littérature, avec des noms variés — de Kafka à Maïakovski, de Keats à Laforgue — et de multiples langues ; le latin est présent, plus encore l’italien, souvent pour des citations comme celle du lamento d’Arianna de Monteverdi ; on lit aussi des fragments dans d’autres langues européennes et, dans une allusion à la "magie noire", quelques-uns de la langue des Dogon. La forme des poèmes elle-même participe de cette harmonie : en strophes (de deux, trois ou cinq vers) ou non le plus souvent : elles ne sont alors régulièrement ponctuées que par l’emploi de blancs qui organisent la lecture, et cette forme est commune aux fictions en vers de Gérard Cartier.
D’autres cohérences apparaissent d’un livre à l’autre. Il est question notamment du Dauphiné, du Vercors, communs à d’autres ouvrages et lieux de formation de la sensibilité de l’auteur ; la venue dans la région (« cette montagne sainte ») fait partie de l’éducation de Mara qui, beaucoup plus tard, devrait vivre ce que vit le narrateur quand il y revient, « la / brume des années se dissipe et sur tes / pas se lèvent de très vieux sortilèges ». Le lecteur note aussi que le voyage ailleurs occupe une place privilégiée, ici pour la formation intellectuelle, esthétique, historique — Rome, Venise, etc., Auschwitz, Theresienstadt —, mais également que par la variété, souhaite le narrateur (l’auteur), « mes vers soient le monde » ».
Le monde est si divers qu’il est indispensable de l’accepter tel ; regarder les fleurs, les plantes, tout ce qui est là ne devrait être que pour le « plaisir du regard et de la pensée ». Mais le chaos existe, et la mort : les paroles du lamento de Monteverdi, lasciatemi morire(« laissez-moi mourir »), reviennent plusieurs fois. O***, la morte jamais oubliée (« O*** mia cara »), mère de Mara « enfantée d’une morte », n’est pas une figure apaisante, le narrateur tout au long du récit sait qu’il « s’obstin[e] à ce qui n’est plus » et ne fait son deuil que devant choisir entre « l’abîme » et un « visage juvénile », moment où il peut enfin écrire le nom "Ornella". Encore le fait-il parce qu’il voit le même dans la morte et la vivante, « même regard charbonneux, même visage sous / la cendre ». Mara elle-même semble représenter le chaos, par tous les aspects divers de sa personnalité ; elle est Mara-la-noire, Mara-en-Bacchus, Mara ivre, au jardin, l’enchanteresse, Mara-la-fantasque, Mara en momie, Mara-des-cendres, Mara-des-cauchemars, Mara-du-soleil, Mara-des-vanités, Mara-la-fourbe, Mara-des-fuites. Cette multiplicité est partagée, figure de toute femme, de tout homme. Le chaos est aussi dans le narrateur qui a embrassé les promesses d’une utopie, celle portée par Lénine, puis a renié pour son amour « vers et révolution », qui commence à recouvrer un peu de sérénité à voir Mara devenir femme, vivant sa passion, « chassant d’un cri l’absente, la remplaçant ».
Gérard Cartier est ici écrivain de complexes voyages intérieurs, celui d’un personnage, Mara, dont on ne connaît que des bribes livrées par le narrateur soucieux de développer sa propre histoire. Le récit s’achève avec deux transformations majeures : connaissance de l’amour pour l’une, acceptation de la vie pour l’autre, « on ne doit pas camper sur les tombes. lâcher la main de l’absente (…) tandis que coule, sous le parapet, la vie perpétuelle ». Tout recommence, autrement : l’essentiel consiste toujours à vouloir « l’Énumération du monde ».
______________________________
- C’est à la fin du XIXe siècle que Raymond Roussel revendique le terme de "roman" pour La Doublure (1897), écrit en alexandrins classiques. Les romans en vers sont plus que rares au siècle suivant et leur appartenance au genre discutée. On cite toujours Le Voleur de Talan(1917), "roman" de Pierre Reverdy, Chêne et chien (1937), de Raymond Queneau, "roman en vers" comme La beauté de l’amour (1955) de Jacques Audiberti, Une vie ordinaire (1967) de Georges Perros, "roman poème".
Gérard Cartier, Le Roman de Mara, Tarabuste, 2024, 140 p., 14 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 5 janvier 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
19/01/2025
Murat, Henriette de Castelnau, comtesse de, Le château de Kerbosy : recension
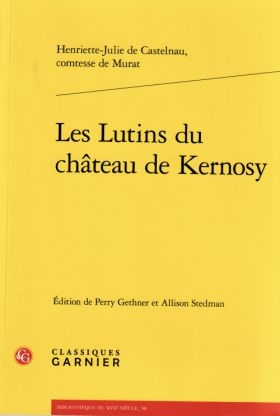
Entrer dans Les Lutins de Kernosy (1710), c’est retrouver l’usage de la langue de la seconde moitié du XVIIe siècle, celle de Madame de Lafayette par exemple, précisément dans ce que l’on désigne par "roman de loisir", genre alors très apprécié. C’est aussi apprendre que s’est alors développée une littérature oubliée qui comprenait, outre ces romans, des contes de fées, de fausses correspondances, des poésies, des chansons écrits aussi par des femmes. On connaît encore les contes de Marie-Catherine d’Aulnoy et les poésies d’Antoinette Deshoulières (rééditées dans Poésie/Gallimard, 2024), mais les noms d’Henriette de la Suze ou de Françoise Pascal, comme celui de la comtesse de Murat (1668-1716), ne sont un peu familiers qu’à des historiens de la littérature. L’œuvre de cette dernière, en partie rééditée depuis la fin du XXe siècle, permet de découvrir ce que l’on ignore le plus souvent, l’existence d’une littérature que l’on qualifie aujourd’hui de féministe. Madame de Murat, ce que rappellent ses éditeurs, a souffert de ses choix : elle était lesbienne et a toujours refusé le rôle imparti aux femmes dans une société où elles avaient fort peu de place ; condamnée à l’exil en 1702, elle passe sept années à la prison de Loches, près de Tours. Elle a défendu, notamment dans Les Lutins de Kernosy, un statut qui, sur bien des points, n’a été acquis qu’au XXe siècle et n’est encore pas unanimement accepté.
L’intrigue du roman est construite pour mettre en valeur tout ce qui, selon madame de Murat, devrait être adopté pour que les femmes aient des droits égaux à ceux des hommes. Les événements se passent pour l’essentiel dans le château d’une vicomtesse en Bretagne, pas très éloigné de Rennes ; elle est la tante des deux jeunes filles héroïnes du roman, reçoit beaucoup et loge ses invités — ce qui facilite la continuité du récit. — propriétaire et hôtes appartiennent à une noblesse fortunée. Les "lutins" sont deux jeunes nobles amoureux des nièces ; ils jouent la tradition des demeures hantées pour transmettre des messages par le conduit de la cheminée des chambres. Les couples d’amoureux finiront tous par se former, y compris l’un d’entre eux qui semblait échapper à une issue heureuse ; une jeune femme a été contrainte à l’union avec un homme riche, ami de son père ; cet époux non choisi tombe gravement malade et, avant de décéder, reconnaît avoir fait le malheur d’un couple possible : il fait du jeune homme son héritier et conseille vivement à sa bientôt veuve de l’épouser.
Madame de Murat développe ses idées à partir de ce schéma simple et le récit s’achève selon les principes qu’elle défend, « Enfin l’amour avait résolu de triompher dans ce vieux château et de n’y point laisser de cœurs tranquilles. » Le lecteur dira que la fin est identique à celle des romans de gare contemporains, sauf qu’aujourd’hui peu d’obstacles s’opposent à un "mariage d’amour" ; à la fin du XVIIe siècle, le choix de l’époux appartenait au père, fille ou garçon ne pouvaient songer à s’y opposer. Les positions de l’auteure, propres plus tard au féminisme, sont plus dans le ton des Lumières que dans le traité de l’Éducation des filles de Fénelon paru un peu plus tôt (1687). Même si les hommes conservent le privilège de l’action dans le monde, les femmes devraient recevoir un bagage intellectuel équivalent au leur.
Dans la micro-société du château, les femmes ont d’ailleurs dans certains cas un rôle social équivalent à celui des hommes ; elles assistent aux pièces de théâtre, les commentent et participent largement aux discussions et aux jeux (y compris les jeux d’argent) qui suivent les repas, passant même une nuit entière à profiter des loisirs. Elles ont aussi un œil et des propos critiques vis-à-vis des hommes ; un noble venu de Rennes, Monsieur de Fatville, dont l’apparence correspond à son nom, est brocardé par les deux nièces, « À la vérité, c’est un fat ; il en faut au moins un pour servir de risée à la compagnie », dit l’une. Quand la vicomtesse entend obliger une de ses nièces à épouser un homme riche pour éponger ses propres dettes, la jeune fille, sans s’opposer frontalement, travaille avec ses amis, femmes et hommes, à changer le point de vue de sa tante. Une autre noble accepte sans jalousie le mariage de l’homme aimé avec une autre femme ; il deviendra riche et ne sera pas éloigné d’elle : le lecteur en conclut qu’elle sera sa maîtresse.
Cette noblesse jouit des plaisirs qu’on aurait cru propres à la Cour (que quelques-uns fréquentent) ou à la ville ; on compose et on lit des poèmes galants, on chante des madrigaux sur des airs à la mode, on boit du café et du chocolat (boissons réservées alors à un public plus qu’aisé), on fait aussi venir des musiciens pour accompagner les danses, une troupe de comédiens pour y jouer des pièces d’auteurs à la mode ou devenus "classiques" dès la fin du XVIIe siècle, Corneille, Racine, Molière : à chaque séance, une tragédie et une comédie ; les éditeurs du roman analysent la relation entre certaines pièces et l’intrigue ou tel personnage — Le Bourgeois gentilhomme ou Bérénice, par exemple. L’un des personnages principaux n’hésite pas à jouer la comédie en se faisant passer pour directeur d’une troupe de comédiens, qui ont alors un rôle dans l’intrigue et une partie des personnes présentes ignore assister au théâtre dans le théâtre.
Le roman est accompagné d’un appareil critique nécessaire, les habitudes sociales de la fin du XVIIe siècle sont fort éloignées des nôtres : l’introduction renseigne utilement sur le « roman de loisir » comme sur la vie théâtrale et sur l’œuvre de Madame de Murat ; une bibliographie de ses œuvres en précède une autre, générale, sur la période. On approuve les éditeurs qui voient dans Le château de Kernosy un roman qui « éclaire un moment de transition, littéraire et intellectuelle » et « annonce un des courants dominants dans la production romanesque de l’époque des Lumières ».
Murat, Henriette Julie de Castelnau, comtesse de, Les Lutins de Kernosy, édition Perry Gethner et Allison Stedman, Classiques Garnier, Bibliothèque du XVIIe siècle, 2024, 192 p., 28 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 11 décembre 2024
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
22/12/2024
François Heusbourg, Une position pour dormir : recension
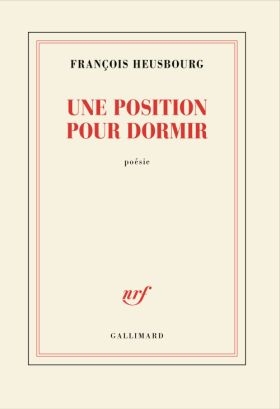
La quatrième de couverture propose une lecture de Une position pour dormir, ce serait un « Livre de fantômes » qui jouerait « de l’apparition et de l’effacement ». C’est ce que suggère le titre avec le passage par le narrateur de sa présence au monde à sa disparition dans le sommeil, d’où surgissent des images recomposées de la vie éveillée plus ou moins trompeuses, des fantômes qui, comme l’affirme Spicer mis en épigraphe, « ne sont pas des gens perspicaces ». Une autre lecture est proposée dans un épilogue en prose : après un résumé des poèmes, d’abord la fin de l’histoire d’un couple (« Ils étaient sur le point de partir chacun de leur côté (…) Comme tout était parti avant eux »), ensuite l’évocation d’une autre histoire, celle de la mère qui semblait exclure le narrateur à sa naissance avec ce commentaire : « il n’est pas très beau ».
Le premier poème présente d’emblée de manière lapidaire et imagée le thème de la séparation, « rentré // forme courte / d’un long voyage ». Il est immédiatement suivi de ce qui apparaît souvent dans la relation entre un je et un tu, l’extrême difficulté d’établir une langue commune : l’Autre parle toujours autrement que soi, quel que soit le sujet, « je dis traquenard tu prononces guet-apens » ; le temps vécu est saturé de mots dont la signification ne peut être entièrement partagée — « nous lisons le même livre dans des livres différents ». Ce qui, pour l’essentiel, constitue les jours d’un "couple" peut devenir une épreuve si est désirée par l’un ou/et l’autre une transparence impossible, une fusion qui gommerait l’écart entre les mots, la langue étant d’abord lieu de l’ambiguïté. Mais les oppositions existent dans tous les domaines, comme si l’idée même d’harmonie dans la société n'avait pas de sens. Il suffit de voyager pour rencontrer, criantes, les différences sociales, l’extrême misère à côté d’une opulence qui s’exhibe, les habitations faites de matériaux de rebut et les maisons à étages devant la mer.
Qu’est-ce donc qui, dans la vie quotidienne, peut être partagé ? tout ce qui ne s’inscrit pas dans le temps, ne demande donc pas de mots ou en demande peu, par exemple « les plus petits gestes quotidiens », notamment ceux des repas arrosés d’un bon vin :
dans les plus petits gestes quotidiens
peut-être ne nous sommes-nous pas trompés
ni de plaisirs ni de vie
Aller ensemble dans un lieu neutre par excellence autorise aussi le partage, encore peut-il être vécu par l’un et l’autre différemment : à la « plage » est associée la « page », une lettre suffit pour séparer la réalité de l’imaginaire. Certes, dans l’étreinte la certitude d’une unité est entière, même si chacun sait qu’elle est éphémère et fondée de manière différente ; une figure tout autre de l’unité du je et du tu est d’ailleurs donnée par la position du chat qui se couche entre leurs pieds — il se trouve un jour devant les portes fermées. Toujours chacun se heurte au mystère d’être, « nous aurions voulu être / tout à la fois, sans savoir quoi // chacun sa solitude / chacun/ sa cacophonie » et si le savoir rend possible l’échange, quelque chose reste infranchissable — dormir met provisoirement à distance la « cacophonie / le bruit d’être les uns / avec les autres ». Cependant, une vie avec l’Autre pourrait-elle « se résumer pour tout dire en une phrase ? » Elle existe dans le temps, s’est construite des souvenirs, se nourrit des moments présents et même de ce qu’il a été rêvé de faire ensemble. La rupture, c’est ce moment où on ne peut franchir l’écart entre le passé et le présent, comme si le temps se vidait de toute trace :
rien dans rien
les choses posées
rien
ne prend plus corps
fantômes
si tu t’en vas
L’Autre disparaît parmi les autres quand le "deuil" de l’amour est accompli. C’est à ce moment que revient un rêve d’abandon, « ce matin enfant perdu dans les bois », sans sortie possible (« on ne sort pas ») et cette perte de soi est immédiatement associée à la mère : le tu n’est plus la femme aimée mais celle qui « racontai[t] des histoires », histoires non pas d’abandon mais d’enfants qui jouent sous le regard de la mère, rêvant peut-être d’aventures très codifiées avec leur voiliers sur le bassin du jardin du Luxembourg. Les mots sur la laideur à la naissance sont une forme forte de rejet, le discours social dominant décidant que tout enfant est "beau" à son arrivée dans le monde.
Peut-on oublier l’abandon ? Le narrateur passe du je au on parce qu’il choisit de se taire — « on enterre on enterre / on fait des tas de terre » —, le silence (ou le sommeil) étant la seule réponse qui permet de maintenir une distance avec la violence du passé, de faire comme s’il appartenait à une autre vie.
Le titre, Une position pour dormir, ne s’éclaire que lentement dans ces poèmes qui mêlent deux histoires différentes, la première de perte, à peine esquissée, modifiant sans doute la seconde même si le narrateur tient à les distinguer, « et maman ou mère ou toi / non ». Plongée dans un vécu ou songe et réalité souvent difficiles à séparer, ce qui provisoirement éloigne les douleurs de la vie.
François Heusbourg, Une position pour dormir, Gallimard, 2024, 112 p., 16 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 17 novembre 2024.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois heusbourg, une position pour dormir | ![]() Facebook |
Facebook |
08/12/2024
La Pléiade, Poésie, Poétique : recension

Parler de la Pléiade aujourd’hui à un lecteur, c’est l’obliger à faire remonter des souvenirs scolaires et, en insistant un peu, reviennent les noms de Ronsard, dont il connaît encore quelques vers des Amours (« Mignonne, allons voir si la rose… ») et de Du Bellay, qui lui rappelle les Regrets(« Heureux qui comme Ulysse… »). À l’exception des sonnets d’Étienne Jodelle aisément accessibles (Poésie/Gallimard, 2022), les œuvres des autres membres du groupe sont, à très peu près, oubliées et lisibles dans des éditions savantes à consulter en bibliothèque ou partiellement dans des anthologies1. L’édition de Mireille Huchon2, d’abord, donne à lire des œuvres qu’il était bon de faire connaître, tel le théâtre de Jodelle ou des poèmes de Belleau, sans du tout mettre de côté d’autres connues (Ronsard, du Bellay) qui gardent la plus grosse part. Elle a ajouté pour la période de grande production (1545-1555) des textes de poétique devenus, eux, quasiment inconnus. Enfin, contrairement à l’image scolaire attachée à Ronsard et Du Bellay, les poètes de la Pléiade n’ont pas été applaudis par tous dans la seconde partie du XVIe siècle, des écrits polémiques et des témoignages complètent heureusement le recueil des textes. Ils sont suivis d’un répertoire des poètes et de leurs contemporains (image et texte) et de notes sur chaque œuvre publiée.
Mireille Huchon rappelle que Ronsard n’a utilisé que deux fois le terme Pléiade, par métaphore, à propos de la "brigade" de sept poètes (dont lui-même) du règne d’Henri II : Ronsard, du Bellay, Étienne Jodelle, Pontus de Tyard, Rémy Belleau, Antoine de Baïf et Peletier du Mans ; son contemporain Henri Estienne, plus tard (1678), parle des « poètes de la Pléiade », de la « nouvelle Pléiade ». La référence à l’Antiquité n’est pas fortuite, elle renvoie aux grands poètes grecs de la période alexandrine. Le nom s’est seulement installé au XIXe siècle, alors que certains membres du groupe ne se connaissaient que par la lecture de leurs textes ; il faut se souvenir qu’un écrivain comme Jodelle a refusé d’être publié de son vivant.
Le nom "Pléiade" est pratique pour évoquer une période particulièrement riche en littérature dans plusieurs domaines. Au début des années 1550, construites à l’antique, les premières tragédies (Cléopâtre captive, Didon se sacrifiant) et comédies (L’Eugène, La rencontre) sont dues à Étienne Jodelle. Parallèlement, si Clément Marot et Mellin de Saint Gelais ont introduit le sonnet en France, il est définitivement adopté comme genre avec la Pléiade qui le développe pendant des décennies.
C’est aussi avec la Pléiade que le sonnet devient par excellence le lieu poétique du discours amoureux. Le blason ancien n’est pas abandonné du tout, chaque partie du corps féminin est toujours exaltée, par exemple par Pontus de Tyard (second quatrain) :
Ton beau visage, où ton beau teint s’assemble,
Ta bouche faite en deux couraux plaisants,
Ton bien parler sur tous les bien disans,
Et ton doux ris doucement mon cœur emble.
En dehors de quelques poèmes, dont les Folastries de Ronsard, où le corps charnel est présent, le corps féminin entier est magnifié, fantasmé, souvent idéalisé et divinisé : les renvois à la mythologie abondent chez tous les poètes, permettant parfois l’allusion érotique ; ainsi, dans les Amours de Ronsard (tercets du sonnet 41) :
S'Europe avoit l'estomac aussi beau,
De t'estre fait, Jupiter, un toreau,
Je te pardonne. Hé, que ne sui'-je puce !
La baisotant, tous les jours je mordroi
Ses beaus tetins, mais la nuit je voudroi
Que rechanger en homme je me pusse.
Les sonnets n’ont pas de fonction référentielle précise, pas plus Marie, Olive ou Francine : s’installe pour très longtemps avec la Pléiade une représentation de la femme aimée — désirée mais absente —, et un je souffrant — image féminine cependant différente de celle de l’amour courtois ou des troubadours. Le thème de l’immortalité donnée par le poète à la femme, mais aussi au Prince, traverse une poésie qui cherche la reconnaissance des puissants ; Ronsard et du Bellay saluent l’un et l’autre l’entrée d’Henri II dans Paris, en 1549 — mais l’intérêt de ce roi pour les arts n’avait rien de commun avec l’engagement d’Auguste chez les Latins.
L’ode et l’hymne acquièrent aussi une place de choix dans les recueils de la Pléiade, mais c’est un autre genre qui prend place et reste toujours très vivant aujourd’hui, sous ce nom ou d’autres, l’art poétique. Pelletier du Mans en a été l’initiateur avec sa traduction (1545) de l’Art poétique d’Horace, largement utilisée un peu plus tard (1549) par Du Bellay dans la seconde partie de La Deffence et illustration de la Langue Françoyse, la première réservée à des réflexions sur la langue et les manières de l’enrichir, et sur l’orthographe. Cette "Défense" a été remise en lumière par Sainte-Beuve3 qui écrivait qu’elle était « la plus sure gloire de Du Bellay et la plus durable » ; elle est considérée comme un monument à partir du XXe siècle et des écrivains en ont repris le titre, y ajoutant « aujourd’hui » et en soulignant l’actualité4. Du Bellay prône l’abandon des genres anciens, propose la création de néologismes à partir des langues anciennes, préconise l’imitation des auteurs latins et grecs et de quelques auteurs italiens ; l’ensemble définit une esthétique nouvelle, mise en œuvre la même année avec L’Olive, recueil de sonnets et d’odes. Les réflexions de Du Bellay sur l’orthographe sont une approbation de ce que Louis Mégret avançait en 1542 : il faudrait une convergence entre l’écrit et la prononciation ; le poète garde cependant l’usage de son temps pour ne pas effrayer les lecteurs. Ronsard, de son côté, avance et dans ses Odes (1550) remplace notamment le i latin par j, le u par v, par ailleurs es par é(espandre > épandre).
Le lecteur découvrira des œuvres peu accessibles, en particulier Le Quintil horatian, critique de La Deffence…de du Bellay, l’art poétique de Thomas Sébillet (1548), la traduction-adaptation de l’art poétique d’Horace par Peletier du Mans (1545) et La Rhetorique francoise (1553) d’Antoine Poclin. Un ensemble de textes polémiques et de témoignages précèdent les notes ; les éclaircissements rassemblés — linguistiques, historiques et littéraires — font de ce volume, si le lecteur le désire, un excellent instrument de travail. Pour le plaisir de lire, il offre une superbe anthologie d’une des périodes les plus riches de la poésie en France.
1 Rappelons que Mireille Huchon a établi le texte des œuvres de la mystérieuse Louise Labé (Bibliothèque de la Pléiade, 2021).
2 La bibliothèque de la Pléiade a publié en 1953, choisis par Albert-Marie Schmidt, une anthologie de la poésie du XVIe siècle, de Marot (1496-1544) à Jean Baptiste Chassignet (1571-1635)
3 Sainte-Beuve, Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVIe siècle
4 « Autres temps, autres barbaries, autres combats mais peut-être même nécessité et même devoir : ne revient-il pas aujourd’hui aux écrivains, aux poètes, face à la domination d’une langue «moyenne» hâtive et désinvolte, asservie aux visées manipulatrices de la communication, de maintenir et de refonder sans cesse une langue affranchie, de revendiquer, par objection souvent, le droit à la nuance, au subtil, à la densité et à l’imprévu ? » Présentation de Défense et illustration de la langue française aujourd'hui (Poésie/Gallimard, hors-série, 2013), par un collectif : Marie-Claire Bancquart, Silvia Baron-Supervielle, Tahar Ben Jelloun, Alain Borer, Michel Butor, François Cheng, Michel Deguy, Vénus Koury-Ghata, Marcel Moreau, Jacques Réda, Jacques Roubaud.
La Pléiade, Poésie, Poétique, édition de Mireille Huchon, Gallimard, Pléiade, avril 2024, 1616 p., 75 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 14 novembre 2024.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la pléiade, poésie, poétique | ![]() Facebook |
Facebook |
01/12/2024
Fabienne Rahoz, Infini présent l'insecte
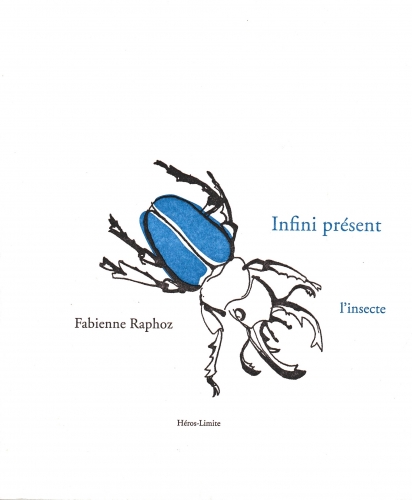
Qui a passé son enfance à la campagne a pu observer ce qui vivait au (et dans le) sol et dans les airs, oiseaux de toutes sortes, insectes de toutes couleurs, hérissons, mulots, etc. Outre cette expérience, irremplaçable, qui peut donner le goût des sciences naturelles, Fabienne Raphoz disposait d’un jeu des 7 familles où l’on demandait, par exemple, le Priam dans la famille des "Papillons exotiques" ; le classement n’était en rien scientifique mais, écrit-elle, « c’est peut-être de là que m’est venu ce goût pour la taxinomie et les classifications ». Goût des mots aussi, avec ce plaisir particulier de « prononcer des mots incompréhensibles ». Ce plaisir, notamment, beaucoup de lecteurs l’éprouveront en lisant Infini présent.
Les neuf citations en épigraphe, de Sei Shonagon (vers 966-après 1013) à la sculptrice Germaine Richier (1902-1959), à la fois pointent la complexité du monde des insectes, leur rôle essentiel dans l’équilibre écologique et leur place dans l’imaginaire. On retiendra la première, de Thalia Field (1966), auteure à la frontière de la narration et de la science, en accord avec les poèmes. « Parler des espèces est plus difficile que de parler de soi ». Au verso, une annonce, « Pour commencer », offre deux citations qui, chacune à leur manière, délimitent l’étendue des poèmes, celles d’un naturaliste anglais du XVIe siècle, Thomas Moffet, et d’un spécialiste contemporain de la Renaissance, Francis Goyet. Conservons la première, lapidaire, « In minimis tota est », que le premier poème, pages 12 et 13, illustre, en même temps qu’il est en relation avec le titre.
Sous le nom de l’ordre « THYNASOURES » une brève notice du naturaliste Walkenaer ; la page 13 répète en titre le nom de l’ordre et s’ajoute le nom de la famille, « Lespimatidae) ; le poème indique que cet insecte a sa place dans un traité de synanthropie : ils sont donc adaptés à la vie humaine et vivent dans les maisons où ils se nourrissent, par exemple, du papier des livres. Ils ont toujours été présents depuis le Dévonien — l’infini pour le temps humain, pour le présent. Le texte est suivi en bas à droite du nom courant (« Poisson d’argent »), de la désignation en latin (« Lepisma saccharina ») et de « Linnaeus, 1758), mention qui renvoie à la dixième édition de la classification de Linné, où son système de nomenclature avec deux noms en latin (générique et spécifique) est alors généralisé.
Se trouverait-on dans un manuel d’entomologiste comme le laisserait penser dans chaque poème l’exactitude des désignations ? Certains poèmes sont construits à partir de l’histoire de l’insecte, comme dans cet unique exemple de « Notoptères » :
Grylloblattes et gladiateurs
tous ailés du Permien
butinent les conifères
cent-cinquante millions d’années
durant
disparaissent au Crétacé
les plantes à fleurs viennent d’émerger
[etc.]
La majorité s’écrit à partir d’une observation rapportée — et le poème peut devenir esquisse de récit, par exemple à propos de l’expédition de Darwin — ou de l’auteure inspirée par une caractéristique de l’insecte ; ainsi après un poème à propos de l’hibernie, papillon qui n’apparaît qu’à l’automne, un autre qui lui est lié, appartenant au même ordre et à la même famille :
… ou alors
jaillissant des bois
une nuit de janvier
dîner tardif
en suspens
regards croisés
Un poème s’écrit à partir de la sonorité des mots, sans qu’il soit toujours nécessaire de retenir le vocabulaire français. Est choisie par exemple, en latin, « une liste de punaises rouge et noir issues de familles différentes » avec plusieurs critères de choix et, ensuite, de classement sur la page, le discours explicatif préalable faisant partie du poème :
Aracatus roeselii
Cenaeus carnifex
Carizus hyoscyami
Eurydema ventralis
Graphosoma italicum
Suivent deux ensembles de cinq noms disposés en échelle.
Une liste de noms, en l’occurrence de 48 oiseaux rassemblés en 4 colonnes, accumule des sons étranges pour qui n’est pas ornithologue (des savacous, des synallaxes, des saltators, etc.) — petit écart dans ce livre autour des insectes, que justifie le titre : « Peupler l’hiver d’ici » et l’amorce de la liste, « j’ai vu là-bas : ». Le lecteur lira aussi un poème en anglais, un autre avec trois lettres grecques répétées sur la page pour figurer le chant de la cigale grise.
Ce que suggèrent déjà les quelques poèmes cités, c’est la liberté de la mise en page qui correspond à la variété de la versification — jusqu’au dernier texte : l’ordre cette fois, avec humour, est noté « Bouquet final » avec pour l’accompagner quelques paroles d’une chanson de Pierre Barouh et, sur la belle page, un poème lapidaire :
Friche
il a suffi de laisser. les couleurs pousser
L’humour en poésie n’est pas des plus courants et l’on se réjouit souvent de la distance, et de la tendresse, prises par Fabienne Raphoz vis-à-vis de son objet. De l’ordre des Siphonaptères, la puce n’est nommée que par une citation (page de gauche) d’un sonnet des Amours de Ronsard, « Hé ! que ne suis-je puce » et par les deux derniers vers d’un poème en anglais de John Donne (The Flea, La puce), précédés d’un extrait de France Culture, « Comment peut-on dresser un si petit insecte ? ». Deux clins d’œil dans le poème en belle page :
quel cirque !
qu’en faire ?
de ces siphonap
tères
Maël me dit :
fais-les sauter
du livre
« je loue dans le poème / une vie plus vieille / que la mienne », écrit Fabienne Raphoz à propos d’un insecte. Ces louanges donnent envie de sortir du livre, de lire ou relire Fabre (présent plusieurs fois) et de vérifier que les insectes sont encore légion partout (y compris dans un jardin public, en ville) dans ce monde où tant d’espèces animales sont en voie de disparition, il faut le répéter et faire autre chose que s’en alarmer. On s’apercevra qu’ils sont souvent aussi beaux que le lucane dessiné par Ianna Andréadis en couverture. Une brève bibliographie complète ces poèmes qui donnent une présence vive à tous les insectes — « pour savoir il faut les voir ».
Fabienne Raphoz, Infini présent l’insecte, Héros-Limite, 2024
130 p.,18 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 25 octobre 2à24.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabienne raphoz, infini présent. l'insecte | ![]() Facebook |
Facebook |





