29/11/2020
Muriel Pic, Affranchissements : recension
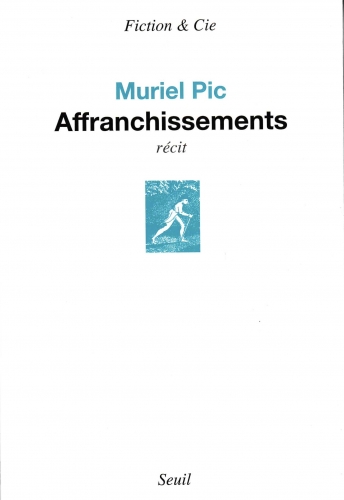
Affranchissements est sous-titré "récit", récit de la vie d’un oncle bossu, James/Jim, disparu au mois de mai 2001 ; cependant, les rares rencontres n’auraient pas permis de rapporter ce qu’avait été cette vie, ce que la narratrice concède, « Je suis bien obligée de reconnaître que je ne sais pas grand-chose de la vie de Jim. » La reconstruction s’opère à partir de documents divers, rassemblés ici et là, « photographies, timbres, cartes postales, dessins, cartes à jouer et bouts de textes ». À partir de cette moisson hétéroclite se dessine une figure qui ne peut être que floue, partiellement inventée, mise en relation avec la réalité chaotique de son temps et avec des lectures. L’enchevêtrement d’éléments hétéroclites restitue l’impossibilité de faire « revivre ce que l’on n’a pas vécu », sans pourtant que le "récit de vie" soit confus, incohérent : plusieurs fils l’organisent et ne demeurent d’obscurités que celles propres à toute vie.
Le livre contient 60 illustrations liées plus ou moins à l’oncle— plan d’un jardin ou d’un hôtel, dessin d’une fleur, carte postale, photographies, etc. —, mais tous ces documents visent à renforcer l’effet de réel du texte. Le mot "affranchissement" revient, à différents moments, avec ses diverses acceptions ; l’oncle, philatéliste, a la passion de « tout ce qui se rapporte à l’affranchissement » et, jardinier à l’Université de Londres, lecteur d’ouvrages d’horticulture il plante des arbres fruitiers en suivant la méthode de l’affranchissement. Le mot est aussi employé avec sa valeur de "libération", en particulier à propos du style dans la mode souvent « asservi à une forme qui satisfait les lois du marché en limitant l’imagination et l’intelligence pour ne pas s’exposer au péril de l’affranchissement ». Il est également choisi pour préciser le passage du réel à la poésie, « L’imagination affranchit les mots d’un rapport conventionnel avec le réel. Comprendre cet affranchissement est comprendre la poésie ». La double valeur du mot est d’ailleurs glosée, avec l’origine commune de free (= libre) et de to frank, « affranchir postalement », d’où l’« affinité entre le geste postal et le geste de libérer, qui fonde le double sens du mot français affranchissement ». En même temps que ce fil, la relation éclatée des moments de la vie de l’oncle forme la trame du récit.
Le portrait physique est limité à l’aspect général, déformé par la tuberculose osseuse : une « allure de vieillard et d’enfant » ; la narratrice explique beaucoup plus avant dans le texte l’origine de la maladie et les soins reçus quand elle relate ce que furent les parents — leur mauvaise gestion de leur hôtel à Menton, leur ruine, l’installation à Londres et leur mort de la grippe espagnole. Par les clients de l’hôtel, l’enfant a découvert très tôt la discrimination provoquée par la couleur de la peau et, plongé par le hasard de sa naissance dans un bain linguistique, il a appris l’anglais, le français, l’allemand et l’italien. Il a tenté de transmettre sa passion à sa nièce en lui envoyant des timbres chaque mois, mais la collection retrouvée dans le grenier en 2017 ne représente plus que « les restes d’un monde en train de partir ». Pour rejoindre son travail, il a inventé des chemins détournés, comme s’il passait « de l’autre côté du miroir, guidé par un être surnaturel ». Si la figure de l’oncle est relativement peu présente en tant que telle, son nom (James / Jim) et son infirmité structurent le récit.
Ainsi, le lecteur rencontre deux hommes qui portent le même prénom, le frère de Frances Yates, historienne de la magie1, et un riche Américain qui sillonnait la Méditerranée et que la rumeur prétendait être l’amant de la mère de l’oncle. Et il est question de bossus tout au long du récit : dans l’histoire économique (une superstition veut que "toucher la bosse d’un bossu" porterait chance pour s’enrichir), dans une fiction de l’Antiquité (l’esclave bossu acheté en même temps qu’un candélabre en or), dans le jeu du tarot (l’Hermite remplacé par le Bossu), dans les lectures (Leopardi, Gramsci), dans un dessin de Frances Yates (une figure féminine au « dos légèrement tordu ») et avec la présence continue de l’écrivain médecin William Carlos Williams : il est supposé rencontrer dans un parc un petit bossu qui, à la fin du récit, est dans sa salle d’attente.
La narratrice a acheté un livre de Williams (Spring and all) la dernière fois qu’elle a rencontré Jim et ses poèmes sont cités au début de cinq chapitres sur six. Le poète américain apparaît comme une référence majeure et un extrait d’un de ses poèmes est même attribué à Jim. Le récit débute d’ailleurs par la présentation de son livre dans des termes qui peuvent s’appliquer à Affranchissements : « il est tout : un essai, un récit avec des chapitres dont la numération est incohérente et des poèmes qui pensent à voix haute et l’œil grand ouvert, les logiques absurdes et jumelles des guerres et de l’économie marchande. » Le titre de chaque séquence des six parties est une date et les dates se suivent sans ordre apparent (1840, 1719, 1927, -225, 1965, etc.), des poèmes2 ferment quelques séquences, d’une écriture dans la lignée de Williams. Pour le dernier point, les essais, le renvoi au poète est explicite ; la narratrice relève que Williams « serre avec son imagination le détail du réel dans ses vers » et, plus loin, qu’elle écrit avec Spring and all ouvert.
Les essais en prose introduits portent aussi bien sur l’introduction de l’héliothérapie contre la tuberculose que sur Mallarmé et, surtout, sur la place de l’argent dans la société — à partir, notamment, d’un poème de Williams et de sa traduction en allemand par Enzensberger — et les méfaits du capitalisme. Si certaines pages sont bien intégrées dans le récit, bien des développements ressemblent à des articles d’une petite encyclopédie ; d’autres, par exemple à propos du capitalisme, manquent leur cible tant ils apparaissent sommaires. Le lecteur comprend bien qu’il s’agit de restituer quelque chose du chaos du monde, de sa complexité et, certes, la narratrice y insiste, le lecteur « ne doit pas chercher les grandes révélations » ; certes, elle renvoie à la fin du livre, à une longue liste « des noms de tous les auteurs d’après lesquels l’ouvrage a été écrit, personne n’écrivant seul ». Il n’empêche qu’un décalage existe entre le récit proprement dit, au tissage subtil et efficace, et ce qui apparaît souvent comme fragments étrangers — mais la narratrice insiste sur le fait qu’elle veut « une poésie documentaire, philologique, engagée objectivement dans le monde », et l’histoire de l’oncle est à lire comme élément parmi d’autres de l’histoire d’une époque.
On préfère retenir ce que l’oncle bossu a appris à la narratrice, « le poème non scriptum de nos échanges (...) juste le don de l’instant » — elle l’imagine d’ailleurs juste avant sa mort avec dans ses bras « le cadavre de l’instant » et, lisant son journal, elle retient sa description d’une prairie sèche : « une prolifération de hasards, un milieu anarchique (...). C’est un libre désordre », description qui pourrait être celle de la société, mais aussi celle d’Affranchissements.
Muriel Pic, Affranchissements, Seuil, 2020, 288p., 19 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 4 novembre 2020.
1 Frances Yates est surtout connue en France pour son livre L’Art de la mémoire (1966, traduit en 1987).
2 17 poèmes, d’abord écrits en anglais et présentés avec leur traduction.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : muriel pic, affranchissements : recension | ![]() Facebook |
Facebook |






Les commentaires sont fermés.