16/06/2018
Wislawa Szymborska (1923-2012), De la mort sans exagérer

Photographie de la foule
Sur la photo de la foule
ma tête septième à droite,
ou alors quatrième à gauche,
ou alors vingtième en partant du bas.
ma tête, je ne sais laquelle,
plus toute seule, plus unique,
déjà pareille aux semblables,
pas plus mâle que femelle ;
les signes qu’elle m’envoie
pas particuliers du tout ;
si l’Esprit du Temps la voit,
il ne la regarde pas ;
ma tête toute statistique,
consommant acier et câble,
globalement, paisiblement,
sans honte d’être quelconque,
sans chagrin d’être interchangeable ;
comme si je ne l’avais guère
pour moi, et à ma manière ;
comme dans un cimetière antique
plein de crânes anonymes,
tous assez bien conservés
malgré leur mortalité ;
comme si elle y était déjà,
pas à moi, universelle ;
où, si elle peut se souvenir,
c’est de son profond avenir.
Wislawa Szymborska, De la mort sans exagérer,
traduction du polonais Piotr Kaminski,
Poésie / Gallimard, 2018, p. 118-119.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wislawa szymborska (1923-2012), de la mort sans exagérer, photographie de la foule | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2018
Pierre Mabille, C'est cadeau : recension
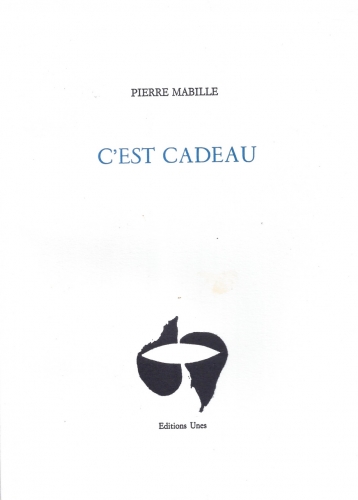
C’est cadeaucomprend deux formes différentes de poèmes, 29 en vers presque toujours courts, 5 beaucoup plus amples écrits, comme le note en avant texte l’éditeur, à partir d’un motif récurrent. Le poème d’ouverture, bref, reprend sous plusieurs formes la séquence « certaines petites choses » : elle se transforme en « certaines / petites choses », puis « certaine / petites / choses ». Les textes plus développés sont construits sur l’énumération, avec une entrée comme « Tout ce qui est à moi » ou « mon poème », ou « mon côté », suivie d’un nom (ou de plusieurs noms, d’un nom qualifié, etc.) ; les noms sont donnés selon l’ordre alphabétique ou l’ordre inverse (de Z à A) comme dans le premier poème de ce type. L’ensemble (donc 26 groupes) s’achève par une formule pour signifier l’abandon des biens désignés — « tout ce qui est à moi / je t’en fais don je te le / donne », « C K DO », etc.
Les listes rassemblent des éléments hétérogènes et un certain humour naît de leur juxtaposition, ainsi : « tout ce qui est à moi mon ordi mon oreiller mon outil mon outillage mon nœud pap mon nuancier mon numéro gagnant ». Pourtant, l’abondance des mots liés à la vie d’aujourd’hui telle que la société consumériste l’impose plus ou moins, oriente parallèlement vers une lecture critique. Ce qui semble n’être qu’un fatras devient en partie un miroir des habitudes courantes, le « mon » renvoie à l’individu qui énumère ce qu’il considère être ses possessions, dans un monde de l’avoir ; on lit au fil d’un poème « mon troisième téléphone mobile », puis « mon quatrième téléphone mobile », avant le premier et le deuxième, puisqu’il faut suivre ici l’ordre Z ®A… Si une partie des objets énumérés distingue une classe sociale restreinte (« mon yacht », « mon avion », par exemple), la plupart est propre au plus grand nombre : sont notés ce que la publicité incite, à un moment donné, à acheter sous peine de "n’être pas de son temps", « t shirt ACDC, t shirt David Bowie t shirt Neil Young, t shirt Virgin Megastore », « Laguiole, Leatherman », etc., sans oublier le zippo.
Il ne faut pas exclure la part de jeu dans ces listes. On y relève notamment des allusions à des chansons (« mon truc en plumes », « mon beau sapin », « mon p’tit quinquin »), à Baudelaire (« mon enfant ma sœur »), à un livre de Michaux (« l’espace du dedans »), et même au premier poème du livre avec « mon poème sur certaines petites choses ». N’oublions pas le jeu culturel avec « mon premier livre de Donald Westlake mon premier livre de Pierre Reverdy ». Plus nombreux sont les jeux avec la langue qui reposent sur l’homophonie (mon nom / mon non), sur la possibilité de construire un mot en ajoutant une syllabe à un autre mot (mou / mouillé ; pass / passeport), en changeant une lettre (vertige, vestige) ou un son (mon blaze/ mon blues ; mon creux / mon cri).
Si les listes sont absentes des poèmes courts, presque tous de forme strophique, on rencontre dans deux poèmes plusieurs vers débutant par un infinitif. Le lien avec les poèmes longs est ailleurs, dans l’attention portée à la vie de l’individu — ici, un "je" — dans la société, notamment à sa solitude. Ainsi, le parcours de la ville dans un bus, le nez collé à une vitre, donne l’illusion d’être derrière une caméra et « personne pour dire / arrête ton cinéma », il n’empêche que, pourtant, « je suis reflet fugitif / éclair doré dans ». Ce qui apparaît souvent, c’est la difficulté d’exprimer des sentiments ; le corps parle dans l’étreinte, sans doute, mais « le mot manque » pour aller au-delà des gestes, « comment te dire / quoi te dire oh ». Même quand la présence de l’autre laisse imaginer une histoire à construire, à raconter — « un récit avec un début / tout le tralala / et une fin » — rien ne se développe, comme si la distance entre désir et réalité était infranchissable, toujours vécue avec un « peut-être ». Quelle issue ?
"Largué", au titre évocateur, reprend un alexandrin d’un poème d’Apollinaire, "Mai", en le transformant : « Le mai le joli mai en barque sur le Rhin » devient « Le mai le joli mai en vélo / bords de marne » ; à l’évocation mélancolique d’un amour ancien fait place le rejet de ce qui symbolise l’intégration dans la société, la connexion permanente et l’argent, avec « le smartphone et le portefeuille ». Les deux objets sont abandonnés dans un fossé avec le vélo, puis c’est le tour du sac, et le narrateur lui-même « se sent largué ce soir » : aucun espoir dans la nuit venue ; alors que les ruines du poème d’Apollinaire étaient parées par le joli mai « De lierre de vigne vierge et de rosiers », ici rien ne peut changer. D’ailleurs plusieurs poèmes reprennent le motif des inégalités sociales (« l’égalité excuse-moi / on l’a pas vu passer ») : elles se maintiennent et restent les images des écrans qui fascinent.
L’amour, quand il est évoqué, semble toujours avoir été connu dans le passé — « ton souvenir en moi / valse dans l’air du soir » ; relisons cependant une déclaration à l’aimée, pudique puisqu’elle passe par une citation
tu es si belle qu’il se met
à pleuvoir écrivait brautigan
Relisons aussi le poème "Aujourd’hui" où le mot « tendre », entre deux strophes, est commenté :
« c’est bien le mot / à isoler afin de / libérer toute sa douceur / et faire voler toutes / ses flèches ». "Aujourd’hui", donc, « n’est pas un poème », mais Pierre Mabille, en isolant un mot chargé de connotations positives, établit un lien avec les poèmes de listes tous présentés comme des dons. Cet avant-dernier poème est suivi d’un adieu au lecteur ; construit avec pour départ la formule finale des lettres administratives, « Je vous prie de », il y a plusieurs essais pour sortir, aucun ne convient parce que la déférence n’est vraiment pas de mise. Alors quel mot final ? « et merde ». Oui, c’est cadeauest à offrir.
Pierre Mabille, C’est cadeau, éditions Unes, 2018, 88 p., 20 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 27 mai 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre mabille, c’est cadeau, répétition, jeux de mots | ![]() Facebook |
Facebook |
14/06/2018
Christiane Veschambre, Ils dorment

Ils dorment.
Leurs corps reposent l’un contre l’autre, l’un dans la présence de l’autre.
Lui ouvre les yeux, tend un bras vers un bracelet montre posé sur la table de chevet.
Il l’approche, avec lui on lit l’heure sur le cadran 6h ¼.
Il lève doucement le drap, il est en tee-chirt et caleçon, il se tourne vers elle qui dort, la regarde, l’effleure, un fable son incertain sort de sa bouche fermée. Il se lève.
Il est à la table de la cuisine. La cuillère prend dans le bol les céréales en forme de petits anneaux. Sa main tient la cuillère. Il voit sur la table la petite boîte d’allumettes.
Il est dehors. Il marche, il est habillé d’une combinaison de travail dont j’ai oublié la couleur. Il tient à la main une sorte de petite mallette semi-sphérique. Il longe des bâtiments de brique. Il tourne à l’angle, sous un porche.
Il est assis au volant d’un autobus à l’arrêt, vide, porte ouverte. Il écrit sur un petit carnet posé sur le volant. On approche de la page et on peut lire ce qu’il y écrit. On le lit aussi en bas à gauche de l’écran. C’est un poème qui dit la petite boîte d’allumettes, le dessin des mots sur son couvercle.
[…]
Christiane Veschambre, Ils dorment, L’Antichambre du Préau, 2017, np.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christiane veschambre, ils dorment, chambre, couple, sommeil, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
13/06/2018
Inger Christensen, La Vallée des papillons

Éphémères visions des regrettés défunts,
le papillon de l’aubépine qui plane
comme un nuage blanc teinté de traces
de bouquets rouges tissés par la lumière,
grand-mère au jardin qu’enlacent les milliers
de bras des giroflées, asters et gypsophiles,
mon père qui m’enseigna les premiers noms
de ce qui doit ramper avant de disparaître
pénètrent avec moi dans la vallée des papillons
où tout n’existe que de ce côté, où même
les morts entendent le rossignol, son chant
possède une pulsation étrange, mélancolique
qui va de la souffrance à la souffrance,
mon oreille répond d’un tintement secret.
Inger Christense, La Vallée des papillons, traduction du danois Karl et Janine Poulsen, Rehauts, 2018, p. 19.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inger christense, la vallée des papillons, grand-mère, mélancolie, rossignol | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2018
Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau,5
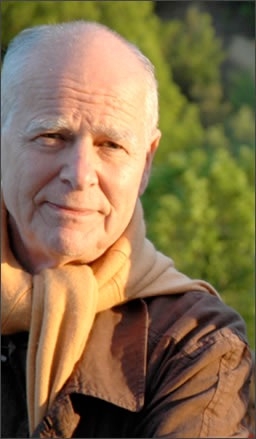
Histoire de la perdrix
Prologue
Les choses ne sont pas ce que les mots produisent. Elles émergent de ce qu'ils séparent. Elles deviennent visibles, visibles et nues, comme elles ne le sont pas elles-mêmes. Visibles après le bain. Issues de l'ombre positive d ela langue, de l'implacable et lumineux glissement de sa négativité.
Cette ombre pour respirer. Cette ombre pour plonger.
Survie phrasique jusque dans l'extrême nuance opaque du poème. Lecture sans le moindre émouvante - ou bien molle, injuste, sans le moindre tranchant.
Voici la découpe où je vis : l'emporte pièce, autant de bandes, brunes jaunes. Adorable limaille.
Et vivable vraiment la présence due aux mots ; sans eux on n'échapperait pas à la chaotique filature du temps ni à la puissance de l'instant laissé à lui-même — seuls les animaux y excellent.
Pierre parmi les pierres. Foin dans le foin, j'écris le maquillage de la perdrix.
Je déracine et brandis son théâtre d'un bloc. Sa brûlure n'est pas extatique, mais douloureuse comme la totalité.
Une précipitation d'apparence.
Une explosion de perdrix pierreuse.
Le théâtre est clos ; à l'intérieur, la ressemblance est infinie.
[...]
Nicolas Pesquès, La face nord du Juliau, cinq, André Dimanche, 2008, p. 57-58.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas pesquès, la face nord du juliau, cinq, histoire de la perdrix | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2018
Joseph Joubert, Carnets, I

Le seul moyen d'avoir des amis, c'est de tout jeter par les fenêtres, de n'enfermer rien et de ne jamais savoir où l'on couchera le soir.
On ne devrait écrire ce qu'on sent qu'après un long repos de l'âme. Il ne faut pas s'exprimer comme on sent, mais comme on se souvient.
Enseigner, c'est apprendre deux fois.
Ceux qui n'ont à s'occuper ni de leurs plaisirs ni de leurs besoins sont à plaindre.
Les enfants veulent toujours regarder derrière les miroirs.
Aux médiocres il faut des livres médiocres.
Les uns disent bâton merdeux, les autres fagot d'épines.
L'un aime à dire ce qu'il sait, l'autre à dire ce qu'il pense.
Évitez d'acheter un livre fermé.
Ce monde me paraît un tourbillon habité par un peuple à qui la tête tourne.
Joseph Joubert, Carnets, I, textes recueillis par André Beaunier, Gallimard, 1994 [1938], p. 73, 79, 143, 143, 161, 165, 172, 176, 183, 183, 211.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2018
Geoffrey Squires, Silhouettes

Eau grise
une petite butte d’arbres
à quoi penses-tu on
ne peut pas demander ça
c’est si bien d’être à l’écart de tout le monde
le doux champ de son ventre
fragile chaleur d’été
juste naturel
Grey water
a little spit of trees
what are you thinking
not allowed to sak that
how nice to be away from anywhere
the soft fiel of her belly
frail summer heat
only natural
Geofrey Squires, Silhouettes, traduction
François Heusbourg,Unes, 2018, p. 21 et 20.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : geofrey squires, silhouettes, françois heusbourg, écart, ventre, été | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2018
Anise Koltz, Galaxies intérieures

Dès notre naissance
nous avons flairé le sang
Les images du déluge
tapissent encore
notre mémoire
Nous marchons sans repères
suspendus au monde
par une épingle de sûreté
Anise Koltz, Galaxies intérieures,
Arfuyen, 2013, p. 50.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anise koltz, galaxies intérieures, mémoire, déluge, repère | ![]() Facebook |
Facebook |
08/06/2018
Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d'abîme
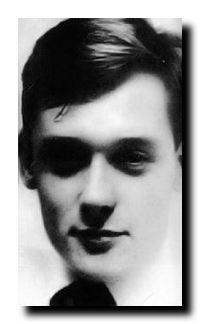
L’heure est dite d’abois
L’heure est dite d’abois dans les arrière-cours
Et de guenilles en sanglots sur les cordes du jour
Par le travers des lampes nues dans l’ombre noire
O reflet malingre d’un vieil été mémoire
D’un soleil en cendres sous les mains dans la nuit
Passé l’orgue de Barbarie où le temps bruit
Le malaise d’un chien la valise d’une âme
Emplie d’herbe lointaine et de cheveux de femme
Accoudé sur la table le ciel venu m’aider
À compte recompter feuilles mortes accoudé
Sur la table tremblante au fond d’auberges vides
Avec autour d émoi pas mal de chopes vides
Eh bien devines-tu j’en ai fini de mon espoir
À jamais je suis seul dans mon amour ce soir
Dans l’aube de la vie les montagnes de lumière
Aspiré par des tourmentes d’étoiles très claires
Au-dessus d’une transparente ornée de vergers bleus
Eclaboussant d’oiseaux qui sont comme tes yeux
Jusqu’à la cime la plus blanche le fol érable
Et ne viens pas me joindre au bord de cette table
Je n’y suis plus je suis parmi les neiges du futur
Pourtant je t’y attends tête tombée fruit mûr
Dans le bois mort de cette table où d’humides années
J’entends la pluie rouler ses renoncules piétinées.
Jean-Philippe Salabreuil, Juste retour d’abîme, Le Chemin,
Gallimard, 1965, p. 12.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-philippe salabreuil, juste retour d’abîme, l'heure est dite d'abois | ![]() Facebook |
Facebook |
07/06/2018
Anna Akhmatova, L'églantier fleurit
Le sous-sol de la mémoire
Oh, caveau de la mémoire
Khlebnikov
Ainsi donc je vivrais affligée,
Rongée de souvenirs ? Sottises !
Je ne rends pas souvent visite à ma mémoire,
Du reste, elle me joue toujours des tours.
Dès qu'avec ma lanterne, je descends à la cave,
Je crois entendre un éboulement sourd
Gronder dans l'étroit escalier,
Ma lampe fume, je ne peux reculer,
Pourtant je vais droit à l'ennemi, je le sais.
Et comme une faveur, j'implore... Mais
Il fait nuit, pas un bruit. Finie la fête !
Trente ans déjà qu'on a raccompagné ces dames,
Et l'espiègle d'antan, il est mort de vieillesse.
Trop tard. Misère !
Où aller ?
Je touche les murs peints,
Me chauffe au coin du feu. Miracle !
Dans ce moisi, cette fumée, et toute cette pourriture,
Deux émeraudes scintillent, vivantes.
Puis un chat miaule... Allons, il faut rentrer !
Mais où est ma maison, où, ma raison ?
18 janvier 1940
Anna Akhmatova, L'églantier fleurit et autres poèmes, traduits par Marion Graf et José-Flore Tappy, La Dogana, 2010, p. 125.
Publié dans Akhmatova Anna, ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
06/06/2018
Aurélie Foglia, Grand-Monde : recension
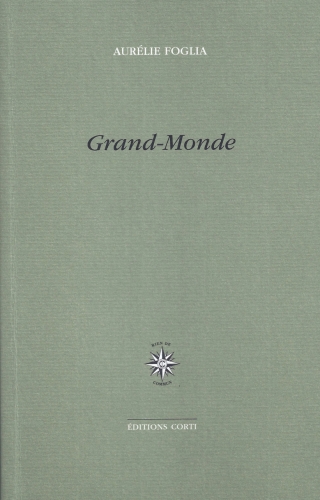
Bien des poètes ont célébré les arbres, de Ronsard à Supervielle, mais un livre entier déborde l’idée même d’éloge. Il ne s’agit pas seulement des arbres et de la manière dont les humains les utilisent, mais du lien étroit, intime que la narratrice entretient avec eux ; elle est surtout présente à partir de la troisième des six parties de Grand-Monde(le néologisme désigne le monde des arbres) et, ensuite, c’est ce lien qui engage sa vie qui occupe une place prépondérante.
C’est essentiellement dans la première partie, titrée "Les Longtemps", la plus développée, que la narratrice précise la manière dont elle perçoit les arbres ; non pas vision de botaniste : ce qu’ils sont au-delà de leur apparence physique. Le nom "Les Longtemps", « au visage vert tendre », leur est donné parce que le temps ne semble pas avoir de prise sur eux — caractéristique classique de la symbolique des arbres, régulièrement reprise (par exemple par Verhaeren, « [l’arbre] voit les mêmes champs depuis cent et cent ans / Les mêmes labours et les mêmes semailles »), mais qui, ici, n’est pas dissociée d’autres aspects qui font des arbres des êtres singuliers. Leur singularité est dite d’entrée : « Ils n’ont pas bougé », notation dans un contexte qui renvoie à des éléments mobiles ; l’absence de mouvement est suggérée comme un choix, répété ensuite avec l’insistance de l’allitération, ils « miment mal le maigre / exploit de marcher ». La majuscule de "Ils" et leurs traits spécifiques les distinguent des humains ; ils forment une communauté, sans qu’il soit question de telle ou telle espèce, dont l’organisation a exclu toute distinction entre les membres : aucun des éléments n’a de prise sur un autre. Sans doute ne parlent-ils pas, ce qui n’empêche pas qu’ils s’expriment de manière non articulée (« un arbre à l’oral est un raclement qui s’éclaircit »), qu’ils peuvent crier (« leurs cris de joie d’oiseaux ») et, quand ils ont perdu leurs feuilles, de faire entendre « des soupirs d’insectes ». En somme, les arbres cumulent ce qui appartient à l’humain, à l’oiseau et à l’insecte ; en outre, s’ils se multiplient grâce aux oiseaux, existent cependant « les femmes des arbres ».
L’arbre serait à sa manière un être complet, opposé en cela à la narratrice qui, par comparaison, se vit comme inachevée, ce que souligne la coupure des mots :
je ne devrais pas avoir droit
à la nudit
é me
réduire à une cuir
rasse casque barbe
lé
[etc.]
Êtres complets également parce qu’ils sont intégrés à un ensemble plus vaste qui comprend, outre les insectes et les oiseaux, l’eau où ils se reflètent « comme peints par Apelle », le ciel puisque par leur position ils vont « vers la lumière dont se faire verts », le ciel et la terre qui ont des qualités complémentaires : les arbres « ont tressé la terre avec l’instable // en brassant le ciel immeuble », le vent avec qui ils ont un rapport de complicité — il les fait « ré / fléchir » — et grâce auquel ils adoptent parfois la figure de la mer — ce qu’appuie l’assonance dans :
tel ancrage de mer vague
sous l’élan caressant du vent cassant
l’ombre
de falaises frémissantes de temps
en temps frénétiques
[etc]
Aurélie Foglia construit une symbolique de l’arbre en inversant un discours dominant à propos des forêts, encore perçues comme des espaces opaques, à l’écart du civilisé, pour l’essentiel ayant une fonction utile : elles sont, d’abord, lieux à exploiter, ce qui les fait disparaître ; les arbres deviennent manches de haches, meubles, etc., ils sont à la disposition des hommes qui y installent une balançoire et laissent leurs chiens uriner contre eux. Que dire d’autre ? Les arbres « sont animaux / qui ne craignant pas l’homme / sauvages / ils ont tort ». Contrairement à lui, ils ignorent ce qu’est la mort et, est-ce bienveillance ?, ils l’aident à se pendre.
Dans la construction de Grand-Monde, les arbres sont étroitement liés à la narratrice, et d’abord par le jeu des mots, "feuille" ne renvoyant pas qu’au végétal, par exemple dans « des mains froissent des feuilles déchirées », et l’arbre pouvant devenir papier : « il paraît / que je viens d’un long voyage de papier » — on ne peut pas ignorer que fogliasignifie « feuille » en italien. Le je, dans la quatrième partie titrée "Hors lieu", déclare « je n’ai pas lieu / la banlieue aveugle », constatant sa rupture avec arbres et terre, se souvenant d’un lieu perdu, le clos des rosiers de la grand-mère, pour ensuite entrer dans une fiction, celle de devenir arbre, ce qui s’opposerait à « je n’ai nulle part ». Entrer dans l’imaginaire, écrire que l’on souhaiterait devenir ce qui dans une grande partie du livre a été présenté comme une forme accomplie, pleine, sans aspérités, cela n’implique pas que l’on quitte la réalité, seulement qu’il faut penser l’impossible — on sait bien que « représenter est théâtral est tuant ». Il y a dans le désir (donc dans ce qui ne peut s’accomplir sans cesser d’être désir) de devenir arbre (« on se demandera // je ne sais pas vous// ce que ça fait d’être / arbre » ; etc.) une aspiration à abandonner les oripeaux du quotidien pour rejoindre le silence des arbres et de l’herbe, confondus en un mot valise : « sous les berces et les ombelles j’ai / jeté mon corps et l’ai laissé / là roulé dans l’harbre à la merci / du soleil et des mouches ».
Aurélie Foglia, Grand-Monde, Corti, 2018, 144 p., 18 €. Cette note a été publiée sur Sitaudis le 15 mai 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aurélie foglia, grand-monde, arbre, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
05/06/2018
Nadia Porcar, Une décision

Une décision
J’avons décidé de surprendre les futurs hommes de ma vie au petit déjeuner. Adieu, petits pains aux quatre figues destinés à des délicats qui bien souvent se contentaient d’un thé sucré. Basta, les confitures aux trois pêches plus une poire confites par les soins de mains chères et provinciales. Désormais, ce sera frites, œufs brouillés, café et pas de discussion. Après le café, je proposerai une lampée de porto. Il sera alors temps d’inviter les futurs hommes de ma vie qui n’auront pas déguerpi à aller pêcher la truite. Ceux qui se croient malins songeront à un petit revenez-y sur mon lit-banquette dur comme pierre. — là aussi j’aurons mis le holà au duvet de cygne et autres foutaises — mais non, de ceux-là il ne sera point question. Je parle pour les littéraux à ma taille, ceux qui iront jeter un coup d’œil dans le jardin, y découvrir le bassin et s’exclamer en se frottant les mains Bon, elles sont où les cannes à pêche ?
[…]
Nadia Porcar, Une décision, dans Rehauts, n° 41, printemps 2018, p. 53.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nadia porcar, une décision, hommes de ma vie | ![]() Facebook |
Facebook |
04/06/2018
Édith Azam, Oiseau-moi

Il y a des centaines de bancs,
et là encore je me grave
écris des mots d’amour
et des envols d’oiseaux.
Je sais
je sais
elle ne sait pas :
je résiste
et vais me dire
qu’Hannah est là
parce que tout simplement :
elle y est.
Ça ne tient pas debout ?
Peu importe
je rêve à m’y méprendre
au-delà de
toute expression.
No sens no sens
j’ai peur Hannah.
J’avale un peu de nuit
pour me calmer
cailloux noirs ronds glacés
et cest si triste alors.
Ce serait bien parfois
que la fatigue
se repose.
Ce serait bien :
diminuer…
No sens no sens…
Édith Azam, Oiseau-moi, Lanskine, 2018, p. 18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, oiseau-moi, rêve, nuit, fatigue | ![]() Facebook |
Facebook |
Édith Azam, Oiseau-moi

Il y a des centaines de bancs,
et là encore je me grave
écris des mots d’amour
et des envols d’oiseaux.
Je sais
je sais
elle ne sait pas :
je résiste
et vais me dire
qu’Hannah est là
parce que tout simplement :
elle y est.
Ça ne tient pas debout ?
Peu importe
je rêve à m’y méprendre
au-delà de
toute expression.
No sens no sens
j’ai peur Hannah.
J’avale un peu de nuit
pour me calmer
cailloux noirs ronds glacés
et cest si triste alors.
Ce serait bien parfois
que la fatigue
se repose.
Ce serait bien :
diminuer…
No sens no sens…
Édith Azam, Oiseau-moi, Lanskine, 2018, p. 18.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Édith azam, oiseau-moi, rêve, nuit, fatigue | ![]() Facebook |
Facebook |
03/06/2018
Pierre Vinclair, La honte de la nation
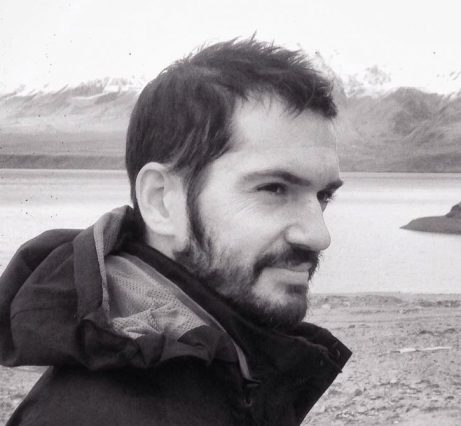
La honte de la nation
Il n’y a pas si longtemps, en France, on était poète de cour. Marot faisait mousser François Ier, Ronsard célébrait Henri II et Charles IX.
La tradition du poète officiel se perpétue d’ailleurs, dans bien des pays anglo-saxons, et (contrairement à ce que notre inconscient sans-culotte nous inciterait à penser) pas toujours au détriment du bon goût : William Wordsworth ou Ted Hughes en Angleterre, Elizabeth Bishop ou William Carlos Williams aux États-Unis, ne furent pas seulement des « poètes officiels ». Ils le furent aussi.
Il en va différemment en France : depuis le XIXème siècle c’est plutôt la figure du poète maudit (bohème, désargenté, mal reconnu, contestataire, et même geignard) que celle du poète lauréat à laquelle elle s’oppose, qui prévaut comme critère de valeur poétique. Le mirliton adolescent se rêve écorché vif, plutôt que tête poudrée et perruquée. Moi poète, se dit-il devant le miroir en soignant ses boutons d’acné, je serai Antonin Artaud. Et aujourd’hui, l’Académie Française pour compter des poètes dans ses rangs est obligée de faire appel à des plumes francophones venues de l’étranger : Dany Lafferière (Haiti, Canada), Michael Edwards (Royaume-Uni).
Exercice : Pensez à un poète français vivant dont vous admirez le travail, et imaginez-le dans l’habit vert. Avec la petite épée au côté droit.
On voit bien, ça ne marche pas du tout.
Vous me direz : il y eut Victor Hugo. C’est vrai, mais le poète de Jersey ne doit-il pas sa respectabilité poétique et morale à son opposition à Napoléon III, et à son exil ? Ses œuvres majeures — Les Châtiments, Les Misérables — sont celles d’un paria. De même, les effusions engagées de la seconde guerre mondiale : c’était d’abord une poésie de résistance. Non d’hymne patriotique. La poésie contre Vichy, au nom de la liberté, — pas de la France. La nation plus jamais ne fait bander du poète français la lyre.
Nation. Ça vient du latin natio qui désigne les petits d’une même portée. On le voit bien, c’est d’abord un objet métaphorique : sauf si tu es mon frère (peu de chances) ou mon cousin (salut Laurent), on n’est pas de la même portée, cher lecteur. Pourtant de la même nation, alors quoi ?
Une nation, dit le dictionnaire, c’est un peuple, constitué en communauté politique et partageant une langue. En refusant la nation, que croit contester le poète ? La langue ? La légitimité de l’État ?
Qu’il partage une langue avec d’autres, que celle-ci soit plus qu’un instrument mais une matière à reconfigurer, enrichir, déplacer ou lacérer, et même un milieu, le poète l’accorde en premier. Le cas échéant, il sait même se contenter de la grammaire et du vocabulaire des manuels. Il ne nie pas non plus l’existence de l’État, qui définit, par l’école, les programmes de quinze années d’initiation à la littérature, qui donne les bourses du CNL, qui encadre de lois publications et performances — et qui parfois est l’employeur du poète-enseignant, documentaliste, gendarme ou diplomate.
En refusant la nation, le poète français ne refuse donc ni la langue, ni l’État — mais plutôt : l’idée que l’une et l’autre se prédiquent d’une même entité, ou soient (comme qui dirait) deux modes d’existence de la même substance « France », par l’intermédiaire de laquelle elles communiqueraient, ou tout du moins, seraient en rapport. Et, partant, que les affaires de langue soient aussi une prérogative de l’État, puisque celui-ci est la volonté de l’entité dont celle-là serait la bouche.
Ce n’est pas tant que le poète, trop conscient de l’empreinte des logiques de pouvoir sur le discours, doive se donner pour mission de les saboter, couper la parole à l’État ou éventrer (avec l’aide du CNL quand même, si possible) ce rêve de congruence de la langue aux enjeux politiques — qu’exprime le concept de nation. Ni que la deuxième guerre mondiale continue, que Vichy guette, No pasaran ! j’écris ton nom.
Non : d’abord, c’est que la nation, ça n’existe pas. Il faut le dire. Il n’y a pas cette substance qui existerait derrière la langue et l’État : la nation n’est qu’un produit imaginaire du discours politique, elle est ce que l’État essaie de faire advenir par une certaine utilisation de la langue, décrets et mythes. Un État, avec son pouvoir bien réel (sa police, ses enseignants, ses diplomates) contrôlant un territoire donné sur lequel vivent diverses populations (elles-mêmes unifiées dans quelque objet imaginaire défendu par des institutions locales plus ou moins puissantes : famille, tribu, 9-3, Bretagne), appelle nation l’objet fantasmatiquement unique sur lequel s’applique son pouvoir. Quelle raison aurait le poète de chanter un objet aussi ridiculement hypothétique ? Et surtout : pourquoi accepterait-il d’identifier sa langue immense à un si pauvre petit territoire ?
Non seulement le poème est rétif à trop de hiérarchie, en effet (il se voudrait bien un lieu où le sens est l’enjeu et où la beauté se partage), mais cette utopie contredit la définition territoriale de la langue, qui est au cœur de l’idée de nation. D’ailleurs, ce n’est pas tant la langue qui est l’objet du poème, que la voix : y bat le projet, sans doute idiot, mais culotté (il faudrait voir comment ça peut marcher), que de la singularité de la voix puissent émerger des figures de sens à la fois immanentes et absolues. Pour le dire autrement : le poète parle, certes dans sa langue (mais une langue s’apprend et se traduit) à tous les hommes de la terre.
Voici la nation : une langue, un territoire. La France au français.
Voilà le poème : une voix, l’être, les hommes.
Pierre Vinclair, édito du n° 9 de Catastrophes, revue en ligne, 31 mai 2018 .
Le numéro 9 de Catastrophesest en ligne : https://revuecatastrophes.wordpress.com/la-honte-de-la-na...
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, la honte de la nation | ![]() Facebook |
Facebook |






