23/09/2025
Pierre Reverdy, En vrac

La poésie est atteinte quand une œuvre d’art quelconque s’intègre, ne fût-ce qu’un moment, à la vie réelle de l’homme par l’émotion qu’elle provoque dans son esprit et comme dans sa chair. La poésie n’est dans rien d’autre que dans la mise en commun d’aspirations diverses auxquelles l’œuvre d’art peut donner la violente illusion de s’être rencontrées.
Le poète ne s’occupe pas et ne doit pas s’occuper de l’émotion que pourra provoquer son œuvre. Il ne doit et ne peut connaître ou reconnaître, dans son œuvre, que l’émotion qui lui a donné l’élan nécessaire à sa création. Mais, plus cette œuvre sera loin de cette émotion, plus elle en sera la transformation méconnaissable et plus vite elle aura atteint le plan où elle était, par définition, destinée à s’épanouir et vivre, ce plan d’émotion libérée où se transfigure, s’illumine et s’épure l’opaque et sourde réalité.
On ne fait pas de la poésie. On écrit des poèmes en risquant sa chance ; on peint des tableaux, on compose un morceau de musique et il s’en dégage de la poésie ou il ne s’en dégage pas, c’est-à-dire qu’on a écrit, peint, composé absolument pour rien, ou bien…
Le poète doit voir les choses telles qu’elles sont et les montrer ensuite aux autres telles que, sans lui, ils ne les verraient pas.
L’art et la poésie ne sont là que pour puiser dans la nature ce que la nature ne fait pas.
Je vis, d’abord — j’écris, parfois, ensuite. Mais il m’arrive de sentir davantage ce que veut dire vivre en écrivant.
Pierre Reverdy, En vrac, Flammarion, 1989, p. 33, 42-43, 78, 96, 99, 185.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Reverdy Pierre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre reverdy, en vrac, émotion, réalité" | ![]() Facebook |
Facebook |
22/09/2025
André du Bouchet, Carnet 2

comme je passe j’ai trouvé
puisque cette fois de nouveau je ne cherche
rien d’autre
que déjà la porte ouverte
poésie — jusqu’au silence du désenchantement de nouveau conduit
en coup de vent à un réveil
dans le calme
de la lecture, ce retentissement, commotion en retour — de la parole perdue, en place alors, et perdue
une parole dans laquelle celui qui a écrit cherche la vérité de
ce qu’il veut atteindre
rouvre à silence dans le tumulte
parole, le silence qui la porte, c’est le souffle — et
souffle qui l’emporte aussi bien
je cours vers la figure
de nouveau disparue quand j’ai couru vers elle
un défaut de la langue éclaire éclaire aussi la langue
ce qui aère la langue — en sortir aussi rapidement qu’on a pu y entrer
le sol, c’est la langue
André du Bouchet, Carnet 2, Fata Morgana, 1998, p. 9, 29, 73, 90, 91, 97, 116, 143, 149.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet 2, andré du bouchet, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2025
Jacques Réda,

Tombeau de mon livre
Livre après livre on a refermé le même tombeau.
Chaque œuvre a l’air ainsi d’une plus ou moins longue allée
Où la dalle discrète alterne avec le mausolée.
Et l’on dit, c’était moi, peut-être, ou bien : ce fut mon beau
Double infidèle et désormais absorbé dans le site,
Afin que de nouveau j’avance et, comme on ressuscite —
Lazare mal défait des bandelettes et dont l’œil
Encore épouvanté d’ombre cligne sous le soleil —
Je tâtonne parmi l’espace vrai vers la future
Ardeur d’être, pour me donner une autre sépulture.
Jusqu’à ce qu’enfin, mon dernier fantôme enseveli
Sous sa dernière page à la fois navrante et superbe,
Il ne reste rien dans l’allée où j’ai passé que l’herbe
Et sa phrase ininterrompue au vent qui la relit.
Jacques Réda, L’herbe des talus, Gallimard, 1984, p. 208.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Réda Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques réda, l'herbe des talus, tombeau de mon livre | ![]() Facebook |
Facebook |
20/09/2025
Jean Paulhan, À demain la poésie

CE QU'EN DIT LE PREMIER VENU
Il est probable, puisque tout le monde le répète, qu'il y a un mystère dans la poésie. Il est sûr en tout cas que nous nous conduisons à son égard comme s'il y avait un mystère. Tu ouvres un livre de poèmes, et tu es dès l'abord saisi. Avant même d'avoir rien lu. Tu attends. Quoi ? Peu importe, tu attends. Déjà tout séparé, retranché, détaché. De quoi ? Mais par exemple — que tu sois homme, ou poète — de toute jalousie, de tout amour-propre, de tout souci de comparaison. Parfaitement débarrassé de toi-même (ce qui ne va pas toujours sans quelque anxiété). Pourtant, tu n'es pas humilié pour autant. Pas molesté le moins du monde. C'est au contraire : tu te rassembles, tu es tout entier redressé — comme si tu entrais dans un beau monument, comme si tu te mêlais à quelque cérémonie. Tout réconcilié, tu penses à toi sans mauvaise humeur. Ta voix intérieure même se transforme.
Ensuite vient le poème, laissons cela. Et quand il est passé ? Non, tu n'as pas appris grand-chose. Que le temps passe vite. Si l'on veut. (Pourtant il est toujours là.) Qu'il faut profiter de la vie pendant que tu la tiens. Bien sûr. Peut-être que tes cheveux ressemblent à des feuilles, et tes dents à des rochers. (D'ailleurs, pas tant que ça.) Tu t'en doutais. Cependant, tu te sens vaguement changé, il t'est resté quelque trace de l'évènement : c'est comme s'il était soudain devenu bizarre que les cheveux ressemblent plus ou moins à des feuilles, et que ta vie soit courte. Dans quelle stupeur es-tu plongé, où le plus banal te paraît singulier, et le singulier banal ? Or il arrive que l'état se prolonge et t'étrange quelques moments. (Comme si le mystère de la poésie, c'était de rendre mystérieux tout ce qui n'est pas elle.) Il dépasse de ta manche un fil qui t'agace parce que tu le vois trembloter sur le papier de ton livre. Tu le brûles à la base, du bout de ta cigarette. Alors tu le vois soudain qui se tord en grelottant, puis se penche et s'abat comme un arbre coupé à la hache, tu crois l'entendre gémir. Tu demeures consterné. Un peu plus tard, tout rentre dans l'ordre. Mais entre l'attente et la retombée, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est proprement là le mystère. Et si l'on accorde qu'il est précisément mystérieux que reste-t-il à en dire ? Rien.
Jean Paulhan, À demain, la poésie, Introduction à une anthologie [1947], dans Œuvres complètes, tome II, Le Cercle du Livre précieux, 1966, p. 312.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Paulhan Jean | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean paulhan, à demain le poésie | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2025
Agnès Rouzier, Non rien
Qu’importe la chambre, – si ce n’est tout entier le temps – qu’importe la chambre ? Pouvait-on même dire : refuge ? (Je effacé par nous mais recevant de cet insistant pluriel la légèreté principale. Je s’écoutant rire.) Qu’importe la chambre, hors les autres cellules qui l’écrasent, l’enserrent, l’entourent, la protègent, qu’importe la chambre hors ces escaliers qu’il faut monter pour l’atteindre, qu’importe la chambre si ce n’est cette île, en plein ciel, portée par d’autres îles, et ce personnage anonyme qui y accède (mettons qu’il se souvienne de … ou de tout autre). Qu’importe ce faisceau de questions, hors cette clôture que nul ne déchiffre, mais que chacun touche et parcourt. Voici que le vent a tourné et que la plage oblique vers un autre espace : la mer impatiente. Jadis chaude, maintenant glacée, frangée d’une même route, même rangée d’immeubles, jadis glacée : roulé en boule dans un creux de sable, un chandail abandonné. Qu’importe la chambre – ou salle à manger – et nous le revoyons dans la petite cuisine – je vous en prie il faut le délivrer – dans la petite cuisine en désordre – mais toujours le bocal de cornichons au sel, à moitié vide – devant le bol de café au lait (odeur et couleur écœurantes, bord ébréché), qu’importe, si nous l’effaçons il se crée – ici bougeant, ici dormant, homme, paysage, et ville, et machine, et fleuve, insecte ou vague, ici endormi et plus dense, de tout son corps pesant attiédi de sueur et d’odeur nocturne (au plus fort), ou bien éveillé les pieds nus après la douche, dans le plaisir infiniment fragile de l’été, avant d’avaler – aliment complet et réminiscences — un verre de lait glacé, ô mères… Qu’importe la chambre et ce récit qui le délivre, l’enserre : le roi dit : nous voulons. Et toi, penché tu te souviens : moi-je. (ou bien la rue, la pluie, les courses, le matin fatigant, et les oranges que l’on transporte déjà fades.)
Agnès Rouzier, Non rien, dans Le fait même d’écrire, Change / Seghers, 1985, p. 30-31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agnès rouzier, non rien, chambre | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2025
Valérie Rouzeau, Récipients d'air
Photo T. H.
Pommes poires et tralalas merles renards flûtes à bec
Et les petites bottes bleues enfoncées dans la boue
Après la peine la joie revenait aussi sec
Au bois sifflaient les ziaux les loups les pâtres grecs
Beaucoup d’airs de toutes sortes faisaient gonfler nos joues
Pommes poires et tralalères merles renards flûtes à bec
Il n’y avait pas d’euros de dollars de kopecks
On pouvait chanter fort la gadoue la gadoue
Après la peine la joie revenait aussi sec
Dans le vent murmuraient le lièvre et le fennec
Tournaient les grues les elfes les roues
Pommes poires et tralalères merles renards flûtes à bec
Au soleil se grisaient les drontes et les pastèques
Les porcelets songeurs échappés de la soue
Après la peine la joie revenait aussi sec
Mais de ce temps bon vieux ont eu lieu les obsèques
Et je sens ma chanson de vilain qui s’enroue
Pommes poires et tralalas merles renards flûtes à bec
Après la peine la joie revenait aussi sec
Valérie Rouzeau, Récipients d’air, Le Temps qu’il fait, 2005, p. 21-22.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : valérie rouzeau, récipients d'air, fruit | ![]() Facebook |
Facebook |
17/09/2025
Jacques Dupin, L'Embrasure

Excédante, inexpiable, la poésie ne comble pas mais au contraire approfondit toujours davantage le manque et le tourment qui la suscitent. Et ce n’est pas pour qu’elle triomphe mais pour qu’elle s’abîme avec lui, avant de consommer un divorce fécond, que le poète marche à sa perte entière, d’un pied sûr. Sa chute, il n’a pas le pouvoir de se l’approprier, aucun droit de la revendiquer et d’en tirer bénéfice. Ce n’est qu’accident de route, à chaque répétition s’aggravant. Le poète n’est pas un homme moins minuscule, moins indigent et moins absurde que les autres hommes. Mais sa violence, sa faiblesse et son incohérence ont pouvoir de s’inverser dans l’opération poétique et, par un retournement fondamental, qui le consume sans le grandir, de renouveler le pacte fragile qui maintient l’homme ouvert dans sa division, et lui rend le monde habitable.
Jacques Dupin, L’Embrasure, dans L’Embrasure, précédé de Gravir, Poésie/Gallimard, 1971, p. 135.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, l'embrasure, manque | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2025
Jacques Dupin, Gravir

Le partage
Une larme de toi fait monter la colonne du chant.
Une larme la ruine, et toute lumière est inhabitée.
La corde que je tresse, la rose que j’expie,
N’ont pas à redouter de lumière plus droite.
Le peu d’obscurité que je dilapide en montant
C’est de l’air qui me manque à l’approche des cimes.
Par le versant abrupt, la plus libre des routes,
Malgré le timon de la foudre et mes vomissements.
L’initiale
Poussière fine et sèche dans le vent,
Je t’appelle, je t’appartiens,
Poussière, trait pour trait,
Que ton visage soit le mien,
Inscrutable dans le vent.
Jacques Dupin, Gravir, Gallimard, 1963, p. 29 et 59.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Dupin Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques dupin, gravir | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2025
Paul de Roux, Carnets

Si je n’écris pas, je me défais. Je me fais d’autant plus en écrivant que j’écris contre le désert, l’impuissance, l’ennui, le dégoût : une horde de bêtes hideuses dont le mufle est plat, le plus banal, le plus terne, le plus impalpable qui soit : cette même puissance qui alourdit et ferme mes paupières, fait dodeliner ma tête — jette sur moi l’envie de dormir comme un filet.
Paul de Roux, Au jour le jour, Carnets 1974-1979, Le temps qu’il fait, 1986, p. 26.
Je relis des poèmes d’Henri Thomas à l’âcreté magnifique. Ici le mot poésie dérape. (Poème est déjà mieux.)
C’est la poésie qui vous tient par la main, le temps d’un poème. Le poète n’existe pas. Car il n’a aucun pouvoir sur la poésie. (Un sabotier mérite d’être appelé sabotier en ce qu’il a le pouvoir de faire des sabots quand il décide de se mettre à son établi.)
Paul de Roux, Au jour le jour, 3, Carnets 1985-1989, Le temps qu’il fait, 2002, p. 141, 142.
On écrit toujours accoté à la mort. On ne le sait pas. On a l’impression que l’on ne pourrait pas écrire accoté à la mort, mais on n’a jamais écrit qu’accoté à la mort. Sans le savoir. Mais le sachant peut-être obscurément ?
Paul de Roux, Au jour le jour, 4, Carnets 1989-2000, Le temps qu’il fait, 2005, p. 17.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul de roux, carnets, se défaire, mort | ![]() Facebook |
Facebook |
14/09/2025
Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société

On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh qui, dans toute sa vie, ne s’est fait cuire qu’une main et n’a pas fait plus, pour le reste, que de se trancher une fois l’oreille gauche,
dans un monde où on mange chaque jour du vagin cuit à la sauce verte ou du sexe de nouveau-né flagellé et mis en rage,
tel que cueilli à sa sortie du sexe maternel.
Et ceci n’est pas une image, mais un fait abondamment et quotidiennement répété et cultivé à travers toute la terre.
Et c’est ainsi, si délirante que puisse paraître cette affirmation, que la vie présente se maintient dans sa vieille atmosphère de stupre, d’anarchie, de désordre, de délire, de dérèglement, de folie chronique, d’inertie bourgeoise, d’anomalie psychique (car ce n’est pas l’homme mais le monde qui est devenu un anormal), de malhonnêteté voulue et d’insigne tartufferie, de mépris crasseux de tout ce qui montre race,
de revendication d’un ordre tout entier basé sur l’accomplissement d’une primitive injustice,
de crime organisé enfin.
Ça va mal parce que la conscience malade a un intérêt capital à cette heure à ne pas sortir de sa maladie.
C’est ainsi qu’une société tarée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités supérieures dont les facultés de divination la gênaient.
Gérard de Nerval n’était pas fou, mais il fut accusé de l’être afin de jeter le discrédit sur certaines révélations capitales qu’il s’apprêtait à faire,
et outre que d’être accusé, il fut encore frappé à la tête, physiquement frappé à la tête une certaine nuit afin de perdre la mémoire des faits monstrueux qu’il allait révéler et qui, sous l’action de ce coup, passèrent en lui sur le plan supra-naturel, parce que toute la société, occultement liguée contre sa conscience, fut à ce moment-là assez forte pour lui faire oublier leur réalité.
Non, Van Gogh n’était pas fou, mais ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques, dont l’angle de vision, à côté de toutes les peintures qui sévissaient à cette époque, eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie second Empire et des sbires de Thiers, de Gambetta, de Félix Faure, comme ceux de Napoléon III.
Antonin Artaud, Van Gogh le suicidé de la société [début], dans Œuvres, édition établie, présentée et annotée par Évelyne Grossman, Quarto/Gallimard, 2004, p. 1439-1440.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, van gogh, le suicidé de la société, psychiatrie | ![]() Facebook |
Facebook |
13/09/2025
Antonin Artaud, Silence

Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, silence, ventre | ![]() Facebook |
Facebook |
12/09/2025
Antonin Artaud, L'anarchie sociale de l'art
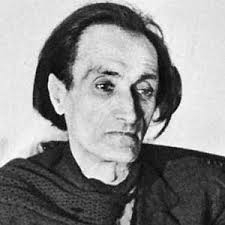
Au cours de la première Révolution Française on a commis le crime de guillotiner André Chénier. Mais dans une époque de fusillades, de faim, de mort, de désespoir, de sang, au moment où se jouait rien de moins que l’équilibre du monde, André Chénier, égaré dans un rêve inutile et réactionnaire, a pu disparaître sans dommage ni pour la poésie ni pour son temps.
Et les sentiments universels, éternels d’André Chénier, s’il les a éprouvés, étaient ni tellement universels ni tellement éternels qu’ils puissent justifier son existence à une époque où l’éternel s’effaçait derrière un particulier aux préoccupations innombrables. L’art, justement, doit s’emparer des préoccupations particulières et les hausser au niveau d’une émotion capable de dominer le temps.
Or tous les artistes ne sont pas en mesure de parvenir à cette sorte d’identification magique de leurs propres sentiments avec les fureurs collectives de l’homme.
Et toutes les époques ne sont pas en mesure d’apprécier l’importance sociale de l’artiste et cette fonction de sauvegarde qu’il exerce au profit du bien collectif.
Antonin Artaud, L’Anarchie sociale de l’art, dans Œuvres complètes, tome VIII, Gallimard, 1971 et 1980, p. 233.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antonin artaud, l'anarchie sociale de l'art, andré chénier | ![]() Facebook |
Facebook |
11/09/2025
Georges Bataille, Le Surréalisme au jour le jour (Sur Antonin Artaud)

Antonin Artaud
Je le [Antonin Artaud] rencontrai avec Boris Fraenkel dans une brasserie de la rue Pigalle : il était beau, efflanqué, sombre ; il avait assez d’argent, que lui rapportait le théâtre, mais il n’en avait pas moins l’air famélique ; il ne riait pas, il n’était jamais puéril, et bien qu’il parlât peu, il y avait quelque chose de pathétiquement éloquent dans le silence un peu grave et terriblement agacé qu’il observait. Il était calme : cette éloquence muette n’était pas convulsive, elle était triste, au contraire, abattue, intérieurement rongée. Il ressemblait à un rapace trapu, de plumage poussiéreux, ramassé au moment de prendre son vol, mais figé dans cette position. Je l’ai représenté silencieux. Il faut dire que Fraenkel et moi étions alors les personnages les moins loquaces qui soient : cela pouvait être contagieux, de toute façon cela n’entraînait pas à parler. [...]
Quelques années plus tôt, j’avais entendu une conférence de lui à la Sorbonne (mais je n’avais pas été le voir à la fin). Il parlait d’art théâtral et, dans la demi-somnolence où je l’écoutais, je le vis soudain se lever : j’avais compris ce qu’il disait, il avait résolu de nous rendre sensible l’âme de Thyeste comprenant qu’il digère ses propres enfants. Devant un auditoire de bourgeois (il n’y avait presque pas d’étudiants), il se prit le ventre à deux mains et poussa le cri le plus inhumain qui soit jamais sorti de la gorge d’un homme : cela donnait un malaise semblable à celui que nous aurions éprouvé si l’un de nos amis avait brusquement cédé au délire. C’était affreux (peut-être plus affreux de n’être que joué).
Georges Bataille, Le Surréalisme au jour le jour, dans Œuvres complètes, tome VIII, Gallimard, 1976, p. 179 et 180.
tr
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Antonin Artaud, ESSAIS CRITIQUES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bataille, le surréalisme au jour le jour, antonin artaud | ![]() Facebook |
Facebook |
10/09/2025
Ezra Pound, Cantos et poèmes choisis

Canto XII
Et nous, assis ici
sous le mur,
Arena romana, de Dioclétien, les gradins
quarante-trois rangées de calcaire
Baldy Bacon
accapara tous les petits sous de Cuba :
Un centavo, des centavos,
disait à ses péons de les « ramasser ».
« Ramenez-les à la grosse cabine », disait Baldy,
Et les péons les ramenaient ;
« Vers la grosse cabine les ramenaient »
Comme aurait dit Henry.
Nicolas Castaño à Habana,
Lui aussi, avait quelques centavos, mais les autres
Devaient payer un pourcentage.
Pourcentage quand ils voulaient des centavos,
Des centavos d’État.
L’intérêt de Baldy
Était dans l’argent.
« Pas d’intérêt pour rien sinon pour le trafic d’argent »,
Disait Baldy.
(…)
Ezra Pound, Cantos et poèmes choisis, traduction
René Laubies, Pierre-Jean Oswald, 1958, p. 27.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ezra pound, cantos et poèmes choisis, argent | ![]() Facebook |
Facebook |
09/09/2025
verlaine, Sagesse

La tristesse, la langueur du corps humain
M’attendrissent, me fléchissent, m’apitoient,
Ah ! surtout quand des sommeils noirs le foudroient,
Uand des draps zèbrent la peau, foulent la main !
Et que mièvre sans la fièvre du demain,
Tiède encor du bain de sueur qui décroît,
Comme un oiseau qui grelotte sur un toit !
Et les pieds, toujours douloureux du chemin,
Et le sein, marqué d’un double coup de poing,
Et la bouche, une blessure rouge encor,
Et la chair frémissante, frêle décor,
Et les yeux, les pauvres yeux si beaux où point
La douleur de voir encore du fini…
Triste corps ! combien faible et combien puni !
Verlaine, Sagesse, illustrations Maurice Denis,
Gallimard, édition fac-similé, 2025, p. 86
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Verlaine, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verlaine, sagesse, corps | ![]() Facebook |
Facebook |






