16/02/2023
Jude Stéfan, Aux chiens du soir
les yeux d’Emma
ocre fougère bistre clairière
amande noisette et verdissants
au soir ou tristes éblouis de
liesse absents vacants il y
a tout dans les yeux de ton nom
dans le nom de tes yeux le non
de ta promesse aime et âme et elle
aima souverains offensés bruns
et lus par cœur où sont-ils en-
volés où s’égrène ton rire avec ?
trois fois je suis passé devant
ta maison vide sans leur flamme
Jude Stéfan, Aux chiens du soir,
Gallimard, 1979, p. 79.
Photo T. H., 2012
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
15/02/2023
Jude Stéfan, À la Vieille Parque
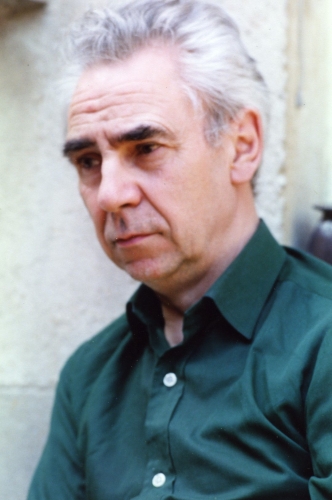
à h.m. †
dans la nuit, la nuit (qui) remue
les souvenirs les brasse en rêves réveils
les meubles bâillent
déjà ils veillent
massifs, profonds miroirs, avec leurs bras
attendant le gisant
cerné de portraits dans l’ombre qui fixent
ses pieds cirés
qui crient au silence et au meurtre
dans les cloisons dégringolent les rats
un Espoir au passé une morne Consolation
deux bougies vacillent
au-dessus des tapis sanctifiant les pas
perdu le temps du cœur
qu’il repose en chose
les chaises vaquent le livre a oublié
Celui qu’il fallait lire en maître zen
Jude Stéfan, À la Vieille Parque, Gallimard,
1989, p. 30.
Photo T. H., 1991
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Stéfan, Jude | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, à la vieille parque, hommage à henri michaux | ![]() Facebook |
Facebook |
14/02/2023
Jude Stéfan, Laures
Jude Stéfan, 01/07/1930-11/11/2020
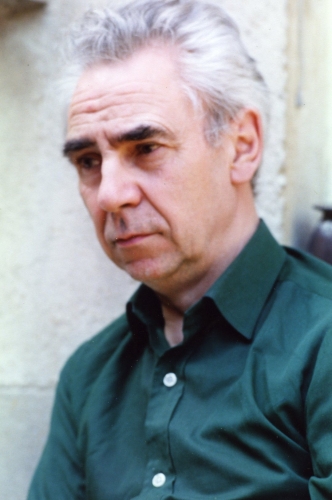
laure VIII
j’ai embrassé ta voix
ma rose carnée
envoûté par les larges boucles de fleuves
comme les amants dans leur coma et qui rêvent
s’apprendre le gin et le cidre
entrecaressés dans la nuit
les plis de ta pitié les râles de ton merci
et tes larmes d’abîme
d’absence qui tombe en froid en deuil
délivre-moi du vomi
retiens-moi de tes rubans
des oiseaux meurent des oiseaux sont tués
dans le lilas des murailles
Jude Stéfan, Laures, ‘’Le Chemin’’/Gallimard,
1984, p. 44.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jude stéfan, laures | ![]() Facebook |
Facebook |
13/02/2023
Cavafy, Poèmes
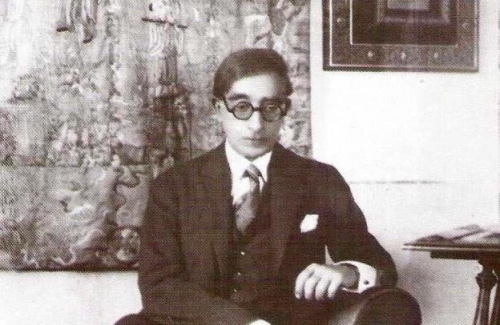
Lustre
Dans une chambre vide et petite — seuls quatre murs
couverts d’étoffes toutes vertes —
un lustre superbe brûle et flambe ;
et dans chacune de ses flammes s’embrase
une lascive passion, un lascif élan.
Dans la petite chambre qui étincelle,
éclairée du feu violent du lustre,
point familière est cette lumière qui en sort ;
ni faite pour des corps timides
la volupté de cette chaleur.
Cavafy, Poèmes, traduction Georges Papoutsakis, Les Belles Lettres, 1977, p. 82.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cavafy, poèmes, lustre, volupté | ![]() Facebook |
Facebook |
12/02/2023
Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant

HAÏ-KAÏ
La nuit du 1er septembre 1923 entre Tokyo et Yokohama
À ma droite et à ma gauche il y a une ville qui brûle mais la Lune entre les nuages est comme sept femmes blanches.
La tête nue sur un rail mon corps est mêlé au corps de la terre qui frémit. J’écoute la dernière cigale.
Sur la mer sept syllabes de lumière une seule goutte de lait.
Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant, Poésie/Gallimard, 1974, p. 198.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l’est, suivi de l’oiseau noir dans le soleil levant, haïkaï | ![]() Facebook |
Facebook |
11/02/2023
Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant

La maison suspendue
Par un escalier souterrain je descends dans la maison suspendue
de même que l’hirondelle, entre l’ais et le chevron maçonne l’abri de sa patience et que la mouette colle au roc son nid comme un panier, par un système de crampons et de tirants et de poutres enfoncées dans la pierre, la caisse de bois que j’habite est solidement attachée à la voûte d’un porche énorme creusé à même la montagne. Une trappe ménagée dans le plancher de la pièce inférieure m’offre des commodités ; par là, tous les deux jours, laissant filer mon corbillon au bout d’une corde, je le ramène pourvu d’un peu de riz, de pistaches grillées et de légumes confits dans la saumure.
Paul Claudel, Connaissance de l’Est, suivi de L’Oiseau noir dans le soleil levant, Poésie/Gallimard, 1974, p. 123-124.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Claudel Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul claudel, connaissance de l’est, la maison suspendue | ![]() Facebook |
Facebook |
10/02/2023
Armand Robin, Lemonde d'une voix

Premier amour
Moi
Je ne vous prendrai même pas la main. J’ai besoin seulement de vous faire une déclaration d’amour… non pas d’amour dans le ciel ni sur terre… d’amour dans le néant qui suivra mon cœur arrêté, d’un amour que trente ans je ne sentirai même pas, d’un amour que seul un peu de cœur éphémère imagera d’éternité.
Elle
Je ne suis qu’une pauvre fille. Je ne fus jamais que cruelle envers vous et je sais que jamais je ne pourrais être que cruelle envers vous.
Je suis une créature comme toutes les autres.
Moi
Mais votre voix muettement est douce.
Elle
Je ne veux pas de l’apparence que l’imagination me donne.
Armand Robin, Le monde d’une voix, Gallimard 1968, p. 86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d'une voix, premier amour, incompréhension | ![]() Facebook |
Facebook |
09/02/2023
Armand Robin, Le monde d'une voix

Solitaire
Je n’ai pas de jour selon vos bonjours ;
Mais jours se veulent bonjours
Que dans l’aube authentique du règne du travail.
Mes bonjours ne salueront
Que l’aube authentique du monde du travail.
Armand Robin, Le monde d’une voix, Gallimard,
1958, p. 163.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armand robin, le monde d’une voix, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
08/02/2023
Jean Grosjean, Une voix, un regard, Textes retrouvés 1947-2004
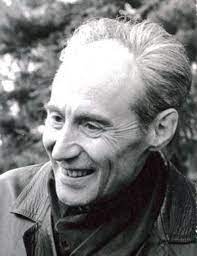
Senteurs
Le grenier sent la poussière
de nos journées inutiles
visitées par la lumière
qui se glisse entre les tuiles.
Tout ce que l’âme a coupé
dans les enclos du dimanche
a l’odeur de foin séché
qu’on hume aux portes des granges.
Un parfum de bois qu’on brûle
circule à travers les chambres
puisque notre feu posthume
n’est pas éteint sous nos cendres.
Jean Grosjean, Une voix, un regard, Textes
retrouvés 1947-2004, Gallimard, 2012, p. 107.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : une voix, un regard, textes retrouvés 1947-2004, grenier, parfum | ![]() Facebook |
Facebook |
07/02/2023
Jean Grosjean, Une voix, un regard

Nos jours
Il a fallu différer les départs
dont nous rêvons
et recevoir tout à tour
les jours inconnus
lourds de soleil ou de pluie.
Les uns donnaient des pépites,
de l’encens ou du pavot,
mais d’autres d’un air candide
lançaient des questions
qui n’ont jamais de réponse.
L’un posait des chrysanthèmes
sur le lit de nos parents,
l’autre offrait aux fronts d’enfants
pour leur faire ombrage
les lauriers des fortsen thème.
Comment vouliez-vous qu’on parte
quand tant de futurs arrivent
et qu’aucun d’eux ne retire
son rire ou son deuil
sans qu’un autre lui succède ?
Mais dès que les nouveaux jours
seront moins nombreux aux portes
nous irons sur l’autre berge
voir quels anciens jours
sont près à nous recevoir.
(Cahiers de l’ENS, Meknès, n° 4, 1983)
Jean Grosjean, Une voix, un regard, textes
retrouvés 1947-2004, Gallimard, 2012, p. 96-97.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, une regard, partir, futur, passé | ![]() Facebook |
Facebook |
06/02/2023
Jean Grosjean, Une voix, un regard
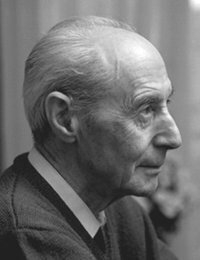
La Beune
Un grand verger bosselé au fond d’ un vallon, bordé de sombres noyers, avec un néflier tortueux, deux mirabelliers, des quetschiers quelques pommiers penchants. Et la fosse d’un étang à sec. Oui, le ruisseau a été détourné. Il circule entre des roches qu’il lave ou bien il les enjambe avec une sorte de chuchotement, de quoi inquiéter les arbres. Ils ont l’air de se retourner à demi comme les vaches quand on traverse leu pâture.
Surplombé de pentes raides où les forêts s’accrochent, ce vallon ne s’ouvre qu’au nord. Il est livré aux brefs jours d’hiver, aux longs vents d’hiver, à de brusques gels, à des neiges stagnantes. Mais le soleil d’été le regarde par-dessus les bois. Le soleil sait voir, à travers l’eau courante, les galets de grès rose qui somnolent au fond du ruisseau. Et il y a les cris des enfants qui jouent à la guere avec des chutes d’étoffes pour drapeau. Ah les prunes par terre.
Jean Grosjean, Une voix, un regard, Textes retrouvés 1947-2004, Gallimard, 2012, p. 189.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean grosjean, une voix, un regard, nature, eau, jeu | ![]() Facebook |
Facebook |
04/02/2023
Antoine Emaz, Erre

9.08.18
on n’a pas trop prise
sur ce qui vient les mots
prennent au passage
ou parfois rien
et ce n’est pas plus important
qu’une ligne de plus ou de moins
dans une dictée d’enfance
cela peut-être qui remonte
dans la nuit ou le vieux rose
d’une branche de tamaris en fleurs
ce qui ne tient à rien
dans la mélasse du temps un balancement
d’acacia ou de pin
le bleu passé au gris d’une lavande
quelque chose en tout cas
de presque silencieux
et doux
« regret souriant » ou deuil calme
d’un passé sans heurt
juste passé
poussière en suspension dans la lumière
pas plus
Antoine Emaz, Erre, Tarabuste,
2023, p. 89.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, erre, enfance, lumière | ![]() Facebook |
Facebook |
03/02/2023
Antoine Emaz, Calme
au fond
c’est plus simple qu’en surface
il ne reste presque
que du silence
on a tout l’espace
pour laisser filer
quelques étoiles pâles
fixer deux ou trois mots qui luisent
balises qui tremblent
lampes tempête
et tout le sombre n’est plus vide
plutôt nuit plaid
châle bleu noir
autour sans angles
quand tout se tait
sauf la vie son bruit faible
d’eau qui court
ou de cœur
le poème ne voudrait pas dire autre chose
Antoine Emaz, Calme, Faï fioc, 2016, np
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, calme, mot | ![]() Facebook |
Facebook |
02/02/2023
Antoine Emaz, Plaie
laisser aller la tête dans le jardin
ce matin
il y a l’air libre et bleu
il y a l’envie
de laisser filer
dans les couleurs du jardin
se perdre
s’évacuer
se dissoudre
comme se laver
dans le vert
on y arrivera
on le sait maintenant
on y arrivera
quoi qu’il arrive
on a repris pied assez
même si
on n’est pas à l’abri
Antoine Emaz, Plaie, Tarabuste,
2009, p. 138.
Photo T. Hordé
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, plaie, savoir | ![]() Facebook |
Facebook |
01/02/2023
Antoine Emaz, De peu

Bleu très bleu
dans le ciel sans fin d’œil
toute histoire engouffrée
rien
quasi lisse vaste couleur quelle
espèce de bleu
sans honte
tant il est sans mémoire
*
ciel plein ciel
sans anges
on rêve leurs battements d ‘ailes
leurs bruits de mouettes folles
d’envol
alors qu’on veut seulement des mots
pour ici
sous l’aplat de l’été
Antoine Emaz, De peu, Tarabuste,
2014, p. 269.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Emaz Antoine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine emaz, de peu, ciel, bleu | ![]() Facebook |
Facebook |








