28/12/2024
Paul Valéry, Tel quel
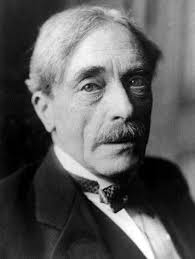
La statue et la gloire sont formes du culte des morts, qui est une forme de l’ignorance.
La notion de « grand poète » a engendré plus de petits poètes qu’il n’en était raisonnablement à attendre des combinaisons du sort.
Que si le moi est haïssable, aimer son prochain comme soi-même devient une atroce ironie.
Amour consiste à sentir que l’on a cédé à l’autre ce qui n’était que pour soi.
On ne sait jamais avec qui l’on couche.
Paul Valéry, Tel quel, dans Œuvres, II, Pléiade/Gallimard, 1960, p. 487, 487, 489, 493, 493.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, tel quel, ironie, culte | ![]() Facebook |
Facebook |
27/12/2024
Paul Valéry, Tel quel
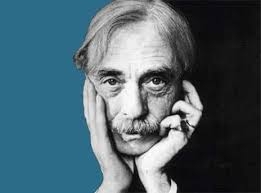
Ce qu’il y a de plus humain. Certains croient que la durée des œuvres tient à leur « humanité ». Ils s’efforcent d’être vrais.Mais quelle plus longue durée que celle des œuvres fantastiques ? Le faux et le merveilleux sont plus humains que l’homme vrai.
Tout poète vaudra enfin ce qu’il aura valu comme critique (de soi).
L’inspiration est l’hypothèse qui réduit l’auteur au rôle d’un observateur.
Idée poétique est celle qui, mise en prose, réclame encore le vers.
Il faut être léger comme l’oiseau et non comme la plume.
Paul Valéry, Tel Quel, dans Œuvres, II, Pléiade/Gallimard, 1960, p. 482, 483, 484, 485, 485.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Valéry, Paul | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul valéry, tel quel, humain, inspiration, critique | ![]() Facebook |
Facebook |
25/12/2024
Danielle Collobert, Cahiers, 1956-1978
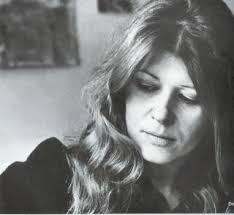
1973, 23/7
Rien — désert
un changement pourtant — le refus de penser à quoi que ce soit — fermer — fermer — boucler — plus rien — disparaître — serait temps — mais non — pour durer — se laisser aller à toutes/dans les petites conneries du quotidien — des nerfs à la minute — qui tressautent
insegnando il fredo agli sassi
non pas même le froid — état de tension absurde — pas même bien physiquement au soleil à la mer — la tête vide — des envies de retourner à Paris pour m’enfermer rue de la Liberté dans l’état de torpeur habituel là-bas —
pas d’alibi pour durer —
ancho donnette l’hanna fatto
pavese —
disparaître — mais peur —
le définitif —
Danielle Collobert, Cahiers, 1956-1978, Change, Seghers/Laffont, 1983, p. 54.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, cahiers, disparaître, fermer, boucler | ![]() Facebook |
Facebook |
24/12/2024
Danielle Collobert, Cahiers 1956-1978

1960, mars
peut-être je n’ai jamais été aussi loin dans la solitude que ces derniers mois — peut-être ça ne suffit pas encore — ici il reste une vague forme de stabilité — de sécurité — quelques doutes sur ce que je peux supporter vraiment —
errer davantage — ajouter le dépaysement — la rupture de toutes les attaches — ou quoi — être sans argent dans un pays que je ne connais pas — peut-être —
probablement une illusion — équivalence d’être dans une pièce seule pendant des jours —ou de partir ailleurs —
Danielle Collobert, Cahiers, 1956-1978, Change, Seghers/Laffont, 1983, p. 31.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, cahiers, dépaysement | ![]() Facebook |
Facebook |
Danielle Collobert, Cahiers, 1956-1978

1976, 24/1 Paris
acide — électrochoc
variations du réel — profondes
suivant l’état qui précède — cette fois très bon — pas de très violentes angoisses — seulement au moment où tenté d’écrire sensation de dédoublement — « gouvernement » de l’inconscient parlant « en clair » — impression de folie — vertige — gouffre à l’intérieur du cerveau — un autre espace mental
souvenir d’avoir retenu ma tête avec mes mains
à l’état normal » corps et cerveau en veilleuse
la volupté — plaisir mouvant
dans tout le corps immobile —intensité — à l’extrême
— aux larmes longtemps dans la glace
vue en corps
vu un corps essayant de dissimuler sa folie
pensé qu’ « elle » est folle celle-là — « moi »
Danielle Collobert, Cahiers, 1956-1978, Change, Seghers/Laffont, 1983, p. 71.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, cahiers, acide, gouffre | ![]() Facebook |
Facebook |
23/12/2024
Danielle Collobert, Cahiers, 1956-1978

1957, décembre
Pourquoi écrire que cette chambre est dans une grisaille jaune — que je somnole presque dans cette inexistence — que seul par momen le bruit du venr dans la plaque de la cheminée… ?
Seule —
Écrire ? faire des phrases ? encore…
La mort — ma mort — sûre — mais essai factice de représentation — infructueux d’ailleurs — À quoi j’arrive : au plus à une sensation très brutale de mon corps — Sensation qui revient de plus en plus souvent ces jours-ci — Idée de la mort — très salutaire si on peut encore parler à ce point-là de santé.
Danielle Colllobert, Cahiers, 1956-1978, Change, Seghers/Lafffont, 1983, p. 11.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : danielle collobert, cahiers, corps | ![]() Facebook |
Facebook |
21/12/2024
Hommage à Jacques Roubaud (1932-2024) : C et autre poésie
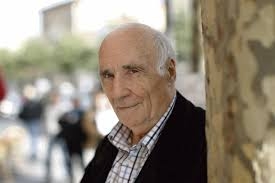
La nuit s’est approchée
La nuit s’est approchée il n’est pas besoin de
se le dire dans l’épaisseur complète dans la nuit
d’empiètements pas besoin d’une parole pour
répandre dans la nuit en l’épaisseur cela.
que la nuit s’est approchée et dans la non
présence complètement emplie de l’épaisseur du
principe du plus intérieur principe réalité
de la nuit quand d’épaisseur je me retourne
de me le taire.
sujet à des chuchotements.
Là.
Jacques Roubaud, C et autre poésie,
NOUS, 2015, p. 229.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, c et autre poésie, nuit | ![]() Facebook |
Facebook |
20/12/2024
Hommage à Jacques Roubaud (1932-2024) : Quelque chose noir
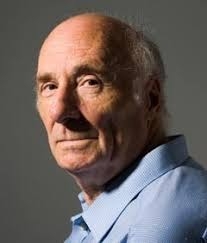
Nonvie, II
Vision nulle au fond du verre épais et brun
Gagné en surface de veines mais jamais dit
Jamais dit au chant vogueur de ta voix rabattu
Du contre-jour tâtonnant à la gorge sans fin
Peut-être cachée derrière le sol avec ça
Grand ouvert du ciel à l’éclat supportable
Au milieu de ta chair et drainant un bruit de mouches
Qui fronce sur l’horizon où il fait bleu
Une heure verticale encore mais juste tes poumons
Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p.141.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, quelque chose noir | ![]() Facebook |
Facebook |
19/12/2024
Hommage à Jacques Roubaud (1932-2024) : Quelque cose
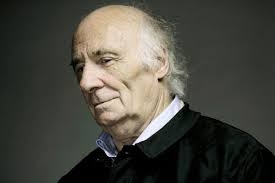
Au matin
Je suis habitant de la mort idiote la tête comme un porridge
Les oiseaux s’envolent à l’avoine noire de fumée (il est quatre heures, il est cinq heures)
Les arbres s’habillent de fond en comble
Dans mon bol des archipels de boue noire qui fondent
Je bois tiède
L’église, le sable, le vent irrésolu
J’avance d’une ligne, à deux doigts
Je voudrais nous coucher tête-bêche
Tes yeux sur ma bouche à la place de ce rien
Jacques Roubaud, Quelque chose noir, Gallimard, 1986, p. 35.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, qualquer chose noir, mort, néant | ![]() Facebook |
Facebook |
18/12/2024
Hommage à Jacque Roubaud (1932-2024) : ϵ
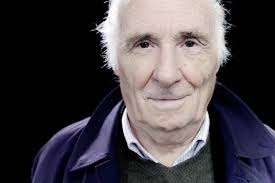
combien de poignées de neige jetions-nous sur les fleurs grises
les pivoines de fumer alors en jouant combien sur les remparts
dans les sentiers couverts de neige combien de neiges terriennes
jetions-nous sur les buissons osselets la prunelle la ronce la
réglisse le houx
savions-nous combien peu durerait le manteau de neige dans
les vignes les manches sous les ronces noires ou crevées dans
l’aire aux barbes des épis. combien peu de neiges nouvelles
fondraient à des anneaux de fer ou sur la brique du foyer sur
l’artère assombrie des braises
la neige était précieuse amande sur et tendre peu de jours de
peu même pas toutes les années ah garde vif le goût de neige
quand il faisait tomber le vent sur le parchemin des sous-bois le
golfe inerse des corneilles
quand nous éprouvions qu’il n’est que quelques neiges capables
d’un creux dans la mémoire capables d’éblouissantes fougères
fraîches sur une vitre qu’une bouche à l’aube couvre de buée
Jacques Roubaud, ϵ, Gallimard, 1988, p. 22-23.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, ϵ, neige, sonnet | ![]() Facebook |
Facebook |
17/12/2024
Hommage à Jacques Roubaud (1932-2024) : La pluralité des mondes de Lewis
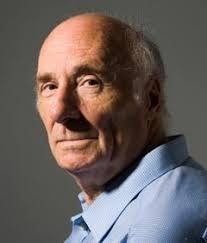
La forme n’est que le mouvement dont elle est la forme ; qu’elle ne retient pas mais qu’elle donne en commun, pour être poésie. Ainsi est-elle, parce qu’’ainsi est ce qu’elle peut faire de mieux’. Il ne lui est pas arrié d’être ainsi (il n’y a pas de forme ancienne) ; il ne lui arrivera pas d’être ainsi (il n’y a pas de forme future) ; elle est ‘ainsi, maintenant’ ; maintenant est la poésie.
Dans le présent infiniment mince est la forme, pour mettre en place le ‘maintenant’ de la poésie. Là est son inférence infernale : approcher au plus près le démon du silence, qui ‘implore notre secours.’ (D’où l’effroi, déguisé en indifférence, le recul des modernes devant la poésie).
Elle ne dit rien, ‘elle préfèrerait ne pas’. Ou encore : elle ne dit qu’en disant.
Jacques Roubaud, La pluralité des mondes de Lewis, Gallimard, 1991, p. 72.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, la pluralité des mondes de lewis, forme | ![]() Facebook |
Facebook |
16/12/2024
Hommage à Jacques Roubaud (1932-2024) : Autobiographie, chapitre dix

131
Où l’on fait le point avec le lecteur
Si tu ne m’as pas, cher lecteur, abandonné depuis longtemps en route, peut-être te demandes-tu où nous en sommes ? question légitime. Moi aussi je me le demande. Auta nt qu’il m’en souvient, je t’ai parlé de ma famille, de la guerre, de mes amours, tu m’as accompagné dans mes voyages, tu as partagé avec moi le vin de la joie, le pain de l’absence (et vice versa), le sel de la douleur ; tu en as été ému peut-être. Mais enfin, tout cela, c’est du passé. Que va-t-il arriver MAINTENANT ?
Jacques Roubaud, Autobiographie, chapitre dix, Gallimard, 1977, p. 82.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, autobiographie, chapitre dix, lecteur, intrigue | ![]() Facebook |
Facebook |
15/12/2024
En hommage à Jacques Roubaud, 1932-2024 : Jacques Roubaud, Dors

nuit
nuit
tu viendrais
les tilleuls
noirciraient
les fusains les
sauges
les villages
pousseraient contre
les collines
des lumières
les collines en
seraient noires
Jacques Roubaud, Dors,
Gallimard, 1981, p. 77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Roubaud Jacques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques roubaud, dors, sommeil, plante | ![]() Facebook |
Facebook |
13/12/2024
Oscar Wilde, Poèmes

La tombe de Shelley
Comme des torches éteintes près de la couche d’un malade,
De maigres cyprès veillent la pierre que le soleil décolore,
La petite chouette y a établi sa demeure
Et le rapide lézard comme un joyau pointe sa tête.
Là où s’embrasent les calices des coquelicots,
Dans la chambre tranquille de cette pyramide,
Un Sphinx antique se tapit dans la pénombre,
Noir gardien de ce lieu de plaisir des morts.
Ah ! qu’il est doux de reposer dans le sein
De la Terre mère accomplie de l’éternel sommeil,
Mais pour toi bien plus douce une tombe inquiète
Dans la caverne bleue des profondeurs peuplées,
Ou bien là-haut, où les hautes nefs sombrent dans la nuit
Comme les rochers escarpés brisés par les vagues.
Oscar Wilde, Poèmes, traduction Bernard Delvaille,
Pléiade/Gallimard, 1996, p.10.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oscar wilde, poèmes, tombe, shelley | ![]() Facebook |
Facebook |
11/12/2024
Oscar Wilde, Poèmes

Sur la vente aux enchères des lettres d’amour de Keats
Voici des lettres qu’écrivit Endymion
À celle qu’il aima en secret, sans rien dire.
Aujourd’hui, les braillards de la salle des ventes
Disputent chaque pauvre billet fané.
Pour chaque battement d’un cœur, les marchands
Font leur prix. Ils ignorent ce qu’est l’art,
Pour briser ainsi le cœur de cristal d’un poète,
Cupides yeux brillants de convoitise !
Ne dit-on pas qu’il y a bien des années,
Dans une ville de l’Orient lointain, des soldats
Ont couru, éclairant de leur torche la nuit,
Pour partager de pauvres vêtements
Et jouer aux dés les défroques d’un malheureux
Un Dieu dont ils ignoraient tout : miracle et douleurs.
Oscar Wilde, Poèmes, traduction Bernard Delvaille,
Pléiade/Gallimard, 1996, p. 21-22.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oscar wilde, lettres, marchand, art | ![]() Facebook |
Facebook |





