31/08/2019
John Taylor, Le dernier cerisier : recension
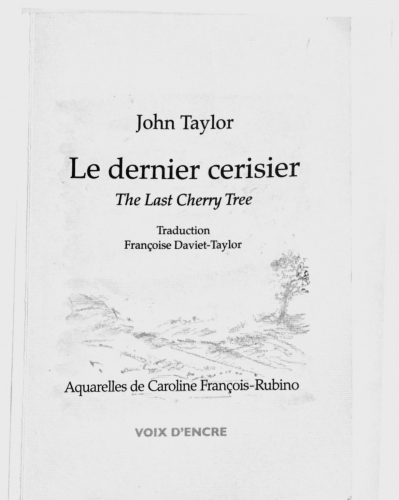
La quatrième de couverture présente le livre comme une « méditation sur le temps » ; il serait possible de réunir en un fort volume des poèmes autour de ce motif, que l’on se limite au domaine français — ou anglais, puisque John Taylor a écrit dans sa langue, mais rien de convenu dans les trois poèmes (le premier donnant son titre à l’ensemble) qui revisitent heureusement un des fondements du lyrisme.
Comment vivre le temps ? C’est peut-être dans le second poème, suite de variations sur l’expression À jamais que John Taylor l’exprime le plus nettement. Ce qui a été vécu l’est sans retour — à jamais—, mais chacun peut l’évoquer, le répéter. Les éléments dispersés du passé apparaissent alors comme un ensemble continu, parce que tout ce qui est derrière soi devient proche grâce à la mémoire et tout autant à l’imagination. Ce sont des paysages qui demeurent présents, ici ceux de la neige de l’enfance avec toutes les sensations qui y demeurent attachées. Avec les lieux de l’enfance revient, très fortement, l’image de la mère ; d’une certaine manière, le temps vécu s’organise à partir d’elle, elle est à la fois la figure du commencement (par « l’accouchement ») et la fin (par « sa mort »).
La mère est aussi présente dans le premier poème. La représentation du cerisier, arbre présent ou non, réel ou non, ramène vers la mère et vers d’autres horizons, comme la culture japonaise. L’arbre, sans lieu assigné, est perçu comme une sorte de « témoin » de tout ce qui se passe, chargé symboliquement du passé, de tout ce qui n’est plus. Il change au fil des saisons, quelle que soit sa place, tout comme l’homme (« où que tu sois / est ton pays natal ») ; chargé de fruits ou avec ses « branches nues » l’hiver, il est l’image même de ce qui change en restant le même, indépendamment de qui le regarde. C’est bien ainsi que la vie se passe pour l’homme, bien peu de ce qui se vit lui est connu (« tant d’autres choses / qui avaient eu lieu / qui ont lieu / sans toi »). Le cerisier, comme les fruits qu’il porte, comme les souvenirs, comme la reconstruction du passé, a d’abord une existence grâce aux mots, « il s’élève dans ton esprit / sur cette feuille de papier / sur cette page ». Il est élément d’un récit destiné à évoquer le changement des choses du monde.
C’est ce changement, minuscule mais qui se répète quotidiennement, avec le passage du jour à la nuit, qu’explore le dernier poème. John Taylor se souvient de la lente disparition du jour « au-dessus de la neige » : le temps semble s’arrêter alors qu’il n’est pas, ailleurs, de transition entre lumière et obscurité. Il retient ce qui se passe avec les arbres : ils restent visibles malgré la venue de la nuit et qui les regarde a l’impression qu’ils « portent de la lumière / un sombre et soudain réconfort ». Pendant ce temps, avant que tout devienne immobile, ce qui est encore perçu donne à imaginer ce que sera l’absence, figure ce que peut être aussi la nuit intérieure.
Ces mouvements de la mémoire et des mots vers le passé sont accompagnés d’aquarelles qu’on penserait aisément être le point de départ de l’écriture, tant les mots paraissent en dire les formes et les couleurs. Pour le premier poème, Caroline François-Rubino propose des silhouettes du cerisier, l’une, grise, emplit la page, d’autres sont disposées à des places différentes, plus ou moins en retrait, jusqu’à n’être plus qu’une branche, puis une ombre. Les autres poèmes excluaient toute représentation nette, et dans les nombreuses images bleues ou grises, on imagine des paysages resurgis du passé, la nuit qui approche. L’association du peintre et de l’écrivain aboutit à une méditation réussie sur le temps, chacun à sa manière mettant en relief une des caractéristiques du lyrisme, la répétition.
John Taylor, Le dernier cerisier, aquarelles de Caroline François-Rubino, Voix d’encre, 2019, np, 19 €. Cette note de lecture a été publiée par Sitaudis le 26 juillet 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john taylor, le dernier cerisier, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
30/08/2019
Jean-Luc Sarré, Ainsi les jours

© photo Florence Trocmé
Iconoclaste est un mot auquel il m’est arrivé parfois de trouver quelque séduction, encore que dans mon cas, plutôt que de fureur il faille parler d’indifférence iconoclaste. Je ne détruis pas j’ignore.
Le cri de l’effraie légitime l’insomnie.
Sans doute est-ce à La Fontaine que je dois ma sympathie pour les rats.
Je me rends compte, à présent qu’elle ressurgit intacte, combien le vent furieux qui vient à peine de retomber avait chassé, transitoirement, mon intolérable conscience du temps.
Mes tourments, la plupart du temps, m’interdisent d’accéder à leur origine.
Jean-Luc Sarré, Ainsi les jours, Le bruit du temps, 2014, p. 131, 137, 140, 142, 150.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sarré Jean-Luc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-luc sarré, ainsi les jours, iconoclaste, effraie, tourment, temps | ![]() Facebook |
Facebook |
29/08/2019
Salle capitulaire, Cathédrale saint Lazare, Autun




Photos Chantal Tanet
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : salle capitulaire, cathédrale saint lazare, autun | ![]() Facebook |
Facebook |
28/08/2019
Johannes Bobrowski, Boehlendorff et quelques autres

Valéry et les haricots
C’est donc un drap en cuir, si tanné qu’il laisse passer la lumière, et si serré et résistant qu’on peut le tendre au-dessus de tout ce qui est en vie ou qui est mort sans le déchirer : au-dessus d’un squelette disloqué comme d’une rame de haricots, qui pousseront bien sous lui et se développeront et peut-être même fleuriront, tant qu’ils trouvent de la lumière dans leur pot, assez pour couvrir les racines, et un peu d’air qui passe par les pores du cuir. Ce drap blanc jaunâtre, tendu sur des crochets et des baguettes, donne là-bas un contour net, ici — au-dessus de la rame de haricots — quelques courbes irrégulières, ne bouffe nulle part, lisse et en même temps très léger il repose et se laisse porter par les mouvements silencieux, précautionneux des feuilles vivantes, des tiges, des fleurs rouges et blanches.
J’ai voulu dessiner un portrait et n’y suis pas parvenu. Un monsieur assez âgé, frêle et pourtant bien en chair, une chair qui s’efface, avec ses veines minces, sous un uniforme doré, un membre de l’Académie avec une petite épée et un beau chapeau sur le bras. Ce n’est pas réussi, je me suis trop consacré aux haricots, à la rame, une plante martiale — même sous un drap de cuir fin et jaunâtre qui laisse passer la lumière du jour.
Johannes Bobrowski, Boehlendorff et quelques autres, traduction de l’allemand Jean-Claude Schneider, La Dogana, 1993, p. 85-86.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Bobrowski Johannes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : johannes bobrowski, boehlendorff et quelques autres, valéry et les haricots | ![]() Facebook |
Facebook |
27/08/2019
Jacques Baron, L'allure poétique, 1924-1973

Éphémérides
Une semaine de tourterelle
Un lundi en fil de la vierge
Un mardi en écailles de poisson
Un mercredi où l’on mange la tête de veau
Un jeudi dans les ajoncs
Un vendredi inquiet comme un lièvre
Un samedi rêvé pour jouer au chat et à la souris
Et pas de dimanche
pas plus de dimanche que du beurre sur la main
pas de beurre donc pas de friture
pas de dimanche dans la friture
Une semaine perdue
Jacques Baron, L’allure poétique, 1924-1973,
Gallimard, 1974, p. 123.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques baron, l’allure poétique, éphémérides, semaine | ![]() Facebook |
Facebook |
26/08/2019
Cédric Demangeot, Pour personne

Pourquoi certains poètes sombrent dans le noir. Sinon parce qu’ils sont seuls. Seuls, j’entends non pas comme en leur romantique adolescence mais plus simplement, plus crûment aussi, qu’ils sont seuls à voir trembler la lumière qu’il leur est possible et donné de voir. Seuls dans l’exercice de voir la vie se vivre en eux. Et cette indéfectible solitude, forte d’un pouvoir absorbant au sens mathématique et total, fait s’abattre leur état naturel de grâce en son néant conjoint— néant d’autant plus béant que le mouvement de joie a pu, un instant, tenter de s’appuyer sur lui.
Attention quand je parle de lumière. Pas d’illumination, pas d’intervention divine, pas de coup monté. C’est seulement dans le regard que nous posons sur le monde qu’est la lumière. Ce n’est peut-être pas de là qu’elle procède physiquement, mais c’est bien là qu’elle tremble ou non. Sur ce fil de feu, de poussière. Et sa vivacité dépend de moi.
Cédric Demangeot, Pour personne, L’Atelier contemporain, 2019, p. 51.
| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cédric demangeot, pour personne, mélancolie, lumière, solitude | ![]() Facebook |
Facebook |
25/08/2019
Anne Parian, Les Granules bleus : recension

Bien peu de lecteurs citadins ont la chance de découvrir une petite limace grise dans leur salade, même étiquetée "bio", quand ils la lavent ou dans leur assiette, seuls ceux qui disposent d’un jardin ou ont un voisin jardinier et généreux, ont ce privilège. La narratrice d’Anne Parian, elle, en trouve des petites et des grosses, orange ou noires, et c’est le rapport qu’elle construit avec elles qui est l’objet de ce récit à la première personne.
Une entrée en matière très générale évoque des « puissances anonymes » qui interviendraient largement dans la vie de chacun : destructrices, elles seraient plus ou moins visibles. Semblant se comporter en ignorant la présence de la narratrice, l’une d’elles en gâte les jours ; nous n’en saurons pas plus, seulement qu’elle laisse des traces et se multiplie. Le second chapitre est consacré à des animaux — la souris, le rat, le mulot — dont peu de personnes apprécient la présence, à tort selon la narratrice : ils sont en effet susceptibles, parce que mammifères, de « nous rappeler la mère qui peut-être nous allaita » : il faut noter le " peut-être " et apprécier l'humour à propos d'un anthropomorphisme répandu aujourd'hui. Le risque d’être envahi oblige, dit-elle, à les supprimer, en employant des moyens discrets. Elle mentionne la tapette, la glu et des produits chimiques dont certains à action lente permettent à la souris, selon le mode d’emploi « de regagner son nid avant de mourir ». Ce qui suscite un commentaire, « Ce à quoi je ne serais pas insensible non plus. Quel ingrat ne le voudrait pas ? » Le lecteur commence à penser qu’il lit l’histoire de quelque folie ou un récit comme en affectionnait Swift, dont on retrouve le ton neutre, distant, pour parler des faits les plus dérangeants.
Le doute n’est pas levé avec le décalage entre le propos (comment se débarrasser des souris ?) et le contenu d’une note à propos de la tapette : on apprend le nom de son inventeur, James Henry Atkinson, et comment elle fonctionne. D’autres notes viendront au fil du livre ; toutes sont données au mode conditionnel alors que l’on peut vérifier l’exactitude des renseignements qu’elles contiennent, par exemple sur la nature du mucus des limaces que la narratrice préfère désigner par « bave », ce qui rapproche l’animal de l’humain. Le contenu des notes, souvent scientifique1, contraste avec ce que fait ou dit la narratrice, surtout préoccupée par la présence des limaces.
Ce n’est qu’au troisième chapitre que ces animaux apparaissent, introduits par l’usage de « granules bleus »2, apportés par un certain Chales qui réapparaît à la fin du livre, sans que l’on apprenne quoi que ce soit à son propos ; d’autres personnages, apparemment familiers de la narratrice, n’existent que par leur prénom. À partir de là, le récit est entièrement consacré aux limaces : ce sont les variations sur la nécessité de s’en débarrasser qui conduit la narratrice « à écrire pour venir à bout de la confrontation » qu’elle a construite. « Sans limaces plus de texte », et elle note plus loin, « Je ne recule devant rien pour écrire et je les tue plutôt que pas. » On lit souvent qu’écrire serait une manière de lutter contre la mort : ici, c’est en tuant qu’elle est rendue possible…
Les limaces deviennent une obsession et il leur est supposé des intentions, une « tactique » et de la « malignité », la capacité de conceptualiser ; les interrogations à leur sujet relèvent d’une anthropologie, il s’agirait par exemple de comprendre les relations de parenté à l’intérieur d’un groupe, savoir si elles ont du plaisir à glisser. Par ailleurs, la narratrice trouve nécessaire de les apprivoiser, « au moins un peu », par crainte qu’elles viennent à bout d’elle. Cette crainte se manifeste constamment, d’une part parce que les limaces se multiplient sans cesse et pourraient revenir venger celles qui ont été tuées, d’autre part, écrit-elle, « elles savent ce que je mange, peuvent venir jusque dans la salade que je leur vole, […] elles ont appris surtout que j’écris à leur propos. » L’idée la traverse d’en élever dans un enclos et d’organiser des courses entre elles, mais il faudrait alors les réunir en les prenant avec des pinces : l’énumération oriente vers l’humour puisqu’il s’agit de pinces à épiler, à linge, à limaces — et de « pinces sans rire ».
L’essentiel semble pourtant de les supprimer par divers moyens, on peut « les donner aux poules (…), les brûler dans le sens du vent ou encore les plonger dans de l’eau savonneuse ou de l’alcool à friction » ; la narratrice rapporte qu’une dame allemande — atteinte de la maladie d’Alzheimer…, — parcourait son jardin en les coupant au sécateur. Mais cette manière de faire présente des dangers dont la narratrice est consciente : découper une limace en rondelles est possible mais, écrit-elle, « en commençant par l’arrière pour qu’elle ne s’en rende pas compte tout de suite, et alors qu’elle ne me voit pas », susceptible dans ce cas de se changer en bête féroce. Les limaces sont dessinées, classées, empaillées même, cuites, mais elle précise « Je ne les mange pas toujours ». À d’autres moments, la proximité avec l’animal est mise en avant, la narratrice souligne « la beauté de les prendre avec les doigts », remarque que ses doigts ont la même consistance que le corps des limaces, et elle s’adresse à elles (le texte est alors en italique), déçue par l’absence d’échange (« Ce qu’il y a pour moi de plus difficile, c’est leur air de m’ignorer ») alors qu’elle accepte de les voir dans son assiette.
Les notations sur les sentiments qu’on peut éprouver en tuant des limaces (« Je ne sais pas si une mère a tué des limaces avant moi, si elle les a pleurées »), la mention insistante du lien entre suppression des limaces et écriture, la présence à plusieurs endroits de jeux linguistiques3, éloignent de mon point de vue "l’histoire d’une folie". Tout comme le choix même des animaux en scène (la souris, la limace), fort éloignés aujourd’hui du quotidien d’un lecteur citadin — d’où le sentiment de gêne de certains à la lecture de certaines descriptions : se débarrasser d’une souris, pourquoi pas, mais discrètement. Récit métaphorique sans doute, mais aussi pour tous ceux qui apprécient l’humour de Swift, auquel Les granules bleus font souvent penser.
1 Par exemple, à la suite d’une liste des sortes de limaces (« petite, jaune, orange, grise, rouge, brune, ou plus grande, rose, bleue ou noire »), une note précise que les bleues « se seraient trouvées plutôt dans les Carpates (Bielza coerulans), les roses en Australie ».
2 Appât à base de phosphate de fer, présent dans la nature
3 La fin de l’un d’eux : « Ne plus tenir au lien entre dire et faire, entre ce que l’on voudrait dire, ce que l’on pourrait dire, ce que l’on saurait dire, ce que l’on aurait à dire, ce que l’on ferait dire, et ce que l’on ferait. »
Anne Parian, Les Granules bleus, P.O.L, 2019, 96 p., 12, 50 €. Cette note a été publiée sur Sitaudisle 26 juin 2019.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne parian, les granules bleus, recension | ![]() Facebook |
Facebook |
24/08/2019
Roger Giroux, Si la mémoire...

À quoi reconnaît-on un « bon », un « grand » poème ? Comment le distinguer du médiocre ? À l’exigence la plus haute, à la plus dense tension, au point de rupture approché, au-delà duquel tout se désorganise et s’effondre dans le néant antérieur. Aller jusque-là et s’arrêter au seuil de ce qui ne peut plus être dit que par le silence. La parole du Poème est la montée — le calvaire — au silence. Jusqu’à la mort-vive. Jusqu’à la déchirure.
Comment combler cette distance entre ce que je dis du Poème et le Poème lui-même ? Quelle est cette distance ? Est-elle située, situable ailleurs qu’en écriture ? Elle est précisément ailleurs— car le P[oème] se situe hors de moi. Il me tourne le dos, il regarde plus loin que je ne saurais le faire avec mes mots avec toutes mes facultés. Né de moi (et d’une culture en expansion) il est le seuil de l’au-delà de moi et de cette culture. Le P[oème] est la porte nécessaire. Ce qu’il y a derrière, nul Poème ne le dira jamais, comme s’il y avait un interdit, un secret à garder*. Poème, gardien du secret ?
(* Mais plus loin, vers un nouveau « possible » de la culture dont je suis une des voix, un des faciès — mais Je… ?)
Roger Giroux, Si la mémoire…, dans KOSHKONONG, n° 16, Printemps 2019, p. 13-14.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger giroux, si la mémoire…, poème, distance, silence | ![]() Facebook |
Facebook |
23/08/2019
Camille Loivier, une voix qui mue

je suis retournée sur les lieux
où j’ai retrouvé l’enfance
le temps avait arrêté de s’écouler
nous venions du passé
nous venions du temps long et de
l’univers clos, nous venions
de l’époque où nos mères sont jeunes et
nous sourient, où nos pères nous
portent sur leurs épaules, il est si
enivrant de voir le monde d’en haut
plus haut, encore plus haut
on vit au ralenti, extrêmement
précautionneux de nos pas
et de nos
gestes
c’est cela qui m’arrive
je retourne à Taipei
comme dans ma ville natale
c’est donc ma ville natale car
je n’en ai pas d’autre
Camille Loivier, une voix qui mue, Potentille,
2019, p. 5.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : camille loivier, une voix qui mue, enfance, passé, ville natale | ![]() Facebook |
Facebook |
22/08/2019
Pia Tafdrup, Le soleil de la salamandre

Bonheur mélancolique
La lumière disparaît avec les voix des oiseaux,
écrasante.
Je me traîne jusqu’à la mer dans l’obscurité.
L’outil pour la transformation est cassé,
d’abord il faut la réparer, aussi je dois
rechercher les changements possibles,
aussi le monde doit…
Descendre. Je me tiens debout au bord de l’eau en bottes,
les vagues tombent et retombent, lavent
par-dessus mes pieds, laissent
un peu d’écume salée dans le sable.
Me tiens penchée sur mon âme,
avec une lampe, éclaire
tout au fond.
Me suis longtemps inquiétée de mes inquiétudes,
qui font que les os s’émiettent,
que l’infini
se fond dans les moindres intervalles.
Les vagues battent leurs coups anesthésiants,
instant d’eau calme,
un bruissement dans ma tête, un mugissement.
Je suis en vie, chaque cellule de mon corps est en vie :
Inhale l’air cru de la mer. Dans les poumons,
le monde se renouvelle.
Le sable, l’eau et le ciel existent,
le froid sur mes pieds.
L’eau est en mouvement constant où je suis —
je pourrais peut-être m’élever avec les vagues,
pour ensuite sombrer,
m’élever encore, me laisser prendre par le vent,
soulever
entre les étoiles filantes.
Je me trouve au milieu de l’obscurité,
secoue mes inquiétudes
dans la mer.
Vais essayer de rassembler l’âme et le squelette,
revenir bien droit dans la clarté de la lampe torche.
Pia Tafdrup, Le soleil de la salamandre, traduit du
danois par Janine Poulsen, éditions Unes, p. 62.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pia tafdrup, le soleil de la salamandre, bonheur mélancolique, changer le monde, inquiétude | ![]() Facebook |
Facebook |
21/08/2019
Francis Ponge, Pratiques d'écriture ou L'inachèvement perpétuel
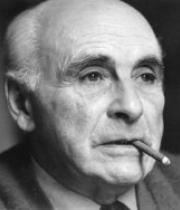
L’écolier
Le langage est donné comme fait. Les hommes parlent et croient se comprendre. Les hommes parlent et croient s’exprimer.
J’y éprouve, tu y éprouves, ils y éprouvent sinon un plaisir du moins la satisfaction naturelle (quoique illusoire absolument) d’un besoin certain.
La littérature est à ce bas niveau de l’expression des hommes, de la conversation. Elle est partie de l’erreur, de l’imparfait social. Quant à ses rapports avec le besoin d’infini, l’aptitude métaphysique de l’homme, elle n’a pas d’avantages sur le langage courant, elle n’a aucune vertu particulière.
Ce qui précède exprimé de la sorte paraît évident : « inutile de le dire ».
Francis Ponge, Pratiques d’écriture ou L’inachèvement perpétuel, Hermann, 1984, p. 66.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Ponge Francis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : francis ponge, pratiques d’écriture ou l’inachèvement perpétuel, comprendre, s'exprimer, illusion | ![]() Facebook |
Facebook |
20/08/2019
Chapiteaux de la cathédrale Saint-Lazare, Autun






Photos Chantal Tanet
Publié dans MARGINALIA | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autun, chapiteaux de la cathédrale saint-lazare | ![]() Facebook |
Facebook |
19/08/2019
Étienne de la Boétie, Sonnet XXII

Quand tes yeux conquerans estonné je regarde,
J’y veois dedans à clair tout mon espoir escript ;
J’y veois dedans Amour luy mesme qui me rit,
Et m’y mostre, mignard, le bon heur qu’il me garde.
Mais, quand de te parler par fois je me hazarde,
C’ets lors que mon espoir desseiché se tarit ;
Et d’avouer jamais ton œil, qui me nourrit,
D’un seul mot de faveur, cruelle, tu n’as garde.
Si tes yeux sont pour moy, or voy ce que je dis :
Ce sont ceux là, sans plus, à qui je me rendis.
Mon Dieu, quelle querelle en toi mesme se dresse,
Si ta bouche & tes yeux se veulent desmentir ?
Mieux vaut, mon doux tourment, mieux vaut les despartir,
Et que je prenne au mot de tes yeux la promesse.
Étienne de la Boétie, Sonnet XXII, dans Œuvres complètes,
Introduction, bibliographie et notes par Louis Desgraves,
Conseil Général de la Dordogne / William Blake and C°,
1991, II, p. 154.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etienne de la boétie, sonnet xxii, poème amoureux | ![]() Facebook |
Facebook |
18/08/2019
Paul Klee, Théorie de l'art moderne

L’art n’est pas une science que fait avancer pas à pas l’effort impersonnel des chercheurs. Au contraire, l’art relève du monde impersonnel de la différence : chaque personnalité, une fois ses moyens d’expression en mains, a voix au chapitre, et seuls doivent s’effacer les faibles cherchant leur bien dans des accomplissements révolus au lieu de le tirer d’eux-mêmes.
La modernité est un allègement de l’individualité. Sur ce terrain nouveau, même les répétitions peuvent exprimer une sorte nouvelle d’originalité, devenir des formes inédites du moi, et il n’y a pas lieu de parler de faiblesse lorsqu’un certain nombre d’individus se rassemblent en un même lieu : chacun attend l’épanouissement de son moi profond.
Paul Klee, Théorie de l’art moderne, édition et traduction de Paul-Henri Gonthier, Genève, éditions Gonthier, 1964, p. 14
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, ÉCRITS SUR L'ART | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul klee, théorie de l’art moderne, impersonnel, modernité | ![]() Facebook |
Facebook |
17/08/2019
Juan Rodolfo Wilcox, Les Jours heureux

La lune descend des platanes immobiles. T’aimer
n’est qu’un grand silence dans les courants
de la nuit indécise.
Si quelqu’un, qui sait, passait avec ton visage,
si on me posait une question avec ta voix,
ô indifférent ! tout
tomberait subitement dans l’espace ;
on me verrait couché autour des arbres,
serrant leur tronc comme le brouillard du crépuscule,
perdu dans les escarpements enfoncés,
éloigné
par où passe la nuit.
La luna desciende de los plátanos inmóviles. Quererte
no es más que un gran silencio en las corrientes
de la noche indecisa.
Si alguien, tal vez, pasara con tu rostro,
si me preguntaran algo con tu voz,
oh indiferente ! todo
caería de pronto en el espacio,
me verían extendido alrededor de los árboles,
encerrando sus troncos como la neblina del crepúculo,
perdido en el fondo de las barrancas ;
alejado
por donde pasa la noche.
Je porte un chiffre sur le cœur, un sceau
de t’aimer comme si le silence s’téait inscrit
dans la chair profondément ; et j’ai parcouru
des galeries de feuilles passionnées, des chemins
qui s’ouvraient au soleil, hurlant, s’arrachant,
te râpant jusqu’à l’âme. Ô s’il m’était donné
de ne pas te voir apparaître, immuable,
là où l’amour naît, comme une image
au fond de l’eau !
Llevo un numéro sobre el corazón, un sello
de quererte, como si el silencio se inscribiera
profundamente en la carne ; y he discurrido
por galerías de hojas apasionadas, per caminos
que iban a dar al sol, gritando, arrancándote,
raspándote del alma. Oh si me fuera dado
no verte aparecer, inmutable,
allí donde nace el amor, como una imagen
en el fondo del agua !
Juan Rodolfo Wilcox, Les Jours heureux[Los Hermosos días],
traduction de l’espagnol (Argentine) et présentation
par Silvia Baron Supervielle, Collection Orphée,
La Différence / Unesco, 1994 [1946], p. 56-57 et 66-67.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : juan rodolfo wilcox, les jours heureux, silvia baron supervielle | ![]() Facebook |
Facebook |





