23/06/2025
Tristan Corbière, Les Amours jaunes

Le crapaud
Un chant dans une nuit sans air…
La lune plaque en métal clair
Les découpures du vert sombre.
… Un chant ; comme un écho, tout vif
Enterré, là, sous le massif…
— Ça se tait : Viens, c’est là, dans l’ombre…
— Un crapaud ! Pourquoi cette peur,
Près de moi, ton soldat fidèle !
Vois-le, poète tondu, sans aile,
Rossignol de la boue… — Horreur !
… Il chante. — Horreur !! — Horreur pourquoi ?
Vois-tu pas son œil de lumière…
Non : il s’en va, froid, sous sa pierre…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bonsoir — ce crapaud-là c’est moi.
Ce soir, 20 juillet.
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, dans Charles Cros, Tristan Corbière, Œuvres complètes, Pléiade, Gallimard, 1970, p. 735.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Corbière Tristan | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tristan corbière, les amours jaunes, le crapaud | ![]() Facebook |
Facebook |
22/06/2025
Silvia Majerska, Blancs-seings : recension
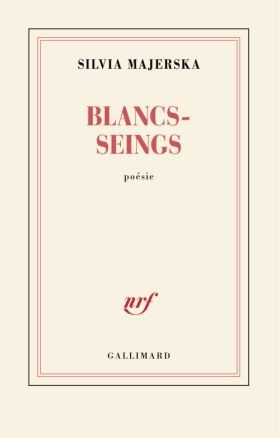
La quatrième de couverture propose une lecture des douze courts poèmes du livre ; chacun, en prose, occupe quelques pages, divisé en séquences précédées de chiffres romains ; aucun ne connaît la majuscule et la ponctuation est réduite au minimum. Chaque poème est consacré à une plante dont le nom en latin est donné en titre. Des éléments nés d’une vision personnelle alternent avec d’autres extérieurs et le tout est éloigné du (triste !) langage des fleurs tout autant que d’un discours sur un herbier. Il s’agit plutôt, comme l’écrit l’auteure, d’une « botanique intérieure » qui mêle constamment l’observation, celle que chacun pourrait faire, et l’imagination, qui transforme telle plante en être qui voit le monde. En exergue, une citation du Bon usage de Grévisse dit que l’astérisque (*) devant un mot signale une forme hypothétique, l’avertissement vaut ici pour le contenu qui suit le nom, pas pour la désignation en latin précédée de ce signe. La rose, fleur par excellence dans le monde occidental, ouvre le recueil.
La rose est reconnue comme le symbole de l’amour, culturellement très présente de la mythologie grecque et à la littérature, en France, du Moyen Âge à Ronsard et à Paul Éluard. C’est pourquoi elle est en ouverture, immédiatement identifiée bien que sous son nom latin, *Rosa. Ce qui n’est pas le cas des autres plantes du livre ; on lit d’ailleurs « il relèverait du miracle d’entrevoir tilia dans tilleul sans connaître un strict minimum de latin ». Le lien entre pinus et pin est encore lisible, comme peut-être celui entre viola et violette, mais l’ignorance de la langue morte ne permet pas de reconnaître dans Castanea, Trifolium, Taraxacum, Papaver, Bellis, Chamaemelum, Vitis et Lilium, respectivement Châtaigne, Trèfle, Pissenlit, Coquelicot, Pâquerette, Camomille, Vigne et Lys. On verra que c’est un motif, celui de la transformation, qui donne une unité particulière au livre : la rose aurait changé, de son passé violent (« sombre », avec ses piquants) au présent (fleur de l’amour), et elle change aussi de couleur hors de la nature.
Ici, la rose, comme vivante, « obéit : à la lumière, à la chaleur », et, avec les sentiments d’un humain, elle se comporte comme tel, douée de la faculté de rêver ; la narratrice comprend que les façons d’être d’un humain — comme la respiration — choquent la rose qui, elle, n’est pas soumise à l’air. La rose peut être transformée par la génétique et la dernière partie du poème rapporte qu’est née une rose bleue (précisément bleu violacé, bleu lavande) dans les laboratoires japonais, transformation destructrice d’un élément de la nature et de sa charge symbolique, de l’imaginaire qui lui est attaché. Toutes les plantes réunies dans Blancs-seings se modifient, chacune à sa manière ; pour les arbres ils grandissent et gardent quelque chose de leur histoire ; la châtaigne, qui semblait dans sa « cuirasse polie » avoir fait « vœu de silence » explose au sol ; le latex du pissenlit est comme du sang ; le pavot ressemble à une marmite, à une jupe et semble lié au feu ; la grappe de la vigne semble un fleur de glycine ; le poème consacré à la violette se termine par un palindrome, attribué parfois à Virgile et choisi comme titre par Guy Debord pour titre d’un de ses films, In girum imus nocte ecce et consumimur igni, « nous tournons dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu ». Pour la camomille,
« et pareil à l’eau chaude que nous versons sur les fleurs desséchées dans le but de ressusciter les cités perdues au fond de nos infusions,
la mémoire insuffle au passé recroquevillé dans le bol de l’esprit ses anciennes courbes et couleurs.
Il s’agit bien sûr d’une construction de l’imagination qui fait penser à la perception d’un bâton dans l’eau : nous ne voyons pas alors la réalité, déformée, ce que développe la fin du poème. On n’oublie pas non plus que le lys par sa blancheur s’apparente à la perle et le poème s’achève avec une explication détaillée à propos de la formation d’une perle dans l’huître, lieu par excellence de la transformation.
Une partie de la page (de chaque poème) reste blanche, comme un blanc-seing, en ce sens que l’on doit combler ce qui n’est pas explicitement donné à la lecture : les mouvements de transformation, de changement qui affectent chaque plante, preuve qu’elle est vivante. Ces douze courts poèmes le disent superbement.
Silvia Majerska, Blancs-seings, Gallimard, 2024, 72 p., 12, 90 €. Cette recension a été publiée dans Sitaudis le 21 mai 2025.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
21/06/2025
Laura Tirandaz, J'étais dans la foule

Le cri dans une prairie quand on s’est perdu
Ce point à l’horizon quand les bêtes cessent leur repas
Ces draps qu’on repousse qu’on espère
Quelqu’un cherche mon prénom
et ne sait plus quelle lumière
sous quelle couture il m’a connue
Je n’ai rien gardé d’autre
que quelques terreurs
et le goût des portes qui fermaient mal
Mais toi
Ton corps se fait virgule
systole
marche
pierre
à lancer contre les murs
Tout n’est pas à l’usage des vivants
Laura Tirandaz, J’étais dans la foule,
Héros-Limite, 2025, p. 56.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laura tirandaz, j'étais dans la foule | ![]() Facebook |
Facebook |
20/06/2025
Laura Tirandaz, J'étais dans la foule

Dans cette aube qui se refuse
se nouent de nouvelles présences
Un vêtement une trame une fuite en avant
J’étais encore là
témoin ou figurante
Je savais
ces lacs qu’on emporte avec soi
ces vieilles bâtisses
la douceur de tout ce qui tombe en ruine
et
tombant en ruine
s’invente un nouveau visage
Laura Tirandaz, J’étais dans la foule,
Héros-Limite, 2025, p.45.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laura tirandaz, j'étais dans la foule, témoin, figurant | ![]() Facebook |
Facebook |
19/06/2025
Laura Tirandaz, J'étais dans la foule

Qu’un pauvre chemin
sans fruit sans ronce
sans brouillard qui affole
sans garçon en embuscade
Traverser
Un simple chemin
Il n’y avait pas de pierre
Rien à construire
Rien à détruire
Voilà
l’éclaircissement qu’apporte l’orage
Laura Tirandaz, J’étais dans la foule,
Héros-Limite, 2025, p. 42.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laura tirandaz, j'étais dans la foule, point de vue | ![]() Facebook |
Facebook |
18/06/2025
Laura Tirandaz, J'étais dans la foule

Les places sont déjà prises
Reste une suite d’espace
de derniers étages
Feux d’une fenêtre close
Il se déshabille
courbe sa nuque
Il jette les restes du jour
les dents serrées sur l’injure
Prisonnier d’un cauchemar où la joie sonnait trop fort
Laura Tirandaz, J’étais dans la foule, Héros-Limite,
2025, p. 25.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laura tirandaz, j'étais dans la foule, injure | ![]() Facebook |
Facebook |
17/06/2025
Henri Droguet, Petits arrangements avec les mots : recension
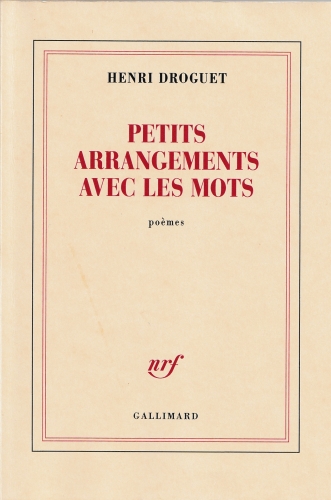
L’arrangement avec les mots commence avec le titre, une note finale indique qu’il est un « écho, et un hommage au beau film de Pascale Ferran, Petits arrangements avec les morts (1994) ». Il se poursuit avec les titres des quatre divisions, à peu près égales, du livre, tous à double sens : "À la lettre" (15 poèmes), "Main courante" (16), "État des lieux" (16), "Veille de nuit" (17), et il est présent du début à la fin. Il ne fait pas oublier les personnages du livre, récurrents dans la poésie d’Henri Droguet, la nature et les manifestations des éléments, la mer, le vent, la pluie, les plantes, les animaux. Cet univers appartient à l’anthropocène, nommé par dérision dans le premier poème « l’antre aux peaux saines » ; pourtant, l’homme, presque toujours anonymisé (un « quidam », un « passant », « quelqu’un »), y tient peu de place et ses actions, sauf celles d’un enfant, sont surtout du côté du chaos. À partir de cet ensemble, est mis en œuvre le programme esquissé en quatrième de couverture, « joie des mots », « fête du langage », soit jeux avec les significations, la morphologie, la syntaxe et la prononciation, qui n’empêchent pas que « la gravité n’est pas absente ».
Le livre débute par ce qui est lu habituellement à la fin d’un écrit, non un post-scriptum mais trois. Le premier exclut temps et espace : « Ni les jours ni les nuits ce n’est / ni soir ni matin c’est la cendre / comme un gouffre et le rien défait » ; la mer et le vent sont dans le désordre et la destruction dans un mouvement qui ne cesse jamais — « sans début / ni fin » — et qui est indéfiniment nourri, du ruisseau vers le fleuve et lui-même vers la mer, tout comme l’aube ne conduit qu’à la nuit. Tout semble se défaire, être voué à la disparition, la belle cétoine peut ravir le regard par ses couleurs mais quand elle « sort du cœur de la rose (…) elle se hâte sans savoir vers sa fin ». La ruine et la mort sont souvent proches, presque toujours liées à une violence ordinaire ; ainsi l’image du corbeau se nourrissant de charogne revient à intervalles réguliers (trois fois) et le bruit même du bec dans la chair morte est restitué, « soc soc soc » ou « toc toc toc » quand il « pioche (…) le désordre d’une entraille bleue », d’« une bidoche désassemblée corrompue ». Seules semblent échapper au désastre les plantes et la faune bien présentes, longuement énumérées : « spergulaire, séneçon, carotte à gomme, vergne, oseille, la belle ombelle, roselière, coudrier, aubépine ; chiens courants, reptile trigonocéphale, lièvre, merle, freux, fauvette » ; ajoutons un oiseau qui « cuicuite quelque part ».
Seul ici le chien courant rappelle un peu l’existence de l’homme dont les travaux et créations sont ignorés ou dépréciés, ainsi un produit tiré de la nature et un outil pour la transformer :
froment pétrifié mauvais pain mauvais
fagot écrasé cabossé
un talus épineux farouche
digère lentement une charrue multisocs
hors d’âge disloquée
Cette nature ne peut que difficilement convenir à l’homme (« l’inouï presque rien ») qui n’agit que pour la changer et parle sans cesse quand il lui faudrait se taire ; il cherche toujours « quelqu’un à qui qui parler ». Il est le « passant » dont les interventions apparaissent inutiles, « viande à Dieu / vautrée /[qui] chante le temps m’enfuit / braille et bée barbouille », qui ne comprend pas qu’il lui faudrait laisser ses fausses œuvres, partir vers la mer « nourricière », « vrai et beau refuge pour aller plus loin / nulle part encore et partout », se diriger vers un ailleurs dont on ne saura rien, sinon qu’« on sera loin / très loin / une fois pour toutes », et délivré au moins provisoirement d’une vie qui n’a pas de but. Les travaux humains n’aboutissent qu’à des constructions provisoires qui se défont plus ou moins rapidement ; pour Henri Droguet, alors qu’il insiste sur la permanence des mouvements et bruits de la nature, toujours semblables, les gestes de l’homme sont à côté de ce qu’il lui faudrait faire : rien n’est dans la durée, y compris les animaux qu’il pensait avoir maîtrisés :
un chemin compliqué se perd (…)
un moulin bat de l’aile (…)
plus bas dans une forge effondrée (…)
des chiens rouges hurlent clabaudent
cherchent qui dévorer
Cependant le lecteur n’est pas dans un univers du désespoir. Certes, « l’infini chaos », « l’informe abîme n’accueille ni / parole ni /rien », et il est bien là ; reste à en sortir autrement que par la fuite au bout du monde, qui ne changera rien. La vraie sortie, c’est l’enfant qui la connaît, il est « l’autre sans trace ni visage / étranger rebelle qui rêvasse encore » ; sans passé, n’étant donc pas devenu le « faramineux déchet » qu’est l’adulte, il rêve, « chante », « poursuit ses romances », « dans l’herbe court après les nuages » ; il « rêve entre deux portes », soit dans une situation des plus instables, et s’il oublie ses rêves il en reprend d’autres très vite. Henri Droguet rappelle que « l’enfance [est] sans parole » — enfant continue le latin infans « qui ne parle pas » —, mais « il ânonne la stupeur l’amour / seul l’amour / et le reste s’est perdu » — il se trouve encore, l’enfance passée, quelques hommes pour vivre « l’amour toujours / inlassablement l’abandon ». Pour ne pas quitter l’enfance, heureuse proximité des prononciations qui permet de parler de « je d’enfant », comme si l’identité était attachée au jeu.
Le jeu, la fête du langage sont en accord avec le chaos : ils sont partout, et d’abord dans la composition ; on l’a vu avec les titres pour les divisions du livre et les poèmes, il faut ajouter dans ce domaine "roman", qui n’en a aucun des caractères, "envoi", "fable", etc. À côté de citations de Victor Hugo, Jean Follain, d’autres non traduites (Coleridge, Dante, Milton) mettent en cause l’ordre du livre, comme l’emploi de l’italique, de capitales et de polices différentes. Il faudrait s’intéresser aux allusions littéraires, sans doute nombreuses ; par exemple, « un grenier où manque la neige » fait penser au passage d’un poème de Reverdy, : « j’écrivais dans un grenier / où la neige en tombant par / les fentes du toit devenait / bleue ». Chaos encore dans ce qui paraît stable dans la langue, les mots pour dire la position dans le temps ; ainsi le tombier — qui creuse les tombes — chantonne « demain / je t’aime hier je t’aimerai encore / toujours et déjà je t’aimais ». Henri Droguet accroît peu le lexique et ses créations sont aisément intégrables comme « grenaillu » ou « tombier », mais il emploie des mots régionaux ou techniques comme « drache », « grouin » ou « mégie » ; beaucoup plus courantes sont les assonances, allitérations, homonymes et paronomases : « Petit petit piètre piéton poieton », « la mer mégère magie mégie », « une averse herse », « orage opéra », « il dément déman / tibule », « qui franchit surgit rugit mugit ; conquis (qu’on dit », etc. Un mot familier voisine avec un énoncé "recherché" : « il lansquine » à côté de « l’indécise beauté / l’argent crispé des saules ». L’emploi au singulier de « entraille » est rarissime, mais on le lit par exemple chez Baudelaire, Giono et Valéry. On n’oubliera pas les nombreuses accumulations d’adjectifs ou/et de verbes qui donnent le sentiment d’un trop plein, comme si le texte débordait :
l’eau cabossée sauvage dévalante merveille
à son bouillon turbulent phosphoreux
sa tambouille ratatouille
chevelu parloir à tout faire et défaire
qui simultanément divague
fauche écorche bronche
vague désosse chuinte rince
happe râpe ponce
berce caresse
prémédite
Cet arrangement foisonnant se relit et le plaisir des jeux dans la langue ne faiblit pas ; on se laisse « prendre au je » et l’on reconnaît plus aisément aussi une dimension plus sombre du texte en suivant « l’homme instable » qui fuit le silence, en retrouvant « le modeste réel ».
Henri Droguet, Petits arrangements avec les mots, Gallimard, 2025, 132 p., 17 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 12 mai 2025..
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
16/06/2025
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski

Nous avons tant écrit
les pierres s’ouvrent, sans retour sur le chemin
les voix des bêtes couvent,
petits feux dans des lieux sans carte
et les étoiles tissent l’espace
hors de nous.
Nous avons trop écrit peut-être
les mots sont plus lourds que des pierres
nous les lançons avec le fol espoir
qu’ils deviennent flamme, éclair, oiseau.
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski,
Arfuyen, 2025, p. 128.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, le rêve de dostoïevsk, écriture | ![]() Facebook |
Facebook |
15/06/2025
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski

L’orchestre invisible
Écoute, comme
par petites touches
le temps s’épaissit,
dans sa pâte de lumière
et d’obscurité,
un roulement,
une rumeur un peu marine,
un peu comme si le sang du corps
remuait vers dehors
et se mêlait à l’air
dans une couleur naissante
impossible à nommer
sans qu’elle ne disparaisse.
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski,
Arfuyen, 2025, p. 109.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, le rêve de dostoïevski, l'orchestre invisible | ![]() Facebook |
Facebook |
14/06/2025
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski

Tandis que la nuit encercle les maisons
d’un horizon toujours plus étroit
qu’un beffroi invisible pèse sur la voix
des vivants, et le froid
s’insinue jusqu’à l’espace intime de nos cils, de nos lèvres,
chaque mot semble usé, effiloché
prêt à s’évanouir dans le pointillé des pluies
résonance assourdie, dont nous redoutons
qu’elle nous fige définitivement,
un cœur se serre
et fait vœu d’une rose aux pétales mobiles
dont le centre serait
notre feu absent.
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski, Arfuyen, 2025, p. 95.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, le rêve de dostoïevski, horizon | ![]() Facebook |
Facebook |
13/06/2025
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski

Aria
Ne précipite rien, trouve ta forme, l’ombre
glisse sous tes ailes
l’épaule des collines se hausse
sur l’intimité des herbes
un seul battement de cils
dans le soleil antique
et l’été coule entre nos doigts
les voûtes claires, rieuses
s’élancent entre les corps.
Cécile A. Holdban, Le rêve de Dostoïevski,
Arfuyen, 2025, p. 77.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, le rêve de dostoïevski, ombre, aria | ![]() Facebook |
Facebook |
12/06/2025
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski

Débordements
Quand le temps ruisselle
sans autres canaux pour couler
que les rigoles du trottoir
d’un dimanche soir de novembre
que chacun se presse chez soi ou aux machines
que chaque geste est dilatoire
les étourneaux
malgré les ombres longues
font leur chemin d’anges citadins
sans que nos yeux les regardent
entre les immeubles et la Seine
un bourdon bleu sur un pavé
une fleur hors saison
qui se soucie encore,
dans ce temps trop humain, de tous ces à-côtés
de ces notes un peu tombées du chœur des villes
de ces battements sourds, de tous ces petits riens
où va encore la vie.
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski,
Arfuyen, 2025, p. 73.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, le rêve de dostoïevski, débordements | ![]() Facebook |
Facebook |
11/06/2025
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski

Deux corneilles
Deux corneilles s’affairent
dialoguent avec leur ombre
elles paraissent sorties
du jardin des délices
Animés de fleurs brûlantes
reines et rois au loin
se déchirent l’homme est un animal
parmi d’autres animaux
Et les corneilles se tiennent
à la frontière qui séparent
les vagues de l’herbe nouvelle
des racines à nu de l’univers.
Cécile A. Holdban, Le Rêve de
Dostoïevski, Arfuyen, 2025, p. 41.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. holdban, deux corneilles | ![]() Facebook |
Facebook |
10/06/2025
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski

Le monde s’est fermé
et s’observe dans le miroir
d’une lune rose
Nous pourrions oublier
la circulation des pôles
le battement des matées
s’il n’y avait les paupières
lentes du lilas
s’ouvrant derrière les canisses
la promesse sans parole
de son regard en pluie
que noue et dénoue l’ombre.
Cécile A. Holdban, Le Rêve de Dostoïevski,
Aefuyen, 2025, p. 24.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cécile a. hodban, le rêve de dostoïevski | ![]() Facebook |
Facebook |
09/06/2025
James Sacré, Choix de poèmes : recension
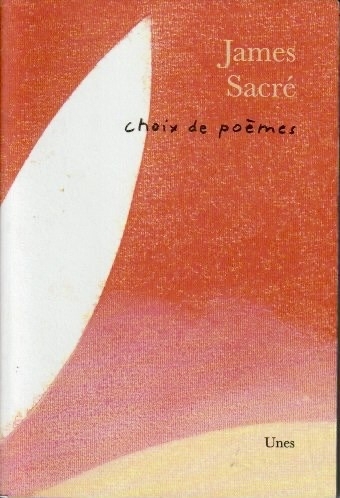
La meilleure anthologie est celle que l’on fait pour soi, écrivait (à peu près !) Paul Éluard qui avait préparé une anthologie de la poésie du passé et une autre des écrits sur l’art. L’anthologie qu’un écrivain prépare de ses propres textes retient plus le lecteur que celle d’un amateur, même s’il connaît fort bien les supports de ses choix. Les éditions Unes, dans une collection de poche, ont sollicité en 2024 Jean-Louis Giovannoni et Geoffrey Squires, en 2025 Esther Tellermann et James Sacré. Ce dernier avait proposé une anthologie thématique à un éditeur algérien (Par des langues et des paysages, APIC, 2024), celle composée pour les éditions Unes est différente, il a choisi un poème (parfois deux) dans 97 des livres publiés, de 1965 (Relation) à 2025 (Rue de la Croix, à Celleneuve ses escaliers puis d’autres), certains regroupant des recueils déjà publiés. Le lecteur serait-il ainsi invité à suivre un parcours, peut-être une évolution des thèmes ou de l’écriture ? cette lecture impliquerait que l’auteur aurait choisi les poèmes en vue d’une telle démonstration. On peut bien dire qu’une œuvre est "vivante", certes, mais la métaphore est à éviter si l’on entend que l’écriture passerait de l’enfance à la maturité.
À lire les quelques lignes retenues de Relation, le lecteur reconnaît une partie du vocabulaire de James Sacré, présent dans les livres ultérieurs, enfance et geste, et récurrents arbre(s) et campagne. On pense à un souhait de donner un aperçu d’une œuvre qui, se développant sur une très longue durée, n’est certes pas restée immobile, mais le regard sur les choses n’a que peu changé. Il s’est affiné, devenu peut-être plus amoureux, et l’écriture a toujours laissé de côté un vocabulaire trop recherché, une syntaxe qui respecte toujours la norme. Pour qui lit depuis longtemps James Sacré, il n’est pas aisé de dater tel extrait :
Il devient inutile de dire le nom des herbes. Cela n’ajoute rien. On découvre qu’il s’agit de trouver un support à des phrases, à des intentions pugnaces. On fabrique un poème. Graminées remuées. Peut-être.
(1968)
Au fil des années, on lit dans les titres que l’un des socles de la poésie de James Sacré est la tentative de dire et redire avec justesse ce qui importe, qu’il s’agisse de l’enfance dans la ferme, de la relation à l’Autre ou ce que l’on voit, ce qui est devant soi : le paysage, le linge qui sèche, la petite salle de restaurant au milieu de nulle part, un âne, les arbres, des marchands dans la rue, des camions. Les poèmes de Follain sont d’ailleurs évoqués, qui ont pu être écrits « À partir de rien, le bruit d’une épingle / Sur un comptoir d’épicerie. Le bruit du monde / Ou le bruit d’un mot ». Aller toujours à la rencontre de l’Autre, de ce qui la plupart du temps est vu sans être regardé, de ce qui n’appelle pas le commentaire parce qu’il serait inutile.
Là où sont des étoffes c’est que des gens sont vivants ;
Carrés de torchons, petite culotte ou T-shirt qui sèchent
Sur un fil qui traverse la rue pas large, on devine
Le manque d’espace (et peu d’argent)
[…] (2010)
Ce qui est regardé n’appelle que rarement une glose ; devant des travailleurs émigrés exploités, dans la souffrance d’être pour longtemps éloignés de leurs proches, on éprouve peut-être de la rage devant l’inégalité dans la vie, et puis « on oublie » jusqu’à la prochaine fois. Devant la misère, rencontrant « une vie pas facile à vivre », note l’auteur, « j’ai pas eu envie de sortir mon carnet » ; mais il retient les détails du parcours dans un marché et une halle et, plus tard, revenu dans « le confort de l’hôtel » le « cahier d’écritures » est à nouveau ouvert. C’est une des caractéristiques des poèmes de James Sacré d’être régulièrement écrits à partir de "choses prises sur le fait"* et l’on en relève de multiples exemples dans cette anthologie. Par exemple, dans La solitude au restaurant (1987), après un rapide descriptif du lieu,
Des mots
(Voilà qu’on vient d’augmenter la lumière) pour seulement
Donner matière au rythme d’un poème, comment se fait-il
Que l’envie m’est venue d’en écrire un
Comme si en somme je l’avais trouvé là à cause d’une chaise remuée
À cause des pas traînants de la patronne (…)
Dire ainsi ce qu’est l’écriture de James Sacré est trop simpliste et lui-même refuse ce qui ferait du poème une manière de reportage, « Certes mon poème n’est pas une photo : mais s’il ne laisse pas dans sa liberté / une femme qui pourrait être ma mère, ou la tienne lecteur / Qui pourrait bien être / toute femme du monde en sa solitude de femme / Qui raconte et fait ce monde par ses gestes de vivante. »
Tout peut aboutir à une prose ou des vers mais, quelle que soit la forme choisie, un doute vient souvent quant à ce que transforme l’écriture : que "disent" les poèmes ? « les poèmes / m’ont emmené longtemps / Par des mots qui n’expliquent rien (…)/. Les mots sont aussi / Le silence et l’énigme ». La réponse n’est décevante que si l’on croit, espère trouver des réponses dans un écrit, dans les mots qui sont « peut-être moins l’or du temps que poussières de solitudes traversées ». Il faudrait citer encore et écarter le commentaire, s’accorder avec Malraux pour qui « toute anthologie se sépare d’une histoire de la poésie en ce qu’on l’établit pour être lue, non étudiée ». Celle-ci est une excellente invitation à lire entièrement les recueils cités
* Titre d’un des dossiers non publiés de son vivant de Victor Hugo.
James Sacré, Choix de poèmes, éditions Unes, 2025, 128 p., 10, 40 €. Cette recension a été publiée par Sitaudis le 24 avril 2025.
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES, Sacré James | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : james sacré, choix de poèmes | ![]() Facebook |
Facebook |





